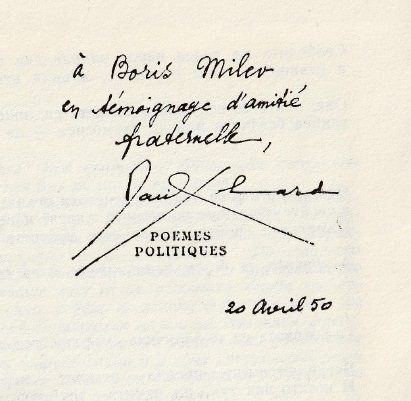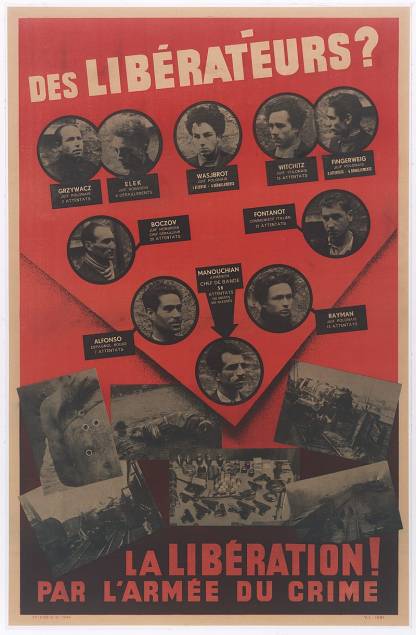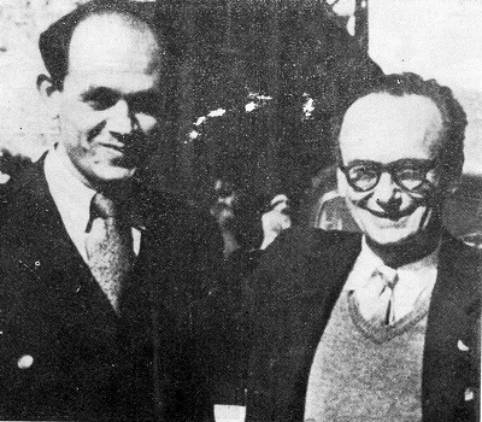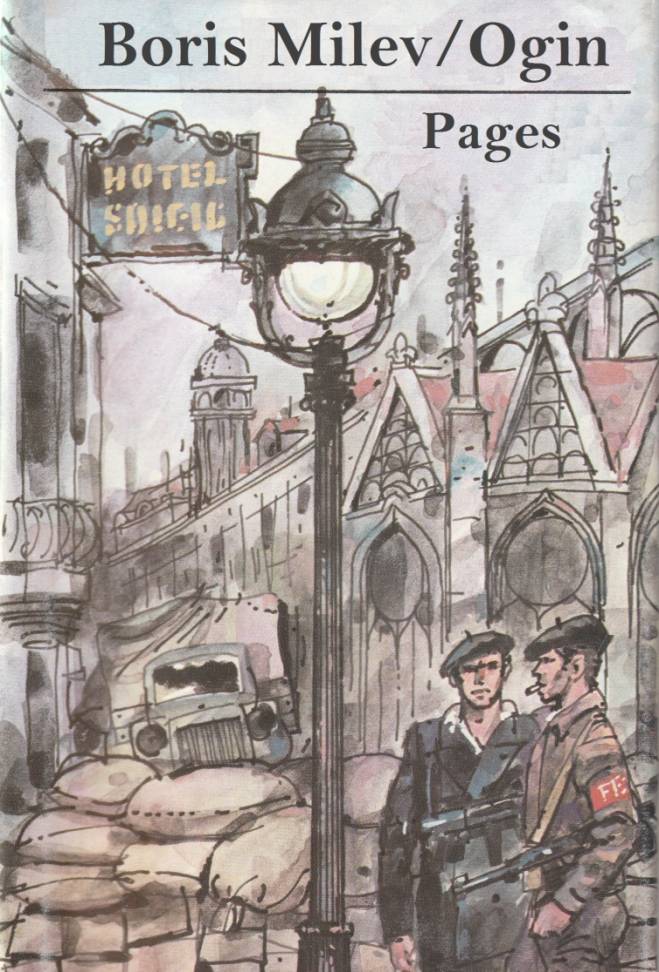
Boris Milev
(Борис Милев)
1903
– 1983
PAGES
(Страници)
1982
Éditions
du Parti, Sofia, 1982
[Deuxième édition révisée et complétée]
© Boris Milev. Traduction
d’André Milev, 2022.
Couverture
Alexandar Khatchatourian
Correction
Brigitte Grumel et Joséphine Castoro
Ce
texte est publié avec l’accord des héritiers de Boris Milev ; le
téléchargement est autorisé pour un usage personnel, mais toute reproduction
est strictement interdite.
Table des
matières
Dans les tenailles du chômage et de
la xénophobie
Nouveau métier, nouvelle grève
Scènes brèves de la vie de
l’émigration
Le rêve du prolétaire chinois Hook
Dans
le village de Saint-Félix-de-Caraman
De
nouveau dans la capitale française
Grève dans la cordonnerie Tango
Auteur du slogan « La religion est l’opium du peuple »
Rencontre avec Dimitar Polyanov
Membre du deuxième district du PCB à Sofia
Dans la rédaction du journal Écho
Les condamnés – fusillés, les
assassins – non inquiétés
Formation théorique à la montagne Lozen
On ne peut pas servir à autre chose ?
Le camp de concentration du Vernet – École de courage
Dans
la prison de Chalon-sur-Saône
Premiers pas dans la résistance
française
Le groupe de combat bulgare à Paris
Je quitte le groupe de combat des Bulgares
Dans la Résistance sur un front plus
large
Une pure prouesse de grande classe
Les stations de radio Sottens, Moscou
et Londres communiquent…
Le combattant Pavel Simo – la
première victime
L’ennemi doit être a-né-an-ti !
Bianca, Martin, Odette, trois abeilles mellifères du
quartier général
Missak Manouchian et sa première action
Salutation et cadeau pour l’armée soviétique
Les déraillements et le combattant
Joseph Boczov
« Tu as le bonjour du commandant de gross Paris »
Expérience parisienne dans la zone occupée
« Non
kaputt ! Volga, Volga, mat radnaia ! »
On les appelait des étrangers. Le procès des 23
La bataille pour la liberté prend un
nouvel élan
« Le 14 juillet – tous aux armes ! »
Lettre du parti communiste français
Témoignage de Louis Grojnowski
SUR L’AUTEUR

Pages - deuxième édition complétée et
révisée d’un livre sur une biographie riche qui se confond avec la biographie
d’une époque unique. Boris Milev - Ogin, un révolutionnaire communiste et
professionnel, parcourt le long chemin d’un garçon prolétaire de la périphérie
de Sofia, à travers les luttes de classe du prolétariat de Sofia, à travers la
prison centrale de Sofia - et à travers une évasion audacieuse, il atteint la
France, où il participe activement aux luttes des ouvriers français. Durant les
terribles années de l’Occupation, l’auteur s’élève jusqu’à devenir l’un des
chefs des FTP-MOI à Paris et en région parisienne, participe activement à
l’insurrection parisienne de l’été 1944, prend part à plusieurs actions
audacieuses et courageuses des antifascistes contre les nazis.
Avec beaucoup
d’amour, d’une plume vive et fascinante, Boris Milev - Ogin décrit l’exploit de
ses compagnons d’armes. Il nous révèle purement et sincèrement ces pages de
l’époque qui, d’une manière ou d’une autre, ont été marquées par les pages de
transition de l’Histoire, lorsque les portes de la vie nouvelle se sont
ouvertes avec fracas.
Paul Éluard
LÉGION
Si j’ai le droit de dire en
français aujourd’hui
Ma peine et mon espoir, ma
colère et ma joie
Si rien ne s’est voilé
définitivement
De notre rêve immense et de
notre sagesse
C’est que des étrangers
comme on les nomme encore
Croyaient à la justice ici
bas et concrète
Ils avaient dans leur sang
le sang de leurs semblables
Ces étrangers savaient
quelle était leur patrie
La liberté d’un peuple
oriente tous les peuples
Un innocent aux fers
enchaîne tous les hommes
Et qui se refuse à son cœur
sait sa loi
Il faut vaincre le gouffre
et vaincre la vermine
Ces étrangers d’ici qui
choisirent le feu
Leurs portraits sur les murs
sont vivants pour toujours
Un soleil de mémoire éclaire
leur beauté
Ils ont tué pour vivre ils
ont crié vengeance
Leur vie tuait la mort au
cœur d’un miroir fixe
Le seul vœu de justice a
pour écho la vie
Et lorsqu’on n’entendra que
cette voix sur terre
Lorsqu’on ne tuera plus ils
seront bien vengés.
Et ce sera justice.
La Résistance ? Quelle Résistance ? La
Résistance française, évidemment ! J’aimerais vous en parler.
En tant qu’ancien Chef régional des Forces françaises de
l’intérieur (F. F. I.) à Paris et en Île-de-France, je peux dire qu’elle était
de nature nationale et de contenu international. En substance, le mouvement de
Résistance français était antifasciste et faisait partie de la lutte armée
alliée sur tous les fronts, qui a éclaté de la manière la plus impressionnante
sur le front de l’Est, où l’Armée rouge a porté un coup décisif aux
envahisseurs hitlériens et a historiquement décidé la sortie de la guerre au
profit des alliés, dans l’intérêt de l’avenir des peuples du monde.
Outre les patriotes français, les antifascistes et les
communistes, un certain nombre de Bulgares ont également participé à la
Résistance, ils ont traversé les épreuves du fascisme bulgare et les batailles
de la guerre civile espagnole, en tant que volontaires des Brigades
internationales.
Le groupe bulgare de combattants faisant partie de
l’organisation « Francs-tireurs et partisans français » (F.T.P.F.)
s’est distingué par un certain nombre d’actions audacieuses — je ne parle que
de la région parisienne ! — contre les occupants hitlériens :
incendie des garages des rues Bolivar et Laborde ; mise à feu de l’atelier
mécanique du boulevard Aristide Briand dans la banlieue de Montrouge ;
attaque à main armée contre une patrouille fasciste rue Jean Jaurès ;
placement d’une machine infernale sous un bus avec des officiers et des soldats
hitlériens à la gare de la porte de la Villette ; attentat à la bombe
d’une compagnie hitlérienne dans les escaliers du métro Jean Jaurès et autres
actions similaires.
Dans toutes ces actions, qui ont atteint leur apogée, lors
de l’insurrection de Paris, en août 1944, le groupe bulgare de combattants a
non seulement fait preuve de courage, mais il a également prouvé qu’il pouvait
mener à bien ses tâches, assurant toujours le retrait réussi de tous ses
combattants.
En 1942 et 1943, j’étais en contact permanent avec le
camarade Boris Milev, que je connaissais sous les pseudonymes de Charles et
Gaby, commissaire politique des groupes d’émigrés combattants de diverses
nationalités dans la région parisienne. J’ai gardé de lui le souvenir d’un
leader doté d’une vision claire et d’un sens aigu des responsabilités dans
l’accomplissement de tâches à caractère politique et militaire. Le camarade
Milev a rendu de précieux services à la Résistance française, au sein de
laquelle il a fait preuve de dévouement et de courage prouvant qu’il était un
excellent organisateur.
À première vue, la Résistance semble appartenir au passé,
à l’histoire vécue. Mais elle est toujours présente et efficace contre les
ennemis constants de l’Humanité - le fascisme et la guerre. Elle est le contenu,
l’esprit, la philosophie du comportement humain face aux problèmes modernes.
Hier, la Résistance signifiait un combat contre la peste brune, qui menaçait
l’existence de la civilisation, de la liberté, du progrès social. Aujourd’hui,
la Résistance est nécessaire pour mettre un terme au cours effréné des
armements, à la tendance au retour des jours sombres de la guerre froide, à la
multiplication des foyers militaires à la surface du globe. Aujourd’hui, la
Résistance signifie vigilance et détermination pour préserver la paix dans le
monde.
Des livres comme « Pages » de Boris Milev, sont
utiles non seulement parce qu’ils rappellent une époque héroïque, ravivent la
mémoire de ses combattants et la victoire des nations sur l’hitlérisme, mais
aussi parce qu’ils gardent vigilants des partisans de la paix et unissent les
nouvelles générations de tous les pays, avec les idées de l’internationalisme
pur.
Colonel HENRI ROL-TANGUY

Grand-croix de la Légion d’honneur,
Compagnon de la Libération. *
CHAPITRE
PREMIER
Église. Une église
ordinaire, comme beaucoup, érigée dans la capitale. Plus précisément, l’église
du jardin des Trois Puits.
Dimanche matin. Les
fidèles, en tenue de fête, se tiennent debout et écoutent la liturgie, célébrée
par Krapchanski, le pope populaire du quartier. Lorsque la liturgie est
terminée, les visiteurs ne partent pas. C’est le moment pour certains de
partager soucis et chagrins ; pour d’autres d’échanger sur les nouvelles
du quartier ou de parler à leurs amis ; pour d’autres encore — juste de
bavarder.
Un tel dimanche
matin, deux femmes se sont rencontrées — camarades de classe, amies. Toutes
deux du même âge. L’une, Nushka, avait atteint la troisième année du lycée et
avait donc une nette supériorité intellectuelle sur son amie, Héraklia, qui
n’avait étudié que jusqu’à la quatrième année.
L’ « intellectuelle » Nushka regarda fixement le pleurnichard
agrippé à la jupe de sa mère et prononça ces paroles d’oracle :
« Haro, je ne connais pas tes autres enfants, mais celui-ci, fais-y bien
attention. Il a une étoile sur le front. »
Cet enfant, c’était
moi.
Ignorant ma vocation
d’ « étoile », j’ai connu la vie des enfants du quartier pauvre
des Trois Puits. L’été, je jouais pieds nus à toutes sortes jeux : un,
deux, trois, soleil ; saute-mouton ; long âne ; esclaves ;
voleurs ; billes ; osselets. L’hiver, je portais des sabots. Mes
pieds, grandissant à volonté, se transformaient en grosses pattes, ignorant la
douceur et l’inconvénient d’une quelconque chaussure. Pour la première fois, quand
j’avais treize ans, mes pieds sont entrés dans un moule. Lorsque j’ai mis les
galoches usées de mon riche cousin Petko, des ailes m’ont poussé, je me suis
senti au septième ciel. J’ai couru jouer au « long âne » dans la cour
de l’école primaire voisine des Frères Miladinovi. Ce n’était pas un jeu, mais
une série de violentes explosions de joie et de bonheur.
De tels moments
étaient l’exception. Quelque chose comme un dessert copieux après une soupe aux
haricots maigres.
Avant même mes
treize ans, ma tête et mon dos en ont vu beaucoup et ont souffert. Un sac à la
main, je courais après les galiotes[1]
à charbon qui piétinaient les pavés du boulevard Ferdinand. Je courais,
espérant tirer un bon profit de la vente des petits morceaux de charbon qui
tombaient par les interstices des crêtes. Les meneurs de galiotes, parfois
généreux, me lançaient une plus grosse boule. Mais il arrivait que je saute
habilement sur les crêtes, et derrière le dos du conducteur au cœur dur, je
jetais rapidement au sol les morceaux qui me tombaient sous la main. Bien sûr,
il y eut des moments où j’ai payé cher ces raids illicites. Dans ces
moments-là, non seulement mon oreille était tordue jusqu’au sang, mais le fouet
de la charrette était impitoyablement enroulé autour de mon cou et de mes pieds
nus.
Le jour de marché,
et pas seulement ce jour-là, je fuyais l’école pour porter des achats des dames
fortunées.
Lorsque je suis
devenu rédacteur en chef d’un quotidien et d’un hebdomadaire littéraire dans
les années 1930, je tapotais souvent l’épaule des petits vendeurs de journaux
et leur caressais les cheveux, emporté par les souvenirs de la période où
j’étais leur confrère. Dans ces moments-là, je me voyais courir follement le
long du boulevard Dondukov et crier de toutes mes forces, à m’en briser la
voix : « Le journal Dnevnik, dernières
nouvelles : l’éclipse solaire et la fin du monde ; Kaiser Wilhelm —
incendiaire de la guerre mondiale. »
Désormais, les
courses se déroulent dans les stades. À cette époque, les participants à de
véritables courses étaient les centaines de vendeurs de journaux qui, comme un
troupeau libéré de l’imprimerie des journaux Utro et Dnevnik, se
précipitaient sur le boulevard Dondukov pour être les premiers à atteindre la
place devant le café Panah, sur le site de l’actuelle commission d’urbanisme.
C’était le carrefour le plus bruyant et le plus fréquenté de la capitale.
L’assaut de l’essaim de vendeurs de journaux était un spectacle attendu, non
seulement des acheteurs, mais aussi des personnes de la haute société attablées
au café, ainsi que des dames de la confiserie Rosa voisine. Les petits vendeurs
de journaux considéraient la place, un terrain propice à la vente, comme libre.
Alors, le cœur battant, ils cherchaient à arriver au moins une minute avant les
autres. Certains d’entre eux, « plus âgés », comme Toushé, Kyoseto et
d’autres, n’étaient pas du même avis. Ils croyaient avoir le monopole de
l’endroit et donnaient brutalement des coups de poing et de pied aux
contrevenants mineurs de la place, arbitrairement occupée. C’est ce mélange
d’appels publicitaires, de cris, de scènes de coups de poing et de coups de
pied qui enchantait le public : commerçants, militaires, fonctionnaires,
escrocs, intellectuels. Plus d’une fois, j’ai été jeté comme un chiffon du fond
du café de quelques coups de pied puissants. Je pleurnichais, je pleurais, je
reniflais, et puis je descendais par la rue Serdika jusqu’au café Splendid, j’y entrais et si j’arrivais
à vendre cinq ou six journaux, je me sentais heureux. Je visitais les restaurants
bruyants Zdrave et Paris — près de
l’actuel cinéma Tserkovski — et je
passais le plus clair de mon temps au café-restaurant Odéon[2] de la
rue Tsar Siméon, à écouter des musiciens, violonistes et chanteurs étrangers.
Il arrivait que je reste émerveillé pendant des heures. À ces moments, je me
voyais comme un grand violoniste avec une chevelure bien fournie et une barbe,
bien que je n’aie même pas appris à jouer de l’ocarina.
Parfois, au risque
d’être expulsé, je me faufilais dans la brasserie Battenberg, qui était du côté
Est de la place de l’église Saint-Georges, aujourd’hui classée monument
historique, au centre de la capitale. Le célèbre vendeur de journaux Daskala,
qui avait le monopole de cette brasserie était remarquable pour trois raisons :
il était orné de toutes sortes d’insignes en fer-blanc, fer et carton ; sa
voix ressemblait à une trompette de Jéricho, aussi métallique qu’enrouée ;
il essayait de donner un rythme poétique à ses cris :
« Je vends Pryaporets, Zname et Narodni prava.
Achetez Bulgaria dépourvue de
bois. »
Il entrait dans
l’imprimerie Mir de la rue Bacho Kiro et demandait :
« Hé, vous, ce
coffre
n’est-il pas en
trop ? »
Ou alors, en se
promenant autour des tables du Battenberg, il fumait du « muftajian »
et prononçait ces mots :
« Laissez-moi
voir, messieurs,
vos cigarettes
ne sont-elles pas
très vieilles ? »
Et encore :
« Achetez Balgaran,
pour un galagan[3]. »
Il paraît que quand
j’étais très jeune, j’aimais chanter. Les gens autour de moi semblaient aimer
ma voix. Peut-être que cette fascination a libéré l’imagination religieuse de
ma mère qui a commencé à nourrir l’espoir de voir un jour son Borko sur un
trône religieux. Et pourquoi rêvait-elle que son fils se consacre à
l’Église ? Vingt ou trente ans plus tard, elle m’a avoué qu’elle s’était
secrètement crue une grande pécheresse et qu’elle espérait la rédemption dès
lors que son fils deviendrait serviteur de Dieu. On peut juger d’après sa vie
quelle pécheresse elle fut : elle épousa un très beau garçon, qu’elle
n’aimait pas vraiment, donna naissance à cinq enfants, ce qui signifiait cinq
bouches à nourrir ; le père frivole et irresponsable délaissa les enfants
qu’il avait conçus. La jeune mère, alors que son aîné avait douze ans et que le
plus jeune de ses enfants était encore un bébé portant des couches, commença
par vendre sa robe de mariée. La dot devint bientôt du pain rassis et du
babeurre, insuffisants pour satisfaire les solides appétits des enfants en
pleine croissance. Plus tard, elle travailla comme femme de chambre pour des
parents riches, comme femme de ménage aux bains féminins de la ville et à
l’Institut cartographique. À la maison, elle nettoyait, cuisinait, lavait,
reprisait et s’occupait en même temps de sa mère et de son frère, avec qui nous
vivions. La jeunesse de cette femme, la plus belle de ses amies, se déroula
dans une chasteté forcée et avec des passions refoulées. Avec son travail dans
des maisons et des institutions étrangères, ajouté à ses besognes nocturnes
insupportables à la maison, elle a soutenu deux des enfants, dans les
conditions d’alors, pour leur permettre de terminer leurs études secondaires.
Une pécheresse ? Une cruelle croyance religieuse a réussi à convaincre
cette sainte terrestre, que sa vie dure était une punition pour les péchés commis
soit par elle, soit par ses proches.
L’espoir de vouer
son fils à l’Église s’est particulièrement manifesté lorsque le pope le plus
respecté, Krapchanski, s’est intéressé à la voix de son Borko. Le prêtre
habitait rue Osogovo, juste en face de chez nous, et il écoutait des chansons
folkloriques et religieuses, que nous chantions parfois en chœur, parfois
séparément.
En mon absence, le
prêtre s’est arrêté chez nous, a vu l’environnement pauvre, s’est assuré de la
piété de la famille par les icônes et les lampes à huile accrochées aux murs et
a demandé de lui donner le garçon — c’est-à-dire moi — comme serviteur dans
l’Église. « S’il est sage, nous l’enverrons au séminaire », a promis
l’invité de haut rang. Dans l’imaginaire de ma mère, les miracles naissaient
comme des mirages de la future vie honorable de son enfant : couronnes
d’or, robes à revers, discours de chaire, la convoitise des voisines, la joie
cachée de la mère. Pas de sa bouche, mais de son cœur, le consentement et la
promesse au pope sortirent.
Le soir, j’ai été
très surpris. Sans que l’on soit dimanche, les haricots vivaces sentaient la
frite et la menthe, et le yaourt n’était pas très dilué. À la première bouchée,
ma mère, avec un sourire épanoui et visiblement émue aux larmes, m’a parlé de la
visite de l’après-midi et de l’invitation importante.
— Peut-être que
c’est là ta chance. Que Dieu t’accorde sa miséricorde et t’offre le bonheur.
Maman m’a serré dans
ses bras, m’a embrassé chaudement et m’a averti qu’elle allait réchauffer l’eau
pour me laver dans la baignoire.
— Que tu sois
propre demain, tant mentalement que physiquement.
Je me suis rendu à
l’église bien habillé, même avec de vieux vêtements et des sandales en bois. Le
clerc m’a immédiatement conduit chez le prêtre. Le pope Krapchanski somnolait
sur une chaise à l’autel. À moitié éveillé, il a demandé :
— Ah, c’est
toi ? C’était quoi déjà ton nom ?
— Borko.
— Très bien,
Boré. Viens ici et lis-moi cette ligne.
Le pope ne m’a pas
donné le livre, mais l’a juste présenté à mes yeux. Un autre garçon de 11 à 12
ans pourrait échouer à cet examen. Les lettres étaient en slavon d’église.
Seule ma curiosité précoce pour les manuels de ma sœur, qui étudiait l’ancien
alphabet bulgare, m’a sauvé de l’échec. J’ai lu la ligne avec une légère
hésitation. Le pope m’a demandé de continuer. C’est comme ça que je suis arrivé
aux quatrième et cinquième lignes. Le vieil homme barbu m’a pincé la joue et a
dit :
— Assez. De
toute évidence, tu apprendras à bien lire. Maintenant, tu vas me regarder et
m’écouter lire, puis tu feras la page entière tout seul. Ce livre s’appelle l’Apôtre. Il est généralement lu par un
diacre, c’est-à-dire par un jeune prêtre. Mais je vais t’essayer aussi, si tu
m’écoutes.
Instinctivement,
j’ai baisé la main du prêtre.
— Je vais
écouter, Père.
Le vieil homme a
aimé la spontanéité du geste. Il m’a pris sur ses genoux et m’a donné des
instructions :
— Écoute
maintenant pendant que je lis et je module ma voix. Ici, dans l’église, on lit
et on chante. Écoute. Ensuite, tu répéteras.
Le pope a
effectivement modulé sa voix dans différentes gammes.
— Maintenant à
toi d’essayer. Lentement, prends ton temps. Il est important, en t’écoutant
lire, que les fidèles pensent qu’il s’agit de chants d’Église.
Les débuts ont été
un succès. J’ai ajouté de nouvelles courbes et respirations au mot
« Seigneur », ce que mon professeur aimait beaucoup. Il me caressa à
nouveau les joues et me tapota à nouveau l’épaule...
Le troisième jour,
j’ai lu l’Apôtre aux fidèles
silencieux en présence de ma mère agitée. Soit ma voix tordait les aigus, soit
elle baissait en baryton. Les fidèles étaient satisfaits. Ma mère en larmes
pouvait à peine remercier les félicitations des voisines : «— Qu’il soit
vivant et en bonne santé, félicitations, Haro ! »
L’artisanat de
l’Église a duré plus de trois mois. Cela s’est avéré rentable et facile. Les
sous sont devenus nombreux : trois ou quatre en semaine et cinq les
dimanches.
Tout allait bien, ce
qui ne voulait pas dire qu’un million de choses ne troublaient pas mon âme
d’enfant. Le jour de la fête de Yordan est arrivé. Nous sommes allés bénir les
fidèles. Le pope entrait dans les maisons, et encore à la porte, balbutiait sa
bénédiction, trempait une poignée de buis dans le seau d’eau bénite, aspergeait
les murs et les gens, et se retirait rapidement. Les arrosés payaient pour la
visite mouillée en jetant parfois beaucoup d’argent dans le seau : des
sous et des pièces d’argent de cinquante centimes. J’étais très tenté de
transférer un sou ou deux du fond du seau d’eau bénite dans ma poche, mais la
peur du péché et l’espoir d’une bonne récompense après le marathon dans le
froid matinal de janvier m’empêchaient de « pécher ». Cependant, mes
sentiments n’étaient pas tout à fait clairs. Je regardais le pope fouler
hardiment les rues et les cours enneigées avec ses hautes chaussures chaudes en
galoches russes et je l’enviais. Et comment ne pas l’envier, alors que je
boitillais à sa suite en sabots dans le froid et que je portais le seau de
cuivre à mains nues ! Laissons de côté la forte impression que j’ai
ressentie lorsqu’au milieu de la visite j’ai vu le pope s’arrêter, mettre la
main dans le seau, en sortir l’argent réuni et le placer dans la poche cachée
de sa robe.
À midi nous
retournions à la maison du curé. Le prêtre enleva ses galoches et ses souliers,
enfila de hautes pantoufles de feutre, suspendit sa robe et son couvre-chef,
mit un bonnet rouge sur sa tête et entra dans une cuisine spacieuse plus grande
que la pièce où nous vivions — ma mère, ma sœur et mes quatre frères. Mes yeux
de garçon affamé fixaient le grand plateau rempli à ras bord de boulettes de
viande frites.
̶ Nous avons
fait du bon travail. Avant de te sécher à la maison, tu vas faire un travail
pour moi. Tiens ces deux bouteilles. Tu vas les donner à Lazo le tenancier, au
coin d’Opalchenska et de Pirotska[4]. Tu
lui diras que c’est moi qui t’envoie. Qu’il remplisse les bouteilles de vin de
ton grand-père Krapchanski. Mais tu seras prudent. Tu porteras les bouteilles
sous le manteau aussi bien à l’aller qu’au retour. Quand tu parles à ton oncle
Lazo, que personne ne t’entende !
Je restai debout
pétrifié. Je n’en croyais pas mes yeux et mes oreilles. Je suis parti comme
dans un rêve. Cachant les bouteilles, enfilant mes pieds gelés dans les
lanières des sabots, je partis pour la fameuse brasserie-auberge. Une vive
curiosité m’obligea à me presser.
Les consignes ont
été respectées jusqu’au bout. L’aubergiste, célèbre dans le quartier pour sa
grosseur et sa voix rauque, a seulement demandé : « Pourquoi le pope
n’est-il pas venu ? » puis il m’a demandé d’attendre dans la cour. Le
tonton est descendu à la cave et au bout d’un moment il a fourré les bouteilles
pleines sous mon manteau.
Ma curiosité a été
entièrement satisfaite. Le pope prit les bouteilles, les dirigea une à une vers
la lumière de la fenêtre, versa le vin rouge dans un grand verre d’eau et
l’avala avidement. Mes yeux se sont écarquillés et ont commencé à aller des
bouteilles au verre et de l’assiette pleine de boulettes de viande frites à la
bouche de grand-père pope, si bien qu’il s’est senti un peu mal à l’aise.
— Ma tension
artérielle est basse et les médecins me recommandent de manger plus de viande
et de boire un verre de vin au déjeuner. Et tu vas prendre quelques boulettes
de viande. Même si c’est vendredi et que l’on doit être à jeun. J’ai parlé à
grand-père Dieu et je t’autorise. Tu n’as pas de tension, mais tu dois croître,
grandir et me remplacer.
Toujours sous le
choc, j’ai reçu ma récompense de trente centimes en petites pièces, j’ai
accepté deux ou trois boulettes de viande enveloppées dans un journal et j’ai
murmuré que je rentrais à la maison me sécher.
Maman m’a
déshabillé, m’a frotté et m’a interrogé, mais elle est tombée sur un silence
inhabituel de la part de son fils bavard.
— Laissez
l’enfant. Tu ne vois pas qu’il est gelé ? trancha grand-mère, donnant au
novice de l’Église excité le temps de réfléchir. Jusqu’au soir, j’étais
complètement déçu par les serviteurs de Dieu. Les actions cachées et les
mensonges du pope Krapchanski avaient balayé ma foi fragile. « Il ne peut
pas y avoir de Dieu s’il tolère de mentir en son nom et d’être servi par de
tels escrocs », ai-je conclu.
J’aimais beaucoup ma
mère, et pour ne pas la chagriner, je n’osais pas lui parler de ma grande
découverte. Je n’ai pas fait preuve de la même retenue envers ma sœur Nadia, de
trois ans mon aînée. Je lui ai tout raconté, du début à la fin. Ma sœur n’a pas
dit un mot pendant au moins cinq minutes. Comme toutes les filles, elle a
commencé à tordre le bout de son tablier d’école en satin et à se mordre la
lèvre jusqu’au sang. Puis elle a fondu en larmes.
— C’est
effrayant, effrayant ! Et comment maman va-t-elle vivre sans croire ?
— Nous ne lui
dirons rien. Elle est âgée (elle n’avait que 45 ans). Elle continuera de
croire.
— Et nous,
qu’est-ce qu’on va faire ?
— Nous croirons
à nos yeux, en nous-mêmes.
— Comment en
nous-mêmes ?
— Comme ça, toi
à moi, moi à toi. L’important est de ne pas mentir et de ne pas se mentir. Il
faut se dire la vérité.
— À l’Église,
les popes disent la même chose.
— Et nous
allons à l’école et en savons plus que les popes.
La conversation
secrète avec ma sœur s’est terminée par un serment : ce soir je vais
tomber malade, je vais me coucher tôt, j’irai à l’école le matin, j’aurai
encore mal l’après-midi et je ne pourrai pas lire l’Apôtre.
Le prêtre
s’intéressa à la santé de son novice, ma mère s’excusa et promit innocemment de
m’amener elle-même à l’église. Le jeu dura trois jours. Le bavardage féminin de
ma sœur n’a pas duré plus longtemps. Elle a trahi ma déception devant notre
mère et a sympathisé naïvement avec moi. Cette solidarité sentimentale a approfondi
le drame de ma mère : soudain deux enfants s’écartent du droit chemin et
tombent dans les filets de Satan !
Grand-mère, fille de
pope, sans illusions sur le caractère terrestre des ministres de l’Église, a
condamné :
— Zorla güzellik olmaz[5].
Si l’enfant ne veut pas, il ne doit pas être forcé.
Maintenant qu’il continue d’aller à l’école. Et c’est là-bas qu’il doit
chercher le salut de notre situation.
CHAPITRE
DEUXIÈME
Comment j’ai obtenu
mon diplôme d’études secondaires et en plus le département semi-classique, je
n’en sais rien. Au lycée, je faisais beaucoup de choses sauf pour mes cours. Je
ne me souviens pas et je ne peux pas non plus établir quand, où et à quelle
occasion je suis tombé amoureux de l’art théâtral, car j’ai commencé à réciter
divers poèmes et presque tous les soirs à assister à des représentations debout
du Théâtre national. Parallèlement à la passion théâtrale, un très fort intérêt
pour la lecture s’est éveillé en moi, pour toute sorte de littérature, intérêt
dont, soit dit en passant, je ne me suis pas encore aliéné malgré mon âge
avancé.
Au lycée, je suis
devenu célèbre en tant que récitant. J’étais invité aux fêtes scolaires et aux
matinées littéraires ; je participais au cercle théâtral de la société
littéraire P. K. Yavorov avec mon ami
d’enfance Petar Hristov, également captivé par les lumières de la rampe de
scène et interprète incomparablement meilleur des poèmes de Pencho Slaveykov,
P. K. Yavorov, Adam Mickiewicz et autres.
Nous étions jeunes,
nous rêvions de nous consacrer au théâtre. Mais les temps étaient turbulents et
ils ont brûlé cruellement nos rêves.
Avant que mes vingt
ans ne sonnent, j’ai vécu ma mort pour la première fois. Après cette première
rencontre, la mort m’a traqué plus d’une fois. Il y avait même des moments où
elle était ma compagne quotidienne. J’ai senti le souffle de son aile, j’ai
senti comment chaque nuit pouvait être la dernière pour moi et comment à chaque
jour levant, le ruban du voyage de ma vie pouvait être coupé avec le couteau du
bourreau.
Dans la malheureuse
et héroïque année 1923, j’ai vécu ma première aventure sérieuse. La capitale
traversait des jours agités. Les forces du « bloc noir » dressaient
habilement le Sofiote moyen contre le gouvernement démocratique d’Alexander
Stamboliiski. Ils profitaient de certains extrêmes erronés de la théorie du
rôle hégémonique de la campagne dans son ensemble, pour les citoyens-parasites,
également sans distinction de classes, pour compromettre le pouvoir aux yeux
des habitants de Sofia. Les excès anarchiques fréquents, meurtres de gardes,
braquages de banques et de magasins, enlèvements d’enfants de familles aisées
et autres ainsi que la répression policière qui s’ensuivit, tendaient
dangereusement les liens entre le gouvernement et les habitants de la capitale.
Bien souvent des agents ou des gardes interpellaient les citoyens pour vérifier
leur identité, pénétraient dans les cafés, restaurants, pâtisseries et
troublaient la tranquillité des citoyens, eux, les forces de l’ordre.
Un soir de juin, mon
ami Petar Hristov et moi, nous faisions notre promenade habituelle du quartier
des Trois Puits, toujours aussi plongés dans des discussions
philosophiques-littéraires-théâtrales. Des grondements forts et fréquents ont
interrompu notre promenade et nos conversations. Des gens effrayés nous ont
dépassés en courant, des cris de « Arrêtez les assassins », des
rideaux de fer se baissaient bruyamment, des portes se fermaient. Je me suis
précipité chez moi et j’ai appris par les voisins ce qui s’était passé :
près du coin de la rue Pirotska et de notre rue Osogovo, des anarchistes
avaient tiré et tué deux gardes dans le restaurant de Lozan le Gros. J’ai
accueilli l’information comme l’un des phénomènes quotidiens de la capitale,
j’ai mangé rapidement et j’ai commencé à travailler avec mon auteur préféré
Przybyszewski. Il y avait une loi établie dans la famille : quand je
lisais, tout le monde devait se taire. Ce soir, les esprits avaient été
réveillés par les grondements à proximité, grand-mère mourait d’envie de
commenter à haute voix l’accident. À plusieurs reprises, ma demande de
« silence » s’est estompée sans réponse jusqu’à ce que grand-mère
explose :
— Le monde, il
se bat, il va se tuer comme des gitans, et toi tu relire et tu relire.
— Même si je ne
lis pas, les gens vont encore s’entre-tuer, ai-je dit.
— Alors, au
moins, parles-nous à quoi tu bousilles tes yeux ? demanda-t-elle
curieusement.
— Je lis,
grand-mère, à propos de l’homme fort.
— Eh, alors,
qu’est-ce que faire ton homme fort ? Et que fabrique cet homme fort ?
Je relisais,
peut-être pour la troisième fois, cet ouvrage sensationnel de l’auteur polonais
à la mode et à ma grande horreur je constatais que je n’étais pas capable
d’expliquer à ma grand-mère qui et ce qu’était l’homme fort. La raison était
simple : moi-même, je ne comprenais pas l’image du protagoniste. J’ai eu
recours à des phrases sonores et creuses sur l’universalisme de la volonté, sur
le rôle transformateur de la musique, sur le rêve d’un orchestre mondial avec
un chef d’orchestre mondial qui, avec sa puissante interprétation de la
nouvelle musique, révolutionnera les esprits en effaçant le moisi du mal et en
faisant briller le bien comme le soleil.
— Je
n’ai rien du tout pas compris. Maintenant, écouter cela que je vais te dire, au
moins que tu savoir ce que dire la vie, pas les livres. Un homme fort est celui
qui résister à l’argent, mais à beaucoup d’argent, qui n’est pas séduire par
une femme, mais pas aussi vieille que moi, mais magnifique comme l’aube, qui ne
succomber point du tout au pouvoir, mais à un grand pouvoir. Celui qui sortir
immaculé des trois fléaux il s’appeler un homme fort.
J’ai vite oublié les
pensées et les images vagues de Przybyszewski, mais toute ma vie je me suis
souvenu de la sagesse populaire de ma grand-mère.
Le lendemain matin,
à 6 heures, un garde est passé de maison en maison pour délivrer un ordre
strict : « Tous les habitants de la rue Osogovo doivent se présenter
à la succursale du IIème commissariat à 8 heures avec leurs billets d’adresse. »
Lors d’une courte réunion de famille, nous avons décidé : la mère, la
sœur, l’oncle et le frère aîné vont travailler ; pour le frère illégal
Anastas[6],
la carte d’adresse ne sera pas présentée. Tous les autres billets d’adresse
seront apportés par Borko, le chômeur, bien qu’à ce moment-là je me préparais
durement pour un examen dans les studios de Lyudmil Stoyanov, Issac Daniel et
Dobri Nemirov.
Ayant enfilé ma
chemise noire col officier, je pris sous le bras la collection Insomnies de P.K. Yavorov et la
collection Éclairs de poésie de
Georgi Bakalov, j’arrivai le premier de mes voisins à la succursale du
commissariat rue Nishka. Mon intention était d’en finir avec les billets le
plus tôt possible afin d’avoir suffisamment de temps pour répéter dans le parc
Boris[7].
À 8 heures précises,
j’ai frappé à la porte du chef. Aucune réponse n’a suivi. Au bout d’un moment,
un garde est sorti du bureau et a annoncé que l’huissier n’était pas là et que
les citoyens devaient attendre. Quelques minutes plus tard, le même gardien est
revenu au bureau avec un verre d’eau chaude. J’ai essayé de lui parler
poliment, mais il était réticent à engager la conversation. Et à l’intérieur du
bureau, il y avait manifestement un homme qui bougeait — des pas pouvaient être
entendus, des objets bougeaient. J’ai encore insisté. Pas un bruit, si ce n’est
quelques voisins du quartier qui conseillaient de ne pas insister et de
s’accommoder de la situation. Le point culminant de la moquerie des citoyens
était la présentation d’un plateau à l’huissier avec du thé, du beurre et des
biscuits. Je n’ai pas pu le supporter : j’ai frappé fort à la porte et
j’ai laissé échapper ma voix pour être entendu.
Et je m’adressai aux
voisins de quartier avec ces mots :
— Les heures de
travail sont pour le travail, pas pour le petit-déjeuner.
La tête d’un garde
s’avança :
— Entrez dans
l’ordre — Et pour plus de poids, il a ajouté : — Numéro un.
Derrière la table
était assis l’huissier — les joues roses et les yeux rouges. Devant lui — le
petit déjeuner inachevé. De côté, un rasoir et le verre d’eau savonneuse.
— Nous n’avons
pas le droit de déjeuner, n’est-ce pas, jeune homme ? demanda le chef
endormi.
— Je n’ai pas
dit une telle chose. Mais puisque vous commencez le contrôle à 8 heures, vous
devriez prendre votre petit-déjeuner avant cette heure.
— Et si j’avais
travaillé toute la nuit ?
— Alors
appelez-nous quand cela vous convient.
— On dirait que
tu en sais beaucoup.
Pendant ce temps,
l’huissier regarda les billets d’adresse.
— Qui est ce
Georgi Tashkov ?
— Mon oncle.
— Où est-il
maintenant ?
— Il est allé
au travail.
— Où ?
— À la Cour de
cassation.
— Et Héraklia
Mileva ?
— C’est ma
mère. Elle est partie, avant que le garde ne vienne chez nous. Elle est femme
de ménage aux bains publics.
— Eh bien, cette
Anastasia Tashkova. Quel est ton lien de parenté avec elle ?
— C’est ma
grand-mère.
— Pourquoi
n’est-elle pas venue ?
— Parce qu’elle
est très âgée, 75 ans.
— J’ai ordonné
à tous les habitants d’Osogovo d’apporter eux-mêmes leurs billets d’adresse. Va
chercher ta grand-mère !
— Ceci est
absurde. Elle est analphabète et a du mal à se déplacer.
— Si elle est
alitée, tu l’amèneras sur ton dos.
— Il est
inutile de soupçonner une criminelle en elle.
— Je n’en doute
pas, je recherche des criminels et il est de mon devoir de les attraper.
Soudain, l’huissier
se leva, regarda la haute taille, les cheveux ébouriffés et la chemise noire,
de ce qu’il pensait, être un jeune homme qui pense beaucoup, et me jeta au
visage :
— Où étais-tu
hier soir lors de l’attaque ?
En toute innocence,
j’ai dit la vérité.
— Dans la rue.
— Quelle
rue ?
— Sur Pirotska
jusqu’à la rue Morava. Dès que j’ai entendu les grondements et vu que les
magasins fermaient, j’ai décidé de rentrer chez moi.
— Alors, tout
le monde s’enfuit de la rue Osogovo et toi tu coures dans la direction
opposée ? N’est-ce pas ?
— Pour rassurer
ma mère.
— Quels livres
portes-tu sous le bras ?
— Regardez-les !
Pendant que le
patron parcourait les livres, j’ai annoncé que j’apprenais certains poèmes des
livres, que je perdais un temps précieux maintenant parce que mon examen était
cet après-midi, et ainsi de suite.
— D’accord,
d’accord — marmonna l’huissier. — Alors, tu lis Georgi Bakalov, le
communiste... Éclairs de poésie.
— Ce
n’est pas son livre, mais une collection d’œuvres d’auteurs de renommée
mondiale.
— Et ce Peyo,
et lui aussi est-il connu dans le monde entier pour ne pas pouvoir dormir,
alors il griffonne pour ses « In-som-nies » ?
— C’est
Yavorov, le plus grand poète bulgare après Botev.
— Allez. À la
bonne heure, maintenant tu fais intervenir l’anarchiste Botev.
Puis en me regardant
une fois de plus depuis les sandales en bois, les pieds nus, aux cheveux
luxuriants, l’huissier se tourna vers le garde :
— Tsanko, tu
l’emmèneras au quartier général, rue Sofronii. Prends ton fusil et s’il
s’éloigne de plus d’un mètre de la lame du couteau, tu tires.
J’ai protesté en
vain et prévenu naïvement l’huissier qu’il répondrait parce qu’il détenait
arbitrairement un citoyen bulgare innocent.
Des voisins ont
réussi à me chuchoter : « Nous allons appeler à la maison. Attention
à ce qu’ils ne t’arrangent pas en chemin une tentative de fuite. »
Nous avons marché le
long de la rue Nishka. La route vers la rue Sofronii me semblait longue et
déserte. Ce n’est qu’occasionnellement qu’un enfant ou une femme avec des
provisions traversaient la rue. Je marchais consciemment lentement, si
lentement qu’à plusieurs reprises le garde a menacé de me toucher avec le
couteau si je continuais à être trop près.
— Je ne sais
pas comment marcher. Tu es derrière moi. C’est à toi de mesurer la distance.
— Tais-toi.
Parce que quand je vais te prendre comme cible, tu vas voir qui commande ici.
Marche et ne réfléchis pas.
Et comment ne pas
réfléchir ? C’était la première fois que j’avais de tels ennuis. Diverses
peurs et pensées apparaissaient et s’entrelaçaient dans mon esprit. Des années
supposées de paix, mais dans les rues de Sofia presque chaque jour des
grondements, des arrestations, des embuscades, des contrôles. Ne suis-je pas
victime d’une malheureuse coïncidence, qui finira qui sait comment...
Ils ont pris mes
livres, mon mouchoir et mon cahier avec des citations littéraires et des mots
étrangers. J’ai été poussé dans le sous-sol du bâtiment intérieur du
commissariat. Sol nu et humide en terre. Odeurs de moisissure et d’excréments
humains. Gribouillages sur les murs de figures féminines dans des poses
cyniques. Toutes sortes d’inscriptions, la plupart provenant d’analphabètes...
Mes pensées
s’agitaient entre l’anxiété de ma mère et l’examen de l’après-midi ; j’ai
entrevu l’image de Flora, mon premier amour platonique, camarade de classe.
Soudain, ils ont
déverrouillé la porte du sous-sol et m’ont emmené dans une pièce de taille
moyenne. Un jeune homme en civil et l’huissier de la préfecture étaient assis.
— Où étais-tu
hier soir ? demanda le civil.
— J’ai déjà
expliqué à l’huissier. Il a probablement...
— Maintenant,
c’est moi qui demande, pas l’huissier. Dis-moi, où étais-tu lors du meurtre de
deux de nos policiers en uniforme ?
Je répétais la vérité
sur le ton le plus sérieux. Le civil sursauta. Il m’attrapa comme un tourbillon
et me retourna trois fois, me giflant et me frappant un nombre incalculable de
fois.
— Pourquoi
pleures-tu, espèce de... Qu’est-ce qu’on t’a fait pour que tu pleures ? Maintenant
tu pleurniches, mais la nuit dernière, tu as tiré.
Ce n’est qu’alors
qu’une terrible illumination éclaira mon esprit : « J’avais été
choisi comme victime. » Effrayé par ma situation désespérée, j’avais
vraiment pleuré.
— Pourquoi
ris-tu, espèce de vermine ? Tu fais pleurer deux mères, tu tues leurs fils
et tu ris !
Encore une danse de
coups de poing et de pied, cette fois non seulement sur le visage mais aussi
sur la poitrine et le ventre. Les pattes du policier s’écartaient et se
détendaient, mais en même temps, avec les talons ferrés de ses chaussures, il
marchait férocement plusieurs fois sur mes pieds nus. Du sang coulait de mon
nez, de ma bouche et de mes doigts de pieds. Des pleurs secouaient tout mon
être, je tremblais comme un oiseau sans défense.
— Toi
et le lait de ta mère tu vas avouer ! … j’entendais la voix de l’huissier.
— Sortez-le
pour que je ne le voie pas, parce que je pourrais raccourcir les quelques
heures qui lui restent — ordonna l’agent civil.
Ils m’ont jeté au
sous-sol jusqu’à 4 heures de l’après-midi. Ils ont de nouveau déverrouillé la
porte. Ils m’ont ramené de nouveau chez le jeune civil et l’huissier.
— Tu vas te
taire. Si tu dis un mot, nous ferons le tour de la salle encore une fois.
Suite à cette
remarque, l’enquêteur s’est tourné vers deux hommes civils :
— Regardez
attentivement et réfléchissez à ce que vous direz.
Les gens m’ont
regardé pendant une minute ou deux. Courbé et ensanglanté, je me tenais comme
un chien battu contre le mur. Une commande m’est parvenue :
— Assieds-toi à
cette table et allume cette cigarette.
— Je ne fume
pas.
— On va voir.
Fume, je te dis !
Les gens regardaient
comment je ne savais pas tenir une cigarette et comment je m’étouffais avec la
fumée.
— Assez.
Ramenez-le.
Une demi-heure
passa. Nouvelle scène dans la même salle. Il y avait maintenant le célèbre
aubergiste Lozan et baï[8]
Hristo Doukov — boucher aux halles et voisin du quartier.
— Est-ce-que
vous le connaissez ? demanda le civil.
— On le
connaît, il est de notre rue, répondit humblement l’aubergiste.
— Si vous vous
occupez de lui comme ça pendant encore deux ou trois jours, il me sera
difficile de dire que c’est le meilleur garçon de notre rue, ajouta le grand
boucher avec audace, presque avec défi.
J’ai été renvoyé au
sous-sol.
Les lèvres dorées de
baï Hristo ! Ils m’ont ouvert la
porte de l’espoir. Je comprends — il y a une enquête ; il y a des gens
bons et honnêtes ; la vérité brillera. Un peu de réconfort se répandit
dans tout mon corps.
Le lendemain matin,
le jeune fils de baï Hristo, âgé de
seulement 15 ans, a été amené au sous-sol. Raison : il avait demandé à un
gardien bien connu du commissariat de dire à l’huissier que je ne savais pas
tirer même avec un fusil de petit calibre. Conclusion : il avait défendu
le tueur, ce n’était pas un hasard – allez ! en prison. D’autres citoyens,
probablement des clients de baï
Lozan, sont également venus, m’ont regardé, ont témoigné quelque chose
d’inconnu et sont partis. Le soir, ils emmenèrent à coups de pied Georgi Darev
dans le sous-sol. Il s’effondra au sol. Lors d’une perquisition dans la rue,
des agents lui avaient demandé s’il connaissait un jeune homme, Boris Milev.
Ignorant mon arrestation, Darev, membre actif de la maison de quartier Hristo
Botev, que je fréquentais en tant que récitant, avait admis me connaître.
Nous avons été
interrogés séparément. Le garçon de baï
Hristo a été battu et battu encore. Au sous-sol, il a avoué sa peur :
— Ils
m’ont traité de tueur, et ils vont probablement m’éliminer aussi. Et pour vous,
c’est déjà décidé. Ils m’ont lu un journal. Lors des funérailles des gardes, un
ministre a prononcé un discours disant que les tueurs avaient été capturés et
seraient pendus. Ils voulaient que j’avoue que j’étais avec vous à l’auberge et
que j’avais tout vu.
Dans cette perspective,
seule la puissance écrasante de la jeunesse pouvait nous fermer les yeux et
nous faire passer une nuit sans rêves.
Le troisième jour a
commencé par l’interrogatoire de Darev, qui est étonnamment revenu sans
blessure. À 5 heures de l’après-midi, on nous a ordonné de faire nos valises.
Les livres m’ont été rendus. Nous avons été emmenés à la mairie au coin des
rues Maria Luisa[9]
et Kiril i Metodii. Dans un grand bureau, derrière une grande table encombrée
de papiers, de journaux et de crayons, était assis le maire lui-même : le
visage enflé, allongé, les cheveux noirs, lissés. À ses côtés — assis et debout
— 10 à 15 agents civils. Tout au long du chemin, un joyeux pressentiment
m’excitait — nous serons bientôt libérés, il y a des gens honnêtes, des aides
invisibles. Ma confiance en moi revenait, rien de mal ne pouvait m’arriver
comme à Aliosha Karamazov. Devant le maire et sa suite policière dense, j’ai
parlé avec sourire de notre accident. Non seulement j’y ai indiqué ma place
chronologiquement, mais j’ai commenté ce qui s’est passé dans le sens que ce
n’était pas de notre faute si on leur avait donné les mauvaises adresses ;
les auteurs des adresses se sont moqués non seulement de nous, les innocents,
mais ils ont aussi trompé leurs propres supérieurs.
L’interrogatoire
dans le bureau du maire s’est terminé mystérieusement. Le résultat n’a pas été
annoncé. Le chef ordonna :
— Emmenez-les
au sixième commissariat. Demain, ils répondront à la Sûreté d’État. Et vous —
il se tourna vers nous — vous avez toute la nuit à votre disposition. En tant
que jeunes intelligents, je vous recommande de réfléchir et de dire la vérité.
La même puanteur
était présente dans le sous-sol du sixième commissariat de la rue Serdika. Pour
des raisons inexpliquées, nous avons été placés tous les trois dans une
position privilégiée : nous étions séparés dans une petite pièce
relativement propre. Le sol — en bois. Les murs — fraîchement peints. Dans la
salle commune, la plupart étaient des hommes, pour beaucoup des voleurs. Deux
jeunes femmes, probablement des prostituées, se disputaient avec un jeune homme
pour une place près de la fenêtre.
Une enseignante
arrêtée, qui avait traversé les ordures du harcèlement policier et perdu le
contrôle de ses nerfs, assourdissait la cour du commissariat avec ses cris.
Dans le chaos des mots, certains faisaient mouche : « Tueurs, rien ne
vous sauvera. Mon honneur abusé va vous aveugler ! »
Au bout d’un moment,
ils ont fait entrer une personne interposée. Il était censé être avec une
joyeuse compagnie féminine à la brasserie Zdrave. Un garde commença à lui faire
la morale puis il s’était impatienté, il l’avait frappé. Il serait bientôt
libéré car son oncle était général. Naturellement, il nous a demandé de lui
dire pourquoi nous étions détenus. Tous les trois, nous avons décrit notre cas
du mieux que nous pouvions. L’agent nous a conseillés
« amicalement ».
— Avouez ce
dont on vous accuse avant d’être torturés, avant que vos ongles de main et de
pied ne soient arrachés, que votre langue ne soit arrachée de votre bouche et
que vos tympans ne soient percés. Après, vous avouerez n’importe comment, mais
ce sera trop tard.
On a eu droit à une
deuxième personne interposée. Il portait une chemise noire col d’officier et
avait une longue barbe mal rasée. Au début, il m’a seulement interrogé et s’est
présenté comme un grand ami de mon frère Tacheto, que la police recherchait
comme évadé de la prison centrale[10]. En
substance, son « conseil » était le suivant :
— Demain
la Direction de la Police mettra en marche tous les appareils pour extraire la
vérité, ils vous serreront la tête dans un cerceau électrifié jusqu’à ce que le
cerveau soit atteint, ils vous courberont la taille sur un levier de fer pour
vous casser la colonne vertébrale, ils serreront dans un étau en bois vos
testicules, vos pieds nus seront collés à une plaque de fer chauffée au rouge.
Il n’y a pas de fin à leur torture. Eh bien, avouez. Quand vous l’aurez fait,
il y aura un procès. À ce moment vous nierez tout et vous serez sauvés.
Brossant le sombre
tableau du lendemain, le deuxième agent s’était également rapidement évaporé.
La peur des épreuves
physiques à venir excitait notre imagination juvénile. De terribles visions
traversèrent notre tête à tous les trois.
Un peu avant minuit,
un gros sommeil ferma nos paupières.
Le bruit des bottes
ferrées, des frappes sur les barreaux de fer du sous-sol, nous réveillèrent. Et
des cris, des cris assourdissaient nos oreilles :
— Les
tueurs ! Sortez les tueurs !
Dans un rêve, le
bruit et les cris avec une grande force ont secoué notre conscience endormie.
Darev, Petreto et moi nous nous sommes regardés avec de grands yeux, comme si
nous nous voyions pour la première fois. Nous avons silencieusement obéi aux
appels et du regard nous nous sommes invités à partir. Seul le petit Petre
éclata en sanglots. Nous nous sommes habillés, nous avons mis nos chaussures et
nos gestes ont montré la résignation avec la fin venue... Et à l’extérieur,
dans la cour, les gardes criaient de plus en plus sauvagement :
— Tueurs,
tueurs sortez ! Dépêchez-vous, enfoirés ! ...
Toujours engourdis
par le réveil, il ne nous est pas venu à l’esprit que nous n’étions pas des
meurtriers et que nous devions, et nous pouvions rester dans la cellule. Darev
est sorti le premier du sous-sol. Il était grand, avec des cheveux noirs
luxuriants. Il montait les quelques marches la tête haute, et il me sembla que
c’était Danton qui se dirigeait vers la guillotine. Un ordre émanant de
plusieurs gorges se détacha du bruit chaotique :
— Au mur, au
mur, assassins !
La folle leur a
crié : « Ha, ha… Allez, les tueurs près du mur, ha, ha, ha… »
Nous étions tous les
trois comme hypnotisés à côté du mur d’un bâtiment intérieur. Nous n’avons
échangé ni un mot, ni un regard. Nous regardions devant nous et voyions avec horreur
les canons des fusils de dix ou quinze gardes, pointés vers nous. Des policiers
civils avec des pistolets tirés parcouraient la cour et derrière le peloton
punitif. Un haut gradé sur le côté commanda :
— Peloton,
prêt !
Les culasses des
fusils claquèrent. Avec ma chemise déboutonnée et debout au milieu, je voulais
crier que nous étions innocents, que ce n’était pas nous, mais eux étaient les
tueurs, mais le cri est resté coincé dans ma gorge. C’était fait, j’étais en
train de mourir.
— Mettez-les à
l’étage ! Cet ordre était venu du balcon du commissariat. Il avait été
lancé par le chef.
Escalader Mussala[11] nous
semblerait plus facile. Je me suis souvenu de la mythologie d’Atlas qui porte
la terre. Dans les escaliers à chaque tournant — un garde avec un fusil ou un
agent avec un revolver. J’ai pensé : ils ont eu peur de nous fusiller dans
la cour. Ils vont nous finir quelque part dans le grenier.
Le silence était
complet. Seuls les pas bruyants de mes sandales en bois troublaient le silence.
— Entre
ici ! — C’était la porte ouverte au premier étage.
Nous nous tenions à
une distance décente d’un grand bureau, derrière lequel étaient assis le chef
du commissariat et un vieux monsieur civil. Le chef parla :
— Toi, petit,
comment t’appelles-tu ?
Petreto avait avalé
sa langue. Il tenta en vain d’écarter les lèvres. Une minute, deux. Il ne
réussit qu’à faire des bruits rauques étouffés.
— Et toi
comment t’appelles-tu ? — Le chef demandait à Darev.
La même réaction. Le
garçon faisait visiblement un effort terrible pour déverrouiller sa bouche,
tapant même du pied, mais il n’en sortait aucun son.
— Quel genre de
tueurs êtes-vous quand vous avez oublié votre nom par peur ? Écoutons le
chef, il faut qu’il ait plus de courage !
Les derniers mots
m’étaient adressés. Ils ne m’avaient pas flatté, mais ils m’avaient rendu
ambitieux. Mais mes efforts avaient également échoué dans ma gorge. Enfin un
petit son sourd se forma.
— Je vais... je
vais... di... re... — J’ai hoché la tête et pointé vers la droite. — Il... il
s’appelle Peter Doukov. Et ça... Ge, ge... orgi... Darev... Et moi... je suis
Boris Milev...
— Le tueur
principal ! ajouta le chef avec un léger sourire.
Le civil voulait que
chacun raconte comment il était entré dans cette sombre affaire. Moi, le
« chef », j’ai été le premier à me lancer dans de longues
descriptions. Je me justifiais autant que je pouvais dans cette situation. J’ai
considéré qu’il était de mon devoir de disculper mes camarades, complètement
étrangers à cette histoire. À leur tour, Petreto et Darev, les nerfs détendus,
ont décrit de manière tordue comment ils étaient attachés à cette affaire.
L’interrogatoire a
duré une heure. Le chef l’a terminé avec un avertissement de ne jamais
s’impliquer dans de telles querelles, de suivre les cours au lycée et à
l’université, d’obtenir une profession, etc.
— Et demain à
la Direction de la Police, s’ils vous croient, vous êtes sauvés, sinon, que
Dieu vous aide ! Descendez en bas !
Je reculais d’un pas
ou deux, me retournais et franchissais le seuil. Le sombre pressentiment ne me
quittait pas tout à fait. Et pourtant toute une montagne se dégageait de mes
épaules, de ma poitrine : je n’étais plus Atlas, portant le globe, mais
descendant l’escalier, marchant avec précaution sur mes sandales en bois. Nous
étions à nouveau trois dans la cellule, à nous regarder, surpris d’être encore
en vie. Nous avons commencé à oublier les horreurs du matin. Petreto était
enclin à des conclusions optimistes.
— Georgi
et moi serons libérés.
Je luttais avec des
pensées sur la réalité-mensonge et la vérité — une grandeur indémontrable. Je
ne savais pas comment j’allais prouver mon innocence. Mes mâchoires tremblaient
comme auparavant, devant le chef, mes bras et mes jambes aussi. Les muscles de
mon dos, de ma poitrine et de mes bras jouaient de manière incontrôlable. J’ai
regardé mes camarades. Ils tremblaient aussi. Nous avons essayé en vain
d’arrêter cette soudaine et puissante fièvre nerveuse. Ni le rire artificiel ni
nos tentatives avec les mains pour contrôler la folle danse musculaire ne nous
ont aidés.
Le silence régnait
dans la cour. La folle s’était également tue. Il était minuit passé. Puis, du
sous-sol, nous vîmes un garde courir dehors et rapporter au chef marchant dans
la cour que le gouvernement était tombé.
Les derniers mots
ont disparu dans les larmes du simple garde.
— Vérifiez
encore une fois. Toi, Stamenov, tu l’accompagneras. Si vous remarquez quelque
chose qui ne va pas, revenez immédiatement ! — Le chef dodu a dit tout
cela d’un ton autoritaire, sans la moindre surprise.
Tous trois, nous
étions tout ouïe. Au bout d’un moment, deux autres gardes se sont précipités
bruyamment et ont mis pied à terre.
— Dans les
rues, monsieur le chef — ont-ils rapporté, — des soldats et des civils armés
patrouillent. Ils arrêtent nos postes. Un capitaine nous a ordonné de retourner
dans le commissariat. L’armée change le gouvernement.
— Que se
passe-t-il autour du palais ?
— Il a été
encerclé par des troupes.
— Avez-vous vu
un garde devant la Banque Nationale ?
— C’est des
soldats qui gardent là-bas.
— Hm … Bien.
Que chacun reste à sa place. Je parlerai au téléphone avec le maire. Ensuite je
verrai ce qu’il faut faire.
Bientôt un
lieutenant, trois civils et deux soldats pénétraient dans la cour du
commissariat. Le lieutenant et l’un des civils s’étaient immédiatement rendus
au bureau du chef. Peu de temps après, le chef, accompagné du lieutenant et du
civil, se tenait sur les marches de pierre et ordonnait aux gardes de rester
calmes — rien de mal ne leur serait fait.
Il annonça : La
glorieuse armée bulgare prend les rênes du gouvernement. Elle sera secondée par
plusieurs intellectuels éminents, comme le professeur Alexandre Tsankov, qui
devient premier ministre. Cependant, nous devons maintenant déposer les armes.
C’est ainsi que se
passa la nuit du 9 juin dans le sixième commissariat. Il a été établi plus tard
que seul ce chef était dédié au secret du coup d’État fasciste.
Le 9 juin, Petreto
et Darev ont été libérés. J’ai été détenu jusqu’au dix. J’ai été libéré grâce à
l’intervention du père de Peter. Ma famille m’a accueilli avec des sourires
misérables : en trois jours les cheveux bruns de ma mère étaient devenus
gris...
DÉBUTS
AU THÉÂTRE
Quand en 1922, la
grande artiste Roza Popova et le critique de théâtre Svetoslav Kambourov
apparurent avec un « manifeste » pour un nouvel art et ont
annoncèrent un concours pour leur studio de théâtre, je m’étais dépêché de
montrer mes talents d’acteur. Heureusement pour moi, Roza Popova apprécia le
timbre « velouté » de ma voix et ma silhouette juvénile élancée. J’ai
été honoré de rejoindre la famille des membres du studio de l’actrice
exceptionnelle.
Les cours se
tenaient à l’école Vassil Aprilov de la rue Oborishte. Bientôt commencèrent
l’étude et la répétition de Prométhée
enchaîné d’Eschyle. Les répétitions étaient dirigées par Svetoslav
Kambourov. Dans le rôle principal confié à mon ami Peter Hristov, le metteur en
scène entendait montrer Prométhée non seulement comme un combattant de Dieu
implacable, mais aussi comme un grand philanthrope. Dans le rôle du personnage
principal, mon ami s’était surpassé. Tout le monde en oubliait sa silhouette
courte et trapue, captivé par la puissance de son tempérament sauvage, son
immersion profonde et sa voix épaisse, chaude et modulée à l’infini.
Dans le rôle du
messager sans âme des dieux, Hermès, je n’ai brillé par aucune réalisation
particulière.
La vie du studio a
été agréable mais courte. Elle a été écourtée non seulement pour des raisons
financières mais la principale raison réside dans le conflit entre les rêves
d’un art nouveau et la dure réalité de la Bulgarie d’après-guerre.
Les membres du
studio ont dit adieu pour toujours à un rêve de jeunesse qui a réchauffé leurs
âmes pendant près d’un an.
Il n’y a pas que
Roza Popova et moi qui avons rompu. L’actrice et professeure voulait jouer avec
moi dans La Femme au poignard
d’Arthur Schnitzler. Ce fut pour moi une terrible épreuve de me retrouver dans
le salon ombragé de l’appartement de la rue Oborishte face à la grande Roza...
Mais les répétitions sous la direction de Svetoslav Kambourov se poursuivirent,
et avec succès. Le jour de l’ultime épreuve approchait : se présenter
devant le public aux côtés de Roza Popova comme son unique partenaire. Une
grande gêne m’étreignait. La peur de l’échec ne me quittait pas jour et nuit.
Soudain, une grave
maladie mit l’artiste au lit. Roza malade était d’une beauté charmante, avec
des cheveux châtain clair flottants, un visage pâle et des yeux brûlants et
inhabituellement grands. L’espoir d’une performance scénique récente
s’estompait. Je n’ai jamais perdu mon admiration pour ma première professeure
de théâtre. Loin d’elle, j’ai été guidé par ses principes d’interprétation
réaliste et de comportement public éthique...
J’ai également fait
mes débuts dans le studio fondé par Lyudmil Stoyanov, Isaac Daniel et Dobri
Nemirov. J’ai participé aux performances Hannele
et L’amour docteur, jouées dans la
salle Slavianska Besseda. Mes collègues étaient Dora Diustabanova, Zorka
Yordanova, Konstantin Kisimov, Stefan Savov, Boris Ganchev, Boris Borozanov,
Petar Hristov et d’autres.
Dans la lutte pour
le modernisme, ce studio aussi a rapidement mis fin à ses jours. Son mérite le
plus remarquable est que plusieurs des brillants talents de la scène bulgare
sont nés dans ses entrailles.
J’avais déjà décidé
de me consacrer au métier d’acteur. C’est pourquoi, lorsque le Théâtre national
a annoncé un concours d’acteurs au printemps 1924, je me suis empressé de
concourir avec près de deux cents candidats venus de tout le pays.
La commission
composée du directeur Vladimir Vassilev, du metteur en scène Osipov, des
acteurs Sava Ognyanov, Tatcho Tanev, Elena Snezhina, Georgi Stamatov, Yordan
Seikov, etc., se réunissait dans le bâtiment en bois du Théâtre libre[12],
où le propriétaire Petar Stoychev avait temporairement hébergé le Théâtre
national après l’incendie de 1922.
Grafa et moi —
Hristo Hrolev — nous nous sommes présentés dans un extrait d’une pièce inédite
de Svetoslav Kambourov. Nous avons joué une scène très dramatique entre père et
fils. L’extrait a duré plus de 18-20 minutes. Nous avons attendu à tout moment
d’être interrompus, mais la commission a écouté attentivement et a pris des
notes. L’extrait pris fin. Une récitation a suivi. Grafa était dans son élément
– Fous-jeunes...
Je me suis concentré
sur Psaume du poète de Pencho
Slaveykov. Mon choix était désespéré, cela ressemblait à une provocation
adressée personnellement à Sava Ognyanov, le réciteur breveté et acclamé du
chef-d’œuvre de Slaveykov. Le grand acteur a répondu à la provocation d’une
manière particulièrement noble. Dès qu’il entendit le titre, il se couvrit le
visage de ses mains et baissa la tête sur la table. Le geste signifiait
évidemment : « Au moins, je ne te regarde pas, jeune homme
arrogant. »
Mon œil aiguisé
remarqua le geste. Cela m’a piqué, alors j’ai fait de mon mieux.
Le début a été,
comme toujours, calme, confiant, chaleureux.
Camarade, je me souviens, la dernière heure approche...
Au troisième
quatrain, Ognyanov releva légèrement la tête. Au cinquième, ses mains trouvèrent
son visage. Le septième, le grand, le seul interprète du Psaume jusqu’à
présent, redressa la tête, la posa sur ses paumes et écouta la musique de la
poésie panthéiste de Slaveykov couler en nuances dans des tons lyriques.
L’exécution dura 15 minutes, sans que la commission ne coupe l’interprète.
Au bout de deux ou
trois jours, les résultats étaient annoncés sur la façade du Théâtre national.
Sur un total de 200 concurrents, Boris Milev, Petya Guérganova,
Milka Stoublenska et Kruger Nikolov avaient réussi le concours.
Les heureux gagnants
devaient se présenter au bureau du directeur à dix heures le lendemain.
Qu’est-il arrivé à
Grafa et Petar Hristov ? Comme toujours et partout, leurs qualités
d’acteur avaient été très appréciées. Mais, comme toujours et partout, des
traits purement extérieurs et sociaux les ont empêchés de recueillir la
majorité des voix de la commission. Pour Grafa – « travailleur, chemise
noire, sandales aux pieds nus », pour Peter Hristov – « trop
petit, manifestement extrêmement pauvre, avec un pantalon rapiécé
aux genoux ». Pourtant, Grafa fut accepté sur parole, le metteur en scène
Osipov lui donnant un rôle dans la pièce La
chocolatière.
Le directeur du
Théâtre national m’a accueilli avec ces mots :
— Je veux avoir
de tels jeunes non corrompus au théâtre … Maintenant, s’il te plaît,
assieds-toi, que j’écrive une note.
Pendant qu’il
écrivait, il disait : « Tu vas immédiatement au Théâtre Libre. Ils y
répètent Macbeth. Le directeur
t’attend. Il y a un rôle pour toi. »
Craignant le
blasphème et avec l’ambition de rester fidèle à ce que je pensais être l’art
véritable, je me suis présenté au metteur en scène Osipov. Mon rôle était le
messager au service de Macbeth. Texte de 15 à 20 lignes en vers.
— Apprenez le
texte et venez répéter demain. Et maintenant, vous pouvez continuer à regarder
— m’a dit le metteur en scène Osipov, bercé par son travail.
— Pourriez-vous
me dire quelque chose sur le rôle lui-même, l’image du personnage ? ai-je
demandé.
— Apprenez
d’abord le texte, puis nous parlerons. Vous connaissez la pièce, n’est-ce
pas ? Vous l’avez étudiée au lycée.
— Oui je la
connais...
— Maintenant,
regardez comment les acteurs jouent et comment je dirige.
Après la répétition,
je suis rentré chez moi et j’ai mangé rapidement. J’ai relu tout le Macbeth en analysant le texte et le
contexte de mon personnage. Avec l’aide de Grafa et Petar Hristov, qui sont
venus à la maison, j’ai créé et répété l’image du messager jusque tard dans la
soirée.
J’avais une peur
intérieure de parler et de jouer sur scène avec les plus grands acteurs, tels
que Sava Ognyanov — Macbeth, Adriana Budevska — Lady Macbeth et Elena Snezhina
— Lady McDuff.
Avant la répétition,
le metteur en scène Osipov m’a demandé si j’avais appris le texte et m’a dit
d’attendre mon tour dans les coulisses.
« Quel
insensibilité ! » me disais-je. Intérieurement, je n’appréciais pas
les coutumes dans ce théâtre ancien et vieillissant.
Mon messager était
un humble serviteur avec une bonne âme. Je révélais ses sentiments humains
d’une manière très réaliste. Le ton de ma performance était parfaitement
naturel. Le metteur en scène et Ognyanov ont insisté pour « donner une
voix »...
Les représentations
se succédèrent. Mon nom était sur les grandes affiches du Théâtre national.
Dans la famille de
la rue Osogovo, la seule personne qui était fière de moi était ma sœur Nadia.
La partie masculine — mon oncle et mon frère aîné Uncho — était indifférente,
et la mère et la grand-mère se sentaient malheureuses : « Dommage
pour notre pauvre garçon. Nous n’avons pas de chance. Cela va nous monter à la
tête. Nous sommes très pécheurs devant le Seigneur. »
Dans les coulisses,
je bougeais comme une ombre. Je ne parlais à aucun des « anciens »
acteurs, et eux ne me disaient mot.
Par ma seule
présence, je dérangeais quelques petites âmes. Je n’ai pas caché mes liens avec
Roza Popova, une ennemie jurée du théâtre, et j’ai évidemment manifesté mes
sentiments amicaux envers Hristo Hrolev, l’ouvrier en chemise noire. Peu à peu,
une ambiance s’est créée contre nous deux. Parmi les acteurs figuraient des
membres des équipes d’espionnage — les horreurs de la répression du soulèvement
de septembre pesaient encore sur sa mémoire fraîche dans le pays entier.
Un soir, au
spectacle suivant de Macbeth,
j’attendais dans les coulisses ma réplique. Enveloppé d’une cape noire, que je
tenais de la main droite sur l’épaule gauche, je répétais à voix basse le texte
de mon rôle. Soudain, l’acteur Boris D. s’est approché de moi, il a soulevé mon
menton avec son doigt et m’a demandé :
— Si
tu es un étudiant de Roza Popova, que cherches-tu ici ? Va chez elle pour
apprendre l’art.
J’ai senti du vin
dans son haleine.
— S’il vous
plaît, laissez-moi seul. J’entre en scène.
— J’entre en
scène aussi. Mais tu dois me répondre, es-tu d’accord avec la critique de
Svetoslav Kambourov à mon égard ? et il saisit fermement ma cape.
Sur scène, Ognyanov
— Macbeth, avait déjà donné la réplique. La pause s’éternisait. Ognyanov répéta
la ligne. Et comme il ne me voyait pas sur scène, il frappa des mains une ou
deux fois.
— S’il vous
plaît, laissez-moi partir. Ognyanov m’appelle.
— Ils
m’appellent aussi, mais tu resteras jusqu’à ce que tu me dises qui tu es et ce
que tu penses !
— Lâchez-moi,
vous dis-je ! d’un coup je suis sorti des pattes du salaud, je l’ai poussé
à deux mains pour me dégager, d’un bond je suis monté sur scène et je me suis
agenouillé devant l’impatient Ognyanov avec plus d’une minute de retard.
— Je vous
écoute, mon seigneur...
C’était l’image du
théâtre. Roza Popova a mille fois raison : « Ils sont capables de la
méchanceté la plus grossière et la plus raffinée. »
Le duel était déjà
ouvert. L’ambiance contre Grafa et moi prit la forme et la taille d’une
campagne. Yordan X., connu pour ses relations avec des hauts placés du coup
d’État du 9 juin, menait la danse. Il s’était rendu chez le directeur et lui
avait lancé un ultimatum : « Soit vous expulsez les deux jeunes
hommes, communistes purs et durs, des traîtres, soit nous, les acteurs, nous
nous mettons en grève. »
— Mais ils sont
doués — tenta de dire le directeur.
— Ce sont des
vers talentueux, ils vont manger tout le théâtre. Ne savez-vous pas qu’ils
interpellent tout et tout le monde au théâtre ?
Le bureau du
directeur était alors installé dans l’actuel bâtiment du cinéma Kultura. Chaude
journée d’août. Dix heures du matin. La réunion était suivie par le directeur
Vladimir Vassilev et nous deux avec Hristo Hrolev. Une vraie scène s’est
développée entre nous, qui s’est déroulée à peu près comme ça.
— Monsieur le
directeur, nous sommes venus ici plusieurs fois. Vous nous avez dit d’attendre.
Nous avons été patients. Mais il vient un moment...
— Le temps est
venu ! ai-je interrompu Grafa.
— C’est
pourquoi nous sommes venus vous demander : pour combien de temps ?
Combien de temps allez-vous nous garder suspendus ?
— J’ai ordonné
que vous soyez payés pour chaque représentation.
— Nous sommes
intéressés par autre chose. Pourquoi n’émettez-vous pas un ordre de
nomination ? Pourquoi ne suivez-vous pas la décision de la
commission ?
— Vous voulez
la vérité ? D’accord. J’espère que vous me comprendrez, quand vous serez
au clair... Maintenant vous êtes deux, mais avant vous ils étaient cinq. Vous
me demandez pourquoi, comment, vous sollicitez, tandis que eux, sans détour me
menaçaient : « Soit vous les retirez, soit une grève avant la saison
théâtrale, on va tous à la campagne. » Voilà l’alternative à laquelle je
suis confronté.
— Nous savons,
Yordan X., Tartuffe sur scène et dans la vie – déclara Grafa.
— Il y en a
d’autres, ajouta notre interlocuteur, découragé.
Pause. Le directeur
se leva, regarda par la fenêtre la circulation de la place Slaveykov, prit au
hasard un livre sur la table, le feuilleta, soupira et se rassit à son bureau.
Nous avons regardé
l’interlocuteur excité et n’avons pas rompu le silence. Le réalisateur laissa
échapper un deuxième soupir et parla.
— J’ai ramené
deux de vos collègues au travail. Savez-vous pourquoi ?
— Nous restons
à l’écart des commérages théâtraux, admit mon ami.
— Oui, oui… répéta
pensivement, comme pour lui-même, le directeur.
Après quelques
hésitations, il nous scruta droit dans les yeux et demanda presque
intimement :
— Dites-moi,
avez-vous des liens… des liens, vous comprenez… ?
Soudain, je décidais
de lui jouer un petit tour.
— Bien sûr,
monsieur le directeur. Nous avons des liens, des liens autant que vous voulez…
— Oh, super
alors, soupira-t-il avec soulagement. — Parce que les capacités ne sont pas la
seule mesure au théâtre.
— Je vais vous
les montrer tout de suite. Tenez, regardez…
Appuyé sur l’épaule
de Hrolev, j’ai calmement levé ma jambe droite.
— Des liens en
coton véritable, et tissés à la main par ma grand-mère Anastasia...
— Ah, les
enfants, les enfants, je ne vous parle pas de tels liens. Des liens avec les puissants
du jour, des généraux, des Macédoniens, des grands du gouvernement…
— Vous voulez
dire des grands noms du jour ? jeta en l’air Grafa.
— Des gens, qui
sont au pouvoir, et qui me forcent à vous embaucher.
— Et
qu’adviendra-t-il alors de la grève ? demandai-je innocemment.
— Vous,
apportez-moi une note d’un grand homme, et laissez-moi m’occuper du reste.
La scène est entrée
dans une phase prosaïque. Je voulais accélérer le résultat.
De nouveau nous
voilà devant le bureau, enlacés.
— Monsieur le
directeur, commençai-je ma tirade, nous avons passé le concours avec succès.
Nous avons joué des petits rôles dans Macbeth
et « La chocolatière » sans
doute avec talent... Nous comptions et nous nous appuyions toujours seulement
sur nos compétences. Vous avez récemment admis qu’elles ne sont pas la seule
mesure. Merci pour votre sincérité. Nous allons vous rembourser avec la même
pièce. Nous n’acceptons pas les « téléphonettes[13] »
pour ouvrir notre chemin vers la scène. Nous ne croyons pas en vos puissants du
jour. Nous les considérons comme des tyrans du jour, mais pas comme des hommes
forts.
— Et
temporaires... Grafa tenait bon.
— Nous sommes
tous des passagers... ajouta le directeur avec une humilité religieuse.
— En dehors du
Théâtre national, nous ferons de l’art pour le peuple.
— Au revoir,
monsieur le directeur...
Monsieur le
Directeur se leva et ses yeux s’écarquillèrent. Il hocha la tête et baissa les
yeux, peut-être honteux à l’idée que la jeunesse quitte le théâtre. Nos
promesses juvéniles d’art parmi le peuple n’avaient rien à voir avec les
promesses électorales de divers démagogues d’alors.
Les sociétés
ouvrières formées par le Parti communiste illégal obstinément perçaient comme
des perce-neige les couches rigides et les milliers d’obstacles à la censure du
coup d’État du 9 juin. Ils organisaient des matinées littéraires et des soirées
dansantes avec et sans l’autorisation des autorités policières. Grafa, Petar
Hristov, Boris Ivanov (fils d’un éminent communiste) et moi-même participions
régulièrement à des programmes littéraires. Le public de la maison du
charpentier sur le boulevard Hristo Botev et dans les salles à manger des rues
Ekzarh Yosif et Tsar Samuil, à Odrin et Pirotska nous connaissait déjà et nous
applaudissait…
Participer à des
fêtes ouvrières, mettre en scène la pièce Les
juges d’Octave Mirbeau dans la salle Maika (Mère), jouer dans le drame Sous le nouveau joug de Mateï Ikonomov
et faire le tour de certaines villes de province avec lui, donner des récitals
en solo dans les quartiers et les villages — tout cela satisfaisait notre
passion théâtrale, mais ne garantissait pas notre subsistance.
Dur était le pain du
chômeur d’une famille opprimée par une pénurie constante.
Une issue au chômage
se trouvait... à la campagne. Je suis devenu enseignant indépendant dans le
village de Kapatovo, région de Petrich. Ce n’est pas par hasard que j’ai choisi
la province. Je traversais une crise morale. Sans être déçu de mes
performances, j’avais décidé de ne pas persister dans l’art d’acteur. La raison
en résidait dans mon intolérance intérieure à la médiocrité, qui se répandait
dans toutes les scènes métropolitaines et provinciales. Je ne voulais pas être
« comme les autres ». Et si je rejoignais une troupe de théâtre
maintenant et une autre demain, je deviendrais inévitablement l’un de ces
acteurs médiocres qui se comptaient par centaines. Avec une naïveté juvénile,
j’élaborai un projet : faire des économies et aller à Paris ; j’y
étudierai la mise en scène théâtrale ; je serais donc le premier metteur
en scène diplômé en France.
Avec de telles
pensées à l’esprit, je suis arrivé dans le village de Kapatovo. Un petit
village niché au pied des collines de Melnik, héroïque et riche. La première
chose que j’ai apprise, c’est que les habitants de Kapatovo avaient résisté aux
forces armées contre les gangs de Vancho Mikhailov[14]
pendant toute une année. Les villageois semblaient éveillés, intelligents et
courageux.
L’ancien bâtiment de
l’école s’élevait sur deux étages. Les deux salles de classe à l’étage étaient
adaptées pour 20 à 30 élèves. Le domestique de l’école utilisait la pièce du
bas, qui avait été transformée en grange, pour ses propres besoins. Mais quand
et où a-t-il été dit que cette grange ne devait être utilisée que pour le foin,
les tiges de maïs et le bois de chauffage ? J’ai proposé, et baï Anguel, le président du conseil
scolaire, puis baï Zlatko, le chef de
section de l’ORMI, ont approuvé la conversion de la grange en théâtre avec une
scène et des chaises et des bancs pour le public.
Avec les jeunes du
village, j’ai participé à la construction. Les villageois ont été étonnés de
mon énergie et de mes bonnes intentions, mais ils se sentaient un peu désolés
pour l’enfant maladroit de Sofia.
— Mon cher
instituteur — m’a dit un jour baï
Velio, l’un des futurs acteurs, — clouer des planches pour la scène, ce n’est
pas comme réciter dessus. Va faire ton travail et viens voir le salon lorsque
nous l’agencerons de façon rustique, car, de la manière que tu le souhaites,
cela ne marchera pas.
Et le farceur Boris
Roumenov avait ajouté :
— Les habitants
de Sofia, vous êtes des gens très simples. Par exemple, toi, tu ne comprends
pas que nous fassions ce théâtre pour parader et irriter les villages voisins
de Novi Chiflik, Harsovo, Levunovo, Sklave.
Après quelques
observations, j’avais déjà sélectionné ma troupe de théâtre parmi la jeune et
moyenne génération. J’ai demandé : « Et si des femmes devaient jouer
dans la pièce ? » On m’a répondu : « Oh la la ! Pas de
femmes. Nous sommes Bulgares, mais nos coutumes sont quand même un peu
turques. »
Nous avons
rapidement trouvé une pièce avec uniquement des acteurs masculins. Il
s’agissait d’une esquisse dramatique inédite de Svetoslav Furen, La mort du voïvoda[15].
Hristo Hrolev — Grafa apporta le manuscrit en personne. Le chômage à Sofia et
les sentiments amicaux ont poussé Grafa à accepter volontiers l’invitation à me
rendre visite en tant qu’ami et aux habitants de Kapatovo en tant qu’artiste.
Les rôles ont été
rapidement distribués. Les répétitions ont duré quatre ou cinq semaines. Elles
ont montré deux choses : des talents remarquables étaient cachés parmi les
gens, les habitants de Kapatovo étaient confrontés pour la première fois aux
problèmes des arts de la scène. Ils percevaient dans leurs oreilles des termes
tels que diction, intonation, articulation, mise en scène, etc., qui ne
faisaient qu’engourdir à la fois leurs pensées et leur langage. Mais Grafa et
moi étions implacables : nous voulions élever les « masses populaires »
à notre niveau, et non nous rabaisser à leur primitivisme.
La
« première » rassembla tout le village. La grange était pleine à
craquer. C’était l’hiver dehors, mais l’air chaud à l’intérieur étouffait les
amateurs de théâtre. Les gens étaient assis exactement selon les lois de la
division des classes dans le village : devant, sur les chaises, les chefs
du village baï Zlatko, baï Anguel, Kuleto, mamie Nedelya — une
femme riche et belle — et d’autres. Derrière eux étaient assis les
propriétaires moyens, installés sur des bancs, et enfin au fond, de côté, les
paysans pauvres.
Le rideau, une
grande toile tendue, se fendit en deux et l’action commença. Cela ressemblait à
la représentation de Genoveva la
souffrante décrite par diado[16]
Vazov, mais les habitants de Kapatovo étaient d’un avis différent : ils se
taisaient, tremblaient, applaudissaient, éclataient de rire ou s’indignaient
contre les Ottomans, et ont finalement déclaré qu’une telle représentation ne
pouvait se voir qu’à Sofia et pas tous les jours. Les chefs du village, qui
avaient auparavant approuvé la pièce, se sont empressés de faire l’éloge des
habitants de Sofia. Bien sûr, il n’y avait pas que des compliments qui nous
étaient parvenus. Pendant le jeu, le voïvoda
au milieu de la bataille s’est levé et a lancé une menace et un appel pour
lutter contre le bataillon turc. En fait, j’ai récité les mots de Johan :
Allez venez, j’ai un visage de pierre
je rencontrerai la baïonnette dans mon
cœur !
Allez venez, fils criminels !
Hommes fous ! Chaque goutte de sang devant
vous
des milliers de nouveaux combattants vont
surgir !
La douzième heure sonne déjà
et nous vaincrons votre puissance
criminelle !
Allez venez ! Venez, salauds !
L’instituteur était
si absorbé dans la tirade, gesticulant si violemment et frénétiquement en
criant sa menace contre tout l’Empire ottoman, qu’une paysanne cria soudain à
tue-tête : « Ah, celui-ci… il en fait trop… ! »
Ce jugement
meurtrier pour mon jeu n’arrêta pas la renommée fulgurante du « Théâtre de
Kapatovo ». Les invitations à visiter les villages environnants
commencèrent à pleuvoir aussitôt, même pour la ville de Melnik. Les habitants
de Kapatovo devenus arrogants répondaient volontiers aux demandes. Les
représentations s’alternaient ici et là avec un succès inégal…
Un proverbe français
dit : « Tout est dans le ton. » Je ne le connaissais pas alors.
Mais à partir de la littérature pédagogique et de la petite expérience
théâtrale, je connaissais le grand pouvoir impressionnant de l’intonation. J’ai
rapidement réussi à utiliser ce pouvoir pour atteindre certains objectifs
politiques. L’affaire était inhabituelle. L’attentat de l’église Sveta Nedelia
du 16 avril 1925 secoua le pays entier. Les forces réactionnaires ont utilisé
l’attentat pour déclencher une terreur sanglante à travers tout le pays. La
presse officielle et officieuse versait une rage anticommuniste dans des titres
à cinq et six colonnes. Les sommités de toutes les fourmilières partisanes
soufflaient le tonnerre et la foudre contre les « traîtres ».
À Kapatovo, trois
personnes recevaient des journaux : baï
Zlatko, baï Anguel et Naseto, le
cafetier. Dans le cours normal des événements, le journal de Naseto passait de
main en main parmi des clients réguliers, consommateurs modérés de café, de thé
et de loukoums.
L’intérêt pour
l’attentat a forcé le journal de Naseto à être lu devant tout le monde. Le
pauvre paysan Atanas Lazarov a suggéré mon nom et le café m’a unanimement
désigné comme lecteur. Je lisais tous les soirs dans le café rempli de
politiciens de Kapatovo. Pour contrecarrer l’effet néfaste des calomnies du
journal, j’ai eu recours à l’arme de l’intonation. Je lisais de manière à
neutraliser au moins un peu le ton vicieux du journal. J’y parvenais en
accélérant ou en ralentissant le rythme et en accompagnant certaines phrases
d’un sourire faible mais éloquent. Je m’abstenais délibérément de tout
commentaire public. Pourtant, à deux reprises, j’ai osé faire des remarques du
ton le plus innocent. Les hérauts des journaux affirmaient que Dieu lui-même
avait sauvé la vie de centaines de fidèles non affectés par l’effondrement du
dôme central. À cette occasion, j’ai suggéré que ce cas ne concernait pas
l’intervention de Dieu, mais le manque d’une quantité suffisante de pyrites
incrustées dans le dôme. Contrairement aux interprétations de l’archimandrite
de Sofia, j’ai expliqué que le roi n’aurait pas été sauvé si l’engin infernal
avait explosé 20-30 minutes plus tard, alors qu’il était déjà entré dans
l’église.
Dans le bureau de
l’école, qui me servait de dortoir et de lieu de rassemblement pour les jeunes
du village, je me lâchais dans de longues conversations sur les événements. Mon
objectif caché était d’amener les jeunes Georgi et Toma Lazarovi, Dimitar
Konstantinov et d’autres à se rendre compte que le blâme ne portait pas sur les
auteurs de l’attentat, mais sur ceux qui les avaient poussés à cette action
désespérée.
Pour des temps
terribles et turbulents, les gens ont leur propre expression :
« L’eau trouble est arrivée ». Les habitants de Kapatovo utilisaient
une allégorie à eux, pour définir la terreur omniprésente post-avril. Ils
disaient : « L’ours noir sillonne tout le pays. Il entre également à
travers des portes verrouillées. Malheur et calamité pour ceux qui sont
visités. » Les rumeurs sur ses visites inquiétantes dans les villages
voisins de Hotovo, Harsovo, Sklave, Levunovo aiguisaient la vigilance nuit et
jour des villageois. Il y avait des postes constants autour du village. La peur
et l’espoir les poussaient à prier : « — J’espère que nous nous en sortirons ! »
Mais « l’ours noir » était cruellement aimable. Il ne manqua pas de
visiter Kapatovo. À quelle porte a-t-il frappé ? À l’école. Il était
apparu sous deux formes : un rebelle armé et un garde accompagnateur. Il
était onze heures du matin. Ils m’ont appelé pour que je sorte de la classe.
Soi-disant je devais aller à Sveti Vrach[17] pour
un « petit contrôle ». J’ai frissonné, j’ai pâli, j’ai transpiré,
mais je me suis ressaisi. J’ai pu objecter :
— Les
élèves ont un examen en classe. Je dois finir le cours.
— Le contrôle
est petit, mais rapide. On nous a dit de t’emmener dès que nous te trouverons.
— Je vais
appeler le président de la commission scolaire. Il doit savoir où je vais.
— Il
comprendra. Toi, prends soin de toi maintenant, que ton contrôle soit propre.
— Je ne
comprends pas de quel type de contrôle il s’agit. L’Inspection de Gornaya
Dzhumaya a toutes les données sur moi. Ici aussi, la commission scolaire sait
tout.
— Tu
expliqueras tout ce qu’il faut là-bas. Dépêche-toi, car nous allons marcher à
pied.
Je suis retourné
vers les enfants qui me regardaient les larmes aux yeux. Ils ne reconnaissaient
pas leur professeur toujours souriant — tellement j’étais pâle.
— Arrêtez
l’examen. Vous rentrez tous à la maison en silence. Toi, Elenke, tu diras à ton
père qu’on m’emmène chez le voïvoda
de Sveti Vrach.
Silencieusement,
presque sur la pointe des pieds, les élèves quittèrent la classe. Ils ont
laissé la blonde Elenka la première à courir dehors. Un peu plus tard, son
père, baï Anguel, était déjà dans le
couloir, parlant aux visiteurs non désirés. Baï
Anguel était un grand homme blond avec une fine moustache en guidon, toujours
avec un chapelet d’ambre à la main. Averti par les postes du village, il
s’était aussitôt empressé de faire connaissance avec les représentants de
l’organisation et les autorités de l’État en sa qualité de président de l’ORMI
du village.
— Vous
auriez dû venir me voir en premier. Je vous aurais dit ce qu’il faut faire.
— C’est ce
qu’ils nous ont dit, de l’emmener tout de suite.
— Vous terminerez
votre tâche, mais ici, dans le village, il y a un ordre. Il fallait me
prévenir. Et maintenant, nous allons attendre que le voïvoda du secteur arrive. Tout ce que lui dira, sera. Je l’ai
envoyé chercher.
Baï Anguel entra dans le bureau, où, ne
sachant que faire, je mettais de l’ordre sur la table. J’avais depuis longtemps
distribué les papillons illégaux apportés par Grafa.
— Cher
instituteur, j’attends que Zlatko vienne. Nous déciderons avec lui comment
agir. Calme-toi. Ils peuvent vraiment t’appeler pour un renseignement. Et
baissant la voix, il demanda : — Tu n’es pas impliqué d’une manière ou
d’une autre dans l’organisation secrète des enseignants ?
Je me montrai
honnête dans ma réponse :
— Non, aucun
lien. Je ne sais même pas si une telle organisation existe.
— D’accord,
soupira de soulagement l’homme au chapelet.
Baï Zlatko arriva. Silencieux et pensif,
il écoutait les personnes envoyées de la ville. Il appela baï Anguel et les deux se retirèrent seuls dans la salle de classe.
Au bout d’un moment, ils annoncèrent :
— L’instituteur,
prépare-toi, nous venons avec toi. Allez !
Une petite foule
d’hommes et de femmes s’était rassemblée devant l’école. Côté de la place —
écoliers et enfants.
— Zlatko, et
toi Anguélé, vous ne rentrez pas au village sans l’instituteur !
Mamie Nedelya, une
femme courageuse, a dit ces mots. L’instruction de la bonne habitante de
Kapatovo me réchauffait le cœur tout au long du chemin. Je voyais dans ma tête
comment tout le village, mené par les chefs, m’accompagnait devant les facteurs
irresponsables et là prenait ma protection.
Le seul conseil que
Zlatko m’a donné concernait le comportement devant le voïvoda et le gouverneur du district :
— Tu ne
répondras qu’aux questions, et seulement brièvement. Tout le reste, tu le
laisses pour nous.
Dans
l’administration du district on m’a ordonné d’attendre dans le hall du bureau
du chef. Zlatko et Anguel sont restés longtemps à l’intérieur, peut-être plus
d’un quart d’heure. Une tête barbue est sortie de la porte et m’a invité dans
le bureau. Les habitants de Kapatovo étaient assis sur des chaises au fond.
Derrière un bureau ordinaire se tenait un voïvoda
lourdement armé. De côté, le chef de district en uniforme fumait nerveusement.
— Pourquoi me
croises-tu un jour de marché et ne me salues-tu pas ? demanda le voïvoda.
— Je viens
rarement au marché. Je ne vous ai pas salué car nous ne nous connaissions pas.
— Vas-tu me
dire bonjour à partir de maintenant ?
— Bien sûr, si
cette rencontre est considérée comme une rencontre.
— Tu es
enseignant et tu marches pieds nus. Pourquoi ? Que veux-tu dire avec
ça ? Que tu es proche de la souffrance du peuple, n’est-ce pas ?
— La route est
longue. Je garde mes chaussures. J’économise de l’argent.
— Pourquoi ?
— Pour aller à
l’étranger.
— Qu’est-ce que
vas-tu faire là-bas ?
— Je vais
travailler et étudier la mise en scène.
— Quoi ?
— J’étudierai
pour devenir metteur en scène.
— Faire du
théâtre, comme à Kapatovo ?
— Oui.
— Toi, tu veux
lui demander quelque chose ? — Le voïvoda
s’est tourné vers le chef du district.
— Non, dit
sèchement l’officier en uniforme.
— Et
vous ?
La question
s’adressait aux chefs de Kapatovo.
— Non, nous
n’avons pas de questions.
— Sortez-le et
soyez vigilants. Qu’il attende dans la petite salle.
Le rebelle barbu
ouvrit et referma la porte du bureau.
Il a fallu plus
d’une demi-heure, c’est-à-dire une éternité, pour que les proches se
présentent. Ils étaient rouges et en sueur, comme s’ils sortaient d’une salle
de bains. Le voïvoda après eux. Il se
dressa devant eux et écarta les jambes près de moi.
— Tu les vois,
ce sont eux tes garants. Tu leur baiseras les mains toute ta vie. Cette
fois-ci, tu y as échappé. Tu retournes au village, qu’il n’y ait pas de
commentaires sur notre rencontre, comme tu aurais aimé en faire à propos de
l’attentat. Si tu vas en France, que ce soit pour y étudier l’art, pas pour
traiter de la commune. Quand tu viens au marché, tu salues comme tout le monde
et que je ne te voie plus pieds nus.
— À partir de
maintenant, il saura comment se comporter, déclara baï Zlatko.
La réunion s’est
terminée. Sur le chemin du village, les deux compagnons me confièrent ce qu’ils
avaient mis en gage pour me sauver de la corde ou de la balle. Ni plus, ni
moins, leurs têtes et leurs familles. Un tel prix devait être payé, pas un autre.
— Tu nous as
fait transpirer, mais nous nous sommes portés garants parce que nous croyons en
toi et nous te comprenons, m’assura baï
Zlatko.
— Tu
as une route devant toi, pas seulement vers Paris, prédisait baï Anguel.
Pendant tout le
trajet, mes protecteurs honnêtes et courageux m’ont raconté que lorsqu’ils
m’ont défendu devant le voïvoda, ils
ont pensé à mon avenir. Ils ne voulaient pas me voir fauché comme un agneau sur
le billot. Ils m’ont fait jurer de me souvenir de mon peuple, qui est un grand
peuple, et m’ont avoué qu’à leur avis les bergers actuels ne sont pas à la
hauteur ; ils croyaient qu’un jour il les chasserait de son corps.
Nous sommes arrivés
le soir. Le village semblait silencieux et mort. Mais la nouvelle se répandit
rapidement dans toutes les maisons. En dix minutes, le bureau de l’école se
remplit de paysans. Mamie Nedelya arriva la première. Elle m’a embrassé comme
son fils et a dit : « Il y a un Seigneur. »
Le cœur de
l’enseignant survivant était large, mais le bureau était trop petit pour
accueillir tous les nouveaux venus rassemblés sur la place devant l’école. Ils
voulaient s’assurer que j’étais à nouveau parmi eux, vivant et joyeux. Je me
suis montré sur le palier de l’escalier extérieur. La réunion était
silencieuse. Je souriais légèrement et hochais la tête. En bas, des gens de
tous âges étaient contents de m’apercevoir en vie. Ils seraient restés
longtemps sur la place si Kouleto n’était pas arrivé, qui, de la part de baï Anguel, les avait invités à se
disperser.
Ils étaient tous
rentrés chez eux. Mais peu de temps après, au moins dix portes de jardin
grinçaient et s’ouvraient. Elles laissèrent passer dans le noir des écoliers et
des écolières avec des assiettes et des baluchons à la main, qui allaient à
l’école. Les enfants apportaient de la nourriture et d’autres sucreries. Ils
les présentaient avec l’accrocheur « De papa », « De
maman », même si beaucoup d’entre eux auraient pu dire « Tiens, ça
vient de moi », ce qui aurait été plus vrai.
L’année scolaire
s’est terminée après la journée de Kiril i Metodii. Jeunes et vieux, femmes et
hommes passaient par le bureau ou dans la rue pour dire au revoir. Ils m’ont
souhaité : « Bon vent », « Reviens vite vers ta mère,
fais-lui plaisir », « Ne nous oublie pas ».
Le jeune Dimitar Konstantinov
m’a accompagné avec une mule jusqu’à la gare de Levunovo. Le train à voie
étroite avait six heures de retard. Mitko me tint compagnie tout le temps.
— Et s’ils te
poursuivent, tu sais où est Kapatovo, déclara le sympathique garçon de
campagne, les larmes aux yeux.
ACTION
COURAGE
À Sofia, ma mère, ma
sœur, ma grand-mère, mon oncle, mes frères et mes amis ne pouvaient pas être
plus heureux de me revoir. Le fils et le frère avait mûri, l’ami et le camarade
avait acquis une expérience de vie indépendante en une année scolaire. Aux yeux
des autres, et devant moi, j’avais endurci ma volonté, grandi
intellectuellement.
De retour de
Kapatovo, j’ai consacré mon temps et mes pensées à la tâche principale —
comment aller plus vite à Paris. Dans ce but, j’ai contacté Lichka, un gars du
quartier qui avait un bureau de voyage, là où se trouve actuellement le Comité
de la culture. Je me réjouissais de sa promesse de me « transférer »
en France et en même temps une ombre planait sur ma joie :
— Et maintenant
va-t’en, tu peux revenir dans un mois. Sache-le, attendre c’est crucial…
J’ai ressenti ce
délai comme un jugement, j’étais condamné à attendre. Et j’attendais...
Un soir, Grafa m’a
emmené pour faire une action. Action « Courage ». Il s’agissait de
diffuser des appels manuscrits au nom du parti communiste illégal dans les
quartiers de Yuchbunar et de Banishora.
Grafa
expliquait :
— Dans les
cours, même si le vent souffle et qu’il pleut, les tracts restent là. Ils se
perdent dans les rues. Sur cent jetés, dix seront lus par des gens honnêtes,
c’est suffisant. L’important c’est l’espoir, la foi dans le parti qui monte...
L’action a duré plus
de deux heures et s’est terminée par un « festin » dans l’une des
auberges du boulevard Slivnitsa. Là, mon ami a révélé la pensée intime de
l’action.
— Je t’ai donné
des matériaux jusqu’à présent. J’ai assuré mes camarades que tu les distribues,
et je te crois. Mais ils ont insisté pour que je te teste en personne. Car
certains acceptent, ne refusent pas, puis les jettent dans les toilettes. Les
temps sont terribles. Ne sois pas en colère contre les camarades. Ils ont
seulement entendu parler de toi. Ce sera différent maintenant. Je te
rencontrerai demain avec un homme à moi.
Je me suis laissé
entraîner par mon bon ami, militant du parti communiste bulgare illégal.
Le lendemain, la
rencontre avec l’homme de Grafa a eu lieu dans le jardin de Yuchbunar, où nous
nous détendions souvent sur les bancs ou sur les tas de branches coupées et
nous nous livrions à d’inépuisables disputes de jeunesse. À ma grande surprise,
l’homme n’était autre que Radi, un marchand de glaces connu, depuis longtemps,
de toute notre compagnie. Grafa m’a invité à prendre un verre. Et comme ça, en
plein jour, servant les « clients » avec de la glace au chocolat, le
charretier Radi m’a regardé un peu spécialement, comme s’il me voyait pour la
première fois, et a déclaré :
— Je suis
d’accord. Nous sommes trois maintenant. À la vie et à la mort. Tout ce qu’ils
nous diront d’en haut sera la loi pour nous. La prochaine fois nous nous
verrons dans un autre endroit. Et pour plus longtemps. Nous appellerons notre
camarade Spas, et désormais je suis Yordan.
— Félicitations
pour ton baptême, Spasé – dit Grafa en se tournant vers moi, avec un sourire
complice aux lèvres : j’ai été surpris par l’évolution rapide des choses.
— Merci pour la
glace. Le nouveau nom ne me dérange pas. Mais il y a une condition dont je veux
lui parler (j’ai pointé du regard Grafa), et alors... on pourra se voir.
Le marchand de
glaces conduisit calmement sa charrette et commença à inviter de nouveaux
clients dans les allées du jardin.
Nous avions parlé
avec mon ami de Kilkis plusieurs fois de ma « sympathie expectante ».
— Comprends,
insuffla Grafa, il ne suffit pas de s’intéresser au travail du parti, de lire
et de distribuer ses documents illégaux, de défendre ses positions dans des
conflits privés. Tu dois rompre avec ta « sympathie expectante » et
rejoindre nos rangs organisés.
Je me suis opposé à
lui, faisant référence à ma passion théâtrale. Mes objections furent
immédiatement repoussées et brisées. Grafa lui-même ressentait la puissance de
cette passion, mais en même temps c’est lui qui donnait l’exemple personnel de
la façon dont elle pouvait être sacrifiée au nom d’un idéal.
La conversation que
j’avais programmée avec Grafa s’est déroulée dans les rues des quartiers
pauvres. Elle était sans fin, ça s’est terminé à minuit. Les thèses étaient
claires pour nous deux et, je pense, tout aussi nobles.
Nous nous séparâmes
à la lumière du poteau électrique au coin des rues Pirotska et Bregalnitsa, où
nous avions vu Hristo Smirnenski et Alexander Zhendov se disputer plus d’une
fois. Notre séparation fut courte, mais l’étreinte fut forte et chaleureuse,
amicale.
CHAPITRE
TROISIÈME
MATURATION
Je suis allé à Paris
avec mon ami Emil Sidérov, surnommé Bolsheto. Grafa, Petarcho, Asen Prahov,
Vasil Stamboldjiev sont venus nous accompagner à la gare. Grafa ne manqua pas
de me souhaiter de revenir plus tôt, et Petarcho me serra dans ses bras en
disant : « J’espère que tu réussiras ton saut dans l’inconnu. »
Paris ! Je
pourrais écrire Paris avec trois et treize points d’exclamation. Ils ne
chuchoteront et ne dévoileront rien à celui dont le pied n’a pas foulé les
pavés de Paris. Mais même pour ceux dont les yeux se sont usés en regardant les
riches vitrines des grands boulevards et des avenues luxuriantes, les points
d’exclamation ne seront pas particulièrement expressifs. Multiforme, Paris est
unique ! Ouverte, c’est une ville profondément mystérieuse ! Atteinte,
elle reste insaisissable ! Toujours semblable à elle-même, elle n’est
jamais la même. Malgré ses vieilles rues, ses immeubles, ses monuments et ses
retraités, blottis aux recoins des cafés ou se reposant sur les bancs du
jardin, elle est toujours neuve et étonne par la jeunesse débordante et la
vitalité de ses habitants. Repoussante par les vices des couches parasites et
ses groupes décadents, elle est séduisante par le charme de ses rares valeurs
historiques et artistiques.
L’histoire marque sa
naissance il y a deux mille ans et plus. Mais elle brille avec le Roi Soleil et
le château de Versailles, avec la Grande révolution française, la Commune de
Paris, le Front populaire. Ele est connue, reste et restera à jamais dans la
mémoire de millions de Parisiens, Français et étrangers. Des millions d’autres
la désireront réveillés et dans leurs rêves jusqu’à la fin de leur voyage
terrestre. D’autres, aussi innombrable, jureront et maudiront jusqu’à leur
dernière heure son ventre insatiable, l’égout puant de la débauche et les dents
jaunes du Veau d’Or.
Que dire de ce
compagnon que je connais depuis plus de cinquante ans ? Et beaucoup, et
peu. Beaucoup sur ses trésors artistiques éparpillés ou rassemblés dans les
rues, les musées, les maisons, les parcs ; beaucoup sur certains de ses
habitants héroïques, naïfs, optimistes, mesquins et majestueux ; beaucoup
sur les quartiers prolétariens aux rues étroites et tortueuses, aux entrées
sombres, aux maisons délabrées, aux chambres mansardées, aux ouvriers magnifiques,
aux chômeurs affamés, aux pères et mères — héros, vagabonds et descendants des
Communards ; beaucoup sur les théâtres — publics et privés, perpétuels et
d’un jour ; beaucoup sur les innombrables concerts de compositeurs, chefs
d’orchestre, interprètes connus et inconnus ; beaucoup sur les centaines
d’expositions quotidiennes — générales et individuelles, bruyantes et
silencieuses, abritées soit dans des halls spacieux, soit entassées dans de
petites pièces, entrées, couloirs, caves et greniers ; beaucoup sur la
résistance des Parisiens — héroïques, loyaux, ingénieux et naïvement dévoués.
Peu sur l’abondante
couche parasitaire d’intermédiaires et d’escrocs qui ont ouvert et rempli des
milliers d’agences, de bureaux et d’offices pour la plus vile exploitation des
Parisiens et ceux de la campagne ; peu sur les agents de la bourse, les
banquiers, les industriels et les militaires, qui, avec leurs spéculations,
actions et plans prédateurs démentent la devise de la république pour la
liberté, l’égalité et la fraternité ; peu sur ces aristocrates tenaces
qui, blottis dans de spacieux appartements et halls sur les quais de Seine, sur
les boulevards Saint-Germain, Henri Martin, etc., rêvent d’un passé
irréversible et ne pardonnent toujours pas à Louis XVI, roi-l’abruti d’avoir
livré leur royaume aux sans-culottes ; peu sur les milliers de
journalistes et gribouilleurs qui écrivent sur tout et sur tous et qui, se
vantant de leur indépendance, ont la capacité de s’adapter à la position
officielle de Sa Majesté du nouveau gouvernement en moins de 24 heures ;
peu sur les prostituées exposées et cachées qui, fidèles aux traditions
combattantes parisiennes, ont manifesté en plein jour devant l’Assemblée
nationale sous le gouvernement de de Gaulle avec des mots d’ordre pour le droit
au travail libre et une réduction de l’impôt sur le travail ; peu sur les
espions du monde entier qui ont fait de la « ville lumière » leur
refuge chaleureux.
Mais aussi prolixe
et aussi concis que l’on parle et écrive sur la capitale française, personne ne
pourra jamais épuiser le contenu et les formes de Paris aux multiples facettes.
L’impossibilité de révéler d’un ou de quelques traits ce complexe ancien et
sans cesse renouvelé : celle que rencontrent les artistes les plus
ingénieux, pourvu qu’ils veuillent couvrir l’infini, l’insaisissable,
c’est-à-dire la Vie. Et Paris — c’est la Vie, ce sont les images que la Vie a
acceptées, accepte et acceptera dans son mouvement historique en zigzag et sans
cesse ascendant. Passé, présent et futur coexistent ici, s’affrontant sans
relâche dans les pages de la presse et des livres, dans les rues et sur les
places, du haut des chaires universitaires et des tribunes parlementaires, des
chaires d’Église et des scènes de théâtre. Dans la poitrine du géant nommé Paris,
tremble et bat le cœur gigantesque de l’humanité éternelle, aspirant à son
Excellence, toujours plus haut et plus haut !
Mais laissons Paris
et l’humanité en paix et voyons ce que je fais en ce matin d’août 1925 dans
cette ville grise, encore endormie et sans lumière.
Nous sommes arrivés
à la gare de l’Est.
Peu importe à quel
point nos bourses étaient damnées, mon compagnon Bolsheto et moi étions
propriétaires d’une petite somme d’argent, capable de nous permettre le luxe de
louer un véhicule à moteur. « Sachant » le français, c’est-à-dire
celui appris au lycée, j’ai été contraint à la position de Virgile, qui emmène
son ami dans les cercles infernaux du paradis de Paris. La première chose que
j’ai dite au chauffeur, je l’ai dite avec un accent impossible et complètement
faux :
— Mosieu,
voilez notr adresse. Voulon allon sur Saint-Michel.
— Bon !
répondit gentiment le chauffeur, un homme aux yeux sournois sous des lunettes
en métal, aux joues rougies et au nez assez long. À peine installés dans sa
Citroën, il se mit à nous parler avec éloquence, comme si nous étions de
vieilles connaissances et semblions tout comprendre. De sa cascade verbale, des
mots distincts sont venus à mes oreilles : Opéra, Bastille, Concorde. Je
pensais qu’il me demandait si j’avais entendu parler de ces endroits. Pour ne
pas être en reste, j’ai répondu « Woui Mosieu ». Un peu plus tard, il
m’est apparu clairement qu’il m’avait probablement demandé si nous voulions
voir l’Opéra, la Bastille et autres lieux. J’avais déjà entendu des commentaires
flatteurs sur la gentillesse des Parisiens. Je ne pensais pas que cette
gentillesse était tellement immense – dès le premier jour — pouvoir voir
certains des sites les plus intéressants de Paris.
Le taxi nous conduit
place de la Bastille, contourne lentement la colonne de Juillet et s’arrête un
peu à l’écart. Ici le chauffeur, un vrai Cicérone, nous raconte quelque chose
sur la Révolution française, évoqua Robespierre, Danton, la guillotine ;
j’ouvre la bouche, répétant plusieurs fois, à tort, le mot le plus simple
« woui » et je pensais que j’avais défendu l’honneur culturel de la
patrie. Le chauffeur bavard nous emmena sur la place où trônait la statue de la
République, surnomma la statue « la vache », continua sur les grands
boulevards pas encore complètement réveillés, nous montra l’opéra et à côté le
Café de la Paix encore fermé.
Nous entrons dans
l’immense place de la Concorde, rue de Rivoli.
Nous avons vu
l’obélisque égyptien, apporté ici avec beaucoup de difficulté par ordre de
Napoléon de l’ancien Louxor, et avec un effort encore plus grand, érigé au
milieu de la place. Des sans-culottes parisiens ont dansé sur cette place après
l’exécution de Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette. Sur les majestueux
Champs-Elysées extrêmement larges (sur lesquels j’ai cherché en vain les vertes
prairies des romans d’Hugo et de Maupassant), le chauffeur nous a conduits
jusqu’à l’Arc de Triomphe, où brûle un feu éternel en l’honneur du Soldat
Inconnu de la première Guerre mondiale. Après dix minutes d’une balade
tranquille en taxi le long des quais de Seine, notre aimable guide nous déposa
à l’adresse du quartier Saint-Michel.
Les Bulgares que
nous avons rencontrés au café de la rue Saint-Séverin nous ont révélé la ruse
de la coûteuse courtoisie du chauffeur.
— Imaginez que
le chauffeur au lieu de la gare sur le boulevard Botev pour vous emmener
directement sur la place Renaissance (aujourd’hui Vazrajdane) vous fasse passer
devant l’église Sveta Nedelya, devant l’Université, sur le boulevard Patriarche
Evtimiy et près du Monument russe. Votre bénéfice est que vous avez vu le
premier jour ce que certains « tchakali[18] »
n’ont pas vu depuis des années.
Nos compatriotes
nous ont informés que nos connaissances ne venaient au café que le soir, et
certaines seulement le dimanche, car elles habitent en banlieue. Nous devrions
donc les chercher à leur domicile : il serait facile de les trouver. Et
ils nous ont emmenés devant le plan du métro Saint-Michel tout proche. Ils nous
ont expliqué comment naviguer dans le réseau du métro, nous ont montré la
dernière station Porte de Saint-Cloud, après nous devrions prendre le bus
№ 3. Là nous devrions demander au conducteur de nous faire descendre dans
la banlieue de Suresnes, près de l’adresse correspondante...
La rencontre avec nos
connaissances était à la fois agréable et effrayante. J’ai connu Stoyko
Dimitrov en tant que vendeur de journaux, écolier au Premier lycée masculin et
adolescent intelligent, que j’avais rencontré à la Bibliothèque nationale ou
lors de représentations au Théâtre national. Radi Radoulov, mon voisin de rue,
faisait une forte impression avec ses poches pleines de journaux et ses
éternels livres sous le bras. Maintenant, ils étaient tous les deux ouvriers,
l’un meunier, l’autre tourneur, avec des vêtements sales et des mains
rugueuses, abîmées par le travail des machines.
Stoyko allumait
cigarette sur cigarette, et Radi crachait démonstrativement par terre ou par la
fenêtre du café où nous étions. Il était évident qu’ils voulaient montrer à
quel point ils avaient fusionné avec la classe ouvrière française, qui n’était
pas aussi mal habillée ou sale qu’eux. Sans trop de détour, ils nous ont
demandé :
— Et comment ça
va avec l’argent ? Et ils se sont dépêchés d’ajouter : — Nous sommes
trop mauvais pour être vos créanciers.
Nous les avons
rassurés en les informant qu’un ancien secrétaire-percepteur voyageait avec
nous ; il a promis de nous accorder un crédit si nous pouvions l’aider à
se légaliser en tant qu’étranger avec le droit de travailler.
— Nous ne vous
demandons pas d’argent, mais des conseils sur la façon de nous légaliser en
tant que travailleurs, car nous sommes des commerçants, d’après nos passeports,
sans droit de travailler.
— Fallait le
dire, frérots. Des conseils, on vous en donnera autant que vous voulez. Nous
vous en donnerons de la même manière que Crésus n’a pas couvert ses hétairies
d’or, cria le garçon cultivé et le charmant homme Radi.
Ils nous ont
conseillés brièvement, concrètement, pratiquement. Le lendemain matin, nous
devions partir pour une ville industrielle proche de la capitale. Après avoir
travaillé pendant 5 à 6 semaines, nous prendrons les récépissés de la
municipalité locale.
Accompagnés de
Stoyko et Radi, nous sommes rentrés à Paris et installés au café-hôtel
Saint-Séverin. Le soir, nous avons marché le long du célèbre boulevard
Saint-Michel dans le quartier Latin. Le mois d’août n’était pas aussi mort
qu’aujourd’hui. Les vacanciers n’étaient pas des millions et les touristes
étrangers n’inondaient pas les rues et les places de Paris comme des
sauterelles. Stoyko en Parisien expérimenté, nous a incités à ne pas fixer
longtemps les vitrines illuminées et élégamment agencées des magasins de
chaussures et de vêtements, des librairies et des kiosques remplis de journaux
et de magazines pornographiques.
— Cent fois par
an, vous traverserez ce boulevard. On vous promène maintenant pour avoir plus
d’impressions sur la vie nocturne des étudiants et intellectuels parisiens. Il
y a aussi des travailleurs, mais ils sont toujours désireux de se ranger parmi
l’intelligentsia. L’air du quartier est intellectuel. Ici aussi, les
prostituées misent sur l’intellectualisme. Un jour, l’une d’entre elles s’est
vantée de connaître le poète Paul Valéry. Partout on discute. Mais entrons dans
un café « intellectuel ». Son nom est Soufflot. On peut un peu
regarder, écouter et se dépêcher, car demain vous et moi, devons nous lever
tôt.
Dès que nous avons
commandé qui un panaché, qui un diabolo, nous nous sommes préparés à regarder
et à écouter. Qu’a-t-on vu ? Un vieil homme solitaire dans un coin lisait
et feuilletait résolument les pages du journal Le Temps, sans prêter attention à son environnement, ni même à son
verre de bière, qui était sans aucune mousse. À de nombreuses tables, il y
avait des couples. Les plus variés. Naturellement, principalement de jeunes
garçons et filles. À l’une des tables, un rassemblement de sept-huit jeunes
était en désordre, librement adonné à des conversations bruyantes et à des cris
et gestes démonstratifs. Au comptoir, un autre groupe grandissait et diminuait
visiblement, mais se disputait constamment. Stojko et Radi nous transmettaient
des bribes des conversations capturées.
Nous avons quitté le
café et descendu le boulevard Saint-Michel. Nous sommes passés devant la
clôture en pierre et fer du musée Cluny. Notre guide culturel Radi a jugé
nécessaire de nous éclairer :
— Le musée est
consacré principalement au Moyen Âge. Vous y verrez des objets en bois et en
fer de la vie de l’homme du Moyen Âge. Il y a des peintures intéressantes, des
tapisseries, des sculptures. Vous visiterez dans l’une des salles du
rez-de-chaussée un bain minéral datant de l’époque de la colonisation romaine —
IIe, IIIe siècle de notre ère. Mais demandez à voir la ceinture de chasteté,
une invention des chevaliers médiévaux. Ce sont des ceintures en fer avec
lesquelles les hommes attachaient leurs femmes pour qu’elles leur restent
fidèles jusqu’au retour des croisades. Cependant, la légende dit que c’est à ce
moment que les femmes chevaleresques, à leur tour, ont fait une
contre-invention : le passe-partout, une clé pour ouvrir toutes les
serrures...
Le lendemain matin,
nous étions parmi les milliers de Parisiens remplissant la gare du Nord en
route vers la campagne. Dire que ceux qui nous entouraient nous regardaient
comme des moutons à cinq pattes serait exagéré. Les voyageurs français avaient
leurs propres occupations et ne prêtaient aucune attention à de quelconques
étrangers. La plupart d’entre eux étaient concentrés dans la lecture de livres,
certains feuilletaient les journaux du matin, d’autres prenaient leur petit
déjeuner, des femmes se penchaient sur leur tricot, et certains, comme nous,
s’intéressaient au paysage ferroviaire.
Notre odyssée nous
conduisit à l’embouchure d’une usine métallurgique près de la ville du Mans.
— Vous
commencerez à travailler demain. Suivez maintenant M. Étienne. Il vous montrera
où manger et passer la nuit.
Ces dispositions
nous ont été données par un jeune homme d’une trentaine d’années, au visage
rond et rose et à la petite moustache noire. La tenue de travail marron
négligemment boutonnée laissait entrevoir sa cravate rouge vif sur sa chemise
blanche.
M. Étienne nous fit
signe de le suivre. C’était un vieil homme, grand et mince, avec des yeux
bouffis, des joues creuses et des pommettes saillantes. Dans la baraque longue
et basse, il nous donna des instructions qu’il avait apparemment répétées des
centaines de fois.
— Voici quatre
lits pour vous. J’apporterai des draps tout à l’heure. Chacun gardera sa valise
sous clé et sous le lit. Vous recevrez de la nourriture ce soir à la cantine au
fond de la cour. Là, je vous donnerai des gobelets, des cuillères, des
fourchettes. Vous devez vous procurer des couteaux vous-mêmes. Et demain matin,
vous recevrez des tickets pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Vous
pouvez vous installer maintenant. Au revoir.
— Les garçons,
le paradis est devant vous. Réjouissez-vous-en ! Stoyko rompit le silence
gêné, pas tout à fait en plaisantant.
Et nous avons
apprécié le paradis : une cabane, environ 50 lits sur deux rangées ;
les lits des soldats, en fer, les couvertures grises et brunes et pas dans leur
prime jeunesse, à en juger par les raccommodages et les bords en
morceaux ; au milieu une table sale en bois surmontée d’un abat-jour en
papier journal ; sur les murs, des petits miroirs ronds, carrés et
dentelés, des coupures de journaux et de magazines pornographiques, des photos
des célèbres stars de cinéma allemandes Asta Nielsen et Henny Porten ; çà
et là des tabourets en bois et des chaises aux dossiers cassés ;
casquettes, costumes, chemises accrochées à des ficelles et des clous. Quand,
dans 15 ans, je serai jeté pour mourir non pas deux ou trois mois, mais près de
deux ans dans les baraques du camp de concentration disciplinaire du
« Vernet » près de la ville de Pamiers dans le sud de la France, la
caserne de l’usine près du Mans restera dans mes souvenirs comme … un
charme !
La première nuit. La
fatigue émoussait mes perceptions, mais une impression générale ne pouvait
manquer de se dessiner dans mon esprit. C’était une petite Europe, représentée
par ses fils peu éminents, qui ont quitté leurs terres natales à diverses
occasions volontaires et involontaires. Prédominaient les restes de l’armée de
Wrangel, dont le russe n’avait rien perdu de sa sonorité et dont les mots
français sonnaient plus doux que le français lui-même. Il y avait des Hongrois,
des Polonais, des Espagnols, des Italiens. Les visages et le discours des
Balkans m’ont soulagé. J’ai échangé quelques mots avec ces gens qui sont des
nôtres et j’ai réalisé qu’une situation — la misère et la terreur — nous avait
rassemblés sous le toit troué du hangar...
Dès le premier jour,
j’ai été placé dans l’un des secteurs difficiles. Je devais saisir les tôles de
cuivre qui sortaient du laminoir, les porter jusqu’au chariot à dix mètres de
là. Dès que le chariot était suffisamment chargé, je le poussais à plus de 50
mètres jusqu’à la cour et là je le déchargeais et empilais les plaques. Le
travail était simple, mais en volume et en poids assez pénible. Environ cinq
cents feuilles passaient entre mes mains chaque jour, ce qui signifiait
transporter, charger et décharger plus de cinq tonnes de masse de cuivre. En
tant que novice, j’ai porté les 30 à 40 premières feuilles avec mes paumes nues.
Mes mains ont été coupées, surtout la droite. Une ouvrière – nettoyeuse — a eu
pitié à la vue de mes paumes ensanglantées et m’a tendu un chiffon de laine pas
trop propre. Ma douleur a été soulagée, mais pas pour longtemps. Le chiffon
était pourri et bientôt usé. J’ai ressenti ma situation désespérée et l’ai
partagée avec Stoyko, qui travaillait sur une fraiseuse. Nous avons regardé
autour de nous, nous nous sommes promenés, mais nous n’avons pas trouvé de
chiffon approprié. L’ami, prêt à faire un sacrifice, cependant, a résolu le
problème.
— Prends ma
casquette maintenant, pendant la pause-déjeuner on va essayer de trouver
quelque chose de plus adapté.
Un Serbe a trouvé
comment me sauver de sa valise en carton.
— Je vois, mon
garçon, que tu es plus fort dans la tête que dans les mains. Tiens ce morceau
de cuir. Prends-en soin pour me le rendre. Je ne te le donne que pour le
travail, jusqu’à ce que tes mains deviennent des semelles.
Avec l’aide d’amis,
je suis devenu un travailleur à part entière en dix jours. Au bout d’un mois,
un mois et demi, j’ai rendu le cuir au bienfaiteur balkanique ; mes mains
avaient attrapé une croûte comme le genou d’un cordonnier...
Dans les derniers
jours du troisième mois, les documents de rêve acquis réchauffaient nos poches.
Avec eux, nous pouvions trouver du travail partout. Nous rentrâmes bientôt à
Paris.
LA
PREMIÈRE GRÈVE
Avec le peu d’argent
économisé, je me suis mis à profiter de la vie parisienne. Pour moi, ses
charmes étaient cachés dans les théâtres, les musées et les bidonvilles.
Pendant mon temps libre, j’étudiais obstinément le français, je lisais des
livres d’auteurs français et faisais connaissance avec les œuvres des
classiques de la littérature marxiste, librement distribuées en français et en
russe.
La colonie
antifasciste bulgare dépassait le millier de personnes. Grâce aux émigrants de
septembre venus de Yougoslavie, elle menait une vie politique active. Au début,
je participais activement à la partie artistique et littéraire des réunions,
matinées et soirées organisées.
Ayant obtenu un
document de travail régulier, je suis d’abord tombé sur les usines automobiles
Citroën, ou plus précisément les ateliers de la banlieue d’Asnières, où l’on
fabriquait les carrosseries des voitures Citroën d’alors. Mes yeux ne pouvaient
se détacher de cette toute nouvelle usine moderne. L’usine près de la ville du
Mans, qui semblait d’abord être une immense entreprise, m’apparaissait
maintenant petite et vieille avec ses machines sales et poussiéreuses, ses murs
enfumés et son plâtre qui s’écaillait. Ici les ateliers étaient hauts, avec des
verrières et des cloisons intérieures et des murs gris mais propres, avec de
larges plates-formes pour chaque machine bien nettoyée.
L’usine n’était pas
seulement moderne en tant que bâtiment. La soi-disant rationalisation
capitaliste était appliquée de plein fouet. L’ensemble du processus de travail
était effectué à la chaîne. Sur l’un des rubans en caoutchouc, par exemple, des
morceaux de bois rabotés partaient, quelque part au milieu on voyait des
figures, des cloisons, des fenêtres déjà assemblées, et à la fin les derniers
ouvriers assemblaient et fixaient l’ensemble du corps en bois. L’un des
ouvriers les plus qualifiés ici était mon ami Georgi Boulgourov. Le squelette
en bois préparé de la future voiture était transporté à l’atelier du
ferblantier. Là, ils recouvraient la partie en bois avec une tôle épaisse et la
plaçaient sur une crémaillère à dents. Chaque dent poussait une carrosserie.
Disposés des deux côtés, les ouvriers essuyaient la rouille de la tôle avec un
papier de verre avant que la carrosserie ne soit emmenée à l’atelier de
peinture. L’un des deux travailleurs de cette chaîne, c’était moi. En général,
je réussissais à faire face à la tâche qui m’était assignée, mais souvent,
lorsque les tôles étaient très rouillées, je continuais à frotter même après
que la carrosserie ait quitté la chaîne. Mon patron me grondait dans son
français dont je ne comprenais pas les trois quarts ; je m’excusais dans
mon français qu’il ne comprenait pas du tout.
Un jour, le chef
Deluque, un ancien sergent aux mâchoires saillantes, m’a traité de « fou
endormi » et m’a transféré à un travail « plus
intelligent » : visser les vis sur les portes et le pare-brise de la
voiture. Et ici aussi il y avait une voie ferrée et une crémaillère à dents qui
poussait les carrosseries déjà peintes. Leur mouvement était également très
précisément calculé pour visser une dizaine de vis. Ils m’ont mis une visseuse
dans les mains, m’ont expliqué comment travailler avec, combien et où je devais
tourner les vis et m’ont averti que j’avais cinq minutes pour toute
l’opération. Les premiers jours, je pouvais à peine tout visser. Au bout d’un
moment, j’arrivais à finir même en moins de cinq minutes. Un matin, Deluque m’a
félicité d’avoir avancé sur ce tronçon et il m’a informé que désormais la
chaîne ferait son cycle en quatre minutes au lieu de cinq. Sous sa supervision
directe, l’expérience s’est avérée être... au mieux de mes forces et de mes
capacités. Le chef sourit presque joyeusement et courut signaler à sa direction
le taux réduit grâce à son initiative. Plusieurs jours passèrent. Nouvelle
surprise. Deluque était maintenant accompagné de trois autres cadres, dont un
grand personnage au visage rougeâtre, une moustache noire coupée et les
sourcils épais de l’ingénieur en chef Monge. Le groupe m’a demandé de lui
montrer comment je travaillais. L’ingénieur en chef me regardait, commentait
quelque chose de temps en temps et regardait sa montre. Après la première
carrosserie, ils m’ont invité à besogner plus prestement et ont de nouveau
commenté, et regardé à nouveau leurs montres. J’ai continué à exécuter les
gestes appris et j’ai essayé de faire mes preuves en tant que bon travailleur.
J’étais censé avoir de l’esprit et, dans ce cas, il ne m’est jamais venu à
l’esprit que ces messieurs n’avaient pas l’intention d’admirer ma dextérité,
mais avaient l’intention de changer la norme. L’ingénieur en chef m’arracha la
visseuse des mains, mit quelques vis dans la poche avant de son tablier blanc
et se mit à travailler. Ses collègues surveillaient leurs montres tout le
temps. M. Monge termina une, deux, trois carrosseries, avant que le groupe ne
quitte le bureau, Deluque ordonna : « Vite, vite, arrête de
regarder ! » M. Monge avait effectué la première opération en 3
minutes et 10 secondes, la seconde en 3 minutes et la troisième en 2 minutes et
40 secondes.
Le lendemain matin,
MM. Deluque et Monge étaient sur mon lieu de travail à 7 h 30. Je me suis
dit : « Ils sont venus me virer. » Reposé de la nuit, je
travaillais fébrilement. Après la deuxième carrosserie, ils ont arrêté la
chaîne pour clarifier quelque chose dont ils discutaient. J’ai entendu M. Monge
commander :
— Trois minutes
et 15 secondes, c’est suffisant ! Faites avancer la chaîne à ce
rythme !
En privé avec mon
patron, j’ai essayé de m’opposer :
— C’est facile
pour M. Monge, il visse une ou deux voitures et il s’en va. S’il fait cela
pendant des jours entiers, il voudra lui aussi que la chaîne avance plus
lentement.
— Ce n’est pas
à moi, mais à lui que tu devais le dire. Et toi, travaille plus dur, sinon tu
peux perdre ton poste.
J’ai atteint la
nouvelle norme à la fin de la deuxième journée. Pourtant, je n’ai pas gardé ma
place. Le capitalisme était entré dans la soi-disant stabilisation temporaire
et partielle. Les luttes sociales du prolétariat européen avaient perdu
l’ampleur et l’intensité des années d’après-guerre. La direction du Parti
communiste français essayait quand même d’enflammer la lutte des classes entre
le travail et le capital.
Le 1er août a été
déclaré Journée internationale contre la guerre. Le Parti communiste a appelé
les travailleurs à faire une grève générale d’une journée pour protester contre
la nouvelle guerre impérialiste en préparation. Pour moi, c’était une question
d’éthique, je ne pouvais pas m’empêcher d’être solidaire des travailleurs
français.
Familier de la
situation en France, Stoyko me l’a décrite en détail.
— Le Parti
Communiste dans les usines Citroën et Renault a des sections bien installées.
Les ateliers d’Asnières emploient
plus de 1 200 personnes. Probablement pas moins de 200 à 300 travailleurs
répondront à l’appel à la grève. La majorité sera française. Quel sera le sort
des grévistes ? Le lendemain, 10 à 20 Français seront licenciés en tant
que meneurs. Tous les grévistes étrangers seront licenciés sans condition. La
police et les patrons sont impitoyables envers nous. Tu peux te préparer à
ranger tes vêtements de travail. Tu recevras ton salaire. Sur ce point ils sont
corrects. Mais en même temps, ils informeront correctement la police de ton nom
complet et de ton adresse. À partir de ce jour tu seras marqué pour toujours.
Tu n’as pas encore reçu ta pièce d’identité, n’est-ce pas ? Tu ne la
recevras plus jamais. Tu feras avec le récépissé que tu as, jusqu’au jour où on
te le retirera et tu seras expulsé de France comme non fiable.
— Il
est clair pour moi que je vais faire la grève. Mais je ne sais pas si d’autres
ont pris la même décision. Les camarades de la place des Fêtes ont promis de me
mettre en contact avec un communiste, mais j’attends toujours.
— Il y en a
certainement d’autres. Chez Citroën, le parti et la CGT (Confédération Générale
du Travail) sont forts. Mais pas assez pour protéger les étrangers. Je dis, tu
seras renvoyé. Réfléchis bien.
Je l’avais déjà
fait. Avec l’argent économisé, je pourrais survivre pendant 2-3 mois. D’ici là,
je trouverais un nouveau travail, sinon à Paris, à la campagne.
Pendant la journée
de grève, je suis resté à la maison, j’ai lu l’Humanité et j’ai étudié le français. Le soir je m’arrêtais au café
Saint-Séverin. Mes camarades me considéraient déjà comme chômeur. Beaucoup
m’ont rassuré.
— Que
ton dos soit fort et tes mains fermes. Et maintenant tu peux nous offrir un
verre à la gloire de la grève qui, selon le journal Journal, était invisible.
À cette occasion,
Stoyko, celui qui sait tout, raconta comment les conducteurs de bus et de
tramway parisiens se sont mis en grève un jour. Le directeur des transports
publics de Paris fit une déclaration aux journalistes et qualifia la grève
d’invisible. Dès l’après-midi, les grévistes louèrent un corbillard et
formèrent une procession derrière lui. Les piétons sur les trottoirs virent
qu’il n’y avait pas de mort dans le corbillard et demandèrent avec stupéfaction :
— Qui est
mort ?
Les grévistes
endeuillés répondirent :
— Le directeur
des transports publics.
— Mais où est
le mort ?
— Il est
invisible !
L’esprit parisien
atteignit son but. Le lendemain, tous les journaux publièrent des photos du
cortège funèbre avec le corbillard vide, et la France apprenait les
revendications des grévistes.
— La première
chose que tu découvriras demain matin, c’est l’absence de ta carte, m’a prévenu
Stoyko. Ne t’embête pas à demander où elle est, qui l’a emmenée, etc. Va
directement à l’administration. Ils y ont déjà préparé ton salaire et ton
certificat de licenciement.
Stoyko se trompait.
Le lendemain matin, la carte № 725 était en place. Je me tenais devant le
tableau et je ne savais pas quoi faire.
Le portier s’est
approché de moi et m’a demandé :
— Ta carte est
là ?
— Oui, ici.
— Alors
pourquoi traînes-tu ? Tu n’es pas malade, tu ne veux pas de congés ?
— Non, je ne le
suis pas.
— Alors
pointe-la et dépêche-toi, qu’ils ne voient pas que tu es en retard.
Comme dans un rêve,
je traversai le vestiaire, enfilai mes vêtements de travail et me dirigeai vers
l’atelier de peinture. Le chef Deluque expliquait à un nouvel ouvrier algérien
comment manier la visseuse et travaillait lui-même sur une autre carrosserie.
J’avais décidé
d’être ferme, mais j’ai dit d’une manière très douce :
— Bonne
journée.
Deluque répondit
d’un ton simple et me demanda sévèrement :
— Pourquoi
es-tu en retard ?
— Eh bien, je
ne m’en soucie plus.
— Comment se
fait-il que tu ne sois pas malade ? Pourquoi n’étais-tu pas là hier ?
— J’ai fait
grève hier.
— Comment,
qu’est-ce que tu as fait ? Tu n’as pas été malade ?
— Je n’étais
pas malade. Hier, j’ai fait grève.
— Comment, tu
as fait grève et tu n’étais pas malade ?! Non, non, tu étais et tu es
encore bien malade, mon Dieu.
— Vous ne
comprenez pas quand je vous dis, hier, j’ai fait grève.
Deluque tourna autour
de moi, me regarda comme une créature tombée de Mars, se frappa le front,
frappa ses mains sur ses cuisses, répéta :
— Il était en
grève ! Et il s’est mis à crier à ses collègues chefs d’équipe :
Pierre, Jean, Gaston ! Venez, venez voir un original, un idiot malade, un
imbécile, complètement fou... Venez, dépêchez-vous !
Ses collègues
m’entourèrent bientôt. D’un ton de supériorité intellectuelle, l’ancien sergent
se tourna vers moi.
— Dis-leur
pourquoi tu ne t’es pas présenté au travail hier.
Devant l’aréopage de
patrons réunis, j’ai répété la vérité. Mon compte était simple. Dans tous les
cas ils vont me renvoyer, au moins que la vraie raison soit connue. Un jour
quelqu’un approuvera et suivra mon exemple...
Un des patrons
m’attaqua assez grossièrement :
— Sale
étranger, si tu es mécontent, pourquoi es-tu venu manger notre bifteck ?
— Je proteste
contre la préparation d’une nouvelle guerre impérialiste, pas contre ma
situation économique.
— Après tout,
le garçon est libre d’avoir une opinion, déclara un autre des patrons. Il est
naïf, mais plus honnête que mon Bécaud, qui a déjà obtenu un certificat
médical. Et il se tourna vers l’Algérien : — Va à la ferblanterie et
appelle Jean Bécaud.
Bécaud était un
Français petit et trapu, plein de santé.
Son patron se tourna
vers lui avec défi.
— Jean, tu es
communiste, n’est-ce pas ?
— Je suis
membre de la CGT.
— Alors j’ai le
droit de dire que tu es communiste ?
— Tous les
types de travailleurs sont membres de la CGT.
— Pourquoi
n’es-tu pas venu travailler hier ?
— J’ai eu une
migraine. J’avais mal au ventre.
Le patron me pointa
du doigt et dit :
— Regarde-le,
étranger, il est plus honnête que toi. Il avoue qu’il s’est mis en grève hier.
— C’est son
travail. J’étais malade. Je vous ai présenté un certificat médical.
Deluque est
intervenu dans la conversation :
— Peut-être
délivré par un médecin communiste ?
— Je ne connais
pas ses convictions politiques.
— Assez
discuté. Bécaud, aie honte d’être français.
— Je suis
blessé au front et ma poitrine est ornée d’une croix de bravoure. Et je connais
beaucoup de sergents qui ne peuvent pas dire ça d’eux-mêmes.
Deluque a révélé
qu’il était affecté :
— Tu en sais
beaucoup, mais je prendrai soin de toi. Et maintenant au travail !
Et j’ai repris la
visseuse. Et pas seulement pour ce jour, mais pour de nombreux jours et de
nombreuses semaines. Je n’ai pas été viré. Que signifiait ce geste ?
Stoyko s’est-il trompé dans sa prédiction catégorique ? Était-ce une
preuve de la démocratie française ? La vérité s’est vite imposée. Plus de 700
personnes s’étaient mises en grève dans les usines Citroën de la banlieue de
Saint-Ouen. Là, 23 Français ont été licenciés comme instigateurs et
organisateurs. Une dizaine d’étrangers solidaires avec leurs frères français
ont été licenciés sans ménagement. La direction de l’usine d’Asnières n’a pas
eu besoin de montrer les dents : sur 1 200 personnes, seuls deux ouvriers
avaient fait grève, dont un étranger, c’est-à-dire qu’il n’y avait pas de
danger sérieux et imminent de lutte ouvrière. La direction pouvait se permettre
d’être... démocratique.
Le deuxième jour,
Jean Bécaud m’a chuchoté devant l’évier qu’il m’attendrait au café Au Nid
d’Hirondelles tout proche. J’appris qu’il était le seul communiste organisé de
l’usine : il y avait plusieurs membres de la CGT ; il avait entendu
parler de moi, mais on avait tardé à lui dire mon nom.
— Le combat
nous a révélés. C’est la meilleure façon de se rencontrer, m’a-t-il dit.
Le vieil ouvrier
français a fait une critique sérieuse de mon geste individuel. Il n’y avait pas
besoin de faire grève, ce qui m’a trahi. Il était absent, mais avait fourni un
alibi en avance.
— Le parti
m’oblige à rester à l’usine le plus longtemps possible. Maintenant que nous
sommes deux, nous allons nous répartir les tâches.
J’ai appris plus
tard (pas de lui) que Jean Bécaud était dans la même compagnie où Henri
Barbusse a servi au front et dont les personnages sont décrits dans le roman L’Incendie.
DANS
LES TENAILLES DU CHÔMAGE ET DE LA XÉNOPHOBIE
Dans la seconde
moitié de 1926, le chômage en France est survenu presque soudainement. Il a
rapidement gagné en masse. J’ai été l’un des premiers ouvriers à être licencié
des ateliers Citroën d’Asnières. Le chef Deluque m’a donné l’avertissement
légal à sa manière :
— Mon cher,
dans 15 jours tu pourras faire la grève autant que ton âme le désire.
Adieu !
Pour ne pas être
redevable, je lui ai dit :
— Au revoir, M.
Deluque, dans les rangs des chômeurs.
Les patrons,
responsables du chômage, manœuvraient habilement. Une campagne de masse contre
les étrangers en situation irrégulière commença dans la presse. C’était la
première fois que je l’entendais et j’allais me souvenir du mot
« xénophobie ». Des écrivains, des personnages publics et des
journalistes éminents ne se sont pas gênés pour poser et répondre publiquement
à la question « Pourquoi suis-je xénophobe ? » La voix du
journal l’Humanité était trop faible
à l’époque pour étouffer la campagne xénophobe qui faisait rage. Pendant tout
ce temps, les étrangers étaient présentés à l’opinion publique comme des intrus
grossiers et indésirables. Pas une seule fois un seul des théoriciens de
« l’Humanisme » avec une majuscule n’a réussi à admettre que les
étrangers sont des gens qui, par leur travail honnête, créent des biens publics
pour la France. Dans cette situation, le Français moyen a succombé à la
campagne xénophobe. Il y a eu des cas d’insultes, de bagarres individuelles,
voire de lynchage. Nous, les Bulgares, étions dans une situation
particulièrement défavorable : la Bulgarie de Ferdinand n’avait-elle pas
combattu la France ? Nous n’osions pas parler à haute voix dans notre
langue maternelle en présence de Français inconnus. À chaque pas nous voyions
s’afficher le mépris des gens.
Il y avait
évidemment des Français dont le sens de l’humanité ne pouvait être émoussé par
des vagues de xénophobie. À l’honneur du peuple français, il y avait des fils
de France qui nous comprenaient. Ces Français sobres pour nous étaient les
propriétaires du café Aux lys, près de la place des Fêtes.
Le mérite de ces
deux Français, Monsieur Pierre et Madame Antoinette, était vraiment grand. Ils
ont ouvert un crédit à durée indéterminée à un groupe de Bulgares pour
consommer du café au lait et des croissants. Parfois, le crédit s’étendait aux
sandwichs au beurre et aux œufs durs. La plus grande qualité de ces généreux
français était leur extraordinaire tolérance. Ils nous permettaient une fois
par semaine de savourer avec des cuillères dans un énorme pot en argile des
haricots bouillis mélangés avec de l’huile et des oignons. Quand nous mangions,
nous étions dignes d’une photo. Avec une certaine retenue, tout le monde se
dépêchait d’avaler autant de haricots sauveurs que possible. De temps en temps,
quelqu’un plaisantait : « Maintenant, je voudrais bien vous entendre
discuter, hein ! » Quelles discussions ! Nous avalions tous
silencieusement les haricots et le pain. Personne n’était sûr que le festin se
répèterait bientôt ?!
Les mangeurs étaient
généralement des hommes forts et en bonne santé. Parmi eux, les habitués
étaient Ivan Mitsiev, connu à Paris sous le pseudonyme de Naiden, Kolyo
Guénchev, Stoyko, Bolsheto, Toushé Chopov et moi-même.
Nous nous sommes
sentis libres dans le café de M. Pierre. Sans crainte nous avons fait du bruit
dans notre langue natale et sans hésitation nous avons utilisé les fameuses
courtoisies bulgares. Comme les hachove[19]
de Botev, nous montrions nos crocs aux tyrans fascistes et, contrairement aux
misérables de Bucarest, nous ne buvions que des liquides innocents. Une fois, à
ma grande surprise, j’ai trouvé Toushé Chopov, neveu de Gotsé Deltchev, assis à
une table buvant un anis français au goût similaire à notre mastika. Toushé
était, comme on dit, un bel homme : élancé, grand, avec un front lisse et
droit, des joues roses fraîches, un nez fin et des lèvres rouges juteuses. Il
avait perdu plus de vingt kilos en deux ou trois mois, et la beauté spirituelle
de son visage ressortait. Il fixait son regard maintenant sur le verre à moitié
vide devant lui. Cette vue m’a intrigué, car c’était pendant la période de
famine et une heure incertaine du matin. Les beaux yeux noirs de Toushé
s’étaient rétrécis et rougis. On aurait dit qu’il n’avait pas cligné des yeux
de toute la nuit ou qu’il étouffait une colère grandissante.
— Bore,
assieds-toi. Tu es mon ami, je veux que tu boives avec moi.
— En aucun cas.
Je n’ai pas mangé une miette de pain depuis deux jours.
— Qu’est-ce que
la vie, notre vie ? Nous ne devons pas nous y accrocher. Tu vas maintenant
boire pour moi et de moi. Je paie.
— Eh bien,
puisque tu as gagné de l’argent, je commande un café crème et un croissant.
— Je n’ai pas
déjeuné et tu ne mangeras pas, tu boiras !
— Et bien
Toushé, comprends que mes jambes tremblent sans avoir bu.
— Je tremble
aussi, tout entier, mais je bois. Et tu vas boire ou tu n’es pas mon ami et tu
devras disparaître, pour que mes yeux ne te voient pas.
Je n’ai pas accepté
de boire. Je demandai tranquillement à madame Antoinette, qui était assise
derrière le comptoir comme une reine, tricotant un boléro jaune :
— Qu’est-ce qui
ne va pas avec notre ami ?
— Je ne sais
pas. Il est là depuis sept heures. Il commande constamment de l’anis. Naiden le
noir nous a demandé de lui en donner autant qu’il voulait et il est allé
demander de l’argent à vos compatriotes.
En vain, j’ai fait
le tour de plusieurs connaissances du café Saint-Séverin. Triste spectacle
partout : camarades épuisés, pâles, ouvrant la bouche avec
parcimonie ! À 4 heures de l’après-midi, je me suis de nouveau arrêté Aux
lys. Toushé était au même endroit. Trois colonnes d’assiettes étaient empilées
sur la table devant lui. (En France à cette époque, chaque assiette avait le
prix de la boisson servie. Tant que le client n’avait pas réglé sa facture, les
assiettes n’étaient pas retirées.) Courbé, la tête baissée, il se cachait derrière
les assiettes élevées comme derrière une barricade. À côté de lui, Naiden
l’exhortait :
— Viens avec
moi à l’hôtel. Tu boiras encore demain.
En réponse, Toushé
ordonnait :
— Je vais faire
pleurer leur mère. J’effacerai et leurs femmes et leurs enfants. Les
bourreaux... mes bourreaux... donnez-les-moi... Quel genre d’amis êtes-vous si
vous ne me laissez pas retourner en Bulgarie ?
— Très bien,
nous allons les massacrer ensemble. Maintenant, lève-toi, demain tu voudras
qu’on te laisse à nouveau entrer au café.
M’ayant vu, Toushé
me pointa de la main :
— Est-ce que tu
le vois ? Et lui aussi m’a laissé. Il a refusé de boire avec moi. Donc, je
suis une ordure, et lui c’est l’intelligence. Et que sait ce moineau ?
Rien. Des mots. Je l’ai aimé. Dites-lui de disparaître, que lui aussi je...
— Tu as tort,
tu disais « garçon sheker[20] »,
mais il va s’en aller. On s’en va tous. Allez debout !
Tard dans la soirée,
alors que Toushé ronflait déjà à l’hôtel, Naiden m’expliqua. Toute la nuit
précédente, Toushé avait marché comme une bête en cage et fumé comme une
cheminée. Il y a des années, la même nuit, les bourreaux du Haut-Juma ont tué
son frère et l’ont torturé à mort : lui brûlant les paumes et les pieds,
lui arrachant les ongles, lui pressant les testicules, le suspendant la tête en
bas, lui coupant les tibias. À l’aube, Toushé dit à Naiden :
— Je vais au
café. C’est mon jour. Le jour de délivrance, de souffrance et de vengeance.
Toi, va chercher de l’argent, pour me racheter à M. Pierre...
Les rassemblements
antifascistes au club communiste de la Bellevilloise, rue Boyer, étaient un
lieu de rencontre commode entre les chômeurs et les chanceux qui n’avaient pas
encore été licenciés. Je me souviens d’une telle réunion très fréquentée sur la
lutte du peuple chinois contre le Kuomintang. Le rapporteur était le
métallurgiste Pavel de Pleven, ayant participé au soulèvement de septembre,
venu de Moscou. Il avait illustré l’information en dessinant une carte de la
Chine en vert, bleu et rouge, montrant le mouvement des troupes
révolutionnaires et l’emplacement des forces ennemies.
La réunion s’était
terminée tard dans la soirée. Le président, le professeur de lycée Boris Velev,
avait appelé les personnes présentes occupant des logements, à accepter les
sans-abri. Quatre ou cinq personnes avaient offert leurs services. Seul Anguio,
un cheminot, un bel homme, choriste du Chœur de Lozen du parti à Sofia, était
resté non logé. Velev s’était tourné vers moi personnellement. Ma réponse avait
provoqué des rires et de l’incrédulité.
— Cinq Bulgares
et deux Serbes doivent venir dans notre chambre ce soir. Et nous deux avec
Bolsheto, cela fait en tout dix personnes.
Ils ont
insinué : « C’est exagéré ! Dis que tu ne l’acceptes
pas ! »
J’étais ambitieux et
j’ai dit : « Qu’il vienne avec moi à condition qu’il dise à la
prochaine réunion combien nous étions dans la chambre. »
Lorsque nous sommes
entrés dans l’hôtel Compans de la rue Belleville, j’ai dit mon nom à haute voix
et j’ai marché d’un pas fort pour couvrir Anguio, qui a enlevé ses chaussures
et, s’accroupissant, est monté au rythme de mes pas.
La chambre était au
deuxième étage. J’ai frappé légèrement une fois, deux fois. Personne ne s’est
levé pour ouvrir. J’ai crié doucement :
— Bolshé, c’est
moi.
La voix de quelqu’un
cria :
— Maintenant.
Des voix et des
déplacements de chaises pouvaient être entendus à l’intérieur. J’ai poussé,
mais la porte résistait. À son tour, Anguio a appuyé et nous avons réussi à
passer l’écart de justesse. Anguio a commencé à compter les
« pièces ». Sans nous, il y avait 11 personnes. L’âme sentimentale
d’Anguio s’était adoucie, il s’était excusé d’avoir douté de mes paroles et
était prêt à quitter le « paradis des chômeurs » ... Plusieurs
personnes lui ont murmuré, à moitié éveillées, qu’il « trouve une place
sous la table et qu’il se taise ». C’était le seul espace libre, à
condition que ceux qui se pressaient par terre plient les jambes. Sur la table
s’étaient « arrangées » deux personnes – appuyées au mur et les pieds
en l’air. Deux autres remplissaient mon armoire à double battant, pliées comme
des cocons. En tant que propriétaire, ils m’ont fait place sur le lit double,
où quatre personnes, couchées en travers, étaient entassées comme des anchois.
Les autres étaient entassés sous le lit. Naiden, une autre âme sensible,
s’excusait d’avoir fait venir quelques frères serbes de plus, imprévus, parce
que quelqu’un leur avait menti et qu’ils allaient rester dans la rue. Et
amusant, comme il était, il lâcha :
— Prolétaires
de tous bords, unissez-vous et... ne ronflez pas. Bon, bonsoir.
Les
« pièces » trouvaient toujours un moyen de rire.
Le chômage depuis
plusieurs mois nous suçait comme une énorme sangsue. Nos nez et nos oreilles
s’amincissaient jusqu’à la transparence. Nous ressemblions à des fantômes
lents. On ne trouvait pas toujours des sous pour un ticket de métro, alors on
traversait souvent Paris d’un bout à l’autre. La marche avait son bon
côté : nous avons appris à connaître la vaste capitale française mieux que
beaucoup de Parisiens...
Notre groupe se réunissait
régulièrement tous les jours, que ce soit le matin ou le soir. Nous échangions
des expériences, c’est-à-dire que nous réfléchissions aux moyens d’obtenir de
l’argent. Nous répartissions nos rôles. De temps en temps, certains se
rendaient à la gare de l’Est ou du Nord pour nettoyer et laver les wagons,
d’autres pour faire la vaisselle dans les grands restaurants. Les uns et les
autres partageaient avec les autres camarades les récompenses qu’ils
recevaient. Une fois ma tournée avait été particulièrement fructueuse. J’ai
apporté 15 francs pour la « commune ». L’étudiant Stoyné Stoyanov,
fils de grands propriétaires terriens, me les a prêtés. Sur la suggestion de
Toushé et de Naiden, la « caisse » n’a accepté que 10 francs et a mis
le reste à ma disposition.
Je n’étais pas allé
au restaurant depuis des mois. J’en cherchais un où je n’étais jamais allé et
où je ne remettrais plus jamais les pieds. Bien sûr, certainement à « Prix
fixe ». Dans ces restaurants, le pain était servi dans des paniers et était,
pour ainsi dire, gratuit. Le client pouvait en engloutir autant qu’il le
voulait. J’avais décidé d’arriver tôt et de rester jusqu’à ce que j’éclate à
force de manger. Je m’arrêtai dans un restaurant de la rue du Temple. Ma
première commande était une soupe de pommes de terre. Au moment où ils l’ont
apportée, la moitié des morceaux de pain français blanc et croustillant avait
disparu du panier. Avant que je finisse la soupe, seules des miettes étaient
visibles au fond du panier. Imperturbable (j’avais baissé le rideau devant mes
yeux ce soir), je commandais : « S’il vous plaît ». La serveuse,
une brune courte et trapue avec de grandes boucles d’oreilles rondes dorées,
revint bientôt avec un panier plein. Avec le pâté, j’ai mangé les trois quarts
du pain du deuxième panier. Lorsque la gentille serveuse m’a apporté un steak
frites, elle a elle-même remplacé le deuxième panier vide par un troisième, pas
tout à fait plein. Nos regards se sont croisés. Un léger sourire traversa ses
lèvres peintes.
Aucun des rares
clients ne remarquait comment j’étais en train de détruire les miches. Les gens
étaient occupés avec leur dîner ou parlaient comme de vieilles connaissances.
Pendant tout ce temps, un seul Français était assis à ma table. Heureusement,
il était pressé, puisqu’il a regardé sa montre à gousset deux ou trois fois. Le
monsieur m’a ignoré, mais il était mon ennemi, consommant le pain de
« mon » panier.
Peu de temps après,
« l’ennemi » a appelé la serveuse pour payer son addition. J’en ai
profité et, à voix basse, je lui ai demandé encore un peu de pain. Je voulais
lui dire de ne pas me regarder avec étonnement et que je paierais bientôt. J’ai
mangé le quatrième panier de pain avec le dessert — confiture d’abricot. La
serveuse était appuyée contre l’une des deux colonnes au milieu du restaurant,
regardant de côté ma table. Ses collègues se sont approchés d’elle, lui ont
chuchoté quelque chose et sont éloignés.
L’horloge murale
indiquait 20 heures. Cela faisait près de deux heures que j’étais entré dans le
restaurant. J’ai crié comme d’habitude, « Mademoiselle, l’addition, s’il
vous plaît. » La brune s’est tournée vers moi avec le sourire le plus
gentil. « Une minute, s’il vous plaît », puis elle s’éloigna vers le
comptoir où se tenaient le propriétaire et deux ou trois serveuses. Au bout
d’un moment, déjà avec un visage sérieux, elle se tenait devant moi avec
l’addition prête. Non par gratitude pour le pain mangé, mais pour sauver
l’honneur des étrangers dans la gêne, je donnais plus de 25 % de pourboire au
lieu des 10 % de pourboire acceptés. Je me dirigeais lentement vers la sortie.
Là, devant le comptoir et à côté de la porte, le patron, sa dame, quatre ou
cinq serveurs et serveuses, deux ou trois cuisiniers et cuisinières avec leurs
tabliers blancs et leurs grands chapeaux blancs, se tenaient alignés. Certains
se retenaient à peine d’éclater de rire, d’autres m’examinaient de la tête aux
pieds. J’étais mort de honte. Au dernier moment, il m’est venu à l’esprit de
plaisanter un peu avec le propriétaire. Je l’ai regardé droit dans les yeux et
lui ai dit avec une courtoisie polie l’habituel « au revoir »
français. Il sursauta comme piqué : « Ah, non ! » Le
patron, frappé à la bourse, avait complètement perdu le sens de l’humour des
Français. Mais la brune a répondu : « Avec plaisir, monsieur. »
Ce n’est que sur le pas de la porte que j’ai entendu une voix masculine
derrière moi demander : « Vous n’êtes pas Français, n’est-ce
pas ? » Toute réponse était superflue. Ma physionomie et mon exploit
portaient une seule empreinte : des Balkans !
NOUVEAU
MÉTIER, NOUVELLE GRÈVE
Le chômage des
étrangers était généralisé. Mais les étrangers ne croisaient pas les bras pour
mourir. Ils cherchaient des voies et des moyens pour sortir de cette situation
difficile. Et ce qui suit s’est produit : la crise continuait, mais
maintenant certains d’entre eux, bien sûr, une petite partie, ont trouvé du
travail.
Les paysans croates
avaient introduit l’exécution de chaussures d’été modernes à base de sandales
tressées en cuir, avec lesquelles ils dansaient le horo[21]
sur les places du village. L’un d’eux, plus entreprenant que ses compatriotes,
appelé Karan, rassemblait des ouvriers, principalement des Slaves des Balkans.
Il travaillait pour l’exportation aux États-Unis. Le prix de ces chaussures à
la mode était au-delà de la puissance du marché parisien, fragilisé par la
crise financière. Plus de 50 à 60 émigrants yougoslaves et bulgares
travaillaient déjà dans l’atelier de Karan. Parmi nos compatriotes se trouvait
Pando Tipov, un grand camarade avec une âme bienveillante et un dévouement sans
bornes à la cause[22]. Je
n’ai pas pu accéder à l’atelier de Karan. J’ai continué à chercher du travail
ailleurs. Mon ami Joro et moi sommes allés apprendre le nouveau métier — le
tressage de chaussures dans l’atelier d’un autre paysan entreprenant de Bosnie,
Mirko. Trois de nos connaissances travaillaient déjà dans son atelier de la rue
de la Présentation : deux étudiants et un jeune homme des villages de
Breznik. Mirko ne nous a pas acceptés comme ouvriers, mais a seulement admis
que Doicho, l’étudiant en médecine, nous montre comment fabriquer des
chaussures tressées.
On est allé, on a
vu... mais on n’a pas gagné. Pendant plus de deux heures, nous avons contemplé
les doigts habiles de Doicho, pendant plus de deux heures, il nous a montré de
bonne foi comment préparer les sangles, comment les percer, comment utiliser le
couteau pour affiner les bords des semelles, etc. Pendant ce temps, il a tressé
une chaussure entière et une seconde pour moitié. Le propriétaire arrêta le
spectacle, car pendant ce temps-là, l’abeille mellifère devait lui fabriquer
complètement deux chaussures. Nous avons remercié le patron pour l’hospitalité
et avec les nouvelles « connaissances », nous avons décidé de nous
présenter en tant que tresseurs de chaussures. Nous avons descendu la rue
Faubourg du Temple jusqu’à la place de La Grizette de 1830. Nous avons tourné à
droite sur le quai de Jemmapes et avons atteint le № 80. Nous avons
pénétré dans une longue entrée couverte et nous nous sommes retrouvés dans une
cour industrielle carrée. Au rez-de-chaussée se trouvaient un atelier de
fabrication de meubles, une fabrique de cartons, un atelier de tournage
mécanique. Nous sommes montés au premier étage, nous avons sonné à la porte
avec l’inscription « Atelier pour chaussures tressées — Anatoly
Goretsky ». Une jeune femme blonde à l’accent russe nous a invités à
patienter dans un vestibule recouvert à la hâte en contreplaqué. Bientôt, un
homme de taille moyenne est apparu devant nous avec des sourcils fermés
extrêmement touffus et des lèvres rouges épaisses. Nous avons facilement deviné
sa nationalité et nous ne nous sommes pas trompés — arménien. M. Astardjian,
responsable de l’atelier, nous a posé trois questions : de quelle
nationalité sommes-nous, avons-nous travaillé des chaussures tressées et depuis
combien de temps ? Nous avons répondu aux trois questions par trois
mensonges : nous sommes croates, nous avons travaillé et même depuis que
nous sommes petits. Nous avons dû être de mauvais menteurs, car le patron a
souri sournoisement et nous a dit d’entrer.
L’atelier était un
long couloir rectangulaire. D’un côté, sur la cour, de larges fenêtres. À
l’intérieur, plus de vingt ou trente personnes, pour la plupart des femmes.
Tout le monde était assis devant de petites tables basses — banco. Sur les
tables se trouvaient des semelles en cuir humides, des poinçons, des sangles,
des moules sur les côtés et sous les tables, des semelles liées et des
chaussures tressées prêtes à l’emploi. Personne ne nous a salués, mais nous non
plus, nous n’avons pas ouvert la bouche. Je n’ai pas senti quand et comment M.
Astardjian nous avait trouvé une table banco, comment Joro et moi nous étions
installés l’un contre l’autre avec des semelles mouillées et des poinçons
courbés dans nos mains. Je sais que j’ai répondu à toutes les questions du
patron par l’invariable « oui », mais ce qu’il m’a demandé, ce qu’il
m’a expliqué et ordonné, tout a disparu de ma tête quand je me suis vu seul
avec mon ami face à moi. J’ai à peine chuchoté, « Où allons-nous
maintenant ? »
— Courage,
camarade. Si nous allons nous noyer, que cela soit dans des profondeurs !
En seulement 15
minutes, j’ai réalisé comment une personne en bonne santé peut avoir de la
fièvre. J’avais tellement peur de la honte que je brûlais dans le feu. La
semelle en cuir mouillée que j’essayais de lier séchait déjà deux fois entre
mes mains. J’aurais dû la finir en un quart d’heure, et je n’avais même pas
encore lié le talon, même incorrectement, même mal. Nous tentions de montrer
l’un à l’autre sans succès. Le patron est venu vers nous, a demandé à voir le
travail et sans aucun rapport nous a demandé si nous étions étudiants.
Nous nous sommes
regardés un instant et avons encore menti : « Oui, monsieur. »
Astardjian sourit légèrement, non plus sournoisement, mais avec une certaine
bonhomie : « Restez calmes, vous avez le temps. »
Heureusement qu’il
ne restait pas beaucoup de temps. Douze heures approchaient et c’était samedi.
Nous avons continué jusqu’à midi — moi sans finir la première et unique
semelle, et Joro s’apprêtait à entamer la seconde. Quand certaines des femmes
quittaient l’atelier, elles jetaient un regard arrogant sur notre travail.
D’autres — avec sympathie. Nous sommes restés les derniers. Astardjian s’est
approché de nous.
— Je comprends
votre situation. Je cherchais également un emploi en tant qu’étudiant. Lundi,
je vous montrerai comment cela fonctionne et tout se passera bien.
Le lundi, en tant
qu’écoliers sur le banc d’école, nous étions les premiers au banco du
cordonnier. Le patron, après avoir réparti le travail entre les ouvriers, s’est
assis à côté de nous et nous a demandé de faire attention. En douze minutes, il
a tressé une semelle et nous a dit que la semelle finie devrait ressembler à un
bateau. Cela la rendait plus facile et plus rapide à monter sur le moule. Il
nous a invités à commencer, mais sans se précipiter. L’important est
d’apprendre à réaliser du bon travail. La vitesse vient avec le temps et la
pratique.
Le patron avait tout
à fait raison. À la fin de la première semaine nous tressions une semelle en
vingt minutes, la seconde semaine quinze minutes nous suffisaient. À la fin du
premier mois, nous sortions trois paires de chaussures du modèle
« croisé » par jour, de sorte qu’après le troisième mois, nous
deviendrions parmi les meilleurs ouvriers et les principaux initiateurs de la
première grève dans l’atelier d’Anatoly Goretsky.
La grève était un
geste révolutionnaire inutile. En général, les ouvriers de Goretsky gagnaient
trois à quatre fois plus par jour que les ouvriers français. Mais, voyez-vous,
nous recevions moins que les ouvriers des ateliers de Karan, Mirko, Mitich de
la rue Pradier, de Michel de la place des Fêtes et autres. Est-il possible de
tolérer une telle inégalité ? En plus, nous avions des informations
précises du comptable français sur les profits fantastiques du patron, qui
vendait les chaussures que nous fabriquions en dollars et nous payait en
francs. Sans beaucoup de persuasion, les ouvriers nous ont suivis. Durant ces
trois mois de travail en commun, nous avions acquis le prestige de travailleurs
consciencieux, gais et bons garçons. Le propriétaire a qualifié la grève de
folie, d’impudence, d’ingratitude et il nous a dénoncés à la police, tous les
deux, en tant qu’initiateurs, communistes, terroristes, bolcheviks. Nous avons
été arrêtés alors que nous participions au piquet de grève près du canal
Saint-Martin, qui longe le quai de Jemmapes. Nous avons été emmenés au poste de
police de la rue Beaurepaire voisine, où deux policiers en uniforme nous ont
agressés avec des mots durs. Ils nous ont traités de sales étrangers, de
bolcheviks, d’affamés, qui venaient manger leur bifteck, etc., mais ne nous ont
pas touchés d’un doigt. Nous avons attendu l’enquêteur civil, un vieil homme
mince et grand avec un visage pâle et des doigts fins et osseux jaunis par le
tabac. L’insigne de la Légion d’honneur brillait comme un point rouge sur le
revers de son costume beige. Il a demandé que M. Goretsky soit appelé. Jusqu’à
son arrivée, il entama une conversation libre avec nous : quelle
nationalité, quelle éducation, que font nos parents, pourquoi sommes-nous venus
en France, où habitons-nous, allons-nous au cinéma, au théâtre, visitons-nous
les bouquinistes, connaissons-nous le consul général de Bulgarie Lamouche,
fréquentons-nous le café Saint-Séverin, etc., questions toujours
« innocentes », et posées sur le ton « amical » le plus
désinvolte. Nous avons été honnêtes dans la plupart de nos réponses, mais pour
certaines nous avons dû duper. Néanmoins, l’enquêteur intelligent a sans doute
atteint son objectif : se convaincre qu’il avait devant lui des jeunes
éveillés qui, mesurés à l’échelle française, n’étaient pas des ouvriers
ordinaires.
La conversation
libre s’est terminée par une question de l’enquêteur et une réponse de notre
côté.
— Je me demande
encore pourquoi vous êtes en grève alors que vous admettez que vous gagnez
assez en une journée pour vivre toute une semaine ?
— Premièrement,
le travail est saisonnier et deuxièmement, les bénéfices de Goretsky sont tels
qu’il peut et doit payer plus ou moins autant que ce qu’ils paient dans les
autres ateliers de chaussures tressées.
Un policier en
uniforme est intervenu dans la conversation sans l’autorisation de
l’enquêteur :
— Ils n’ont pas
honte, monsieur l’enquêteur, de manger notre bifteck, de troubler l’ordre du
pays. Qu’ils repartent d’où ils viennent, et qu’ils fassent grève là-bas,
n’importe comment là-bas ils ont faim.
L’enquêteur lui
demanda soudain :
— Combien tu
gagnes par mois ?
Le policier nous
regarda confus.
— Dis-le, ce
n’est pas un secret d’État.
— Deux cent
vingt francs avec les allocations enfants et femme.
— Et vous,
combien gagnez-vous par semaine ?
— Deux cent
cinquante à trois cents.
— Tu vois, cinq
fois plus que toi et ils sont en grève. Bravo ! Je voudrais te voir gagner
comme eux et faire la grève. Des étrangers, et ils nous montrent comment ne pas
accepter même beaucoup et en vouloir de plus en plus. Bravo encore ! Si
Goretsky est arrivé, faîtes-le entrer.
Nous nous sommes
regardés, nous écoutions et n’en avons pas cru nos yeux ni nos oreilles.
L’enquêteur était plus que sérieux, et son ton était tout à fait sincère. Les
policiers en uniforme ne savaient pas non plus où regarder, nous, l’enquêteur,
le parquet ou le portrait de Clemenceau accroché au mur.
Le propriétaire nous
a accusés d’avoir incité et organisé la grève. Il a dit que nous étions
persécutés par le gouvernement bulgare et que lui était un Français qui avait
servi dans la Légion étrangère.
L’enquêteur
l’interrompit d’une note clairement moqueuse dans la voix :
— Monsieur
Goretsky, n’oubliez pas que vous n’êtes qu’un Français naturalisé, en fait
comme un étranger. Nous ne sommes pas intéressés par leurs croyances dans ce
cas. La France est une démocratie et elle tolère divers courants politiques. Ce
qu’ils ont fait dans leur pays les concerne eux et leur gouvernement. Veuillez
prouver, s’il vous plaît, s’ils ont empêché par la force quelqu’un de
travailler avant ou pendant la grève ? C’est ce que je veux de vous.
— Ils ont
encouragé les travailleuses à faire grève.
— Eh bien, ils
les ont convaincues et elles ont volontairement, sans violence, accepté. En
était-il ainsi ? il s’est tourné vers nous.
Nous avons senti le
nœud coulant et avons répondu :
— Un membre du
syndicat a pris la parole devant tout le monde et nous a demandé :
« Êtes-vous prêts à faire la grève ? » Toute l’assemblée a
répondu d’une seule voix « oui ». Nous ne voulions pas nous séparer
de nos collègues.
— Excellent !
Vous avez utilisé l’un de vos droits, le droit de grève.
— Je me
permettrai de remarquer, monsieur l’enquêteur, si tous les
étrangers-communistes peuvent, quand ils le veulent, arrêter la production,
embrouiller nos comptes, alors, je me demande, qu’adviendra-t-il de nous, les
propriétaires, et qui nous défendra ?
— Monsieur
Goretsky, vous prétendez être Français, et vous n’avez pas encore compris que
vous vivez en France, et non en Russie tsariste. Je vous répète ma
question : avez-vous des preuves qu’ils ont utilisé la violence physique
contre certains des grévistes ou qu’ils ont endommagé des machines ou des biens
dans votre atelier ?
— Non, je ne
sais pas, dit-il après une pause douloureuse.
— Vous êtes
libre.
— Mais
qu’allez-vous faire d’eux ?
— C’est mon
travail. Vous feriez mieux de penser que faire avec la grève.
— Je vais faire
faillite.
— Courage,
monsieur Goretsky. Au revoir !
La scène s’est
terminée par une surprise de taille. L’enquêteur excentrique se tourna vers
nous avec un sourire suffisant.
— Vous êtes
libres. Continuez votre grève, mais sans violence... Sinon on se reverra, mais
alors... autrement.
Nous ne pouvions
nous empêcher d’exprimer notre admiration pour son impartialité. Pendant
longtemps, plus d’un an, nous avons parlé de la position au-dessus des classes
de l’enquêteur et loué la démocratie française.
Pendant tout ce
temps, cependant, la police ne dormait pas, mais recueillait des informations
sur nous.
SCÈNES
BRÈVES DE LA VIE DE L’ÉMIGRATION
Jusqu’au jour où
j’ai été expulsé du sol français, je vivais librement dans le courant de la vie
ordinaire. En semaine — travail pour le pain quotidien ; les soirées —
réunions, théâtres, cinémas, conversations amicales ; les dimanches —
excursions autour de Paris, le plus souvent vers la forêt de Meudon avec sa
prairie autour de l’Arbre rouge.
Les excursions à
l’Arbre rouge n’étaient pas seulement pour les loisirs. Là, sur le pré, la
colonie antifasciste tenait nombre de ses réunions politiques et éducatives
publiques. Selon des coutumes du début du siècle, elles étaient souvent
accompagnées d’une partie musicale et littéraire. Les camarades de la direction
m’avaient confié l’organisation des performances artistiques. Bien sûr, le
récitant principal ou plus précisément le plus régulier, c’était moi. En
général, le public accueillait bien les poèmes que je déclamais Johan, Mineur, À mon premier amour,
Lutte et autres. Vasil Patsev[23],
venu étudier le chant à Paris, participait également à la partie artistique.
Avec son baryton chaud mais puissant, il interprétait les airs du toréador de
Carmen et du père de Rigoletto avec un vrai talent artistique. Nous ne cachions
pas notre admiration pour le grand chanteur. Vaskata avait toutes les données
pour conquérir non seulement nous, les malheureux immigrants. Il aurait pu fasciner
même le prétentieux public parisien avec sa voix. Cependant dans sa pureté
humaine excessive, il avait fait preuve d’un sectarisme inutile. Il déclara
Paris symbole du capitalisme pourri, ses cercles artistiques un nid puant, et
se hâta de rentrer chez lui pour soigner sa tuberculose.
Les célèbres Georgi
Bakalov, Nikolai Hrelkov, Boris Velev, Metodi Shatorov et ceux qui deviendront
célèbres, Ivan Stefanov, Georgi Kostov, Ivan Andreev, Stefan Hristov, Milko
Tarabanov, Avakoum Branichev, Israel Meyer et quelques autres ont participé à
la partie politique des rassemblements dominicaux autour de l’Arbre rouge à
différents moments.
Pendant les journées
d’automne et d’hiver, les activités de l’émigration antifasciste se déroulaient
dans des salles et salons de la capitale française. Trois célébrations étaient
devenues traditionnelles : le soulèvement de septembre 1923, le Nouvel An
et la fête de Botev.
J’ai été chargé de
compiler le programme artistique d’une soirée Septembre. Dedans, j’ai prévu La libération des femmes — un ballet de
Maria Dimova, qui venait d’arriver de Berlin, Johan — déclamé par Ivan Krosnakov, Lutte – par l’artiste Georgi Petrov et Septemvri — récitation par moi. Au piano, la Russe Lydia
Shelgounova, étudiante au Conservatoire de Paris. Performance solo d’Igorov —
Popeto, connu dans la colonie pour sa voix puissante.
Je devais coordonner
le projet avec Georgi Bakalov. Depuis la Bulgarie, le célèbre éditeur et
critique était pour moi une autorité littéraire incontestable. Mon oncle socialisant
le présentait comme l’un des hommes les plus cultivés de notre pays. J’avais
moi-même suivi de très près tous les numéros du magazine Nouveau chemin. Influencé par les récits de Karaliychev, par
exemple, j’avais écrit un récit, Le
soleil, qui ensuite avait été publié dans Relef[24].
Après avoir
rencontré Georgi Bakalov, tout ce que j’ai entendu à son sujet m’a semblé vrai.
Il avait vraiment une culture extrêmement étendue et était doué d’une mémoire
incroyable. Dans les conversations sur une variété de sujets, il insérait des
citations réussies presque toutes les cinq à dix minutes : soit des vers,
soit de la prose, soit des passages philosophiques distincts. Quand j’ai eu la
chance d’être avec lui, j’écoutais et avalais avidement chacune de ses pensées.
À mes yeux, il était une incarnation vivante de l’enseignement et de la pensée
marxistes. Je le considérais comme un marxiste, et un grand marxiste, mon
professeur. Au cours des rencontres fréquentes et de la participation aux
réunions, j’ai découvert une autre facette de son talent polyvalent et riche —
son grand talent d’orateur. J’avais peu entendu parler de cette qualité. En
fait, Bakalov était un interlocuteur captivant et un véritable orateur. Son
discours — direct, coloré, l’intonation riche et modulante. Sans aucune note,
il prononçait des discours de deux ou trois heures sur les questions
politiques, littéraires et philosophiques les plus complexes.
C’est avec cet
homme, devant lequel j’étais en admiration et qui m’inspirait profondément, que
j’allais maintenant parler du projet de la partie artistique de la soirée
Septembre. Georgi Bakalov vivait avec sa famille sur le boulevard d’Italie dans
un nouveau bâtiment moderne avec des portes vitrées et de larges escaliers en
pierre. Excité, je n’ai pas gravi les escaliers d’un seul souffle, comme je
l’avais fait plusieurs fois auparavant ; je me suis arrêté à presque tous
les étages. Je me suis reposé devant la porte de l’appartement, j’ai rassemblé
mes forces et j’ai sonné avec le sentiment que ce ne serait pas la porte d’un
appartement ami, mais le porche d’un tribunal strict et implacable.
La porte s’ouvrit
et, à ma grande surprise, un visage rose et souriant apparut derrière, le
visage du bon Georgi Bakalov. L’hôte, aux cheveux légèrement grisonnants, avait
la capacité de prédisposer les invités avec son apparence aimable et son regard
bienveillant. Je lui tendis le projet de programme et commençai à
m’excuser :
— Le programme
sera pauvre, il n’y a pas de numéro qui se démarque, presque tout est connu.
En lisant le projet,
mon interlocuteur sourit brièvement et même, me sembla-t-il, soupira. Il leva
la tête et me demanda tout à fait professionnellement :
— Combien de
temps dureront les numéros individuels et l’ensemble du programme ? Est-ce
que tu prévois un entracte ?
— J’ai parlé à
tout le monde. La camarade Dimova, la pianiste, Johan, La lutte et le
solo prendront environ une heure. Septembre...
— On
en reparlera à la fin. Dans quel salon se déroulera la soirée ?
— Dans le salon
Cadet de la rue Cadet. Il appartient à une société franc-maçonne. La camarade
Laura[25]
sait combien nous avons dû insister. Ils nous l’ont à peine donné. Nous n’avons
pas trouvé d’autre salle.
— Et
pourquoi n’avez-vous pas loué le club du parti rue Boyer ?
— Nous avons
demandé, il était occupé. Et puis, cette fois nous prévoyons de faire venir
beaucoup de Bulgares, le club La Bellevilloise sera petit.
— Et maintenant
tu vas me dire honnêtement ce qui t’a donné envie de réciter Septemvri, ou quelqu’un te l’a-t-il
suggéré ?
— Comment
puis-je vous dire ? Je n’ai parlé à personne ; je veux essayer.
— Est-ce que tu
comprends le poème ?
— Je pense que
oui.
— Bien, mais
est-ce que les travailleurs qui vont t’écouter comprendront ce que leur dit
l’auteur ? Comment penses-tu qu’ils vont se débrouiller dans les symboles
de Geo Milev et dans toute sa mythologie ? Moi, qui suis pour ainsi dire
préparé, je l’ai lu deux fois et le manque de points et de virgules m’a rendu
difficile de suivre la pensée de l’auteur.
— Vous avez
raison, camarade Bakalov. Toute la partie mythologique ralentit le rythme,
complique l’imagerie du poème. C’est pourquoi je laisse tomber cette partie et
si vous en êtes d’accord, je le réciterai sans les déviations mythologiques...
— Passions,
vagabondages...
— ... Et quand
je dis les signes, je les mets aux bons endroits pour que l’auditeur puisse
facilement saisir la pensée de l’auteur.
— Tu veux
vraiment essayer ce poème ?
— Oui. Je le
trouve extrêmement fort... Je me suis permis quelques abréviations,
déplacements de mots, ajouts pour donner une expression plus claire à certaines
phrases. Vous m’entendrez même et alors...
— Une fois que
nous avons fait confiance à la jeunesse, nous accepterons l’expérience qu’elle
offre. J’avoue que j’ai un faible pour la jeune génération. Nous allons prendre
une tasse de thé maintenant. Pendant ce temps, vous me raconterez quelles sont
les pièces les plus intéressantes des théâtres parisiens...
Jusqu’à la fête
elle-même, mon anxiété grandissait pour deux raisons : je ne savais pas ce
que seraient les débuts de Dimova et je n’avais pas confiance en ma propre
force.
Heureusement, le
premier sujet s’écarta. La ballerine était vêtue d’une robe large et courte
beige foncé en lambeaux, une épaule nue, ses cheveux noirs ébouriffés comme
ceux d’une Amazone. Elle aborda le sujet de la « libération des
femmes » historiquement, introduisant d’abord la femme humiliée et privée
de ses droits. Son corps se déplaçait sur la scène, comme s’il portait le poids
de toutes ses sœurs de la terre entière. Son éveil en tant qu’être avec une
dignité humaine se traduisit par des mouvements nouveaux mais déjà fluides,
avec des yeux éclairés, un sourire, un visage. Sa danse a montré comment une
femme devient une combattante pour les droits de l’homme et les libertés ;
comment elle se bat à mains nues contre les baïonnettes de la police et là...
il s’élève de loin et se rapproche de plus en plus et puissamment du
rugissement de la révolution aux éclats de feu. Ici, Maria Dimova se balançait
avec de beaux mouvements dans une danse si folle de la joie de la liberté, de
la rupture des chaînes de l’esclavage, dans un tel hymne de la femme libérée
que le public ne pouvait contenir son enthousiasme et, avant la fin du ballet,
il a décerné à la ballerine révolutionnaire des applaudissements forts et
longs.
Après le triomphe de
Dimova, ma tâche devenait encore plus difficile. Il fallait non seulement
réussir l’examen devant Georgi Bakalov, mais aussi ne pas avoir honte de moi.
Je ne me souviens
pas comment j’ai récité. C’est ce qu’environ un millier de personnes présentes
pourraient dire, ou plutôt les rescapés. Je ne sais qu’une chose : les
derniers mots « Septembre sera mai ! La Terre sera un paradis !
Ce sera ! » je les prononçai d’un ton et dans la position d’un
prophète, debout de toute sa hauteur et levant les bras, la tête haute. Je suis
resté dans cette position pendant cinq ou six secondes. Le public était
silencieux. Alors seulement, il éclata en applaudissements et cria :
« Bravo ! Encore ! » Épuisé, je cherchais une chaise
derrière le rideau. Laura a été la première à me saluer. Ses mots étaient
stéréotypés, « Merveilleux, merveilleux », mais ses yeux brillaient
étrangement et sa voix tremblait clairement.
Derrière le rideau,
les gens n’arrêtaient pas d’applaudir. À ce moment, après avoir traversé la
longue salle, sauté sur le podium avec le rideau baissé, Georgi Bakalov
lui-même est apparu. Comme piqué je me suis levé, prêt à entendre ma
condamnation à mort. Il a ouvert ses bras et m’a étreint avec les mots :
« Grand, sublime, inaccessible ! C’est un grand poème fougueux et
tout à fait compréhensible. Bravo ! »
J’étais heureux non
seulement en raison de l’approbation générale. J’étais particulièrement heureux
d’une découverte : Bakalov n’a pas caché que ma performance l’avait aidé à
ressentir plus profondément la grandeur du travail de Geo. Le soir même, il a
annoncé son intention de chercher un autre poète et de le traduire en russe[26].
Des luttes ont eu
lieu dans l’association étudiante, qui nous paraissait très importante. Nous
pensions sérieusement que les jours du gouvernement Liaptchev en Bulgarie
dépendaient presque de l’activité de l’association étudiante. C’est cette foi
naïve qui nous a conduits à nous consacrer spirituellement et physiquement aux
luttes étudiantes. Deux groupes y ont pris une part active : les fascistes
et les antifascistes. Un certain nombre d’éléments hésitants et politiquement
désorientés se déplaçaient entre eux. Le groupe antifasciste, qui comprenait
des communistes, des agriculteurs, des anarchistes et des sans-partis, était
toujours à l’offensive. Notre tâche principale, reprendre l’organe de direction
de l’association étudiante, nous l’avons réalisée à moitié. Après des efforts
persistants qui ont duré un an, nous avons réussi à imposer comme président
l’antifasciste sans-parti, étudiant en médecine et tresseur de chaussures
Doycho Doychev et comme membres de la direction Lyubomir Pipkov, Marko Bunin et
la respectée Lora Bakalova. Les autres tâches, surgissant sans cesse, mais pas
toujours grandes, nous poursuivions avec non moins de persévérance. Surtout,
nous avons essayé de ne pas permettre aux fascistes de poursuivre la politique
officielle du gouvernement bulgare à travers l’association étudiante. Nous
rejetions toute tentative par diverses résolutions d’induire en erreur
l’opinion publique française sur la situation en Bulgarie. Nous réagissions
jusqu’à la violence lorsqu’un étudiant naïf ou fanatique proposait à
l’association étudiante de féliciter le roi le jour de son sacre. Je me souviens
qu’en une occasion similaire, un étudiant pâle et au visage pointu fut horrifié
lorsque j’appelai le tsar Boris le troisième et dernier. Extrêmement indigné
par ma grossièreté, il m’a demandé publiquement :
— Qui êtes-vous
et est-ce que vous êtes né d’une mère bulgare ?
Ma réponse,
renforcée théâtralement, était :
— Je suis né
d’une simple mère bulgare, femme de ménage du Bain Central, et je suis le fils
du fabricant de kebapcheta[27]
Mile, qui appartient à la vraie Haute Société — la classe ouvrière.
Les étudiants
fascistes indignés rivalisant d’efforts se plaignaient :
— Scandaleux !
Sa Majesté est insultée ! Dehors les fils des fabricants de kebapcheta ! À chaque crapaud de
connaître sa tourbière !
Immédiatement après
cette manifestation de ma part, les fascistes ont quitté la réunion ; leur
résolution a échoué.
Georgi Bakalov, qui
avait appris le scandale par Laura, aurait dit : « Il est bon de
temps en temps d’imposer des mots durs du prolétariat sur les tympans de ces
fils de bourgeois. »
Sans de telles confrontations,
la vie de l’association étudiante était impensable. Elles arrivaient souvent et
prenaient parfois des formes aiguës. Nous avions réussi à obtenir le
consentement du conseil d’administration pour célébrer la Journée de l’écriture
slave avec une fête dans l’une des petites salles Pleyel de la rue
Saint-Honoré. Le discours d’introduction serait prononcé par le président de la
société. La partie artistique m’a été confiée. C’était à nous, les
antifascistes, de prouver que nous étions capables de présenter un programme de
haut niveau. Il fallait attirer toutes les forces bulgares à Paris. Cela
signifiait parler avec Lubomir Pipkov, venu étudier la musique avec le grand
compositeur français Paul Dukas, avec l’artiste d’opéra Tsvetana Tabakova — en voyage
d’affaires créatif, avec Vladimir Trandafilov – en spécialisation chez le
metteur en scène et directeur du théâtre Odéon Firmin Gémier, avec un jeune
homme — Uzunov, qui étudiait le chant, ainsi qu’avec notre chanteur Igorov —
Popeto.
Sur instruction de
la légation bulgare, les fascistes ont tenté de compromettre le concert. Ils
ont prévenu tous les boursiers et artistes en mission que Sofia couperait leur
soutien financier et qu’ils seraient même licenciés s’ils participaient au
« concert communiste ». Un slogan de boycott a été lancé parmi les
étudiants. Les méthodes de chantage et de menace directe ont donné quelques
résultats. La méthode américaine de vol a été appliquée en particulier à
Vladimir Trandafilov. Ils l’ont kidnappé avec l’aide de plusieurs étudiantes,
qui auraient été très flattées et heureuses si l’amant de la scène bulgare
avait accepté de leur tenir compagnie lors d’une promenade au château de
Fontainebleau.
Cependant, la pointe
des flèches empoisonnées n’a pas pu toucher et faire hésiter Lubomir Pipkov. Le
jeune compositeur repoussa chevaleresquement leurs attaques. Il leur déclara sa
volonté indomptable de servir avec son art le peuple et seulement le peuple.
— Au concert,
que vous appelez communiste, viendront des Bulgares, pour qui j’écris ma
musique et qui la comprennent.
Lyubomir Pipkov a
récolté de vrais lauriers. Il interpréta d’abord des pièces de Chopin. D’un
point de vue technique et musical, l’interprétation des œuvres du grand
compositeur polonais révéla à quel point le jeune musicien maîtrisait librement
l’art du piano. Ses premières tentatives du grand oratorio, Prélude de septembre, suivirent. La
musique de sa composition sonnait bulgare, mais sans la chanson ni les rythmes
brillants sautillants de nos compositions de ce temps. Elle sonnait comme une
musique nouvelle, encore une fois bulgare, mais moderne, une musique qui au fil
du temps acquerra une image, une couleur, un rythme, une structure et un son,
laissés dans l’histoire de notre développement musical en tant que Pipkovski. Ce dimanche après-midi, au
rez-de-chaussée du bâtiment Pleyel, dans la petite salle de chambre Debussy, le
talent d’un des plus grands compositeurs bulgares s’est épanoui d’une beauté
juvénile. Avec son instinct infaillible, le large public a apprécié l’acte de
naissance créative du jeune homme talentueux et l’exploit du citoyen
antifasciste Lyubomir Pipkov.
Pendant le concert,
j’étais vraiment content : tous les interprètes étaient accompagnés avec
des bouffées d’enthousiasme ; mon Mineur d’abord,
puis Septemvri avec l’accompagnement
improvisé de Pipkov lui-même ont également réussi.
L’écho du concert se
répandit dans toute la colonie bulgare hétérogène. Tout le monde parlait du
haut niveau artistique, le succès des antifascistes était reconnu.
La semaine suivante,
j’ai rencontré Vladimir Trandafilov dans un café de la rue des Écoles. Il était
le premier à me parler :
— J’ai entendu
dire que le concert s’était très bien passé. Je suis désolé de m’être laissé
berner. Ce n’est rien. Je vais me venger… J’ai vu Fontainebleau. Château-musée
d’une richesse étonnante. Napoléon était un grand génie militaire et
étatique... Si tu m’appelles une autre fois, je viendrai. Tu dois savoir que je
suis avec vous. Trinquons, jeune homme, à nos succès futurs.
Les paroles de
Vladimir Trandafilov n’étaient pas un adoucissement de comptoir de café, ni une
explosion sentimentale devant un jeune confrère. C’était une confession de
l’homme et du citoyen Trandafilov.
Il l’a prouvé
quelques mois après la conversation. Le réveillon du Nouvel An de la colonie
était organisé par le Comité des antifascistes bulgares. À cet effet, nous
avions loué divers salons. La fête du Nouvel An de 1927 a eu lieu dans une
salle de danse avec un bar, un ancien cinéma avec une petite scène. Le salon
était situé sur l’avenue de la Motte-Picquet en face de la spacieuse brasserie
Schmid. L’acteur de premier plan a pris part à cette fête non pas avec Désolation de Pencho Slaveykov et Armentzi de Peyo Yavorov — ses
récitations préférées — mais, ni plus ni moins, avec Gladiator de Hristo Smirnenski. Il a fait ce choix lui-même.
— Je
récite en fonction de l’audience. Maintenant, la plupart des ouvriers, des
communistes, des immigrés politiques, des septemvriitzi
m’écouteront. Je dois leur plaire. Et comment ? En récitant Roussalka de Kiril Hristov ? Non.
Ici, vous avez besoin de foi, de feu, de flamme, de rébellion. Laissez-moi leur
réciter Gladiator. Pour qu’ils se
souviennent de moi. Et je suis en accord avec moi-même.
— C’est
ta volonté. Mais ils auraient accepté Roussalka
et d’autres poèmes si seulement ils viennent de toi. Tu verras comment
« ceux d’en bas » t’accueilleront.
Nous avions raison
tous les deux. L’artiste, venu vers le peuple, récita le poème avec une telle
maîtrise, avec un tel zèle et une sincérité profonde, que lorsqu’il cria aux
patriciens fous :
... Mais ce soir soyez prêt,
je vous appelle au combat !...
des frissons
parcoururent les corps des auditeurs combattants essoufflés. Et quand, enfin,
dans le dernier quatrain, il appela les frères esclaves :
... Et là, dans la ville, pour une vengeance terrible
Spartacus avait conduit les foules
et rugit sauvagement dans la nuit étoilée d’or :
Debout, frères esclaves, debout !...
le public se leva
vraiment, prêt à suivre à la vie et à la mort l’artiste, qui avait grandi à ses
yeux comme un tribun prolétarien. Au milieu des cris généraux et des
applaudissements « Bravo, encore, hourra », le baryton bruyant
d’Anguio le cheminot rugit : « Camarades, suivez-moi ! »
D’un bond, il monta sur scène et seul, comme un vrai borimechka[28],
il souleva l’artiste qui s’inclinait. L’enthousiasme des gens ne connaissait
pas de limites. Porté dans des bras, l’artiste fut mis droit sur une table. Là,
les cris et les applaudissements ont pris une nouvelle force. Chaque tentative
de Trandafilov, prisonnier de cette situation, de descendre de la table était
brisée par les poings serrés des admirateurs et admiratrices en liesse. Il
resta debout sur la table pendant dix minutes. Finalement, le favori captif
croisa les bras en prière et dit : « J’ai soif ». Le public
excité eut pitié de son idole. Des dizaines de mains l’attrapèrent de nouveau
et le placèrent sur une chaise devant une table vide. En un instant, cinq ou
six bouteilles de vin, généreusement offertes par des admirateurs visibles et
invisibles, se dressaient sur la table.
À la table de
l’artiste ayant fusionné avec le peuple, les bouteilles et les assiettes de
collations arrivaient pleines et au bout d’un moment disparaissaient vides
quelque part. La sélection naturelle avait eu lieu dans le groupe autour de la
table. Des chanteurs amateurs, dirigés par Anguio, augmentaient la joie de
l’artiste de son contact avec l’âme folklorique chantante. Ils commençaient des
chansons populaires et révolutionnaires, des extraits d’opéra, des romances
russes sans les terminer. Trandafilov lui-même chantait avec enthousiasme. Il
régnait déjà une fraternité et une égalité complètes dans le groupe. Tout le
monde se tutoyait. On disait à Trandafilov : « Vlado, tu es un homme
en or ! » La valeur de « l’or » de Vlado a bondi, comme
jamais, le taux de change de l’or n’a augmenté sur aucune bourse du monde,
lorsque ses amis à table ont été témoins de la scène suivante.
À 11 h 30 du soir,
un messager de la légation arriva et s’adressa au grand artiste bulgare :
— Monsieur
Trandafilov, je viens sur commande spéciale. Monsieur le Ministre
Plénipotentiaire vous demande de vous dépêcher. Tout le monde vous attend. Il a
envoyé sa voiture personnelle.
— Remerciez le
ministre, dit Trandafilov, déjà un peu grisé. — Mais dites-lui que je suis en
compagnie d’un groupe... sans pareil. Comment la quitter, dites-moi, s’il vous
plaît ? Je me sens si proche de notre cher peuple bulgare. Chantons
« Travaillons, travaillons, éduquons le travailleur »... Vous voyez
monsieur le plénipotentiaire du Ministre Plénipotentiaire, ici les chansons
sont chantées complètement dans l’esprit de Lyuben Karavelov, notre grand
éveilleur des consciences, n’est-ce pas ?
— J’espère
que vous êtes conscient des conséquences de votre refus, monsieur
Trandafilov ?
— Pas de
chantage, monsieur. Je ne refuse pas, mais c’est trop tard, je suis fatigué...
— Que dois-je
transmettre en votre nom au ministre ?
— Ce sera un
grand plaisir de nous voir. Il connaît mon adresse. Je serai heureux d’attendre
qu’il m’appelle. Bonne nuit ! Bonne année ! Bonne nuit...
L’exploit de
l’artiste n’a pas entraîné de conséquences graves. La dénonciation du Ministre
Plénipotentiaire pour les sympathies antifascistes de l’artiste s’est avérée
impuissante à briser le grand charme du rare talent sur la scène du Théâtre
National. Vladimir Trandafilov continua à apprendre du grand art de Firmin
Gémier.
AU
THÉÂTRE L’ATELIER
Ayant accumulé des
économies pendant environ un an, je demandai à mon professeur Georgi Bakalov de
me recommander par l’intermédiaire de quelqu’un à l’école d’art dramatique du
théâtre l’Atelier avec Charles Dullin comme metteur en scène principal. J’avais
vu plusieurs productions dans ce théâtre et admiré le jeu réaliste de Charles
Dullin lui-même, en particulier dans la pièce Volpone de Jonson et l’Avare
de Molière.
Quelques jours plus
tard, Bakalov m’envoya chez le critique de théâtre du journal l’Humanité, qui signait sous le pseudonyme
de Le Parisien. Je suis allé à la rédaction rue Montmartre, excité par toutes
sortes de sentiments. Je n’étais pas sûr de mon français et j’avais
terriblement peur d’apparaître, aux yeux de ce célèbre critique, comme un
simple jeune homme balkanique. J’étais aussi excité par le fait que dans cet
immeuble le journal était édité par le grand Jean Jaurès, tué à quelques pas de
là, au café Croissant. Alors que je franchissais l’étroite porte d’entrée et
que je montais les escaliers raides en bois, une pensée s’imposa à mon
esprit : le vendeur de journaux de Yuchbounar avait vécu assez longtemps
pour entrer dans la rédaction d’un grand quotidien français. Pâle, trempé de
sueurs froides, je frappai à une porte grise ordinaire, longtemps non peinte.
La salle triangulaire était trop petite pour les deux tables et les deux
éditeurs. J’ai fait un effort et j’ai dit :
— Je
cherche le critique de théâtre Le Parisien.
Un homme d’une
quarantaine d’années, de taille moyenne, avec une moustache noire et un
pince-nez doré, répondit :
— C’est moi.
Que voulez-vous ?
— C’est Georgi
Bakalov qui m’envoie.
— Ah, je me
souviens. Voici une chaise, assieds-toi, camarade. Mon ami Bakalov m’a beaucoup
parlé de ta passion théâtrale. C’est merveilleux, tant que le feu ne s’éteint
pas. Mais décris-moi plus en détail ce que tu as fait jusqu’à présent au
théâtre, afin que je sache mieux t’aider, si je le peux.
Je trébuchais sur
chaque phrase. Au final, semble-t-il, il a compris ma courte existence
théâtrale et mon grand désir de me consacrer à la scène.
— Eh bien, il y
a des choses à voir et à apprendre dans les théâtres parisiens. Mais pourquoi
as-tu choisi Dullin ? Tu connais sans doute aussi le théâtre de la
Gaîté-Montparnasse du metteur en scène Gaston Baty ? Il est très
intéressant.
— J’ai même lu
le livre de Baty sur le théâtre. Mais il me semble qu’il est trop abstrait et
idéaliste dans la théorie. Et Dullin, j’ai écouté ses discours, est plus terre
à terre, plus clair, réaliste...
— Tu as raison.
De ce point de vue, l’Atelier se rapproche plus du grand public en termes
d’idées et de jeu. D’accord, mon garçon. Nous avons un camarade là-bas. Il
s’appelle Jean Millet. Je vais te donner une lettre pour lui et lui te
recommandera à Dullin en son nom et en mon nom.
Tout en parlant, Le
Parisien saisit son stylo et écrivit une page entière en grosse écriture. Avant
de finir, il me demanda si j’étais le premier à réussir l’examen de notre
théâtre National et quels étaient mes deux noms. Il se leva, me tendit
l’enveloppe cachetée et me raccompagna jusqu’à la porte. À ce moment je
remarquai qu’il était légèrement boiteux.
Un soir d’automne,
je cherchai l’artiste Millet au théâtre. L’acteur m’accueillit comme une
vieille connaissance, me prit par la main et me conduisit avec ces mots :
— Vite après
moi ! Le patron veut te voir.
Nous avons descendu
des escaliers en bois, sommes entrés dans les coulisses et nous nous sommes
retrouvés dans le couloir du théâtre de la rue d’Orsel. Par deux, par trois,
des actrices et acteurs parlaient et fumaient. Charles Dullin nous jeta un coup
d’œil perçant de ses petits yeux bleus et, sans attendre que Millet me
présente, salua et demanda :
— Voulez-vous
apprendre la mise en scène ?
— Oui monsieur.
— Nos
répétitions commencent demain à dix heures du matin. Venez quinze minutes plus
tôt. Vous me chercherez dans le hall. Connaissez-vous Les Oiseaux d’Aristophane ?
— Oui
monsieur.
— Lisez-les
encore une fois. Et demain je dirai qu’ils vous donnent le texte remanié, que
nous jouerons. Au revoir.
Il tendit sa main,
douce et chaude. M’accompagnant sur le chemin du retour vers la sortie de la
rue d’Orsel, mon protecteur me murmura :
— C’est une
chance rare. Tu ne dois pas la manquer. Pour la première fois, le chef accepte
ainsi un étranger.
De la rue d’Orsel,
je tournai et j’entrai dans la rue des Martyrs. Je passai devant le cirque
Medrano, pris le faubourg Montmartre et gagnai les Grands Boulevards. Avant de
m’arrêter dans un restaurant, je décidai de chercher la pièce d’Aristophane
chez les bouquinistes du bord de Seine. Je la trouvai facilement et je
m’arrêtai au restaurant le plus proche. Pendant tout ce temps, je n’arrêtais
pas de me demander : « Est-ce que tout cela est un conte de
fées ? »
Les premières
semaines de mon « assistance » étaient consacrées à regarder les
répétitions de la pièce Les Oiseaux.
Mon objectif principal était de pénétrer les activités créatives de Dullin, de
comprendre son style et sa méthode. Le grand metteur en scène répondait
généreusement et directement à mes questions, avec lesquelles j’essayais de ne
pas l’embêter. Il s’est un jour tourné vers moi lui-même :
— Cher
monsieur, je vois que vous regardez attentivement. Je voulais qu’il passe un
peu de temps pour que vous compreniez vous-même l’essentiel dans mon idée de la
production. Maintenant, je pense que je peux entendre votre opinion.
— Je pense que
vous et l’auteur de l’adaptation Bernard Zimmer voulez mettre l’accent sur le
côté satirique de la pièce. C’est pourquoi vous mettez l’accent sur des
situations et des remarques plus éclairantes. À mon avis, cela est en harmonie
avec l’idée d’Aristophane. Ensuite, vous actualisez fortement la pièce. J’aime
aussi beaucoup ça. Je pense que la production sera un grand succès.
— On
espère tous... Mais avez-vous des questions, des remarques sur le jeu, sur le
typage, sur le rythme, etc. ? Parlez librement.
— Si vous
permettez, je vais poser une question. Serait-ce du naturalisme si les acteurs,
qui représentent différents oiseaux, essayaient d’imiter dans leur discours et
leurs gestes les caractéristiques des créatures volantes respectives ?
— Ça dépend. Dans
notre art, la mesure joue un rôle crucial. Si tu sais comment trouver et suivre
la mesure, tu as réalisé la chose la plus importante. Au début, vous n’étiez
pas encore là, le Russe Serov, qui est un gars très talentueux, a aussi demandé
la permission d’être plus un oiseau qu’un homme. Je lui ai dit :
« Essaye d’être humain sous le costume d’oiseau. Conforme-toi au costume,
c’est-à-dire à l’extérieur, mais ne manque pas le principal, l’intérieur,
l’humain.
Les Oiseaux
ont été joués plus d’une centaine de fois avec un bon succès.
La pièce Jean le
Maufranc de Jules Romain a été préparée à la hâte et jouée pendant très peu
de temps. Lors des répétitions, le metteur en scène Gaston Baty et les
comédiens-metteurs en scène Louis Jouvet et Georges Pitoëff sont venus deux
fois. Ces trois innovateurs théâtraux, avec Charles Dullin, ont formé
« Le Cartel des quatre ».
Dans l’un de leurs « manifestes », ils se sont déclarés solidairement
responsables des performances de chacun d’eux individuellement. L’aide qu’ils
recevaient les uns des autres s’exprimait en avis ou plutôt en conseils
amicaux, facultatifs pour le destinataire. J’étais très impressionné par le ton
collégial, la liberté et la sincérité avec lesquels les « quatre »
parlaient, échangeaient des pensées, croisaient des expériences. Ces rencontres
d’artistes très cultivés et compétents étaient pour moi une véritable école de
coopération créative.
Après Jean le
Maufranc, les répétitions d’un drame contemporain du jeune auteur alors
inconnu Steve Passeur ont commencé — À quoi penses-tu ? La pièce
était vraiment faible. Le sous-texte critiquait les fausses idoles, mais le
développement n’était pas original. La langue — incolore, le dialogue —
dépourvu de qualités scéniques. Charles Dullin, qui rencontra des malentendus
évidents dans le discours scénique, des incohérences psychologiques dans la
représentation des personnages, exigea de l’auteur, qui était présent, qu’il
apporte immédiatement les corrections nécessaires sur place. Insatisfait de la
première édition des corrections, le metteur en scène en exigea une deuxième,
puis une troisième. Lui-même dictait parfois presque le texte souhaité.
Les répétitions
étaient difficiles. La relation entre l’auteur et le novice avait atteint un
point de refroidissement. L’auteur sans expérience considérait qu’il était
opprimé dans sa liberté de création. Dullin, metteur en scène et interprète du
rôle central, était mécontent de l’inexpérience du dramaturge novice, qui
insistait avec ténacité sur des images clairement intenables d’un point de vue
scénique, de la parole, de la construction de l’intrigue. Tout le monde était
exaspéré par les disputes qui accompagnaient les douleurs d’enfantement de la
pièce et de la mise en scène. Je me suis demandé : à quoi bon continuer les
répétitions, puisque le succès médiocre de la pièce peut désormais être prédit
d’une manière positive ? Les mauvaises langues donnèrent une explication.
Le jeune auteur a payé une somme énorme pour jouer sa pièce. C’était une
pratique dans les théâtres parisiens.
Steve Passeur, jeune
homme blond d’origine irlandaise, s’est disputé avec le maestro. Parfois, il
montait sur scène pour montrer que le texte ou la situation qu’il proposait
pouvait être interprété magnifiquement et naturellement. Pendant un temps, Dullin
toléra ces interventions d’auteur, mais un jour il défendit fermement ses
droits de metteur en scène :
— S’il vous
plaît, monsieur Passeur, séparons les choses. Vous êtes l’auteur et le
responsable du texte de la pièce. Je suis le metteur en scène et je dois penser
à la production. Même lorsque vos remarques sont justes, ma parole est décisive
qu’elles soient prises en compte ou non.
La forte
personnalité de Dullin prévalait et prenait le dessus sur le débutant. Le jeune
homme ambitieux avait une dent contre le metteur en scène. Il lui arrivait de
perdre son contrôle et me faisait part de ses doutes sur les qualités de la
production. Bien que timidement, j’ai exprimé certaines de mes opinions
critiques. L’auteur déprimé a aimé cela, et il a commencé à me consulter plus
souvent.
J’ai un jour
critiqué l’interprétation scénique d’une scène entière. Je l’ai fait en privé
avec monsieur Passeur, avec qui j’étais assis au fond de la salle. Avec toute
ma sincérité, j’ai exprimé ces pensées :
— Je me trompe
peut-être, mais il me semble que l’ambiance appropriée n’a pas été donnée sur
scène après le vol et la blessure de votre personnage principal. Que
poursuivez-vous avec le vol et l’expulsion des voleurs ? Vous voulez
donner au protagoniste l’opportunité de se présenter comme le sauveur de la
propriété et de la vie de la famille dans laquelle il s’est impliqué le plus
effrontément, et par cet acte gagner la gratitude commune des femmes et des
hommes pour reconnaître ses mérites.
— C’est
correct, continuez.
— Eh bien, il a
atteint son objectif. Et de plus, il a été blessé dans la bagarre avec les
voleurs, il a été blessé, il s’est évanoui et maintenant il est malade, entouré
des soins de tous. La position du héros dans la famille a changé. L’attitude de
chacun envers lui devrait également changer. Malheureusement, Dullin n’exige
pas cela des autres. Ils continuent d’aller et venir, parlant avec le ton
précédent, ignorant son exploit de minuit. Comment exprimer le
changement ? À mon avis, la scène doit être en sourdine, les membres de la
famille doivent aller et venir tranquillement, sur la pointe des pieds, en se
parlant comme dans une chambre d’hôpital ; traiter le patient avec une
attention particulière, si vous voulez, avec une attention exagérée, lui parler
sur un ton nouveau, bienveillant, voire trop bienveillant. Le changement est
aussi nécessaire au vu des évolutions à venir : lorsqu’on s’apercevra que
l’exploit a été délibérément taillé sur mesure, la déception, le choc avec la
méchanceté sans fond de tels escrocs sera plus dramatique. Alors votre question
à la dame déçue, À quoi penses-tu ? sera révélée dans toute sa profondeur. Je ne sais pas si vous
avez compris ce que je voulais dire ?
— J’ai
compris. C’est exactement mon idée dans cette scène. Je vais le dire à Dullin.
N’ayant aucune
expérience de la vie, avec le sentiment d’être flatté par l’auteur, j’ai
dit : « Comme vous voulez. » Mon interlocuteur, jeune homme
comme moi, semblait n’attendre que cela. Il s’approcha de la balustrade de l’orchestre
et se tourna vers le metteur en scène :
— Je m’excuse,
monsieur Dullin, votre assistant m’a fait part d’une idée pour la scène que
vous êtes en train de répéter.
Charles Dullin
réagit visiblement irrité :
— S’il vous
plaît, allez droit au but, notre temps est précieux.
— Il trouve, ou
plutôt on pense qu’il sera plus proche de l’idée de cette scène, si...
Alors même que
l’auteur parlait, l’un des artistes a involontairement lâché
« D’accord. » Charles Dullin écoutait à moitié allongé sur un canapé,
accoudé sur sa gauche. À la fin de l’explication de l’auteur, il se leva,
s’assit face à nous, le jeune couple agaçant, et coupa assez sèchement :
— Monsieur
Boris vous a parlé. Vos idées correspondent. Merveilleux. Mais comme je n’y ai
pas pensé, la répétition continuera comme avant. Veuillez tous vous asseoir.
La répétition
continua, mais aussitôt le ton baissa. Pendant le temps libre de répliques, les
artistes se réunissaient en groupes et commentaient ce qui s’était passé.
Dullin était nerveux sur scène. Il renvoya les acteurs deux ou trois fois et
exigea qu’ils lui parlent à haute voix, lui fassent des répliques complètes.
Dans la salle, nous étions comme sur des œufs. Nous n’osions pas bouger, même
pas nous regarder. Passeur fumait nerveusement sa pipe. Je ne savais pas ce qui
lui arrivait. Je sentais que j’avais fait une erreur irréparable avec toutes
les conséquences possibles, prévisibles et imprévisibles. Je voulais m’enfuir,
mais je n’en avais pas la force. Je restai comme cloué au banc des accusés.
Le verdict ne s’est
pas fait attendre. Quand tout le monde se fut dispersé, le maestro s’approcha
de moi et me frappa de sa noblesse :
— Je vous ai
donné mon entière confiance, vous laissant suivre les répétitions quand j’étais
occupé ou indisposé. Je vous ai donné accès à tout et à tout le monde dans le
théâtre. Pourquoi est-ce que je vous le rappelle ? Pour vous dire que
votre comportement de ce matin m’a surpris. Pourquoi avez-vous partagé vos
pensées non pas avec moi, mais avec l’auteur ? Ne vous ai-je pas écouté
attentivement lorsque vous avez présenté une certaine opinion
personnelle ? Bref, comment jugez-vous votre démarche ?
Personne ne m’a
giflé, personne ne m’a piétiné avec des bottes chaussées, personne ne m’a
menacé d’emprisonnement, de fusillade, de pendaison. En plus, mon professeur
m’a parlé d’un ton paternel. Je sentais de tout mon être qu’un seul repentir
pouvait m’aider à sortir de la situation. Coupable et timide, je parlai à
peine :
— Je m’excuse
sincèrement... C’est de ma faute la remarque de monsieur Passeur à tout le
monde. S’il vous plaît, pardonnez-moi.
— Je ne suis
pas Dieu pour pardonner. Attention à ne pas tomber dans de telles situations.
La vie est devant vous. Elle est pleine de passages secrets, de fosses cachées,
de nœuds, d’embuscades. Et quant à votre idée, je vais y réfléchir et on en
parlera. Au revoir, à demain.
Je ne savais pas où
aller jusqu’au matin. Je n’ai pas eu la force d’aller voir Georgi Bakalov et
d’admettre mon erreur. Chercher des amis et leur avouer dans quelle situation
difficile je m’étais empêtré devant l’homme Dullin, à qui je ne devais que
gratitude ? Je n’ai pas trouvé nécessaire d’embêter qui que ce soit avec
mes tourments. Je suis resté seul avec mes questions et mes remords.
Le lendemain matin,
vingt minutes avant la répétition, j’ai pris place dans le salon. Nous avons
échangé des salutations ordinaires avec les personnes présentes et celles qui
arrivaient. Certains d’entre eux ont montré un changement envers moi. Certains
étaient plus gentils, d’autres plus modérés.
Millet m’a rassuré
sincèrement :
— Tu connais
ton erreur. C’est le plus important. Tout le reste ira bien. Question de temps.
ÉMIGRANT
EN BELGIQUE
Comment la relation
enseignant-élève se développerait-elle à l’avenir ? Le temps, juge implacable,
a laissé cette question sans réponse. Parce que... un beau matin de l’été 1928,
réveillé en sursaut par de grands coups à la porte, à ma question « Qui
est là ? », j’ai reçu la réponse : « Police,
ouvrez ! »
Un petit policier
trapu aux cheveux roux avec une courte moustache noire entra. Il me tendit
silencieusement un message pour me présenter le lendemain à la préfecture de
police, escalier E, à l’office des étrangers.
— Vous devez
venir demain. Sinon, ils vous amèneront avec des gardes. Vous demanderez
l’inspecteur Roger.
Je pressentais que
cette visite matinale de la police ne me ferait aucun bien. Le lendemain matin,
à l’office des étrangers, le même policier m’a confisqué mes papiers d’identité
et m’a remis en retour un avis d’expulsion de France. Date limite pour quitter
le pays — une semaine. J’ai fait semblant d’être étonné d’une telle mesure
envers moi, « une personne qui ne se mêle pas de politique ». Le
policier me demanda si j’avais participé à la grève dans l’atelier d’un certain
Goretsky. Surpris, je n’ai rien pu dire, mais j’ai réalisé que me défendre
serait inutile.
Dans l’escalier,
l’enquêteur de police « objectif, humainement juste » que Joro et moi
avons continué à louer partout et tout le temps, a émergé dans mon esprit.
Quatre ou cinq autres Bulgares ont reçu des invitations similaires à se séparer
de la France, dont Naiden, Joro et Nikola Zhechev, un boulanger de Pazardzhik.
Ce soir-là, au café Aux Lys et dans tous les cafés de la place des Fêtes, la
nouvelle était vivement commentée, mais pas toujours avec la compétence
nécessaire. Des prédictions étaient formulées : « tout le monde va
être expulsé », des recommandations – « nous devons garder le
silence », des conseils – « il vaut mieux retourner en Bulgarie,
comme Toushé Chopov, à qui ils n’ont rien fait, il a ouvert un café, il vit
librement », etc.
Aucune des personnes
concernées n’avait l’intention de retourner en Bulgarie. Chacun trouvait des
raisons de poursuivre son séjour à l’étranger. Naiden, Nikola Zhechev et moi
avions décidé de déménager temporairement à Bruxelles. Notre objectif était de
disparaître temporairement des yeux de la police parisienne. Il était inutile
de demander des visas réguliers pour la Belgique : aucun des pays voisins
n’acceptait les gens dans notre cas, expulsés de France. Après avoir pris
connaissance du régime, du laxisme en vigueur à la frontière franco-belge, nous
avons décidé de la franchir illégalement.
Le poète Nikolai
Hrelkov et le séminariste de gauche Ivan Marinski sont venus nous accompagner à
la gare du Nord. Minuit approchait. Un vent vif de février soufflait. Je
n’avais pas bien dormi depuis plusieurs nuits et j’étais plus gelé que les
autres. Hrelkov eut pitié de moi, enleva le manteau de son dos osseux et
m’enveloppa de force. Il était jaune-vert, tissé à partir d’un manteau de
différentes parties, et avait une histoire. Le poète l’avait reçu en
Yougoslavie en tant qu’immigrant politique. Probablement le manteau appartenait
à un géant monténégrin, car sur Hrelkov il lui arrivait sous les genoux, et sur
moi — jusqu’aux chevilles. À Paris, le poète n’a pas pu se débarrasser de lui.
Il ne pouvait toujours pas réunir ou trouver assez d’argent pour un imperméable
ordinaire. Contrairement aux parisiens bornés, le tuberculeux Nikolai portait son
manteau jusqu’à la fin du printemps. Lorsqu’il était de bonne humeur, Hrelkov
s’enveloppait du manteau comme d’une pèlerine et chantait des extraits de l’air
de Méphistophélès...
Nous sommes arrivés
à Bruxelles tôt le matin. Les principales personnes présentes du grand
boulevard Adolf Max qui part de la gare, étaient les nettoyeurs d’ordures et
les nettoyeurs à jet d’eau. Quelques brasseries et cafés servaient des
collations à de rares clients. Des camions transportaient et déchargeaient des
pots à lait devant les maisons. Des tramways avec des lève-tôt passaient
rapidement.
Nous avons marché
jusqu’à la première adresse : Théodore
Angheloff — Bojanata, ma connaissance, à la voix
puissante, dont j’avais fait la connaissance, lors d’une nuit mémorable passée
à la gare de Levunovo. Nous avons tourné à gauche de la place Saint-Lazare pour
chercher la rue Verte.
Catastrophe !
Bojana aurait quitté l’appartement deux semaines plus tôt sans donner sa
nouvelle adresse. Et nous lui avions écrit cinq jours avant. Naiden s’orienta
rapidement :
— On va jurer
plus tard. Il y a toujours encore de l’espoir. Nous avons une deuxième adresse.
Immédiatement à sa recherche. Car si de nouveau on tombe sur un os, on chantera
« Ouvre-moi, ma chère mère, la terre noire ».
La discussion a été
courte. La décision ferme — prendre un taxi, à pied on va se perdre.
La deuxième adresse
était sur la rue des Franchises, près de l’avenue Van Overbeke. Nous n’avions
aucune idée de la distance qui nous séparait de la rue que nous recherchions.
Nous sommes tombés sur un chauffeur honnête qui nous a déposés assez rapidement
au numéro indiqué.
Vers dix heures
l’ami Pijo, un ancien athlète, est arrivé. Nous le connaissions depuis Paris,
où nous travaillions ensemble dans l’atelier du Serbe Simich. Il a reçu la
lettre trois jours plus tôt et s’est rendu compte que nous ne venions pas pour
admirer la beauté de la capitale belge. Pour travailler, c’était facile. Au
début, nous pourrions travailler dans son atelier, puis nous pourrions choisir.
Il ne pouvait pas nous aider auprès des autorités belges. Il faudrait voir avec
Bozhana et l’avocat Dr Zlatev — ils savaient comment fournir des papiers pour
des gens comme nous...
Quand je suis arrivé
dans la capitale belge, j’ai constaté la présence de communistes, voire de septemvriitzi, mais il n’y avait pas
d’organisation communiste. Trois d’entre eux : le Dr Zlatev — un avocat de
Sofia, Ruskov — un employé de banque de Stara Zagora et Georgi Rizov — un
tailleur de Dupnitsa, se sont rencontrés une ou deux fois, mais n’ont pas
réussi à établir une vie organisationnelle régulière. Ruskov et Rizov se sont
rangés délibérément en dehors de l’organisation, car eux, les septemvriitzi, ne voulaient pas que lui,
l’avocat, soit leur secrétaire. Et le Dr Zlatev avait déjà noué des liens avec
les communistes belges. Il accusait ses deux camarades d’avoir du mal à payer
leur cotisation et de ne pas collecter suffisamment d’aides pour les victimes
de la terreur blanche. Les trois avaient la même opinion et la même attitude envers, Théodore Angheloff
— Bojana, ils le considéraient comme un camarade élevé et honnête, mais bien
que septemvrietz[29],
ils le soupçonnaient de ne pas avoir encore rompu avec son anarcho-communisme
et ne lui proposaient donc pas de rejoindre le parti. Deux autres Bulgares se
sentaient communistes : le tailleur Vladikov, un vieil homme borné qui
refusait catégoriquement de rejoindre le groupe jusqu’à ce que le PCB ne
punisse les responsables de l’erreur du 9 juin, et Boris Trakiiski, un
cordonnier qui avait participé au passage à tabac des ministres fascistes Kulev
et Vazov à Paris, extradé en Union soviétique et revenu de là-bas de son plein
gré.
Un gros travail de
préparation a dû être fait, jusqu’à ce que tous ces camarades donnent leur
accord pour se retrouver en une, voire deux, voire trois rencontres. Après
quelques douleurs d’enfantement, un accord général a été conclu pour créer un
groupe communiste pour aider le Bureau des Affaires étrangères du Comité
central du Parti communiste bulgare et la Commission d’émigration du Comité
central du Parti communiste belge. L’ouvrier peintre et ancien enseignant Théodore Angheloff a été accepté comme membre du Parti
communiste belge dans l’approbation générale. Avec du zèle dans ses grands yeux
bleus et de la conviction dans sa voix grave, le septemvrietz Bojana a fait la déclaration suivante :
— Merci,
camarades, pour la confiance de m’accepter comme un égal entre vous.
Aujourd’hui, je suis né comme un combattant communiste. En tant que communiste
conscient, j’exécuterai toutes les décisions du parti. Je suis prêt à donner ma
vie pour l’idéal communiste[30] !
Notre groupe menait
une vie régulière. Nous avions convoqué des assemblées générales de la colonie.
Nous avons collecté des aides pour les prisonniers politiques en Bulgarie. Nous
avons organisé des réunions communes et des soirées littéraires et musicales
avec les camarades yougoslaves dans le quartier Vilward, avenue Depage.
En tant que membre
du Parti communiste belge, chacun de nous était affecté à une section de
quartier distinct. Nous sommes entrés dans la vie et les luttes des communistes
bruxellois. Trois d’entre nous — le Dr Zlatev, Bozhana et moi — avions été
invités à notre grande surprise lors d’une réunion des militants du parti
bruxellois. Zlatev nous a expliqué qu’il avait déjà assisté à de telles
réunions à plusieurs reprises et que la composition des personnes présentes
changeait constamment. À cette occasion, il nous a présenté la situation des
effectifs de l’organisation bruxelloise. La grande majorité de son personnel
était constituée d’étrangers.
Il ne fallut pas
longtemps avant que je sois recruté comme membre du Comité Exécutif de l’Aide
Rouge Belge. Le secrétaire du comité était la camarade Janka, une Polonaise
mariée à une camarade belge.
ORATEUR
INVOLONTAIRE
À l’automne 1928,
certaines mines de la région de Charleroi se mirent en grève pendant plus d’un
mois. L’aide collectée jusqu’à ce moment ne répondait pas aux besoins
croissants des mineurs en grève et de leurs familles. Lors d’une réunion du
comité exécutif de l’Aide Rouge, il a été décidé d’envoyer un camarade
responsable sur les lieux pour renforcer l’action de secours. Tous les yeux se
sont braqués sur moi, le nouveau venu. Avec une sympathie mal dissimulée pour
moi, Yanka m’a proposé la tâche. J’ai commencé à marmonner quelque chose, mais
cela n’a pas empêché les autres d’approuver sa proposition.
Descendant après la
réunion au café du peuple de la rue Laeken, dans une conversation privée et sur
un ton intime et amical, la petite Yanka, rougeâtre et mobile comme le mercure,
s’est plainte à moi de la composition intellectuelle petite-bourgeoise du
comité avec laquelle elle était forcée de travailler. Elle m’a révélé la lutte
existante entre les « vieux » et les « jeunes ». Elle a
défendu les jeunes et accusé les vieux de venir du Parti social-démocrate de
Vandervelde et d’apporter avec eux du lest réformiste dans le parti.
En partageant ces
réflexions et d’autres, Yanka a poursuivi l’objectif de me présenter l’essence
de ma mission. La situation était telle que nous, les étrangers, devions aider
les camarades belges à remettre le parti sur pied et le conduire sur des voies
véritablement révolutionnaires…
J’ai passé la nuit à
écrire fébrilement. J’ai esquissé le discours supposé. Si je devais le lire, il
pourrait un peu marquer les esprits. Mais les consignes de Yanka étaient
explicites : « Tu ne dois en aucun cas prendre des notes écrites
lorsque tu leur parles. Les mineurs n’aiment pas les personnes livresques. Ils
les considèrent comme des bureaucrates et ne leur font pas confiance. »
Je suis arrivé dans
la zone minière Borinage-Charleroi dans la soirée. Jusque-là, je n’avais vu ni
visité aucune mine. Toutes mes idées sur les mineurs et leurs maisons venaient
du roman Germinal d’Émile Zola et de
la contemplation en musée des sculptures de Constantin Meunier et des peintures
de Pierre Paulus de Châtelet. Ma première impression fut que je quittais un
paysage naturel pour entrer dans une nature artificielle : au lieu de
collines envahies de verdure, je voyais d’énormes tas de scories
fumantes ; au lieu d’arbres – des poteaux électriques et des
lanternes ; au lieu d’une brume transparente avant le coucher du soleil —
un épais brouillard, des tours et des cheminées fumantes, percées çà et là par
les flammes jaunes du coucher du soleil.
Je m’arrêtai dans la
ville de Mariemont, située sur une prairie vallonnée et entourée de plateaux à
coke, de hauts fourneaux, d’usines sidérurgiques et faïencières. Le camarade
Hippolyte Delmelle, responsable de région de l’Aide Rouge, m’a accueilli avec
une satisfaction évidente. Je lui tendis la lettre de Yanka, qu’il lut
rapidement. Il m’a tutoyé et m’a sauvé de diverses introductions ennuyeuses et
protocolaires.
— J’attendais
avec impatience un camarade du centre. Ici, nous avons épuisé toutes les forces
et le personnel locaux. Il y a une certaine retenue de la part des mineurs.
Nous devions leur présenter une nouvelle personne. Ils viendront te chercher,
tu verras. En tant que délégué du Centre, tu peux décrire une partie de la
situation internationale. En tant qu’étranger, tu ne dois pas t’attarder sur
les événements politiques de notre pays, même si la grève en dépend
directement. C’est ce que je ferai pour ma part, quand je dirai à la fin le
discours de clôture.
Chemin faisant,
Hippolyte m’a mis au courant du déroulement de la grève, avec quelques
positions proches de la capitulation de la part d’un ou deux membres du comité
de grève. Alors que nous passions devant les ruines d’un couvent médiéval,
l’ancien professeur d’école, grand et avec un visage noble, m’a raconté le
contenu d’une pièce de Maurice Maeterlinck dont je n’avais jamais entendu
parler, Sœur Béatrice. L’écrivain a
utilisé une légende liée au monastère.
Le premier meeting
public a eu lieu à cinq heures de l’après-midi près d’un tas de déchets de
charbon. Plus de cinq ou six cents mineurs se sont rassemblés. Deux policiers
en uniforme parlaient à certains d’entre eux. Hippolyte Delmelle est monté sur
une estrade en bois de fortune et a ouvert le meeting. Il a parlé plus de dix
minutes. Des applaudissements timides ont été entendus ici et là.
Je ne peux pas me
souvenir exactement de ce que j’ai dit lors du premier meeting. C’est au-dessus
de mes forces. Par contre, je peux dire ce que j’ai ressenti et ce que j’ai
pensé pendant que les gens m’écoutaient. Les bons mineurs belges ! Ils ont
enduré la torture d’écouter des vérités alphabétiques que je répétais avec le
ton de Colomb qui découvre l’Amérique. Je me souviens clairement, ma tête
grondait comme un tube vide et je criais jusqu’à m’enrouer. À un moment je suis
tombé dans le genre des célèbres futilités françaises et je me suis
empêtré : « Camarades, unissons-nous pour gagner ! Et pour
gagner, unissons-nous. »
Fait intéressant,
les applaudissements étaient plus vifs qu’après le discours d’Hippolyte. J’ai
su tout de suite que les mineurs belges étaient des gens polis. Présenté comme
l’orateur principal, je n’ai pas parlé plus de quinze ou vingt minutes. C’était
le plus que je pouvais donner en tant que conférencier.
Mon nouvel ami belge
était également gentil et poli. Il m’a encouragé en me disant que mes débuts
étaient satisfaisants, que le public m’écoutait avec une attention sans faille,
etc. Je doutais du mérite attribué, mais les assurances d’Hippolyte m’ont
encouragé à m’exprimer plus librement dans les communes de Maurage, Anderlues,
Bascoup, Bray et Ressaix. Au cours de la semaine, j’ai pris confiance en mes
capacités. Juste quand j’imaginais qu’il n’y avait plus de tempête dans ma tête
et ma mission se termina.
VOUS
NOUS SUIVEZ
De retour à
Bruxelles, j’ai repris ma vie personnelle et publique ordinaire. Le parti m’a
utilisé comme instructeur pour le comité municipal et comme membre du comité
exécutif de l’Aide Rouge. Presque tous les soirs, j’organisais des conférences,
soit dans telle section du parti, soit dans telle autre, soit dans les sections
de quartier de l’Organisation Auxiliaire. Cela n’empêchait pas une autre
activité : accompagné d’un ou d’une camarade belge, d’entrer dans les restaurants,
les cafés ou les clubs populaires du Parti social-démocrate pour distribuer
l’organe du parti Drapeau Rouge ou
des pamphlets politiques. Il n’était pas rare que nous nous livrions à des
débats sur des questions internationales d’actualité.
Un soir, mon ami
belge et moi faisions notre tournée habituelle. Nous venions d’entrer dans un
restaurant près de la Bourse et nous faisions le tour des tables lorsque quatre
gardes en uniforme et un policier en civil ont fait irruption après nous. Le
policier en civil a crié : « Police. Tout le monde montre sa carte
d’identité ». J’ai cherché une issue, mais il était trop tard. L’un des
gardes se tenait déjà à l’entrée des toilettes. J’ai présenté mon passeport
bulgare. J’ai essayé de faire croire que j’étais venu récemment et que je
n’avais pas encore reçu de carte d’identité. Le policier en civil m’a
dit :
— Vous
nous suivez.
Avant de quitter le
restaurant, j’ai demandé à ma camarade d’informer notre groupe de ma détention.
Je n’étais pas seul
dans la voiture de police appelée panier à salade. En face de moi se tenait une
jeune femme découragée, probablement une prostituée. Les cinq ou six autres
hommes me semblaient être mes confrères — des étrangers de différentes nations.
Tout le monde était silencieux. Le panier démarrait et s’arrêtait non seulement
devant les restaurants et les cafés, mais aussi au milieu des rues, et comme un
vrai sac de ménage, il se remplissait de plus en plus de pièces. Deux très
jeunes filles montèrent, poussées par les poings peu tendres des gardes. Elles
protestèrent et répétèrent plusieurs fois :
— Nous sommes
régulières. Si c’est pour votre plaisir, merci de payer. Gratuit, quand les
poules auront des dents.
Le garçon blond de
mon âge assis à côté de moi m’a demandé :
— Quelle
nationalité ?
Je lui ai répondu et
demandé à connaître la sienne. Il s’est avéré être un Polonais, étudiant à
l’Université de Gand, avec des papiers irréguliers.
Le hall du
commissariat était plutôt correct : propre, balayé, chaises rangées,
portraits royaux aux murs. Les gardes, bien nourris, jouaient aux dominos,
fumaient, lisaient les journaux. Avec l’étudiant polonais ils nous ont poussés
dans une pièce sombre. Un colocataire nous y attendait déjà. Il venait de l’île
de Madagascar, serveur de profession, travaillait sans droit, et avait été
amené ici. Assez jeune également. Le Polonais et moi avons essayé de nous
asseoir. Le Malgache nous a expliqué que le sol était en tôle et qu’il était
surélevé comme un dôme pointu au milieu et fortement incliné sur le côté. Il
était impossible de s’asseoir normalement. Et pourtant nous avons bien dormi.
Le lendemain, nous
avons de nouveau été poussés dans le panier à salade et conduits à la prison de
Saint-Gilles au centre de la capitale. Prison moderne préventive. Ils nous ont
indiqué les cellules. C’étaient des cages grillagées ouvertes sur cinq côtés.
Le plafond était le même mur en treillis que les quatre autres côtés. Chaque
prisonnier voyait trois voisins, deux à gauche et à droite et un devant. Mais
eux aussi surveillaient tous ses mouvements. La salle était fortement éclairée
toute la nuit. Deux gardes par intervalles faisaient le tour des cages. Debout
à des endroits opposés, aucun mouvement particulier de la cinquantaine de
prisonniers n’échappait à leur vue.
Le programme
quotidien était strictement réglementé. Vous vous levez à 7 heures. Jusqu’à 8
heures, vous vous habillez et prenez votre petit-déjeuner. À 8 heures précises,
vous entrez dans une grande salle avec des bureaux. Des livres sont alignés sur
une grande table. Vous choisissez un livre et vous vous asseyez pour lire. Si
vous faites une sieste sur le livre et parlez à vos voisins, le surveillant
assis derrière l’estrade vous frappe avec un long bâton en bambou en
avertissement. S’il s’avère que tu es stupide et que tu ne comprends pas les
annonces de bambou, prépare-toi à passer trois jours à l’isolement. Pour moi,
ce point de correction est resté inconnu. Je n’ai pas parlé aux voisins, mais
c’était très difficile pour moi d’éviter de faire une sieste. Surtout à 11
heures du matin et à 3 heures de l’après-midi. La littérature qu’ils nous ont
offerte m’endormait aussi. Elle était surtout religieuse ou historique,
parsemée d’intrigues entre différents papes et rois.
Au déjeuner, nous
allions dans la salle à manger, alignés autour d’une longue table avec des
bancs en bois sur le côté. L’atmosphère était comme une pension de famille. La
nourriture : suffisante et appétissante. Bien sûr, comme à toutes les
tables belges, les éternelles pommes de terre bouillies présidaient aux
déjeuners et dîners. À 14 heures, nous nous asseyions à nouveau sur les bancs
et sous la contrainte, nous lisions et somnolions, somnolions et lisions
jusqu’à 18 heures. Pendant les deux heures suivantes, nous dînions et nous nous
rafraîchissions en nous promenant dans une étroite cour pavée entourée de hauts
murs de pierre. À 20 heures précises, nous étions emmenés dans les cages
grillagées. Nous faisions nos lits et nous nous couchions les yeux ouverts. Le
silence n’était rompu que par les pas lourds et constants des gardes et le
bruit des trousseaux de clés. Parfois, un farceur courageux toussait
excessivement et sa toux infectait la plupart de ceux qui étaient couchés. Le
concert de toux exaspérait les gardes non musicaux. Il y avait des soirs où les
prisonniers, soudain accablés par un éternuement bruyant, donnaient un concert
d’éternuements. Le but était d’irriter les nerfs des gardiens et de secouer les
couches d’ennui de la prison.
Nous n’avons comparu
devant aucun tribunal. Nos peines ont été annoncées dans la salle de lecture
par le directeur de la prison. Nous trois, nous avons été condamnés à deux
semaines de prison. Ensuite, nous serions expulsés de Belgique. Où ? Nous
allions l’apprendre le dernier jour.
Ce jour arriva
relativement vite. Un après-midi, un gardien inconnu a lu les noms d’environ 20
d’entre nous dans la salle à manger et nous a dit de monter dans les cellules,
de faire nos valises et de descendre dans la cour. Ils nous ont mis dans le
panier à salade et nous ont enfermés. Par les interstices des volets de fer,
j’essayais de garder les images fugitives de la capitale belge, que je croyais
voir pour la dernière fois. À la gare, la moitié d’un wagon ordinaire de
troisième classe nous était réservée. Personne ne nous avait dit quoi que ce
soit sur le but du voyage, mais nous le savions tous : nous étions chassés
de Belgique.
LE
RÊVE DU PROLÉTAIRE CHINOIS HOOK
Le train s’est
arrêté en gare de Namur. On nous a fait attendre dans une pièce à côté. Nous
formions tous les trois un groupe à part avec le Malgache et le Polonais. Les
policiers nous ont séparés sans ménagement.
À notre descente du
train, la journée touchait à sa fin. Ils nous ont mis dans des voitures de
police découvertes. Nous n’avions pas d’autre choix que de faire connaissance
de la ville. De petits restaurants, cafés et autres commerces brillaient ici et
là. Certaines vitrines ont attiré notre attention par leur éclat. De rares
piétons dans les rues étroites. Une ville de campagne tranquille qui se prépare
à dormir à cette heure du début de soirée.
Nous avons traversé
un pont large et long sur la Meuse. Les eaux calmes reflétaient les lumières
déchirées du soir et, oh, une vision merveilleuse, les hauts murs et les tours
d’un château médiéval illuminé de partout s’assemblaient au fond. La citadelle
de Namur ! Bien que pendant un court instant, nous avons pu sentir sa
sombre grandeur : sur une hauteur accidentée et vallonnée, d’épais murs de
pierre illuminés en contrebas, de hautes tours arrondies avec des meurtrières,
une grande porte voûtée avec des barreaux de fer.
L’intérieur de la
citadelle n’était pas moins impressionnant : une cour spacieuse parsemée
de grandes dalles de pierre, encore de hauts murs de pierre, encore d’immenses
tours arrondies. Derrière les colonnes des longs couloirs se trouvaient des
serruriers et des prisonniers transportant de la nourriture dans de grandes
marmites. Nous étions dispersés dans différentes cellules. Notre trio s’est
retrouvé enfermé dans une pièce relativement large avec un plancher en bois et
des murs écaillés comportant d’innombrables inscriptions et figures. Il n’y
avait aucun lit, aucune paille.
La porte s’ouvrit.
Un serrurier sec, gros et moustachu nous a demandé des gamelles ou des
assiettes pour la nourriture. Nous n’en avions pas. Il a envoyé quelque part le
prisonnier-cuistot qui l’accompagnait. Quelques minutes plus tard, l’homme en
tenue de prisonnier nous a lancé trois boites de conserve vides et trois
cuillères. Nous les avons regardées — relativement propres. Le cuistot
remplissait les boites à ras bord de petits pois et de riz trempé dans du
saindoux. La quantité de nourriture était suffisante, la qualité — trop grasse
et salée. Aucun de nous ne pouvait tout manger. La question de l’eau s’est
posée. Nous espérions qu’ils passeraient et nous en apporteraient. Nous avons
versé le reste d’une boîte dans l’autre et avons attendu que le cuistot se
présente. La porte s’ouvrit et à la place nous vîmes un petit chinois entrer.
Il portait deux boîtes de conserve, une avec de la nourriture et l’autre avec
de l’eau. Dans un français assez malmené, il nous a informés que nous ne
recevrions pas d’eau et nous a offert de son eau. Nous avons accepté avec
plaisir l’offre généreuse. Notre humeur s’est améliorée. Ça démangeait sous nos
langues et nous étions prêts à chanter, mais nous avons choisi de nous
intéresser au sort du nouveau colocataire. Il se recroquevilla dans l’un des
coins près de la porte, enroula ses bras autour de ses genoux et fixa le mur
opposé. Il ne toucha pas à sa nourriture. Le Polonais s’approcha de lui et lui
demanda :
— Pourquoi ne
dînes-tu pas, tu n’es pas malade ?
— Je n’ai pas
d’appétit.
— C’est mauvais
alors. Si, en plus de la liberté, une personne perd l’envie de manger, sa situation
devient très difficile.
— La mienne n’a
pas été facile depuis longtemps.
Nous lui avons
demandé presque en compétition d’où il venait, comment et pourquoi il était
tombé entre les mains de la police, comment il s’appelait, s’il avait des amis
à l’extérieur, s’il était marié et des dizaines d’autres questions similaires.
Enfin, il nous a raconté son histoire autour du monde avec des mots simples.
Il s’appelait
Hook-Kehua. On l’appelait simplement Hook. Il était né à Shanghai. Son père
était pêcheur. Dix-huit enfants vivaient dans la maison — 13 garçons et 5
filles. Il était troisième en ligne. Ils vivaient dans la misère et la famine.
Il travaillait comme pousse-pousse. Il a commencé à tousser et a eu peur. Il
savait que dès que la toux touchait quelqu’un, elle l’empoignait et l’emmenait
au cimetière. Il a décidé de fuir la Chine pour ne pas mourir. Leurs voisins,
les garçons, ses amis, étaient déjà partis en France. Ils lui écrivirent :
« Nous vivons ensemble. Il y a du travail pour tous. Viens. Tu vivras avec
nous ». Viens ! Mais comment ? Il n’avait pas d’argent pour un
billet. Même s’il avait retourné les poches de toute la famille, vidé tous les
tiroirs de la maison, il n’aurait jamais ramassé autant d’argent. Il a essayé
de se faufiler dans deux ou trois paquebots. Ils le trouvaient à chaque fois et
le jetaient comme un chiffon. Des amis marins lui ont montré un moyen de
partir. Ils lui proposèrent de le clouer dans une caisse et de le mettre au
fond du paquebot. Là, il jetterait du charbon dans les fourneaux. Il a été
averti — s’il était retrouvé en haute mer, le capitaine avait le droit de le
jeter aux requins comme nourriture. Il n’avait pas le choix — ici la toux, là
les requins. Quoi qu’il en soit ! Même les requins c’est mieux, car une ou
deux fois et c’est fini. Ils ont voyagé pendant plus de deux mois. Devant le
port de Marseille il s’est replié dans la caisse, a été cloué par ses camarades
et emmené dehors. Il a dû attendre toute la nuit pour que ses amis viennent
pousser les caisses au-dessus pour le libérer. Ils l’ont trouvé ni vivant ni
mort. Ils l’ont emmené dans leur dortoir. Il a bu du vin pour la première fois.
Comparée à Shanghai, Marseille lui apparaissait comme une ville petite et
tranquille. Ses amis l’ont emmené travailler avec eux dans une briqueterie près
de la ville. Chaque matin, ils embarquaient dans un bus qui les emmenait à
l’usine. Le travail était dur, fatigant, mais ils gagnaient beaucoup d’argent.
Au troisième mois, il envoya la première somme à son père. Tout se passait
bien. Le dimanche matin, ils se lavaient et repassaient, et le soir ils
allaient au cinéma. Tout ce dont il avait besoin était une carte d’identité.
Ses camarades lui assurèrent qu’ils attendaient le retour d’un Français de
Paris, il lui fournirait des papiers. Hook n’avait qu’à économiser de l’argent
parce qu’un ou deux fonctionnaires demandaient un sérieux pot-de-vin. Un matin,
des gardes montèrent après eux dans le bus. Vérification. Ils voulaient les
cartes d’identité. Il y avait eu un meurtre cette nuit-là, et maintenant ils
vérifiaient tous les points de sortie de la ville. Il fut détenu et condamné.
Il passa deux semaines en prison à Marseille et fut expulsé de France.
Où ? On lui proposa l’Italie et la Suisse. Il choisit la Suisse. Il avait
entendu dire qu’il y avait beaucoup d’étrangers là-bas, il y avait la liberté,
c’était un pays riche. Il fut arrêté à la frontière et jeté directement en
prison. Il ne savait toujours pas où il était. Soi-disant un pays riche et
libre, mais les prisons étaient très mauvaises. Il devait payer sa propre
nourriture. Deux semaines plus tard, on lui a demandé où il avait des amis. Il
répondit en France. Il espérait se faufiler sans se faire remarquer. Il s’est
trompé. Ils l’ont attrapé. Il a passé trois mois à la prison de la Santé. La
deuxième peine était de trois mois, la troisième d’un an. Pendant ce temps, il
écrivit à la légation chinoise pour qu’on lui fournisse des documents chinois.
Un greffier de légation est venu. Lorsqu’il apprit que son père était pêcheur et
comment il était venu en France, il l’abandonna, comme si les Chinois ne
fuyaient pas la Chine, mais y travaillaient pour le bien de leur patrie. Ses
amis ont écrit que le Français était venu, et s’il pouvait les rejoindre, tout
irait bien. Il n’a pas pu les atteindre. Il a été jeté à la frontière
allemande. Il a immédiatement envoyé une lettre à la légation chinoise à
Berlin. Ils ne lui ont pas répondu. Deux semaines plus tard, les Allemands
l’ont remis aux Hollandais. Il a été expulsé en Belgique.
— Je
suis là maintenant. Si je suis expulsé vers le Luxembourg demain, je
saurai : encore deux semaines. Si les Allemands m’attrapent, de nouveau
trois mois. C’est ma situation. Je ne sais pas combien de temps je vais faire
le tour des prisons. Comment je vais m’en sortir, je ne vois pas. Vous rêvez de
différentes choses et peut-être de femmes. Je ne rêve que d’une chose : me
recroqueviller dans un coffre et retourner à Shanghai, conclut le bon Hook,
d’une voix désespérée.
L’histoire ne
pouvait manquer de nous émouvoir. Hook était dans un cercle vicieux. Il fallait
l’aider. Il avait un peu d’argent — ses amis marseillais ne l’oubliaient pas.
Dans la discussion entre nous trois, différentes opinions ont émergé. Le
Malgache Kamara a fermement déclaré :
— Si les légations
refusent de s’intéresser à lui, que Dieu lui vienne en aide. Qu’il se prépare à
se laisser pousser la barbe jusqu’aux genoux et à réclamer le titre de
« Prisonnier éternel pour rien ».
À mon tour, j’ai
fait de mon mieux pour encourager Hook. Je lui ai dit l’adresse de l’Aide Rouge
dans la ville luxembourgeoise d’Esch, adresse que les camarades bulgares
m’avaient donnée lors d’une visite à la prison de Saint-Gilles :
— Souviens-toi
bien de l’adresse. Nous y annoncerons ton nom. Si tu n’arrives pas à t’y
rendre, écris à tes camarades pour qu’ils te rendent visite en prison. Ils
viendront certainement. L’Aide Rouge a été créée pour protéger les victimes de
la terreur fasciste, mais elle a aussi des objectifs humanitaires.
Il est vrai que les
projets des détenus ne coïncident jamais avec les intentions des autorités
pénitentiaires. Le lendemain matin, les choses ne se sont pas déroulées comme
nous le souhaitions. Notre groupe de trois a reçu un honneur particulier. Nous
étions séparés dans un compartiment fermé du wagon. Trois gardes en uniforme
paradaient à l’intérieur du compartiment. Nous nous sommes regardés – c’était
clair, ils nous considéraient comme une marchandise spéciale. Nous avons essayé
de parler à nos compagnons imposés. Un fiasco complet. Ils ont commencé à jouer
à la belote et au début ils ne nous ont pas dit un mot. Mais après avoir
échangé quelques mots en flamand, l’un d’eux, le plus jeune, proposa qu’on lui
donne de l’argent pour qu’il nous achète quelque chose pour le petit déjeuner.
Le train s’est
arrêté à la frontière belgo-luxembourgeoise. Deux des gardes quittèrent le
compartiment, et le troisième se tint dans le couloir devant la porte, comme
une statue de marbre. Ce n’était pas la peine de lui demander quoi que ce soit.
Nous avons écouté, jeté des coups d’œil par la fenêtre. Des gens comme nous
sont sortis du wagon. Le Chinois Hook nous a adressé un signe désespéré.
C’était un signe de séparation.
Plus d’une
demi-heure passa. Le train ne repartait pas. Des passagers ordinaires avec des
bagages légers montaient dans le wagon. Le garde ne bougeait pas de sa place.
Il ne faisait qu’expliquer de temps en temps aux femmes et aux hommes que le
compartiment était occupé. Enfin de la vapeur s’échappa des wagons. Le sifflet
de la locomotive retentit. Le garde muet se tourna vers nous.
— Messieurs, je
vous dis adieu. Faites attention de ne plus nous revoir.
Il sursauta presque
au moment où le train partait déjà.
Nous étions habitués
aux surprises. Cependant, nous ne nous attendions pas à nous voir, pour ainsi
dire, libres. Nous avons regardé dans le couloir du wagon — pas de garde. Nous
avons dû reconsidérer notre situation. Nous en sommes vite arrivés à la
conclusion que la police belge avait décidé de nous remettre, tous les trois,
directement entre les mains de leurs collègues luxembourgeois ; elle a dû
annoncer notre arrivée et nous serons arrêtés à la gare de Luxembourg. Que
faire ? Le Malgache Kamara a proposé de descendre à une gare quelconque.
Oui, mais... Le train s’arrêtera-t-il ou est-il direct ? Tadek s’enquit
rapidement. Le train ne s’arrête que dans la capitale. Au bout d’une heure et
demie ! Nous avons utilisé notre temps pour réfléchir, nous avons élaboré
différentes combinaisons, nous avons admis la possibilité de toutes sortes d’options.
Nous avons fait un plan : changer nos manteaux et nos chapeaux, car ils
ont sûrement signalé notre apparence ; à tout prix il faut quitter le
compartiment où ils nous chercheront ; il faut aller dans différents
wagons. Si nous sortons de la gare avec succès, nous nous retrouverons au
premier salon de coiffure que nous rencontrons pour raser nos barbes de deux
semaines et avoir l’air de citoyens ordinaires. En dernier recours – rencontre
à l’Aide Rouge dans la ville d’Esch. Nous connaissions tous l’adresse par cœur.
Le train filait. Le
temps pressait. Je n’étais pas intéressé par le paysage. Debout sur la
plate-forme du premier wagon à côté de la locomotive, je considérais les
chances de briser l’embuscade policière.
Le sifflet de la
locomotive retentit. Il annonçait la capitale toute proche. L’idée m’a traversé
la tête : « Je dois boiter. Obligatoirement. » Le train est
entré dans la gare avec un rugissement de soupirs et de vapeur. J’ai attendu
qu’un petit groupe de passagers sorte sur le quai. J’ai sauté aussi et j’ai
immédiatement boité légèrement. Ce n’était pas une mauvaise idée, mais c’était
encore mieux de trouver un groupe de dos ou un dos plus large, pour se cacher
derrière eux. Un peu courbé et un peu boîteux, je m’accrochais presque au large
pardessus d’un monsieur grand et très bien habillé. Mon regard balayait ici et
là, mais j’approchais impétueusement vers la sortie. Je suivais les traces de
l’élégant monsieur. Kutsuk-kutsuk
j’ai traversé le hall rempli de passagers et j’ai sauté sur la place devant la
gare. Ce n’est qu’à ce moment-là que je me suis retourné et que j’ai vu Kamara
descendre les escaliers et me saluer discrètement. Je me suis arrêté et j’ai
regardé autour de moi pour voir Tadek. En vain. J’ai attendu Kamara. Il s’est
approché de moi et m’a dit :
— Sauvés.
Je lui ai demandé.
— Et
Tadek ?
— Et lui.
Regarde l’homme à la tête bandée. Vous êtes tous les deux des artistes.
Kamara et moi sommes
entrés dans le premier salon de coiffure. Tadek est entré sans pansement. Lors
de notre embellissement, nous étions silencieux et ne nous connaissions pas.
Dehors, dans la rue,
notre joie s’est déchaînée et nous nous sommes embrassés à la stupéfaction des
passants. Tadek a affirmé avoir vu trois civils et deux policiers en uniforme
se diriger vers notre wagon, le dernier. Nous nous sommes complimentés sur la
blague que nous avions faite à la police luxembourgeoise et avons ri de bon
cœur. Nous nous sommes sentis sauvés, libres, bien que sans papiers réguliers.
Nous étions tous les trois désolés pour Hook.
Le même jour, nous
sommes partis pour la ville d’Esch. Nous sommes arrivés à l’adresse indiquée
après 6 heures du soir. Le portier nous a demandé d’attendre pendant qu’il
faisait venir le secrétaire Jean Maurice. Le camarade secrétaire était un homme
d’une trentaine d’années, avec un air fiévreux dans ses yeux noirs. J’ai appris
plus tard qu’il avait une tuberculose diagnostiquée.
Jean Maurice nous a
fait plaisir :
— J’ai reçu un
message vous concernant de Bruxelles. Vous pouvez vous déplacer tranquillement.
Nous n’avons pas de cas où la police rechercherait les papiers de quelqu’un
dans la rue. Nous allons vous héberger dans des familles à nous. L’important
est que je sache combien de temps vous souhaitez rester ici et par quelle
frontière vous transférer.
Je lui ai expliqué
que nous voulions tous rentrer en France au plus vite. Il a promis de consulter
quelques connaissances le soir même, le lendemain il nous informerait de la
date et de la manière de franchir la frontière.
Les trois jours
passés dans la ville frontalière provinciale d’Esch auraient été terriblement
ennuyeux s’ils avaient été privés de deux choses : la chaleur humaine de
nos hébergeurs luxembourgeois et l’apparition de notre Hook.
L’amitié de trois
jours avec Jean Maurice m’a convaincu de l’existence d’une armée de millions de
communistes dispersés dans le monde. Les hébergeurs nous ont acceptés comme des
frères. Le nouvel ami nous a présenté la situation au Luxembourg. La propagande
politique et éducative parmi les travailleurs se heurtait à l’antisoviétisme et
à l’anticommunisme de la presse bourgeoise. Avec ses sermons de curé et ses
pamphlets, l’Église a également empêché la révolutionnarisation des masses. Les
camarades luxembourgeois connaissaient leur place et leur rôle : ils
cherchaient à maintenir éveillée la conscience révolutionnaire de la classe
ouvrière, afin qu’à un moment donné, lorsque des gouvernements progressistes
seraient établis en France ou en Allemagne, eux aussi puissent conquérir le
pouvoir de leur peuple.
Le deuxième jour,
Hook nous a surpris avec son sourire clair et ses yeux brillants. Nous étions
contents, presque plus que lui. Nous avons senti combien il était bon de faire
du bien à un innocent. Et lui, accablé de gratitude envers nous, nous a forcés
à acheter à ses frais des sucreries chères et des boissons raffinées. Et
pendant tout ce temps, il n’arrêtait pas de nous raconter comment il s’en était
sorti de l’embuscade policière à la frontière.
— Sur le no
man’s land, les gardes belges nous ont alignés. Ils nous ont donné un coup
de pied et nous ont chassés vers la frontière luxembourgeoise. Il y avait un
petit bosquet entre les deux frontières. Je me dirigeai vers le bois. Certains
m’ont suivi, mais avant qu’ils n’atteignent la forêt, les gardes les ont arrêtés
avec leurs sifflets. Seulement moi, j’étais allé assez profondément à
l’intérieur. J’ai grimpé sur un arbre aux branches épaisses. Je tremblais de
peur et il me semblait que je secouais l’arbre. J’ai attendu la nuit. Dans le
noir, je me suis glissé et j’ai atteint une gare. Le matin j’arrivai en train
dans la capitale. J’ai répété l’adresse d’Esch dans ma tête au moins dix mille
fois. Maintenant, que vous le vouliez ou non, je ne me sépare pas de vous
jusqu’à Paris.
Traverser la
frontière franco-luxembourgeoise n’était pas un problème. Le secrétaire de
l’Aide Rouge nous a gardés à Esch pendant quelques jours jusqu’à ce que notre
sympathisant, avec qui on devait parler, se tienne au poste frontière. Le
quatrième jour au matin, nous avons pris une route large et sablonneuse. À
environ 200-300 mètres de la frontière, Jean Maurice m’a fermement serré la
main et m’a souhaité bonne chance. Les camarades me suivaient à 30-40 mètres.
Hook me suivait en deuxième.
Le garde douanier
luxembourgeois s’est concentré sur le remplissage et l’allumage de sa pipe. Il
ne voulait délibérément pas regarder qui passait. Son homologue français ne
vérifiait jamais personne, puisque son confrère d’en face l’avait laissé
passer. Alors, en même temps que les ouvriers luxembourgeois, nous nous sommes
retrouvés tous les quatre sur le sol français.
Dans le train nous
avons embarqué en gare de Longwy, ville de grande métallurgie ferreuse.
À la gare de Paris,
Hook sembla sentir que c’était notre dernière rencontre. Notre étreinte était
une étreinte de frères. Les yeux du garçon chinois étaient larmoyants, les
miens n’étaient pas secs.
DE
NOUVEAU EN FRANCE
Je me suis présenté
à l’appartement de mon ami Milko Tarabanov, semi-étudiant, semi-ouvrier. Il
avait déjà choisi pour compagne de vie la Bessarabienne Lyuba, une belle
blonde, également semi-étudiante. Les deux vivaient dans un hôtel plutôt
misérable rue Jouye-Rouve dans le 20e arrondissement. Il n’y avait qu’un seul
lit étroit dans leur petite chambre.
Milko m’a
chaleureusement accueilli.
— Pour le
dîner, c’est clair. Nous t’offrons ce qui reste. Pour la nuit, nous devons
chercher un autre endroit. Je te suggère d’aller chez Ibrishimov, c’est un
vieux célibataire, il vit dans une maison privée sans portier, et demain —
nouveau jour, nouvelle chance. Avant tout, tu dois rencontrer Ivan Andreev. Il
remplace Boris Velev, qui est parti pour Leningrad.
J’ai toujours eu bon
appétit, même si je n’ai pas toujours trouvé quelque chose à manger. Ce
soir-là, mon appétit était tel que j’aurais pu avaler les hôtes eux-mêmes. À la
fin, après avoir dévoré tout ce qui était offert, Lyuba s’est excusée en
russe-bulgare-français : il ne restait que du pain, de l’ail et un peu de
chocolat. Non seulement parce que j’avais encore envie de manger, mais aussi
par envie d’être original devant le couple amoureux, j’ai commencé à avaler
l’ail et le chocolat en même temps. Mes amis se sont sentis désolés pour moi et
ont prédit que j’aurais certainement des maux d’estomac la nuit. En réponse,
j’ai développé la théorie des contrastes et déclaré que sans contrastes, la vie
perd sa couleur et son goût. Preuve : Milko — grand et mince, Lyuba –
petite et rondelette. La théorie et la plaisanterie n’étaient pas classe, mais
nous avons éclaté de rire amicalement.
Dans la rue Haxo,
j’ai cherché baï Veltcho Ibrishimov.
Sa petite chambre nue se trouvait dans une maison à cour intérieure, rappelant
nos auberges de campagne aux longues vérandas. Cet ancien enseignant des
villages thraces, participant au soulèvement d’Ilinden et aux troupes de Yané
Sandanski, fanatique social-démocrate et fervent partisan de l’idée d’une
fédération communiste balkanique, vivait comme un Spartiate. Il n’y avait pas
de lit dans sa chambre, seulement un petit poêle en fonte assez haut au milieu,
une petite table rectangulaire dans le coin avec plus de livres et de journaux
que de couverts. Tout le sol était recouvert du journal l’Humanité. Le vieux social-démocrate ne reconnaissait aucun autre
quotidien français. Près d’un mur, en face de l’unique fenêtre, les journaux
formaient un matelas. Notre Rakhmetov bulgare y dormait. Un vieux manteau
servait de couverture.
Veltcho Ibrishimov
ouvrit les mains et me dit :
— J’ai ça, je
t’offre ça. Si tu es un inconditionnel du matelas, cherche un autre endroit. Si
tu es révolutionnaire, tu resteras. Il faut cultiver les vertus
révolutionnaires non seulement dans les réunions, mais aussi dans la vie, entre
camarades... Le vrai révolutionnaire est un homme avec une majuscule. Ainsi, tu
dois savoir et t’en souvenir toute ta vie. Tu es jeune. Tu ne dois pas
t’imaginer que tu as attrapé Dieu par la barbe, mais tu dois écouter les plus
âgés. Tant qu’ils ne sont pas déliquescents, ils sont précieux. S’ils se
mettent à chanter sur une fausse note, crache et passe ton chemin. Rassemble
des forces pour ne pas leur ressembler, ni prématurément, ni jamais.
Jusque tard dans la
nuit, j’ai écouté les souvenirs personnels de baï Veltcho du soulèvement d’Ilinden, de sa campagne avec les
rebelles de Sandanski, de son rêve de vivre pour retourner dans son Dedeagač natal et se
régaler de poisson frais du lac Bistonis.
Nous avons rencontré
le représentant du Bureau de l’étranger du Comité central du Parti communiste
bulgare Andreev dans le luxueux café Weil près de l’église de la Madeleine. Il
était grand, mince, avec un visage maigre et pâle. Les conséquences d’une
tuberculose grave passée en Yougoslavie en tant qu’émigrant politique septemvrietz étaient encore apparentes.
Il m’interrogea sur la situation en Belgique, sur la vie et les manifestations
politiques de notre émigration. Après l’avoir brièvement informé, il m’a à son
tour mis au courant des moments les plus caractéristiques de la vie politique
en France et du travail politique auprès des Bulgares. Mais ce n’était pas pour
« nous éclairer » l’un l’autre que nous nous étions rencontrés. Le
responsable de l’émigration antifasciste m’avait évidemment appelé et pour
autre chose. Negli termina donc la conversation d’une manière très
professionnelle :
— Nous
avons assez parlé aujourd’hui. Le premier souci désormais est de te fournir des
documents réguliers sous un autre nom. On va t’aider. Avec un compatriote, on
va vous envoyer chez des camarades français à la campagne. De l’argent pour le
voyage et quelque chose en plus vous seront remis par l’organisation. Là, vous
devrez travailler pendant un certain temps, n’importe quoi, jusqu’à ce que vous
obteniez les papiers. Quand vous reviendrez, on reparlera... Tu as passé la
nuit dernière chez Ibrishima. Son appartement est sûr, même s’il semble dur.
C’est rien. Un révolutionnaire doit s’endurcir. Sois en bonne santé. Revenez
bientôt. Ici, le travail vous attend.
Après la séparation,
j’ai ressenti une sensation de gêne. C’est comme ça quand l’un des
interlocuteurs pense une chose et l’autre autre chose. Andreev s’intéressait à
l’afflux de personnel à Paris ; moi, honnêtement, je pensais au théâtre.
Je n’avais pas cessé de caresser le rêve de me livrer à mes occupations
théâtrales. Et maintenant — que s’est-il passé ? Au cours de cette première
rencontre, je n’ai pas eu assez de courage pour révéler honnêtement au camarade
responsable Andreev mon premier amour — le théâtre. J’ai eu un sentiment de
malaise pendant quelques jours.
DANS LE VILLAGE DE
SAINT-FÉLIX-DE-CARAMAN[31]
Nous avons voyagé
jusqu’à la ville de Toulouse avec Ivan Dyulguerov. En chemin, mon compagnon —
plus âgé que moi — m’a expliqué brièvement pourquoi il avait quitté la
Bulgarie. Après la répression du soulèvement de Septembre 1923, il a été chargé
d’acquérir des armes de toutes les manières possibles. Il a réussi à entrer en
contact avec son ancien camarade de classe, soldat dans un campement militaire
à côté de leur ville natale Panagyurichté. Ils ont fait un plan sur comment et
quand récupérer des armes de l’entrepôt et comment et où les cacher. Ils
étaient prêts à agir lorsque le soldat a été soudainement arrêté. Dyulguerov
est alors entré dans la clandestinité. La police a suivi ses traces. Pendant ce
temps, il a réussi à rejoindre Marseille via la Turquie et la Méditerranée et
de là Paris. Un long moment s’est écoulé et il n’a toujours pas reçu de papiers
réguliers. C’était différent chez nous.
— Le parti
social-démocrate, m’a-t-il dit, avait gagné de nombreuses municipalités
rurales. Là, nos conseillers étaient obligés de délivrer des documents aux
émigrants étrangers. Combien de combattants de la commune hongroise ont reçu
des papiers de ces communes !
Le secrétaire
fédéral du Parti communiste français à Toulouse à l’époque, Edmond Ginestet,
s’est excusé de ne pas pouvoir nous envoyer sur place immédiatement et de
devoir attendre quelques jours. Nous avons utilisé notre temps pour nous
familiariser avec la ville — une grande ville de province très ensoleillée et
relativement calme, beaucoup plus ordonnée et plus belle que notre capitale
d’alors. Nous avons également tenu plusieurs réunions avec le groupe étudiant.
Andreev avait prévenu l’association étudiante de Toulouse de nous accueillir
comme envoyés spéciaux de l’organisation communiste de Paris.
Près d’une semaine
plus tard, Sébastian Villen, le secrétaire de l’organisation du parti venu
spécialement pour nous, nous conduisit au village Saint-Félix de Caraman. Il a
décrit sa ville natale comme un petit village de plaine, assez calme, dont le
principal gagne-pain était la viticulture et la vinification. Il serait
difficile de nous trouver un emploi, mais il espérait l’aide d’un gardien sur
la voie ferrée en construction à côté du village. Le travail serait dur, mal
payé, mais pour l’instant il ne voyait pas d’autre issue. Obtenir des documents
ne serait pas un problème. Le secrétaire municipal était acquis à notre cause,
il votait avec une liste communiste à toutes les élections, il lui parlerait et
il était sûr de sa disponibilité pour nous servir.
Sebastian nous a
offert de son propre vin dans son propre établissement. Pour dissiper notre
évidente surprise (un patron communiste, et en plus d’un bistrot), il nous
expliqua qu’en fait tout appartenait à son père, un vieil homme trapu aux
cheveux roux, et qui vivait et travaillait pour lui en tant que célibataire
avec un salaire. Sebastian était un homme grand et en bonne santé avec des
joues rouges comme son père, et contrairement à son créateur, il portait une
petite moustache. Il a participé au massacre de 1914 et a été blessé au mauvais
endroit, il craint de perdre ses facultés viriles, déteste la guerre et, après
avoir lu Le Feu de Barbusse, devient
membre du parti communiste. Il était le premier communiste du village, mais
maintenant il y a environ 12 personnes. La plupart d’entre eux étaient de
petits exploitants, les autres travaillaient comme métayers. La police ne les
harcelait pas, mais les surveillait. Il n’y avait pas de poste de police dans
le village. Ce soir, tous les camarades viendraient au bistrot pour nous voir,
mais ils ne nous parleraient pas. Le père a également deviné qui nous étions,
mais il serait aimable. Par exemple, il a accepté que l’on passe la nuit chez
eux.
Le travail sur le
chemin de fer était vraiment dur. Ils nous ont donné une section de cinquante
mètres. Les rails et les traverses étaient déjà posés sur une fine couche de
gravier. À une distance d’environ deux cents mètres, nous devions transporter
du gravier supplémentaire dans des charrettes à bras en fer, l’étaler
uniformément sur les rails et entre les traverses, et remplir soigneusement
tous les endroits vides. Nous devions souvent choisir avec nos mains des
pierres appropriées et boucher les trous. Non seulement le soleil brillait et
tapait fort, mais il nous brûlait. Nulle part, il n’y avait un arbre pour
s’abriter à l’ombre. Au lieu d’eau, Sebastian mettait du vin avec nos
provisions de fromage et de salami. Le soleil à l’extérieur, la soif à
l’intérieur nous épuisaient tout au long de la journée de dix heures.
Pour tout le monde
autour de nous, le temps filait. Pour nous deux, il était au même endroit. La
fin du deuxième mois approchait et la fin de nos douleurs de travail n’était
pas en vue. Toulouse, le chef-lieu, gardait un silence obstiné et suspect.
J’avais soumis ma candidature avec une vraie photo de moi jointe sous un faux
nom. Il fallait faire quelque chose pour décamper du village hospitalier. Nous
avons eu recours à la noblesse du mensonge : mon frère en route
d’Argentine pour la Bulgarie est tombé malade à Paris ; il m’a écrit d’aller
chez lui. Nous avons convaincu Sebastian du mensonge. Il s’agissait maintenant
de convaincre le maire et le secrétaire qu’ils pouvaient nous délivrer les
documents, étant eux-mêmes absolument certains que la préfecture de Toulouse
nous enverrait l’autorisation. Nous sommes allés tous les trois à la
municipalité. Sebastian a innocemment confirmé la fable et les personnes
officielles ont donné l’acception attendue. La scène à laquelle nous avons
assisté restera mémorable. Le maire ordonna au secrétaire de s’asseoir et de
remplir les papiers. Le secrétaire s’est soudain avéré très occupé, car il
devait se rendre à la poste, avoir une conversation avec Toulouse, etc. Mais le
maire n’avait pas à s’inquiéter, il avait bien quelques minutes à sa disposition.
Voici le sceau, voici les formulaires, nos amis, c’est-à-dire nous, nous les
remplirons nous-mêmes et il ne restera que la signature et le sceau, ce que
monsieur le maire a fait magnifiquement, avec beaucoup d’habileté et de grâce.
Le secrétaire n’était pas encore parti que je m’étais mis au travail comme
commis dans la commune de Saint-Félix de Caraman.
C’est une vieille
vérité : plus la bureaucratie est débile, plus les conspirateurs respirent
et vivent facilement. Et la bureaucratie estropiée, maladroite, stupide a
existé et continuera probablement d’exister encore longtemps. J’espère que les
conspirateurs de toutes sortes ne durent pas si longtemps !
Sebastian, deux ou
trois de ses camarades et moi-même nous nous sommes séparés comme de vieux
amis. Nous avons quitté ce village comme quelque chose de lointain et de natal.
Sebastian nous avait fait découvrir l’histoire du village qui, bien avant nous,
avait abrité des centaines de bogomiles. Cela s’était produit en 1167, lorsque
les opposants au pape s’étaient réunis dans le village pour un concile
paneuropéen. À la tête de la lutte anti-papale se trouvaient les Albigeois ou
les Cathares qui, sous l’influence des Bogomiles chassés de Bulgarie et
installés dans le sud de la France, adoptèrent la doctrine bogomile contre les
rois, les nobles et le haut clergé. Le concile a ajourné ses réunions en
attente du savant Bogomile Nikita. Il devait parcourir le chemin de la Bulgarie
au village français pour interpréter un certain dogme de l’Évangile, sur lequel
les participants au concile méditèrent en vain pendant plusieurs semaines. Lors
de ce concile, la question aussi d’un nouveau pape pour s’opposer au
représentant romain de Dieu a été soulevée. L’autorité de l’hérésie bogomile
était si grande que les participants au concile étaient prêts à élire un homme
parmi les bogomiles bulgares comme pape de la nouvelle Église qatarienne.
DE
NOUVEAU DANS LA CAPITALE FRANÇAISE
Nous sommes revenus
à Paris en 1929. La crise financière mondiale à New York a été le signe avant-coureur
de forts bouleversements sociaux en Europe et en Amérique. De puissantes grèves
de masse ont bousculé la tranquillité de nombreux patrons de France,
d’Allemagne, d’Angleterre, d’Italie, des États-Unis et du Japon. En même temps,
ils ont éveillé et nourri l’espoir d’une prochaine célébration des idéaux
ouvriers. Les travailleurs en Bulgarie bénéficiaient d’un essor indéniable. Il
m’a semblé, à moi le jeune communiste, ayant deviné trop vite la fin du système
bourgeois pourri, que la révolution prolétarienne frappait, frappait
littéralement à la porte de l’ancienne société. Mon imagination ardente
raccourcissait énormément les délais. Pour moi, la crise boursière de New York
était presque le début de la fin. Je me suis dit : « Voilà, l’ancien
système s’effondre sous mes yeux. » En fait, je prenais mes désirs pour
des réalités objectives. Mais en tout cas, j’en suis venu à la conclusion de
m’engager pleinement au service direct de la libération de la classe
prolétarienne, des peuples. Intérieurement, je rompais avec le théâtre et je
m’engageais dans la révolution. Une passion s’éteignait et un amour flamboyant
et dévorant s’épanouissait. À la suggestion du chef du parti Ivan Andreev, qui
ressemblait à un ordre pour moi, je me suis lancé dans les batailles de grève
des tresseurs de chaussures. À la suite du travail de plusieurs Bulgares, des
grèves éclatèrent dans les ateliers du propriétaire grec Christodorakis — rue
Pixérécourt, des frères serbes Michel et Marco — rue Pré-Saint-Gervais, du
Serbe Simich — rue Pradier, du Français Thénardier et du Bulgare Govedarski —
rue Vilin, du garde-blanc Alexis – rue Botzaris, etc.
Nous avons porté une
attention particulière au travail dans l’atelier de Thenardier et Govedarski.
Il a été récemment ouvert et dès le début, les salaires étaient bas pour chaque
paire de chaussures fabriquée. Nous avons reçu les informations de mon ancienne
connaissance du studio Citroën Georgi Boulgourov, qui travaillait déjà comme
finisseur, c’est-à-dire river les talons et les semelles et donner un visage
aux chaussures tressées. L’intérêt de la profession exigeait qu’une bonne leçon
soit donnée à ces nouveaux patrons aux grands appétits d’enrichissement rapide.
Recommandé par Boulgourov, Milko Tarabanov, Nikola Petev et moi avons commencé à
travailler. Notre première tâche était de nous montrer comme de bons ouvriers.
Deuxièmement, nous devions étudier et bien connaître nos collègues. Avant deux
ou trois semaines, nous avons réussi à nous imposer avec nos produits de bonne
qualité et à mesurer et évaluer la maturité politique et militaire des autres
travailleurs et travailleuses. Il y avait une particularité dans cet atelier.
Le propriétaire français avait attiré de nombreuses jeunes femmes françaises.
Son raisonnement était clair. Leur payer des salaires inférieurs et retirer aux
étrangers le monopole de la confection de chaussures tressées. Mais en même
temps, plusieurs Bulgares et Yougoslaves y travaillaient, faisant autorité dans
la profession et endurcis dans la lutte. Lors de deux réunions préliminaires
entre les confrères des Balkans, nous avons discuté de la manière de nous
préparer, désigné lequel d’entre nous parlerait aux Français, et décidé quand
faire grève. Nous étions tous pressés car nous savions que les propriétaires
avaient reçu une commande importante et coûteuse des États-Unis. La préparation
psychologique des nouveaux ouvriers, principalement des travailleuses
françaises, se déroulait conformément au plan. Chaque jour qui passait
renforçait notre confiance dans le succès de l’action entreprise. Nous sommes
finalement arrivés au jour fixé pour la grève.
Les propriétaires
ont été très surpris. Ils se demandaient comment leurs humbles ouvriers
salariés s’étaient soudain transformés en grévistes courageux. Le comité de
grève m’a chargé d’assurer la liaison avec les syndicats français, car je
connaissais Charles Michels[32],
secrétaire de la Fédération des Cuirs et Peaux auprès de la CGT. Charles et moi
avions fait grève ensemble à la grande fabrique de chaussures Dressoir, rue
Théophile Gauthier, dans le 19e arrondissement. En plus, je devais surveiller
et en fait organiser les piquets de grève.
Sept ou huit jours
passèrent. Tout allait bien. Il n’y avait pas de briseurs de grève. Les
propriétaires étaient furieux. Ils attaquaient durement les grévistes et les
accusaient de manière provocatrice d’avoir agressé des travailleurs à la
recherche d’un emploi. Les patrons ont appelé la police et, à côté des
grévistes de la rue Vilin des gardes du Commissariat de la rue Ramponeau ont
commencé à monter la garde. J’appris que Thénardier était intéressé par mon
adresse. Il a insisté pour que je sois arrêté dans l’espoir d’intimider les
grévistes et de bouleverser nos rangs. Il a réussi. Un après-midi, j’ai
descendu la rue Vilin pour voir si les piquets étaient en place et ce qu’ils
avaient remarqué. Le Bulgare Hristo Tonchev — Itseto, un ancien métallurgiste,
m’a balbutié qu’une heure plus tôt environ, avec les hommes en uniforme, deux
policiers civils se déplaçaient dans la rue, mais qu’ils avaient maintenant
disparu quelque part. Je lui ai proposé d’aller boire un verre au coin de la
rue Julien Lacroix. Toujours assoiffé, Itzeto ne m’a pas laissé renouveler mon
invitation. Il m’a fait part de son admiration pour la préparation au combat
des Françaises. Par la porte vitrée du café, nous avons remarqué deux agents
civils surgissant du trottoir d’en face. Ils nous fixaient sans ménagement de
leurs yeux perçants. Il n’était pas nécessaire d’être clairvoyant pour deviner
leurs intentions. Surpris par le changement de couleur de mon visage, Itzeto
m’a demandé :
— Qu’en
penses-tu ? Vont-ils nous arrêter ? Les grèves ne sont-elles pas
autorisées en France ?
Au lieu de répondre,
j’ai demandé :
— As-tu quelque
chose sur toi — un tract, un couteau ?
Itzeto fouilla
rapidement ses poches, dit qu’il avait tout distribué et exprima une fois de
plus l’espoir que nous ne soyons pas arrêtés. En quittant le café, les agents
se sont approchés de nous, se sont identifiés très poliment et nous ont demandé
de les suivre. Nous avons obéi silencieusement à leur ordre. Toute résistance
était inutile. Un policier en uniforme est apparu devant nous et un derrière
nous.
Au commissariat de
la rue Belleville ils ont vérifié nos identités, demandé nos adresses et nous
ont fouillés. À la grande horreur d’Itze, ils ont trouvé un tract parmi ses
affaires, des cigarettes, un carnet, un mouchoir, un portefeuille. L’appel
contenait une invitation à la solidarité avec notre grève et un appel à la
fermeté adressé aux grévistes eux-mêmes, car la victoire était proche et
certaine. Ils nous ont mis dans une cage avec un treillis de fer, des murs en
ciment et d’épais bancs en bois brun foncé aussi froids que les murs. Itzeto
pleurnichait :
— Putain, je ne
sais pas comment et où j’ai fourré ce papier. Mais que peuvent-ils me faire
maintenant ? Ceci est un appel de la fédération française de fabrication
de chaussures. Les Français me l’ont donné à lire. S’ils sont en colère à
propos de quelque chose, qu’ils se disputent entre eux. Dis-moi, qu’est-ce qui
va sortir de ce bordel qu’on a créé ?... Et ma Française ? Elle en
est une, sans pareil. Elle me gronde constamment. À propos de la grève, elle me
dit, si tu ne veux pas te disputer avec tes amis, fais semblant d’être malade.
Je vais te trouver trois certificats médicaux. Je l’ai écoutée, j’ai écouté, et
je l’ai envoyée au diable. Mais maintenant, elle devra m’attendre. Et quand
elle apprendra où je suis, wow, mon garçon, ça va être dur. Elle va ouvrir une
bouche, tu n’as pas besoin d’un meeting, c’est une Assemblée nationale entière.
Et quand ses démons passent, elle oublie tout et de nouveau : ici, Itze,
mon chéri, là, mon Itze, mon cœur...
Dans le hall du
commissariat, nous avons vu les propriétaires Thenardier et Govedarski. Leur
présence a suscité des illusions à Itzeto :
— Ils sont
venus nous libérer. Demain, ne voudront-ils pas que l’on travaille de nouveau
pour eux ?
Les patrons se sont
révélés fidèles à leur nature. Au contre-interrogatoire, ils ont affirmé :
— Ce grand
homme est leur chef. Il les a inspirés. C’est de sa faute. Il a menacé de
battre quiconque ne se joindrait pas à la grève. Et celui-ci, Hristo Tonchev,
est induit en erreur par lui et les autres, les scientifiques, car il y a des
Bulgares qui ne sont pas des ouvriers, mais des étudiants, des avocats.
Dans ma défense
préméditée, j’ai précisé que la grève était menée par des syndicats français,
que les grévistes étaient majoritairement français, et que nous souhaitions
qu’un ventilateur soit placé dans l’une des pièces où travaillent une vingtaine
d’ouvrières françaises, blotties comme dans une boîte de sardines… Enfin, je me
tournai vers le commissaire du secteur :
— Ai-je menacé
les travailleurs de coups ? Je demande aux messieurs d’en amener au moins
un pour qu’il le confirme devant vous ainsi qu’à moi !
Le commissaire, un
jeune homme blond d’une quarantaine d’années, dans un élégant costume gris, au
visage très intelligent, ne m’a pas interrompu. Il m’a regardé attentivement
avec ses yeux bleu verdâtre vifs, et une seule fois il a noté quelque chose
dans son carnet. Sans qu’aucun muscle de son visage ne tremble, il m’a posé une
question qui m’a d’abord semblée assez bizarre, voire étrange et cynique.
— Vous aimez
beaucoup votre logeuse, alors vous couchez avec elle ?
Surpris par la
question, j’ai protesté :
— Que
voulez-vous dire par cette insinuation ?
Toujours froid et
sans passion, le commissaire me fixait dans les yeux et continua à
parler :
— Tu me
comprends parfaitement. Seule une Française qui vous fait l’amour peut dire à mes
agents : « Pour fouiller la chambre de mon locataire en son absence,
vous devrez passer sur mon cadavre ».
Soudain j’ai
compris. Ils se sont rendus au logement de la rue Émile-Pierre Casel et Mme
Laurent ne les a pas fait entrer. Elle, juriste, s’est fondée sur la loi, selon
laquelle une perquisition ne peut être effectuée qu’en présence de la personne
concernée, et sur l’ordre explicite du procureur. Bravo à Mme Laurent !
Elle se querellait souvent, et assez grossièrement, avec son mari, comptable
dans une usine d’optique, et malgré sa beauté, je ne l’aimais pas beaucoup.
Maintenant, elle a grandi à mes yeux comme digne du nom de sa nation. J’ai été
logé dans cet appartement par l’intermédiaire du Parti communiste français, où
je préparais pour une expédition en Bulgarie les journaux bulgares Fédération balkanique et Affaires macédoniennes publiés à Vienne.
Généralement inconnus des Bulgares, Nikola Razlogov, Dino Kyosev, Ivan
Stefanov, Petar Grigorov, Ivan Andreev y sont venus pour des réunions illégales,
et une fois Geo Pirinski, venu des États-Unis, y a passé la nuit. J’y
conservais l’organe mensuel du PCB Drapeau
Communiste, les résolutions du Komintern, la revue Imprekor, ainsi que plusieurs de mes manuscrits, dont le manuscrit
de la convocation saisi sur Itseto.
J’ai dit au
commissaire :
— Je ne sais
pas ce que ma logeuse a dit. Mais vous insultez votre nation avec votre
accusation sévère. Madame Laurent est une femme qui a consacré sa vie à
s’occuper de ses enfants et, pour votre information, à la musique, car dès
qu’elle a du temps libre, elle est pressée de s’adonner à sa passion favorite.
Elle fait honneur à la femme française.
Le commissaire se
leva, s’approcha de moi, me tapota l’épaule et se mit à me parler d’un ton
sarcastique :
— Bravo. Je te salue
et je t’envie. Tu es immaculé. Tu organises des grèves, tu excites les
travailleurs, tu les obliges à faire des piquets de grève, mais tu es propre.
Tu n’es nulle part. Tu ne laisses aucune trace. Il n’y a aucune preuve physique
contre toi. Ton camarade pathétique, semble-t-il, est entraîné dans le courant
général. Mais dans son appartement, mes gens ont trouvé l’Humanité, et même des livres de Lénine et de Staline. Sa femme
légale est française, mais elle ne sacrifie pas sa vie pour lui. Mais tu ne sais
pas à qui tu as affaire. Je viens de Saint-Denis[33]. Là,
j’ai détruit le nid de serpents de votre Doriot[34].
Depuis combien de temps là-bas n’y a-t-il pas eu de grèves, pas de
manifestations ? L’accalmie dans la forteresse révolutionnaire est de mon
fait. Et ici à Belleville, je nettoierai les têtes brûlées. J’arracherai votre
darde révolutionnaire, vous n’empoisonnerez pas l’âme des prolétaires honnêtes
et naïfs.
Et à ma grande
surprise, il dit d’un ton sec et catégorique :
— Et maintenant
tu es libre. Nous garderons ta victime. Qu’elle voie les chefs s’en sortir
indemnes, et qu’elle aille pourrir à la prison de la Santé...
J’ai ressenti comme
un coup de fouet porté à mon camarade la décision du commissaire arrogant.
Itzeto se tourna vers moi avec un regard surpris et stupéfait. Je me sentais
coupable sans être fautif.
Jugé selon la
procédure accélérée, Itzeto écopa d’une peine inattendue : trois mois de
prison ferme. Sa femme l’a en fait abandonné et ne lui a pas rendu visite une
seule fois en prison. Elle m’a parlé durement, ainsi qu’à une amie, quand on
lui a conseillé de demander une réduction de peine pour son mari. Dans la
demande, elle aurait pu indiquer des raisons sérieuses : une petite fille
de deux ans, sa maladie — la tuberculose chronique — la famille se retrouve
sans soutien matériel. Malheureuse et sans instruction, à la fin de la courte
réunion, elle nous a montré la porte.
Nous n’avons pas
abandonné Itzeto. On lui envoyait régulièrement de l’argent, des cigarettes, de
la nourriture, mais surtout, le Secours Rouge français s’occupait de lui. Le
Secours Rouge a engagé le célèbre avocat parisien André Breton. J’ai dû lui
expliquer personnellement dans son appartement spacieux et cossu du boulevard
Saint-Michel, quelle part avait pris Itzeto à la grève et ce qu’il représentait
en tant que personne. L’avocat m’a écouté attentivement et m’a dit qu’il
essaierait de l’aider, mais qu’il rencontrerait probablement de sérieuses
difficultés en raison du courant réactionnaire du gouvernement Tardieu.
Le plaidoyer de
l’avocat faisant autorité a porté ses fruits. Itzeto n’a passé qu’un mois à la
Santé. Nous avons été remplis d’un véritable respect pour ce Français riche et
cultivé lorsque nous avons appris qu’il s’était porté garant en son nom
personnel de la future loyauté de l’ouvrier bulgare inconnu. Nous n’avions pas
d’autre choix que de lui exprimer notre gratitude. Itzeto et moi avons décidé
d’acheter un bouquet inhabituellement grand au marché aux fleurs du parvis de
la préfecture de Paris. Nous l’avons présenté maladroitement à Madame Breton,
qui fut émue aux larmes, et considérant que sa reconnaissance verbale était
insuffisante, elle nous invita à prendre un café...
Dans la rue, Itzeto
n’arrêtait pas de se demander comment des gens aussi éduqués et riches
pouvaient être communistes, car, m’a-t-il assuré, « ils doivent être
communistes s’ils défendent des gens comme moi et s’assoient pour boire un café
avec nous ».
Je ne manquai pas
l’occasion d’expliquer à mon ami Itzeto quelques particularités de la lutte des
classes en France, mais je m’empressai de me séparer de lui en lui promettant
de le voir dans un des cafés de la place des Fêtes. En fait, j’étais pressé de
me rendre au bistrot Tout va bien. Mon nouvel ami Stefan Hristov m’y attendait
pour aller à l’opéra.
Stefan était venu en
France en tant qu’immigrant politique. Dans sa ville natale Tsaribrod, il était
l’un des communistes les plus actifs et les plus éclairés. À la demande du
parti, il a effectué des tâches responsables et dangereuses, a dirigé le canal
entre la représentation à l’étranger du Comité central du Parti communiste
bulgare et la direction du parti à l’intérieur du pays, il a été torturé à
plusieurs reprises et emprisonné dans des commissariats, prisons et
« Glavnjacata » de Belgrade.
Il arrive à Paris
avec une tuberculose déjà diagnostiquée. Grand, yeux olive noir et cheveux
noirs, Stefan frappait par sa faiblesse physique, son visage amaigri, pâle et
allongé. Je l’ai aidé à apprendre à tresser des chaussures. Nous avons
travaillé et vécu ensemble. Dans notre chambre d’hôtel de la rue Belleville,
j’ai découvert à quel point sa santé était mauvaise. Non seulement il
transpirait souvent et abondamment, mais il haletait et parfois vomissait du
sang. En cas de crise, son sang remplissait des cuvettes entières. Mon ami
était une réfutation vivante du proverbe latin « Corps sain — esprit
sain ». Sa force physique a été réduite à zéro. Il pouvait à peine marcher
dans les rues, montait avec difficulté les escaliers, il était fatigué toute la
journée. En même temps, il avait un esprit riche et clair, une culture marxiste
large et solide, une volonté d’acier, un caractère têtu et direct. Il était
l’un des conférenciers actifs dans les cercles d’éducation du parti et
peut-être le participant le plus ardent aux querelles idéologiques entre les
émigrants antifascistes[35].
Ayant pris un petit
déjeuner rapide au café, mon ami Stefan et moi nous sommes dirigés le long des
grands boulevards jusqu’à la place de l’Opéra. Nous avons montré nos billets,
mais le gardien, qui m’a regardé de la tête aux pieds, a dit : « Vous
ne pouvez pas entrer dans l’opéra sans cravate. S’il vous plaît, dégagez la
voie ! »
Stefan et moi nous
nous sommes regardés, c’était inutile de contester devant la stature implacable
de ce cerbère d’opéra. Nous sommes sortis, nous nous sommes éloignés un peu de
l’entrée, j’ai sorti ma cravate pliée de la poche de mon manteau et nous nous
sommes présentés à un autre garde. Nous avons monté l’escalier de marbre, et
fidèle à mon intransigeance envers l’ordre « bourgeois » de l’Opéra
de Paris, là, toujours dans l’escalier et à l’abri des regards des gardes, j’ai
remis la cravate dans ma poche. Je rusais comme un jeune ! Stefan, vêtu
d’un costume neuf, d’une chemise blanche et d’une cravate bleu marine, riait
aimablement de ma « révolte prolétarienne » inappropriée.
Mes anciens
collègues Konstantin Kisimov et Zorka Yordanova ont visité Paris à des moments
différents. Ils ont tous deux reçu des bourses d’État. Nous nous sommes
rencontrés comme de vieux amis. Aucun changement chez eux envers moi. Ils
voyaient en moi un abandon temporaire de leur milieu. Ils espéraient que je
sois à nouveau parmi eux — non pas en tant qu’artiste, mais en tant que metteur
en scène. J’étais gêné de les tenir informés de ma décision personnelle.
RETOUR VERS LA PATRIE
Ce n’est pas un
hasard si au premier appel du CC du PCB à rentrer au pays, j’ai répondu
« je suis prêt ». Prêt à prendre le chemin d’un activiste
travailleur, ayant renoncé à ses désirs personnels, embrassant une fois pour
toutes le travail sacré du peuple.
Dans une longue
rencontre au parc de la Butte Chaumont, comme une rencontre entre père et fils,
Ivan Andreev m’a parlé de la montée massive des travailleurs dans notre pays.
Pour organiser, canaliser et conduire cette montée, le parti avait besoin de
tous ses cadres fidèles. Le CC du PCB a envisagé une « action de
retour ». Les jeunes les plus alertes à l’étranger devaient rentrer au
pays et joindre leurs forces au mouvement.
Fatigués de marcher,
nous nous sommes assis sur un banc. Le bon baï
Ivan ne s’est pas adressé à moi sur un ton solennel, mais sur un ton
confidentiel :
— Le
parti te donne pour tâche de rentrer au pays natal. Ta vie là-bas sera sujette
à des milliers d’épreuves, de difficultés, de risques, mais tu seras parmi les
tiens. Et tu verras, tu connaîtras le rare bonheur d’être l’un des combattants
pour la liberté nationale. Nous connaissons ton amour pour le théâtre, mais il
semble que tu t’es toi-même convaincu que tu ne pourras pas te consacrer au
théâtre maintenant. Penses-y quand même. Considère la situation de tous les
côtés. Tu peux me répondre dans deux ou trois jours, voire dans une semaine.
L’important est de réaliser le besoin du parti et de prendre ta décision de manière
tout à fait volontaire, consciente et responsable.
Le camarade Andreev
n’a pas été surpris par ma volonté de partir là, maintenant. En fait, j’étais
prêt depuis longtemps. Mon séjour à l’étranger avait perdu son sens à partir du
moment où j’avais décidé de rompre avec le théâtre.
L’action de retour
« a arraché » de la capitale française le pète Nikolai Hrelkov, mon
ami Stefan Hristov, le statisticien Ivan Stefanov, le comptable Totev, tous les
quatre travaillant à la représentation commerciale de l’Union soviétique à
Paris, le décorateur Valentin Veliotz, le séminariste Ivan Marinski, les
émigrés politiques Nikola Petev et Ivan Dyulguerov, les cordonniers Georgi
Boulgourov, Ilko Igov et d’autres.
C’était en mars
1931. Le temps était pluvieux. Nuit de mars à la gare de l’Est à Paris —
humide, lumineuse et bruyante. Dans l’un des cafés voisins près de la gare,
Andreev est venu me souhaiter bonne chance.
Avant que la
locomotive ne souffle et ne siffle, ce furent des câlins amicaux et des
cris : « À bientôt dans la patrie. Écrire. »
Je suis monté dans
l’un des compartiments du milieu d’un wagon de troisième classe. Mes bagages ne
prenaient pas beaucoup de place, puisqu’il s’agissait d’un simple sac de
courses avec de la nourriture pour trois jours et d’une petite valise en
carton. Je revenais d’un « gourbet[36] »
nu comme un ver, léger comme une plume, sans-le-sou, des chaussures rapiécées
et un manteau d’hiver court et fin que m’avait donné un ami. Accroupi dans un
coin près de la fenêtre, je lisais le roman Une
vie de Guy de Maupassant. Je n’ai prêté aucune attention aux deux femmes
âgées et à un vieil homme — mes compagnons. Ils ont répondu de même. Ils ont
rapidement éteint les lumières et se sont endormis. Je n’ai pas fermé les yeux
dans le noir. Mes pensées et mon imagination se sont envolées quelque part,
vers la patrie, au-dessus de la patrie, à l’intérieur de la patrie. Mon passé
mouvementé à Sofia revenait, je me revoyais vendeur de journaux, lycéen,
professeur de village, récitateur, acteur. Les images de ma mère, d’amis comme
des visions se pressaient, passaient et revenaient dans mon esprit. Le
processus de maturation était terminé. Le duel avec les dragons fascistes
m’attendait.
À la gare bondée et
silencieuse de Sofia, j’ai vu mon fidèle ami Petarcho. Mon oncle avec sa haute
taille se tenait à côté de Petarcho, et à côté de lui, maman et ma sœur, qui me
cherchaient anxieusement des yeux. Excité par la vue, je descendis et me
retrouvai immédiatement dans les bras de maman. Elle m’a étreint chaleureusement,
en larmes — ni vivant, ni mort. Elle a embrassé mon visage, mes yeux, mes
cheveux, mes vêtements, mes mains. Les larmes aux yeux de l’amour maternel si
sincère, je répondis à ses caresses par des caresses.
Au bout de quelques
minutes, tout a pris un joli caractère familial et natif. Ma sœur m’a embrassée
et m’a dit : « Tu as bien grandi, que cela te porte chance. »
Mon oncle m’a serré dans ses bras et a murmuré :
« Bienvenu ! » L’odeur du crin m’a frappé sur la place devant la
gare. Mon oncle a commandé un des beaux fiacres, quelque chose comme la
première classe. Nous avons commencé à sautiller sur les sièges en passant sur
le boulevard non pavé Hristo Botev, dans les rues Tsar Simeon, Opalchenska et
Pirotska et ainsi, assez secoués, nous avons atteint la maison de la rue
Osogovo.
Des souvenirs
éclataient et envahissaient mon esprit. Je me suis donc traîné sur ce boulevard
après les galiotes pour ramasser des
morceaux de charbon ; sur le pont de fer sur la rivière Vladayska, j’ai
déchiré plus d’un pantalon en glissant sur ses côtes semi-circulaires en
fer ; ici se trouvait aussi le bâtiment de l’association Dulger, où
j’avais plus d’une fois récité Smirnensky et mes propres monologues ; dans
la rue Tsar Siméon, j’avais travaillé comme vendeur dans une pharmacie suspecte
pour avoir secrètement vendu de la morphine à ses clients garde-blancs ;
les rues Opalchenska et Pirotska me connaissaient comme enfant et jeune homme
qui les parcourait pas à pas. Pauvre Sofia ! Je ne l’ai pas comparée avec
Paris. Presque rien n’avait changé en elle. Elle portait la même pauvre tenue…
DANS
« LE TUNNEL HEMUS »
Le pays gémissait
sous le règne d’Andreï Liaptchev. Le célèbre professeur Alexander Tsankov
régnait dans le domaine de l’éducation. Par l’intermédiaire de l’Assemblée
nationale, il tentait de légiférer un projet de loi sur l’éducation physique.
Le gouvernement entendait, par le biais des organisations sportives, inclure
tous les jeunes, en particulier les travailleurs, dans le système de l’État
fasciste. Sous la direction du Parti communiste illégal, une puissante campagne
de protestation a été lancée contre le projet de loi. Un meeting a été convoqué
dans le salon Hemus au coin de la rue Clémentina et Hr. Botev. Mon vieil ami
Grafa — Hristo Hrolev m’a emmené à la réunion. C’était dimanche matin. Avant
l’heure dite, la salle était remplie d’ouvriers et d’ouvrières. Grafa m’a
présenté à des camarades. Il m’a décrit comme « notre garçon ».
Hristo Kalaïdjiev a
parlé au nom du Parti des Travailleurs et Yordan Bratkov a parlé au nom de la
gauche agricole. Pendant le discours de Kalaïdjiev du haut du balcon, des
policiers civils ont commencé à crier de manière provocante :
« Démagogie. Ici, ce n’est pas la Russie soviétique, mais la Bulgarie. Tu
mens. Donnez des chiffres. On veut la parole. » Le responsable sportif
illégal Ivan Pianechki a appelé les camarades au calme. Dans une atmosphère
survoltée, le premier orateur a terminé sa présentation d’une manière ou d’une
autre. Yordan Bratkov se leva derrière lui de toute la hauteur d’un homme en
bonne santé et soudain sa voix puissante retentit. Il a stigmatisé avec des
mots forts non seulement « le professeur sinistrement célèbre, à la honte
de la Bulgarie toujours ministre de l’Éducation », mais aussi la politique
globale de Liaptchev. L’orateur marchait sur scène comme un lion. Chacune de
ses phrases résonnait dans la salle, où le public grondait, sifflait,
applaudissait. Les policiers ont décidé de remplir leur tâche — de briser à
tout prix la réunion autorisée par la police elle-même. Ils larguèrent des
bombes puantes qui dégagèrent une mauvaise odeur dans le salon. Mais l’orateur
a continué son attaque verbale et le public a applaudi avec encore plus
d’enthousiasme. Puis plusieurs chaises ont volé du balcon, jetées au-dessus de
la tête des gens du rez-de-chaussée. Au même moment, un groupe d’agents est
monté sur la scène, mais Bratkov, criant « À bas la dictature
fasciste ! » a réussi à leur échapper, a sauté au rez-de-chaussée et,
avec d’autres camarades, s’est engagé dans un combat au corps à corps avec les
policiers civils enragés. En vain Pianechki brandit le slogan « Ne quittez
pas la salle ! » Les policiers, commandés personnellement par leur
chef de groupe Nikola Guéshev, avaient déjà réussi à faire sortir une douzaine
de personnes et avaient commencé à frapper tous les autres dans le salon. Avec
des pistolets et des poings de fer, ils frappaient partout où ils pouvaient et
criaient : « Dehors, dehors, ta mère communiste ! » Des
agents avaient formé un « tunnel » sur les escaliers en pierre depuis
le premier étage jusqu’au rez-de-chaussée. Debout, l’un en face de l’autre, ils
frappaient impitoyablement et aveuglément les personnes se trouvant dans
l’impasse avec leurs poings, des matraques en bois et en caoutchouc, des pistolets,
des poings en fer et des coups de pied. Ayant trébuché au début de l’escalier,
certains d’entre nous ont roulé tête baissée jusqu’au rez-de-chaussée, où
d’autres brutes les ont matraqués de nouveaux coups avant de les jeter comme
des balles dans la rue. J’ai traversé le « tunnel » relativement sans
grands dégâts. Mettant mes mains à l’arrière de ma tête, accroupi, j’ai pu
sauter les escaliers avec de larges enjambées sans tomber. J’ai reçu des coups
sur la tête, les bras et le dos, mais j’ai atteint la rue presque indemne. Et
juste quand je pensais être hors de danger, un agent que je connaissais en tant
qu’écolier de la Deuxième école de garçons, surnommé Diadoto, m’a frappé au visage d’un coup époustouflant avec un poing
de fer. J’ai tourné autour de moi comme une toupie et je me suis enfui en moins
de deux par la rue Clémentina jusqu’à l’église Sv. Nedelia.
J’ai reçu mon
premier baptême du feu à Sofia avec une dose considérable. Au moment où je suis
rentré à la maison, la pomme sous mon œil droit était enflée et bleue. Le coup
a été brutal et n’a causé ni sang ni égratignures.
Dans l’après-midi,
Grafa m’a appelé. Il était boiteux et avait le bras gauche bandé.
Le lendemain, le
journal Echo énumérait les noms
d’environ 200 personnes blessées ou amochées dans le tunnel Hemus. Le journal Pogled a donné les portraits de
certains, gravement blessés, dont Hristo Kalaïdjiev et Kunka Apostolova. Lundi
soir, mon oncle m’a demandé si j’étais allé au cinéma Hemus la veille. Je lui
ai menti directement : « Non, je n’y suis pas allé. »
GRÈVE
DANS LA CORDONNERIE TANGO
Dans les premiers
jours, mes proches, comme on dit, ne posaient pas de questions sur mes projets,
sur mon travail. J’avais déjà demandé à mes camarades de me chercher un emploi,
et ils ont interrogé par ci, par là. Je ne me souviens pas qui m’a dit de me
présenter à la cordonnerie Tango de la rue Légué dans le bazar des riches
frères Dishkovi. Le propriétaire d’âge moyen, petit, gros et bien nourri, connu
sous le nom de Tango, doutait de mes compétences professionnelles en
cordonnerie. Il pensait que je n’étais pas du métier. Je l’ai persuadé de
m’essayer en m’engageant à payer la première paire de chaussures tressées si je
la gaspillais. Le test a été réussi, voire très réussi. La question s’est posée
du prix d’une pièce. J’avais volontairement bien travaillé, mais lentement,
pour prétendre à un salaire plus élevé. Le propriétaire a accepté mes
conditions sans dire un mot.
Il y avait deux
secteurs dans l’atelier : l’un classique cordonnier et l’autre nouveau
tressage. Lorsque nous avons reçu nos salaires le samedi, les cordonniers
professionnels avec quinze ou vingt ans d’expérience m’ont regardé de
travers : je n’étais pas un vrai cordonnier, mais je gagnais plus qu’eux.
Ils voulaient m’espionner... Je leur semblais mystérieux. Je gagnais beaucoup
d’argent, mais j’étais d’accord avec toutes leurs protestations et rumeurs de
grève. Ils étaient perplexes, et certains d’entre eux, comme ils me l’avouèrent
plus tard, me considéraient comme un agent envoyé parmi eux. Une fois, Grafa,
qui était devenu entre-temps le récitateur préféré des ouvriers de Sofia, m’a
rencontré après le travail et nous avons quitté l’atelier ensemble. Le
lendemain, le cordonnier le plus âgé, le communiste Ivan Grantcharov de Kilifarevo,
l’a trouvé et lui a demandé quel genre d’oiseau j’étais. En quelques mots,
Grafa m’a décrit et s’est porté garant de moi. Nous sommes donc devenus amis
non seulement avec Grantcharov, mais aussi avec Milko Gradinarov, un excellent
jeune travailleur et un homme honnête.
Un jour, les
cordonniers du secteur classique m’ont présenté leur plan. Samedi, ils
recevront leur salaire et lundi matin, une délégation dirigée par Grantcharov
fixera des conditions – augmentation des salaires, paiement des heures supplémentaires,
enregistrement régulier de l’assurance des travailleurs dans les livres, etc.
Ils attendront une réponse jusqu’à midi. Puis ils se mettront en grève. Dans un
premier temps, le secteur tressage, dont les ouvrières ne sont pas assez
conscientes, n’y participera pas. Si le conflit s’aggrave, je devrai impliquer
mon unité dans la lutte.
Tangoto a calé. Il
comparait les conditions chez d’autres cordonniers et reprocha à ses ouvriers
l’ingratitude ; il connaissait les convictions communistes de certains
d’entre eux, mais par noblesse il les endurait et ne les révélait pas à la
police. Avant midi, il a rejeté les demandes. Dans l’après-midi, l’atelier de
cordonnerie, situé au rez-de-chaussée, était désert.
Au début, Tangoto
sifflait et fumait calmement. Le soir, il monta à l’atelier de tressage et
chanta la même chanson de l’ingratitude humaine. J’ai longuement réfléchi à la
manière de réagir pour ne pas lui permettre de tromper les ouvrières qui
regardaient sa bouche. Ma seule remarque était : « Chacun a raison
pour soi-même. »
Le lendemain matin,
l’atelier de cordonnerie était toujours vide. Les piquets de grève étaient en
place. Des traîtres et des briseurs de grève ne se sont pas présentés. À 11
heures du matin, Tangoto était absent. À son retour, il a appelé Grantcharov,
Gradinarov et d’autres grévistes. La délégation des grévistes a tenu à ses
revendications et était prête à quitter l’atelier. Tangoto couvrit sa retraite
d’un voile humanitaire :
— Bien, je suis
d’accord, venez travailler l’après-midi pour découvrir que je suis un humain.
Dans ce monde,
presque tout n’est pas toujours révélé à temps, mais à la fin, le secret
devient souvent de notoriété publique. Nous avons également découvert où le
patron avait passé la matinée. Il est allé rapporter la situation et obtenir
des conseils chez le célèbre officier de police Nikola Guéshev. Ils semblent
avoir parlé de chacun des travailleurs individuellement et avoir établi des
tactiques d’action. C’est ainsi que nous nous sommes expliqué l’arrêt rapide de
la grève. Dans le même temps, en se basant sur le ton et le comportement de
Tangoto et sur quelques visites de célèbres policiers civils dans les deux
secteurs, on devinait la vengeance préparée par le patron.
Nous étions en
alerte. Mais l’ennemi non plus ne dormait pas. Il a envoyé son agent pour
m’observer. Il s’est présenté comme un comptable au chômage, contraint de se
reconvertir. Tangoto l’a recommandé comme père de deux enfants en difficulté,
que je lui apprenne, pour qu’il puisse sauver sa famille de la famine. L’agent
s’est nommé Stoycho et s’est déclaré apolitique :
— Nous, les
Bulgares, jouons beaucoup aux partis et c’est de là que viennent tous nos
malheurs. Et les gens ne veulent pas tel ou tel parti, mais ils veulent
travailler, nourrir leurs enfants. Je ne m’intéresse à rien d’autre qu’au
travail.
Le comptable
« affamé », un monsieur trapu aux joues rougies de son visage de
paysan et au front très bas, fumait comme une cheminée les chères cigarettes
Tomasyan et sortait souvent « chercher du travail dans sa
profession ». Dans notre secteur travaillait la très belle fille Vyara, la
fille des propriétaires de la maison délabrée des rues Vranya et Opalchenska,
où vivait Grafa. C’est elle qui nous signala la présence de l’homme de Guéshev.
Comme nous nous y
attendions, le plein succès de la grève a été de courte durée. À la fin de la
deuxième semaine, Tangoto, qui a estimé que l’augmentation gagnée lui coûtait
plus de 50 000 leva[37]
par semaine, est passé à l’offensive. Il a renvoyé Grantcharov et Gradinarov
disant qu’ils étaient inutiles. Le gant jeté a été récupéré le lendemain. Tous
les cordonniers se sont mis en grève. Au grand dam de Tangoto et de Stoycho,
cette fois, ils ont été rejoints par le département tressage privilégié. Nous,
les tresseurs, n’avons fait aucune demande économique. Notre lutte s’est
concentrée sur le seul mot d’ordre : la solidarité avec les licenciés.
L’appel sentimental s’est avéré attirer et fédérer les grévistes. Nous
représentions un poing très serré. Nous nous rencontrions régulièrement lors
des réunions du club NRPS[38],
nous nous soutenions financièrement, nous avons participé à des tribunes de rue
et à des meetings de chômeurs. Insensiblement, les grévistes ont traversé une
véritable école révolutionnaire. Une fois, l’ouvrière Vinarova et la fille
Nadia du village de Tangoto ont chassé avec leurs cris dans les escaliers les
agents de police Grozev et Boncho Mehandov, qui ont fait irruption dans la
« Maison de grand-mère[39] »
en plein jour. En dehors de la maison syndicale, nous nous réunissions parfois
dans le jardin de Boris, derrière le terrain de jeux Yunak.
Les journées de
grève pendant lesquelles l’intime cohésion prolétarienne a porté ses fruits ne
se sont pas passées sans nuages. Le dixième ou le douzième jour, les agents de
Guéshev nous ont encerclés dans la Clairière Rouge du jardin de Boris
(aujourd’hui le parc de la liberté) et nous ont conduits au quatrième
commissariat de police au centre de la capitale, rue Aksakov. Là, un enquêteur
civil nous a déclarés traîtres à la patrie et a menacé de nous poursuivre en
justice en tant que communistes si nous ne mettions pas fin à la grève. Dans la
soirée, tous sauf les « trois chefs » ont été libérés :
Grantcharov, Gradinarov et ma personne. La gentille ouvrière Vinarova a refusé
de profiter de la noblesse policière.
— Vous
m’insultez en me libérant. Je n’étais pas une brebis à me laisser conduire par
eux, comme vous les appelez, les dirigeants. J’ai fait la grève par moi-même,
pas sous commandement.
À coups de poing et
de pied, elle a été poussée sur le trottoir. Les politesses des gardes ont été
entendues : « Traînée. Tu te sacrifieras une autre fois. »
Nous avons passé la
nuit au rez-de-chaussée de la police.
Vers 11 heures du
matin, nous avons été emmenés chez l’enquêteur. Il nous a dit de signer un
protocole pour notre détention. Si seulement nous signions le protocole il nous
libérerait. Le but du document de police était de reconnaître que nous avions
fait grève sur ordre de Moscou, que nous avions prononcé des discours sur le
paradis en Russie soviétique lors de nos réunions au jardin Borisov, et que
nous promettions de ne pas empêcher le propriétaire du Tango d’accepter de
nouveaux ouvriers. Tous les trois, nous nous sommes opposés à ce qui était
écrit et avons refusé de signer. Ils nous ont ramenés au cachot en nous
menaçant de pourrir dedans si nous persistions.
Vers six heures de
l’après-midi, on m’a appelé à l’étage. J’ai été introduit dans le bureau de
l’huissier du commissariat Mitovich, célèbre pour sa belle barbe et son gros
ventre. Dans un coin, l’enquêteur se tenait debout tranquillement tenant le
protocole dans sa main droite. À côté du bureau de l’huissier était assis un
bel homme de grande taille en costume gris, les jambes écartées. C’était
Guéshev, le chef de groupe que je connaissais du « tunnel d’Hemus ».
L’huissier m’a adressé ces mots :
— Aimes-tu
vraiment l’arrêt, pour refuser de signer le protocole ?
J’ai répondu que je
ne refusais pas, mais que je m’y opposais, car le procès-verbal contenait des
choses manifestement fausses. Alors l’huissier a défendu les agents, disant
qu’ils ne mentaient pas, qu’ils nous avaient suivis, écoutés et tout
enregistré, que j’avais personnellement parlé aux ouvriers avant la grève du
paradis dans la patrie prolétarienne. Ensuite la conversation suivante
s’ensuivit entre nous :
— Pourquoi tu
ne signes pas le procès-verbal ?
— Parce que je
nie que quiconque, encore moins quelqu’un de Moscou, nous ait ordonné de faire
grève. Si le propriétaire n’avait pas licencié les ouvriers, nous n’aurions pas
fait grève.
Guéshev est
intervenu dans la conversation :
— D’où
viens-tu, mon garçon ?
— De Sofia.
— Où
vis-tu ?
— Rue Osogovo.
— As-tu des
parents ?
— Seulement ma
mère.
— Tu es comme
moi aussi. Qu’a fait ton père ?
— Cuisinier !
— Humm,
prolétaire ! Quand es-tu revenu de Moscou ? demanda-t-il soudain.
— Pour en
revenir, il faut que j’y sois allé là-bas, et je ne l’ai jamais vue même en
rêve.
— De quel droit
alors, tu leur fais des discours sur la Russie soviétique ?
— Je n’ai pas
fait de discours, j’ai répondu aux questions.
— Eh bien. Nous
allons changer le protocole... Monsieur Danchev, écrivez : « Ils ont
parlé de la Russie soviétique et sont en grève par solidarité prolétarienne...
(Vers moi) ou seulement par solidarité sans prolétarienne ?
— Comme vous
voulez.
— Alors, tu es
d’accord... Euh, on commence à s’entendre. Qu’est-ce que cela signifie de
traiter avec un monsieur intelligent, pardon, camarade. Quel lycée as-tu
fini ?
— Aucun. J’ai
étudié jusqu’à la première année de collège.
— Eh bien,
excellente éducation ! Où ?
— Dans le
premier collège, rue Bregalnitsa.
— Arrête de
faire l’imbécile, a-t-il dit. — Tu signeras le protocole, celui corrigé, et tu
sortiras... Mais il est temps de savoir à qui tu as parlé et à qui tu auras
affaire si tu ne deviens pas plus malin. Je m’appelle Guéshev. Tu interrogeras
les camarades. Ils te donneront suffisamment d’informations sur moi, si tu n’as
pas déjà écouté ce que je représente à l’Université Rouge. — Et soudain, il a
explosé : Vos plans pour gonfler le parti illégal avec de nouveaux cadres
de l’étranger ne fonctionneront pas. Nous vous connaissons tous et nous allons
vous attraper et vous noyer comme des souris. Stoupai[40] !
Mes réflexes étaient
rapides. J’ai décidé de faire une blague avec le policier arrogant. Je n’ai pas
bougé.
L’huissier
cria :
— Qu’est-ce que
tu regardes comme une dinde ? Monsieur Guéshev t’a dit : tu peux
retourner en cellule pendant que l’enquêteur corrige le rapport.
— Je suis
désolé, je n’ai pas compris dans quelle langue il me parlait.
— Toi, tu n’as
pas compris ?! Guéshev a soudainement explosé. — Oh, petit malin. Je te
promets qu’un jour ce sera l’heure des représailles entre moi et toi. Allez,
maintenant, vas-t-en avant que le seigneur de bois ne commence à jouer.
Nous avons beaucoup
ri dans le cachot de l’omniscience et des services de renseignement de Guéshev.
Une heure plus tard,
nous avons signé le protocole. Avant de quitter le commissariat, l’huissier
Mitovich nous a conseillé ... paternellement :
— Et demain j’espère
ne pas vous voir près de l’atelier. Je vous le dis comme un père. Je veux que
le calme règne dans mon quartier. Je ne laisserai pas les gens se révolter au
centre de la capitale.
Nous nous sommes
« rebellés » encore pendant quatre ou cinq jours. Tangoto a fait
venir plusieurs cordonniers de la campagne et a commencé à satisfaire les
commandes urgentes.
AUTEUR
DU SLOGAN « LA RELIGION EST L’OPIUM DU PEUPLE »
Avec son autorité en
tant que meilleur récitateur des travailleurs, Grafa m’a présenté un soir aux
chefs des Blouses bleues : Georgi Pendjerkov – La Dialectique, Lyuben
Ognyanov — Rizor et Isidor Hershkovich. Les Blouses bleues étaient une troupe
de théâtre amateur avec un nombre fluctuant de membres : parfois dix,
parfois vingt, voire parfois trente ou quarante participants. Avec elle,
travaillait la chorale ouvrière du NRPS sous la direction du septemvrietz Asen Biserov. Ce soir, la
chorale a répété le Marseille dans la cantine de la rue Tsar Samuil entre les
rues Pirotska et Ekzarh Yosif. La mélodie et les paroles d’origine étaient de
Rouget de Lisle. Mais en écoutant mieux, je me suis rendu compte qu’il y avait
des nuances à la fois dans la mélodie et dans les paroles de l’hymne français.
Le cordonnier Asen Biserov m’a expliqué qu’il fallait tout mettre à jour et que
Rouget de Lisle « devait se tromper s’il pensait avoir créé un
chef-d’œuvre que le prolétariat ne pouvait pas adapter à ses tâches
militantes ». Sur cette base « marxiste », des legato et des
couronnes ont été insérés dans la mélodie, et des modifications ont été
apportées au texte – « Enfants de la patrie, levez-vous ! Le jour de
gloire est arrivé, vainquons le fascisme ! »
En ce moment, les
Blouses bleues répétaient le billet de propagande collectif « La presse
laborieuse » des auteurs La Dialectique, Rizor et Hershkovich. Il sera
joué lors de la matinée artistique que le Parti des Travailleurs organisera
deux semaines plus tard au Théâtre Libre. Le projet de programme de la matinée
comprenait des récitations de Botev et Smirnenski, des récits humoristiques du
magazine Zhupel, la chorale de
Biserov, des performances musicales et autres. À mon avis, il y avait un manque
de matériel antireligieux, c’est-à-dire que le contenu de la matinée ne
répondait pas à l’une des tâches du moment — étendre et renforcer le mouvement
athée. Gosho la Dialectique m’a soutenu. Il a dit :
— Je
suggère à Hershkovich, et à nous tous, de parcourir la littérature athée et de
sélectionner quelques citations. Les Blouses bleues les réciteront depuis la
scène. À cette fin, on peut étirer sur le devant de la scène la pensée de Marx
« La religion est l’opium du peuple ».
Grafa trouva que les
citations répéteraient le billet de propagande collectif « La presse
laborieuse » et, à ma grande surprise, suggéra autre chose :
— Pourquoi le
nouveau camarade n’écrit-il pas quelque chose de spécial sur la question ?
Il y a des années, il a griffonné diverses pièces. Toi, Bore, qu’en
dis-tu ?
Au début, j’ai
hésité. Puis je me suis dit que ce n’est pas la mer à boire et j’ai promis de
présenter quelque chose dans un jour ou deux.
Le quelque chose
s’est avéré assez long — une pièce en deux actes d’une durée d’environ une
heure ; acteurs principaux : Archimandrite Stefan — courtisan et beau
séducteur des femmes de la haute société de Sofia, le capitaliste Capo, le
prolétaire Prolo, une dame de la haute société, des gardes. Titre : La religion — Opium pour les peuples.
Que le titre n’ait rien à voir avec l’esthétique — cela ne nous est pas venu à
l’esprit à nous, les « créateurs ». L’important pour tout le monde,
et surtout pour moi, l’auteur, était que la pièce soit acceptée par le
« conseil artistique » et par Grafa, pour qui j’avais spécifiquement
écrit le rôle principal — l’archimandrite de Sofia. Les Blouses bleues ont
également apprécié à la première lecture.
Un accord a été
conclu : Grafa jouera l’archimandrite, Hershkovich sera le secrétaire
privé du capitaliste, le forestier Tsekov — le Capo, Micheto Damianova — la
dame de la haute société, le cordonnier Lazar Milev, surnommé Zaharchouk —
Proloto, Rizor — le policier secret, et autres dont je ne me souviens pas. On
m’a confié la mise en scène pour aider les comédiens et accélérer la
préparation de la pièce. Combien je les ai aidés, les interprètes pourront le
dire. Les personnages incarnaient des idées sociales. Ils n’avaient aucun
psyché individuel, ils étaient composés sur le principe du noir et blanc, sans
lumière ni ombre. Leur langage était de mélodrames du boulevard,
journalistique, leurs relations — plates et simples.
Sans doute la
« pièce » était naïve. Ce serait ridicule et impossible maintenant.
Mais tout dépend du moment, des circonstances dans lesquelles une œuvre est
présentée.
C’était une ère de
grande ascension tous azimuts des travailleurs. L’épée de Damoclès du
professeur Tsankov et de l’équilibriste politique Andreï Liaptchev a plané sur
le pays pendant près de huit ans. Avec des sacrifices et des efforts
incroyables, les courageux antifascistes ont brisé et cassé la croûte de la
dictature fasciste. Ils avaient forcé le gouvernement de Liaptchev à accorder
une certaine liberté pré-électorale et se dépêchaient de profiter du déglaçage
temporaire. Sofia la laborieuse est venue en masse pour la première grande
matinée du travail après les événements de septembre 1923. Le bâtiment délabré
du théâtre libre de Stoychev a été secoué par le public excité qui se pressait
dans la salle et sur le balcon. Parmi eux se trouvaient : Atanas Nenov,
Atanas Damianov, Yanko Petkov, Gana Pavlova, Rada Balgarova, Stefana Klintcharova,
Kunka Apostolova, Trayana Nenova, Savka Bogdanova et d’autres. Presque tous les
écrivains, poètes, journalistes prolétaires étaient présents — Todor Pavlov,
Dimitar Polyanov, Hristo Radevski, Alexander Zhendov, Georgi Karaslavov, Nikola
Lankov, Krum Penev, Anguel Todorov, Asen Boyadzhiev, Arman Barouh, Dimitar
Naïdenov, Encho Staykov, Vladimir Topentcharov, Tsvetan Stefanov, Alexandar
Naoumov, Hristo Kalaïdjiev, Hristo Traikov, Yordan Bratkov, Ivan Martinov,
Alexandar Bourmov, Atanas Romanov et bien d’autres. En un mot, le gratin de
l’intelligentsia ouvrière de Sofia. Mais avec eux, dispersés dans le hall et
montant la garde dans la cour, des dizaines de policiers civils connus et
inconnus reniflaient comme des limiers.
Les récitations
individuelles, la chorale du NRPS, le billet de propagande collectif « La
presse laborieuse » passaient avec un enthousiasme indescriptible. Le
public d’élite de la classe ouvrière était transporté dans un réel ravissement,
applaudissant et criant : « Bravo ! »
« Encore ! »
Les agents, dont le
chef Guéshev sortait souvent pour appeler ses chefs, palissaient et
rougissaient de haine.
La fin du premier
acte du billet de propagande La religion
— Opium pour les peuples a provoqué de vifs applaudissements. Mais ici la
puissance du mot ne peut exprimer la puissance de la réaction des vivants dans
la salle. Applaudissements, cris, piétinement sur le mince plancher de bois —
le tout accompagné d’un bruit inimaginable. Les gens brillaient comme s’ils
avaient découvert un continent perdu, comme si les bagnards de l’Île de la Mort
avaient posé le pied sur la rive dure et salvatrice de l’Île de la Liberté et
de la Joie. Le pouvoir de la classe montante bouillonnait et explosait comme de
la lave.
Chacun utilisait
l’entracte à sa manière. Certains commentaient ardemment, d’autres haletaient
de joie, d’autres fumaient et philosophaient : « Si Liaptchev permet
encore deux ou trois matinées de ce genre avant l’élection, son royaume est
fini. » Guéshev n’avait pas non plus perdu son temps pendant l’entracte.
Il avait appelé ses chefs. De leur côté, ils s’étaient tournés vers le ministre
de l’Éducation, Tsankov, et celui-ci leur avait ordonné d’arrêter à tout prix
la « moquerie communiste de la religion ». Guéshev a convoqué sur la
scène Yanko Petkov, secrétaire du comité régional du Parti des Travailleurs, au
nom duquel la matinée a été donnée, et lui a ordonné de mettre fin au
spectacle. Bien qu’il n’ait aucune formation juridique, le travailleur du tabac
Yanko a montré au policier l’autorisation en règle de la Direction de la
Police. Il a déclaré :
— La
matinée est parfaitement légale. Nous agissons dans le respect de la loi. Les
gens ont payé leurs billets, vous connaissez le programme. Merci de ne pas nous
déranger.
En rougissant,
Guéshev se sentait mal à l’aise. Il n’a réussi qu’à marmonner :
— Je me fiche
de ce que c’était. Le ministre de l’Éducation ordonne, et moi et mes hommes
exécutons les ordres. Maintenant, vous direz aux vôtres, que le spectacle est
terminé et que tout le monde rentre chez soi.
— Je leur ai
déjà dit avec des affiches énormes « venez, la police permet ». Je ne
peux pas leur dire le contraire maintenant.
À ce moment-là,
Grafa, vêtu d’une soutane et avec une longue barbe, se présenta devant Guéshev
avec toute sa majesté d’acteur et dit d’un ton légèrement arrogant :
— Nous faisons
de l’art, monsieur Guéshev. Pourquoi n’interdisez-vous pas les représentations
dans tous les théâtres alors ? S’il vous plaît, veuillez quitter la scène,
car les gens se demandent depuis cinq minutes pourquoi nous ne commençons pas.
Perdant son
sang-froid, Guéshev hurla :
— Je vais tous
vous arrêter. Vous allez terminer le spectacle. Dites-leur de partir. Tout le
monde doit vider la salle.
Jusqu’ici, bien que
tendue, la conversation avec l’agent était relativement dans les limites de la
décence apparente, mais soudain Stefana Klintcharova, une militante syndicale
bien connue, prit la parole. Elle se dressa de toute sa hauteur, une grande
femme blonde au visage flamboyant et aux yeux pétillants, fit deux pas en
avant, tapa du pied et, d’un poing dirigé vers Guéshev, cria de sa voix
d’alto :
— Pas nous,
mais c’est vous qui sortez d’ici, bande de salauds. Vous ne nous battez pas
assez dans les commissariats, alors vous êtes venus ici pour nous harceler. Attendez
dehors et arrêtez-nous là-bas. Et maintenant dégagez le terrain !
En réponse, Guéshev
menaça :
— Toi, tu as
été entre nos mains plusieurs fois et tu y viendras à nouveau. Mais cette fois,
tu te souviendras de nous toute ta vie.
Les chiens subordonnés
à Guéshev sont également intervenus. Ils ont attaqué avec des jurons grossiers
et des menaces contre le groupe de Blouses bleues. Mais la courageuse Stefana a
montré à ses camarades comment réagir à l’intervention de la police. Elle s’est
mise à crier :
— La police
dehors !
Maria Damianova a
été la première à rejoindre son amie plus âgée. Grafa et Zakharchuk n’étaient
pas en retard, donc un instant plus tard, une douzaine de personnes criaient,
protestaient, hurlaient, braillaient : « Hors les fascistes !
Houh ! Bourreaux ! Salauds ! Dehors, dehors !
Houh ! »
Guéshev a hurlé :
— Arrêtez tout
le monde ! et il se précipita pour kidnapper Stefana, mais il rencontra sa
forte résistance : avec ses mains et ses pieds, elle essayait de se
détacher des pattes de Guéshev. Un combat au corps à corps s’ensuivit, un
combat accompagné de cris et de jurons qui se firent entendre derrière le
rideau de la salle. À ce moment, ayant réussi à échapper aux mains d’un agent,
Grafa descendit vers l’ouvrier qui manipulait le rideau, et de sa voix
puissante lui ordonna :
— Le rideau,
lève le rideau !
Et le rideau se leva
en une seconde. La lutte au corps à corps battait son plein. Le public dans la
salle le vit et frémit de colère. Des centaines de gorges ont déchiré
l’air : « À bas la police fasciste ! À bas les bourreaux !
Salauds, dehors, dehors ! Nous voulons la liberté de réunion ! Hors
de la scène ! » Certains camarades tentaient déjà de sauter sur
l’avant-scène pour venir en aide aux héroïques Blouses bleues. Guéshev, qui s’est
trouvé à l’étroit, s’est tourné vers le public, mais n’a réussi à prononcer que
le mot « Messieurs... » et les cris ont de nouveau éclaté avec une
force volcanique. Enragé par son impuissance face à la colère de cette masse
vivante, il se retira, accompagné de cris mêlés : « Honte ! Hors
les bourreaux ! Vive les Blouses bleues !
Au paroxysme du
public triomphant, Yanko Petkov a crié que le spectacle continuait.
Le deuxième acte a
été un grand succès. Le public excité accompagnait la moindre remarque avec des
approbations et des applaudissements nourris.
Sur les conseils de
Yanko Petkov, Stefana et moi nous avons dû disparaître de la place avant la fin
du spectacle. C’est ce que nous avons fait — nous sommes sortis par la porte
arrière de la scène et dans la rue Regentska, nous nous sommes dirigés quelque
part vers Poduyane, et de là vers le parc de la Liberté.
Quelles ont été les
conséquences concrètes de la matinée rarement couronnée de succès des Blouses
bleues ? Une vingtaine de personnes ont été arrêtées, dont Yanko Petkov,
Hristo Hrolev — Grafa, Vladimir Topentcharov, Georgi Pendjerkov – La
Dialectique, Lyuben Ognyanov — Rizor, Izidor Hershkovich, Georgi Kostov,
Petroush Yurgandzhiev, le tailleur, le garçon de village, le rédacteur en chef
de l’hebdomadaire humoristique Jupel
etc. Pendant deux semaines, ils ont été harcelés pour dire qui était l’auteur
et le metteur en scène de la pièce. Tout le monde a témoigné dans l’esprit de
ce que le garçon de village a dit au début :
— J’ai
trouvé la pièce dans la boîte aux lettres du club du Parti des Travailleurs. Je
l’ai aimé et j’ai réuni mes amis pour la jouer. J’en assume l’entière
responsabilité. Vous pouvez m’écrire à la fois comme auteur et aussi metteur en
scène.
Le lendemain, j’ai
reçu un message des détenus — que je me cache sérieusement parce que la police
me cherchait principalement. S’ils m’attrapaient, ils engageraient un procès
ZZD[41] contre
tout le groupe.
« MARIÉ
À LA RÉVOLUTION »
Ainsi commença ma
semi-légalité et mon itinérance. La première raison c’étaient les nouvelles de
la Direction de la Police. Mais une autre raison importante s’y est ajoutée —
le choc entre deux mondes : le monde du petit propriétaire apolitique et
le monde du jeune révolutionnaire.
Ma grand-mère était
une femme avec un beau visage, un front haut et des yeux vigilants
particulièrement vifs. Elle avait un esprit naturel éveillé et une grande
expérience de la vie. Mon grand-père s’était égaré depuis longtemps et souvent
pour travailler en Asie Mineure, elle était obligée de s’occuper de la maison
et d’élever leurs nombreux enfants. Ils étaient au nombre de quatorze, dont
seulement deux ont survécu à ce jour — ma mère et mon oncle. Mon oncle était
encore célibataire, même s’il avait la trentaine. Selon la tradition populaire,
la grand-mère voyait le sens de sa vie dans le bonheur de son fils. Et ce
bonheur à ses yeux prit la forme de ma future tante. Et quelque chose empêchait
toujours le « bonheur » de franchir le seuil de la rue Osogovo. Au
lieu de cela, oh, horreur, presque la mort elle-même s’est installée en moi et
a menacé le présent et l’avenir de tous les habitants et, bien sûr, en premier
lieu, elle a menacé le sort du chef masculin de la famille, le bien-aimé, le
fils unique de grand-mère Anastasia.
Par une belle journée
de mai, vers trois heures de l’après-midi, dans la maison où je suis né et où
j’ai grandi, une conversation sérieuse entre ma grand-mère, ma mère et moi
s’est engagée. J’en ai oublié beaucoup, mais je me souviens de l’essentiel pour
toujours. Grand-mère a commencé la première :
— Dieu a envoyé
son fils sur terre et encore une fois le mal continue. Je veux dire, laisse
tomber les malentendus de l’état et prends soin de toi et de ta mère, qui n’a
pas vu un jour heureux à cause de toi. Un de tes frères a été tué par les
gardes et toi aussi tu veux être anéanti ? Tu es venu, on t’a recueilli,
on s’est dit : « Essayons, il pourrait revenir à la raison ».
— Et maintenant
vous découvrez que j’ai complètement perdu la raison ?
— Des agents
sont venus te chercher déjà deux fois. Tu te caches, donc ce n’est pas bon.
— Ça dépend.
Ma mère est
intervenue :
— Mori ato[42],
s’il n’y avait personne pour combattre les Turcs, qui nous aurait libéré ?
— Les
Turcs, que le feu les brûle. Maintenant, nous sommes tous des Bulgares. Je ne
veux pas qu’il y ait un feu dans la maison, je ne survivrai pas au licenciement
de ton frère, et même il risque d’être jeté en prison pour avoir hébergé un
homme opposé au gouvernement.
Et se tournant vers
moi, elle commença à me frapper avec le tranchant de sa paume droite.
— Eh bien, toi,
eh bien, comment as-tu commencé à embrouiller nos vies ? Si tu n’as pas
pitié de moi, de ton oncle, n’as-tu pas une goutte de miséricorde pour ta mère,
pour ta mère qui t’attendait et t’espérait ? On s’est dit : un jour
il deviendra plus malin, il se mariera, il pensera à une femme, à des enfants,
il oubliera les bêtises de jeunesse.
À ce moment, sans me
rendre compte des conséquences de mes paroles, j’ai fait une blague
cruelle :
— Mais je suis
déjà marié...
— Eh bien,
pourquoi ne l’as-tu pas dit, quel âne ! cria ma grand-mère sévère. —
Sûrement c’est l’une des vôtres ? Ouvre ta bouche, espèce d’idiot. Qui
as-tu épousé ?
— La
révolution.
C’était comme si le
tonnerre avait éclaté dans la pièce. Mamie frappa dans ses mains comme si elle
sonnait le glas.
— Oh, bon sang,
misérable, que Dieu te tue toi et ta révolution. Est-ce que tu écoutes,
Haro ?
— J’écoute,
j’écoute... C’est mon destin ! ma mère sanglotait.
Je devais consoler
l’inconsolable. Je lui ai donné des exemples d’aide désintéressée entre
camarades, j’ai essayé de la rassurer que je ne resterais pas dans la rue et
j’ai invoqué sa foi en moi, que ce que je faisais était pour le bien de gens
comme nous. Ai-je réussi à soulager sa souffrance ? Une grande question
sans réponse... La séparation approchait inexorablement...
Nous nous sommes
étreints plus fort qu’il y a des semaines sur le quai de la gare. J’ai emporté
des livres et des manuscrits avec moi. En entrant dans la cour pavée, je me
suis retourné et j’ai dit au revoir à grand-mère : elle pleurait. Seule ma
mère en larmes m’a escorté jusqu’à la porte d’entrée.
Je me suis dirigé
vers ma nouvelle maison : le club du Parti des Travailleurs. Mon
raisonnement était que là, je demande à des camarades de m’héberger. À cette
heure-là, six heures du soir, il y avait très peu de monde dans le club, la
plupart m’étant totalement inconnus. Je me suis installé dans l’un des coins de
la petite salle pour 100 à 150 personnes et j’ai lu le roman alors populaire Le premier de l’écrivain soviétique
Bogdanov. Fasciné par l’histoire de la jeune héroïne, je n’ai pas remarqué
quand le salon fut presque plein. Habituellement, ici, tout se faisait dans la
bonne humeur : des salutations, des blagues étaient échangées, des tâches
spécifiques étaient convenues, des groupes séparés se réunissaient dans les
coins, d’autres se disputaient bruyamment, bref, le club bourdonnait comme une
ruche dans laquelle les gens parlaient à volonté et n’arrêtaient pas d’entrer
et de sortir.
L’ambiance générale
ne m’a pas captivé cette fois. La scène de la rue Osogovo était toujours dans
mon cœur. Grafa, Stefana Klintcharova, Yanko Petkov, ayant ressenti ma
condition particulière, ont fait preuve de délicatesse et ne m’ont pas demandé
les raisons. Seul Grafa a plaisanté de manière inappropriée :
— Tu
ressasses ? Je comprends. Pas facile de cuire dans son jus quand on a été
ballotté par la berceuse de la démocratie française... Haut la tête ! et
il se glissa dans un groupe d’ouvriers et d’intellectuels débattant s’il y
avait deux arts — prolétarien et bourgeois — et ce qu’ils avaient en commun.
À un moment donné,
j’ai vu Sasha, la femme de Théodore Angheloff, mon
ami de Bruxelles. Je l’ai approchée et lui ai révélé mon sort. Avec toute sa
petite taille, son visage de boule et ses doux yeux noirs, et surtout avec sa
voix d’alto douce et chaleureuse, elle rayonnait de gentillesse,
d’instantanéité, de simplicité. Presque ravie, elle me dit :
— Mais
bien sûr ! Mais sache que chez nous notre grand-mère commande aussi. C’est
ma mère. Je te préviens, nous habitons rue Zaichar, près du quartier gitan.
Avant d’entrer dans la pièce, tu franchiras des flaques d’eau ménagères. Comme
tu es mon Parisien, ça va être un peu difficile à supporter pour toi.
C’est ainsi que je
suis entré et que j’ai vécu dans la famille Sharlandzhiev. C’étaient des
réfugiés du village de Gorno Brody, région de Demirhisar. Après un séjour à
Gorna Dzhumaya, ils s’étaient installés à Sofia. Mamie Mitra vivait avec son
fils, un marchand de légumes, et avec sa fille, Sasha, qui est passée
d’enseignante à relieuse. Ses quatre petits-enfants — Dimitar, Todor, Stoyan et
Boris — avaient entre 10 et 25 ans.
Nous dormions sur
les trois lits de fer : le locataire Kosta Veselinov, étudiant, Dimitar
Sharlandzhiev, également étudiant, et moi. Les autres membres de la famille se
blottissaient dans un couloir étroit et une pièce du rez-de-chaussée qui
servait de cuisine et de salle à manger. Ayant survécu aux horreurs du
soulèvement de septembre, mamie Mitra avait une haine féroce envers les
fascistes. Elle les considérait comme pires que les Turcs et non seulement elle
n’intervenait pas, mais elle encourageait également les siens à lutter contre
eux.
Dans la famille
Sharlandzhiev, je respirais librement. Je me sentais vraiment parmi les miens.
Avec moi, le chômeur, ils partageaient souvent leur maigre pain. En plus, ils
m’ont aidé avec de l’argent pour un tram et d’autres petites dépenses.
RENCONTRE
AVEC DIMITAR POLYANOV
Le temps est venu de
comparaître devant le rédacteur en chef du magazine Enclume Dimitar Polyanov. J’étais gêné d’être confronté devant le
poète prolétaire respecté, mais mon désir d’entendre son opinion sur deux de
mes articles de Paris l’emporta. J’étais encore plus intéressé par le sort
d’autres matériaux soumis mais non publiés. Le pionnier de la poésie
prolétarienne vivait quelque part sur le boulevard Slivnitsa, sur la rive
gauche du fleuve. Il m’a longtemps gardé devant la porte de la maison sous
prétexte qu’il s’apprêtait à sortir à l’imprimerie, mais en fait il n’arrêtait
pas de me demander qui je connaissais de mes camarades du club et qui j’avais
vu récemment. Je lui ai mentionné quelques noms, mais ils n’ont pas semblé le
convaincre. Comme s’il n’avait rien entendu, il m’a grossièrement demandé de
m’identifier. Complètement gêné par le geste non poétique de l’auteur de mon
poème préféré, Les idoles ruinées,
j’ai présenté ma pièce d’identité. L’examinant avec curiosité, l’hôte m’a
finalement invité à entrer :
— Allez,
bon, bienvenue.
Le bureau de
l’éditeur était situé dans une petite pièce au rez-de-chaussée. Des journaux,
des magazines et des livres bulgares et étrangers étaient entassés sur une
table de taille moyenne. Entre eux — des pages manuscrites dispersées ici et
là. On pouvait voir d’anciens numéros d’Enclume
sur le sol et sur plusieurs chaises empaquetées. Les étagères sur les murs
étaient pliées sous le poids des livres anciens et nouveaux reliés et non
reliés. Toujours avec une suspicion évidente à mon égard, Polyanov m’a demandé
de lui dire ce qu’ils jouaient actuellement dans les salles parisiennes.
Pendant le récit, il m’a observé et a semblé recueillir des preuves de ma
sincérité. Afin de gagner sa confiance, je lui ai confié, en tant que vieux
communiste éprouvé, la décision du CC du PCB de faire venir certains camarades
de l’étranger.
Au final, mon
interlocuteur a changé de ton envers moi et s’est excusé pour l’accueil peu
aimable du début :
— Vous savez,
ils m’envoient constamment des provocateurs, ils veulent à tout prix s’emparer
de mes liens avec le parti.
Il s’est empressé de
me faire plaisir et m’a remis l’honoraire de 200 levas. Pas un instant je
n’avais imaginé que je serais récompensé financièrement. En rougissant, j’ai
refusé l’argent, mais l’éditeur a insisté, et j’ai accepté.
La conversation a
rapidement pris une tournure constructive. Le vieux poète, qui n’était pas du
tout vieux mais portait une barbe, loua mes articles imprimés et non imprimés,
s’excusa d’avoir été grossier en ne répondant pas à deux de mes lettres, et me
fixa une nouvelle tâche : un article-réponse aux conférences populaires de
Nikola Sakharov après son retour d’URSS. Le parti cherchait un camarade pour
une telle réponse, mais personne n’osait discuter avec le
statisticien-économiste communiste de haut niveau, un renégat du parti
communiste.
Armé de mon
enthousiasme sincère mais nu, j’ai accepté la tâche. Mon oubli de soi juvénile
avait encore quelques retenues. J’ai demandé que ce qui était écrit soit révisé
par notre spécialiste de l’économie soviétique...
Quelques semaines
plus tard, le titre sensationnel Les
incarnations d’un équilibriste est apparu dans le magazine Enclume. On ne sait pas qui et dans
quelle mesure mon travail « économique » a convaincu. Une chose est
sûre — après la publication dans Enclume,
la participation massive aux conférences de Sakharov baissa. Nos gens
raisonnaient ainsi : si une publication du parti critique Sakharov, alors
il est contre le parti et ne mérite pas d’être soutenu.
De ce travail
imprimé a suivi un effet privé. Avec son langage relativement vif et la pensée
de Lénine (sans citer le nom de Vladimir Ilitch pour des raisons de censure),
il donnait l’impression que l’auteur était un « professeur »
récemment revenu du pays des Soviéts. Après le billet de propagande
antireligieux et surtout après cet article polémique, il m’a été plus facile de
me faire une place dans nos cercles intellectuels. Encho Staykov, Sava
Ganovski, Dimitar Naïdenov, Hristo Radevski, Jacques Nathan, Georgi Karaslavov,
Nikola Lankov, Alexander Zhendov, Anguel Todorov, Krum Penev, Vladimir
Topentcharov m’ont accepté comme un des siens avec qui ils pouvaient se
comprendre et discuter sur un certain nombre de questions.
LA
FAIM DE SOFIA
Pendant cette
période, ma vie ne s’est pas limitée aux petits et grands succès. Après la
grève chez Tango, beaucoup d’entre nous ont rejoint la longue file des chômeurs
amaigris. Peu de temps après, la famine est arrivée. Cela a duré pour moi plus
de trois mois. Les camarades le savaient. C’était souvent par hasard qu’ils
m’offraient différentes collations ou m’invitaient à manger à la maison. Au
début, j’ai accepté, mais avec la prolongation de la faim due au chômage, mon
sens de la dignité personnelle a commencé à me dissuader d’utiliser l’aide
désintéressée de mes amis proches. Comme Rakhmetov, je voulais voir combien de
temps je pouvais tenir. J’ai perdu beaucoup de poids, en marchant, je
chancelais. La famine de Sofia a dépassé la famine de Paris. Non seulement en
temps, mais aussi en atmosphère morale. À Paris, ma faim la plus longue a duré
trois jours. Ici, pendant plus de cinq jours, je ne me suis rien mis sous ma
dent sauf une gorgée d’eau des fontaines de la rue. Là-bas on mourait de faim
en groupe, ici j’étais seul.
Véritable assistant
invisible, Grafa s’est mis en tête de me sauver. Il a parlé à son gendre et l’a
forcé à m’engager comme serveur dans l’auberge végétarienne du boulevard Hristo
Botev.
L’auberge venait
d’ouvrir, il n’y avait pas encore de gros chiffre d’affaires, ils ne pouvaient
pas me payer, je ne travaillerais que le midi. Je pourrais bien m’empiffrer,
pour me garder rassasié jusqu’au lendemain. C’était une solution temporaire.
Face à la menace de
me faire fondre de faim, j’ai accepté d’être serveur. J’ai servi pendant plus
de deux mois. Les premiers jours, je me suis senti sauvé. Les plats végétariens
m’ont semblé magiques, et je les ai dévorés de la grandeur d’un Krali Marko[43].
Au début, le travail
manquait. Après le premier mois, la clientèle, attirée par les prix abordables
et la bonne qualité de la nourriture, remplissait toutes les tables. Les
clients étaient principalement des cheminots de la gare et de l’atelier
mécanique voisins. Ils avaient une pause-déjeuner d’une heure et insistaient
pour que le serveur s’exécute prestement. En toute bonne foi, je faisais un
effort incroyable pour bien travailler. Après les cheminots venaient les commis
et les artisans, alors je pouvais m’asseoir pour déjeuner vers deux heures et
demie. De plus en plus, j’étais épuisé au point que je ne pouvais pas manger
suffisamment pour durer jusqu’au lendemain. J’ai recommencé à perdre du poids.
Heureusement, le
parti veillait sur moi. Par décision de la représentation à l’étranger du CC du
PCB, les dirigeants de l’organisation de Sofia s’étaient déjà tournés vers deux
des « Parisiens » de retour : Stefan Hristov –
« l’indien » et moi-même. Mon ami, qui était impliqué dans le premier
comité de district du PCB, bénéficiait depuis un certain temps d’un modeste
soutien financier.
MEMBRE
DU DEUXIEME DISTRICT DU PCB À SOFIA
Un jour, fin
septembre 1931, Hristo Radevski m’invita mystérieusement dans son appartement.
Il vivait rue Clémentina dans la famille des sœurs du militant des jeunesses
Dimitar Konstantinov – Mitreto, assassiné à la Direction de la Police. Dans une
pièce étroite et modestement meublée, Hristo commença à me lire des extraits de
150 000 000 de Vladimir Maïakovski.
La conversation est passée inaperçue sur Geo Milev et son poème Septemvri. Je lui ai vanté d’avoir été
l’un des initiateurs de la publication de ce poème à Paris, de l’avoir déjà
récité avec quelque succès. Puis Hristo a exprimé son opinion sur le poète Geo
Milev.
— J’aime
Geo. Il y a quelque chose de tourbillonnant, de déchaîné, mais en même temps de
beau chez lui. Mais Maïakovski semble être d’une autre matière et de
différentes dimensions. Dans chaque mot qu’il dit, tu sens le membre du parti,
le parti. Quelle perspicacité : « Quand on dit Lénine, on veut dire
le parti, quand on dit le parti, on comprend Lénine. » C’est-à-dire, mon
ami : l’art est et ne peut qu’être partisan. Je veux créer un tel art, je
veux être Maïakovski, mais je ne peux pas.
Et Hristo fut le
premier à rire de sa blague, regarda l’horloge, appela Sonia, une des sœurs, et
lui demanda si les camarades étaient venus ? Il n’y en avait qu’un dans sa
pièce, mais elle ne savait pas combien devaient venir. Hristo en a profité pour
me présenter :
— Vous êtes un
peu comme des collègues, mais vous ne vous connaissez pas. La camarade est de
Kilkis comme Grafa, elle s’appelle Sonya et elle récite aussi, et très bien,
mais pas aussi bien que lui !
Sonia ne se laissa
pas faire :
— Tu as trouvé
quelqu’un à qui me comparer. Camarade, je ne te connais pas, mais je dois te
dire que Radevski est un bon, voire un très bon poète, mais pas aussi bon que
notre Hristo Smirnenski de Kilkis... Je te l’ai rendu ?
Nous avons ri de bon
cœur. Surtout, Hristo, qui a avoué être surpassé en bavardage :
— C’est ma
faute ! Un chien qui ne peut pas aboyer fait entrer lui-même le loup dans
la bergerie.
Quelqu’un a frappé
avec un code à la porte du couloir. Avant de sauter pour ouvrir, Sonia a
demandé ce qu’elle devrait répondre si par hasard des policiers arrivaient.
Hristo lui expliqua que ses camarades seraient venus le voir pour lui demander,
lors de leur excursion à Vitosha, de leur parler du dénominateur commun entre
la poésie de Botev et Smirnenski. Sonia en profita pour remarquer qu’un jour il
faudrait vraiment qu’il se penche là-dessus. Hristo a décidé de plaisanter et a
répondu :
— Un jour... un
jour je pourrai épouser Sonia, mais un jour...
Sonia lui répondit
avec esprit cette fois aussi :
— Dieu me
protège. Ce jour-là, ta petite chérie m’arrachera les yeux...
La bonne camaraderie
et le ton joyeux dans la pièce de mon ami étaient une excellente introduction à
mon entrée dans les rangs du parti illégal. Et pas en tant que soldat
ordinaire, mais en tant que membre du deuxième comité de district de
l’organisation régionale de Sofia. Parce que cette réunion était de facto une
réunion du comité régional.
Le secrétaire du
comité Stoyan Zmiyarov a prononcé quelques mots d’introduction. Le Comité
central m’a envoyé vers eux. Donc, il n’y a pas à me questionner. À partir
d’aujourd’hui, je suis devenu membre du deuxième comité de district de
l’organisation régionale du PCB. La composition du comité était un secret
absolu. En cas d’échec, nous n’aurions pas dû nous connaître. Et me perçant de
son regard acéré, il haussa la voix et souligna :
— Nous devons
être prêts pour tous les sacrifices : passages à tabac, arrestations,
prisons... tout... Et maintenant, si le camarade veut nous dire quelque chose,
il a la parole.
J’étais plus excité
que surpris. Je m’attendais à être attiré par le parti. Grafa et Stefan m’ont
suggéré que cet acte serait accompli le moment venu.
Ce jour est
arrivé ! J’ai frissonné de la tête aux pieds. Je pouvais à peine
prononcer :
— Je remercie
le parti pour sa confiance. J’essayerai de la mériter.
Le secrétaire et
Hristo étaient manifestement ravis de mon laconisme. Seul David Asa a
dit :
— Le camarade
doit être un orateur. Il pourrait en dire plus.
Ensuite, j’ai appris
les frontières du deuxième district : principalement le centre et Poduyane
— à Sofia et dans la province — Elin Pelin, Samokov, Dolna Banya, Kostenets. On
m’a confié la direction des sections du parti de la Maison du commerce, de la
poste centrale, de l’usine Berov, de la coopérative de meubles Tonet, etc.
J’établirais des liens avec eux par l’intermédiaire d’Asa. Enfin, j’ai annoncé
mon nom fictif — Mircho.
Radevski et moi
sommes allés au club. Je me sentais comme un nouveau converti dans un ordre
monastique secret. Désormais, me semblait-il, je serais différent, je
regarderais la vie différemment, les autres, et eux, à leur tour, ressentiront
probablement le changement et me traiteront différemment. Ma nouvelle qualité —
membre du comité de district du parti illégal de Dimitar Blagoev — a révélé le
monde autour de moi d’une nouvelle manière. Hristo et moi avons marché le long
de rues super connues, devant des maisons et des gens que nous avons rencontrés
des centaines de fois, et il semblait qu’il ne s’agissait pas des mêmes rues,
maisons et personnes.
En cours de route,
le jeune poète m’a surpris avec une opinion. Il est né pour écrire. Son désir
le plus profond était de s’isoler dans un grenier, de s’entourer de ses livres
préférés et d’écrire, d’écrire, de créer selon sa force en faveur de la
libération du prolétariat. Il parcourait les gradins, distribuant de la
littérature illégale. Il n’a pas refusé même de rejoindre le comité de
district. Il avait donc témoigné de courage et il était prêt à des sacrifices.
Mais il ne comprenait pas pourquoi on lui confiait des tâches d’organisation.
Premièrement, il ne savait pas comment, il était un piètre organisateur, même
dans sa vie privée, il était assez dispersé, et deuxièmement, cela lui prenait
du temps, qu’il pouvait utiliser de manière créative au profit non pas d’une
section, mais de l’ensemble de la classe ouvrière. Il voulait être un bon
combattant avec la plume, pas un mauvais organisateur de section. Nous avons
soi-disant cherché à entrer la culture des travailleurs dans le parti et ses
instances dirigeantes, et nous avons souvent poussé des intellectuels à de
nombreux postes à responsabilités.
Intérieurement je
l’approuvais, mais extérieurement j’ai considéré qu’il était de mon devoir de
nouvel initié d’attirer son attention sur les considérations suprêmes, souvent
inconnues de nous, de la direction du parti. Ne trouvant rien à dire, je me
suis lancé vers une porte ouverte : le service du parti demande des
sacrifices, il faut être prêt à les faire à tout moment et indépendamment des
intérêts personnels. Dans son ton polémique inhérent, Hristo a crié :
— Le parti veut
des sacrifices et il a raison. Mais nous, les victimes, n’avons-nous pas le
droit de vouloir que le parti répartisse son personnel avec plus de sagesse et
de parcimonie ? Et sans cela, en termes de personnel, nous ne sommes pas à
la hauteur !
Nous avons rencontré
David Asa au club, mais nous ne nous sommes pas dit bonjour. Voilà, je suis
devenu un conspirateur !
Il y avait deux
distributeurs à la poste centrale — Asen et Ivan. Aussi grand qu’était Asen,
avec un regard ouvert dans ses yeux bleu-vert et un baryton doux, aussi bas
était son compagnon, éprouvé et caché — silencieux et faible dans ses yeux et
sa voix. Ce qu’ils avaient en commun, c’était leurs uniformes usés et leur
volonté de servir la cause. Ils furent rejoints par un troisième camarade, un
petit commis, grand, maigre et pâle comme un linge. J’ai travaillé avec cette
section de trois personnes pendant plusieurs mois. Lors de réunions et
rencontres secrètes, je leur ai transmis les instructions du comité de district
sur la manière de renforcer le travail parmi les facteurs. Je leur recommandai
toutes sortes de propagandes et d’agitations, sans être jamais entré dans les
bureaux de poste en activité et sans connaître d’autre facteur vivant qu’eux.
Il est facile aujourd’hui d’imaginer à quel point mes grands mots leur
semblaient détachés de la réalité. Cependant, les résultats ne se sont pas fait
attendre. Les camarades ont accepté de répandre des tracts illégaux alors que
tous les distributeurs étaient occupés à distribuer les lettres, d’écrire une
brochure anti-guerre à une fausse adresse, de la récupérer et de la glisser à
leurs collègues pour qu’ils la lisent, d’écrire des slogans sur les murs des
couloirs et des toilettes, de distribuer le Journal
ouvrier et autres.
En plus, Asen et
Ivan ont rempli une tâche principale : ils ont convaincu trois jeunes
employées du service téléphonique de rejoindre le parti. À l’exception d’une —
parfaitement mince, comme un squelette drapé d’un imperméable — qui paraissait
plus âgée, les deux autres camarades ne dépassaient pas l’âge initial du
Komsomol[44].
Il était logique pour eux de former une section du Komsomol. Mais devant notre
comité de district et moi-même personnellement nous avions pour tâche
« d’augmenter le nombre » du parti dans le centre-ville, alors dans
mes rapports sur l’état du nombre des sections, je gardai sous silence l’âge
des téléphonistes.
Olga, Tséna et
Zdravka, comme elles s’appelaient devant moi, ont rapidement rejoint le combat
après une certaine hésitation. Le point culminant de leur maturation politique
a été leur participation aux tribunes de rue et à la délégation d’Olga — aux
joues roses et aux lunettes dorées sur un visage d’enfant — à une conférence
régionale illégale sur Vitosha.
À la maison du
Commerce, David Asa m’a mis en contact avec le tailleur Petar Grantcharov,
propriétaire d’un petit atelier de couture au rez-de-chaussée. La maison était
bondée de cabinets d’avocats avec des centaines d’avocats, de greffiers et de
dactylographes. La section du parti de Grantcharov avait réussi à atteindre
certains qui avaient accepté de recevoir de la littérature illégale, d’acheter
des timbres pour aider les prisonniers politiques et d’autres à céder leurs
bureaux pour des réunions et rencontres illégales. Mais aucun avocat n’a
accepté de devenir membre de la section. Sans analyse politique sérieuse, Grantcharov,
son collègue Temelkov et moi nous nous sommes mis à les qualifier
« d’intelligentsia petite-bourgeoise » et à les déclarer indignes
d’être dans les rangs du prolétariat conscient de classe. L’histoire de
l’organisation de Sofia montre à quel point nous avons été injustes à leur
égard : nombre de ces avocats, lâches opportunistes selon nous, ont servi
directement le Comité central ou ses organes.
Seuls les artistes
prolétaires, qui étaient toujours avec nous et parmi nous, nous considéraient
alors comme de véritables révolutionnaires. Hristo Radevski, Georgi Karaslavov,
Nikola Lankov, Mladen Isaev, Krastyo Belev, Anguel Todorov, Ivan Martinov,
Alexander Zhendov et d’autres sous nos yeux ont été endurcis dans un combat au
corps à corps avec la police.
Un dimanche matin,
le Comité régional du PCB avait convoqué les travailleurs de Sofia pour
protester contre le chômage. Le lieu de la manifestation — Place Sveta Nedelya.
Chômeurs, chômeurs à temps partiel — comme moi, et avec un travail à temps
plein – travailleuses, travailleurs et intelligentsia ouvrière, nous avons
commencé à nous rassembler en groupes et à marcher autour de l’endroit de
l’action. Nous nous attendions à une plus grande majorité de chômeurs, et c’est
pour cela que l’action a été retardée. Selon un mot de passe secret, nous
devions tous nous rendre à l’arrêt de bus de Kniajevo. Là, élevé dans les bras
de deux camarades forts, l’orateur Todor Stoyanov — Toshkata, faible, petit,
mais vif comme du mercure et d’une voix bien supérieure à la taille de sa
silhouette, a condamné la politique sans âme du gouvernement réactionnaire. Dès
qu’il a prononcé quelques slogans, un groupe de civils et de policiers en
uniforme a attaqué l’orateur et les chômeurs autour de lui avec des revolvers
et des sabres. Un corps à corps s’ensuivit à la surprise des passagers et
touristes rassemblés devant l’arrêt de bus. Plusieurs touristes ont crié :
« Honte ! Laissez les chômeurs manifester pacifiquement. » En
plein affrontement, la police à cheval a pris d’assaut la place. Avec des
chevaux, la police écrasait des piétons et des manifestants, et avec le dos des
sabres ils frappaient des coups sauvages. Bien que nous ayons reculé le long de
la rue Clémentina, nous nous sommes défendus vaillamment, à la fois en groupe
et individuellement. Radevski, Lankov et moi nous nous sommes retirés également
dans cette direction, ne cessant de protester et de jeter des pierres sur les
cavaliers enragés. Un garde à cheval s’est précipité sur moi, m’a forcé à
tourner et à dévaler la rue Lavelé. Il m’a suivi. J’ai précipité ma course.
Juste devant le coin de la rue Positano, attrapant un poteau électrique, j’ai
soudainement fait un cercle complet en arrière. Le cheval freina des quatre
fers, des étincelles jaillirent, il se dressa sur ses pattes arrière, mais ne
put s’arrêter. J’ai cherché le salut dans la porte d’entrée ouverte d’un
immeuble. Haletant, je montai au deuxième étage, occupé par des cabinets
d’avocats, tous enfermés. Dans le noir, j’ai vu des toilettes. Je suis entré et
j’ai fermé de l’intérieur.
Une demi-heure plus
tard, le silence habituel du dimanche est tombé dans les rues, interrompu
seulement par le bruit d’un tramway à proximité. J’avais peur qu’il y ait une
embuscade devant la maison. Il n’y avait que deux étages, mais assez hauts.
J’ai regardé par la fenêtre et j’ai bien hésité, mais j’étais jeune et agile,
j’ai sauté. Je me suis retrouvé dans une cour envahie de buissons verts
sauvages. Par une brèche dans la clôture en bois, je me suis glissé dans la rue
Positano.
Je suis rentré à 16h
à la maison. Mon pied droit a commencé à me faire mal au talon. Deux heures
plus tard, il a enflé. Le lendemain, la grande silhouette du Dr Ratcho Anguelov
a constaté un os cassé. Un merveilleux camarade, un homme noble et un médecin,
il m’a rassuré :
— Cette fois ça
va passer légèrement. Le septième jour, tu seras complètement guéri. Mais ce
n’est qu’à la septième année que ton talon cessera de te rappeler qu’un jour tu
as sauté bêtement. Une autre fois saute sur tes doigts de pied.
DANS
LA RÉDACTION DU JOURNAL ÉCHO
Mon existence de
semi-affamé a pris fin le jour où j’ai été admis au journal Écho. Ce n’était pas seulement un
tournant dans mes années de famine. Le parti m’honorait d’être l’un des cinq ou
six rédacteurs de son quotidien légal. J’aimais écrire et j’écrivais un peu,
mais être parmi les héritiers de Dimitar Blagoev, Georgi Kirkov, Georgi
Dimitrov, Hristo Kabakchiev, Todor Petrov — les fondateurs de la presse
ouvrière dans notre pays — mon esprit n’en revenait pas.
La rédaction du
journal Écho était installée dans
l’imprimerie Kambana. Quand je dis
rédaction, je veux dire une pièce de 10-12 mètres carrés avec deux tables de
cuisine ordinaires et une seule fenêtre de taille moyenne. Les rédacteurs
écrivaient leurs matériaux sur ces tables, et moi, en tant que correcteur, je
corrigeais les épreuves et les pages. Le rédacteur en chef, Jacques Nathan,
debout, feuilletait hâtivement la presse du matin puis s’asseyait à la table et
de la main gauche avec une petite écriture, esquissait l’éditorial au crayon.
(Très rarement, il écrivait ses articles à la maison.) Cela était établi comme
règle pour être en phase avec la vie quotidienne. Nous réagissions avec
vivacité à l’évolution rapide des événements politiques. Chaque jour, les membres
du parti et les sympathisants en dehors du parti attendaient avec impatience le
journal, c’est-à-dire la parole du parti communiste bulgare endurci et
éternellement vivant. La parole était audacieuse, claire et interpellait.
Répondant aux moindres besoins et questions, nous n’avons jamais oublié
d’orienter les lecteurs vers le but ultime — l’établissement d’un gouvernement
ouvrier et paysan démocratique. Sans aucun doute, nos écrits souffraient d’un
certain nombre de faiblesses du sectarisme d’alors. Un défaut que nous n’avons
jamais montré était l’opportunisme réformiste. Il était étranger à notre sang
chaud et jeune et à notre conviction de la proximité de la révolution
prolétarienne.
Mon travail
principal était la relecture. Mais entre les épreuves successives, je
corrigeais ou écrivais souvent des dizaines de notes que je n’avais pas pu
préparer la veille. Je consacrais habituellement les après-midis et les soirées
à des rencontres et réunions illégales, et à l’écriture de documents du parti.
Jusque tard dans la nuit, j’écrivais des articles sur les questions syndicales
et les grèves. Parallèlement, je participais aux Opinions et Notes, m’essayais au feuilleton, et étais responsable
des feuillets littéraires. Aucun de mes écrits ne portait ma signature. Soit
dit en passant, les autres éditeurs ne publiaient pas leurs noms. Mon article
littéraire sur l’œuvre acclamée La
chanson des sabots de Krastyo Belev a été publié dans Écho sous le pseudonyme de Yasen Veselinov. Toujours dans le
journal Écho, j’ai publié une
critique littéraire de Georgi Karaslavov en relation avec son roman Sporjilov.
Un matin, Hristo
Radevski est entré dans la salle de rédaction et m’a demandé si j’avais regardé
la veille au soir Le chemin de la vie,
le deuxième film soviétique depuis Petroushka
à être passé par les aiguilles de la censure policière. La présentation du film
Le chemin de la vie était l’occasion
de démontrer notre amour inextinguible pour l’Union soviétique. Les
représentations au Théâtre Moderne, aujourd’hui cinéma Ts. Tserkovski, se sont
transformées en manifestations de masse en l’honneur du pays des Soviets. Au
bout de 7 jours, malgré la fréquentation sans précédent, ou plutôt à cause de
son énorme succès, le film a été arrêté. Le premier jour, j’étais l’un des spectateurs
et j’essayais d’obtenir un billet pour le voir une deuxième fois. Je n’ai pas
pu voir le film une deuxième fois et à la demande pressante de Hristo, j’ai dû
écrire le matériel rapidement.
Environ une heure
plus tard, la critique était rédigée, lue devant la rédaction en présence
d’Alexander Zhendov et insérée le lendemain dans Relef sous le pseudonyme de Boris Ogin.
Mon travail de
journaliste à Écho et plus tard à Relef a été très intense et varié
jusqu’au coup d’État du 19 mai, lorsque tous nos journaux et magazines ont été
interdits.
UNION
DES ÉCRIVAINS LABORIEUX
Au début des années
1930, dans notre propagande écrite, nous écrivions souvent et avions
familiarisé le public ouvrier avec les thèmes de la littérature prolétarienne
et du réalisme socialiste, que nous appelions artistique pour des raisons de
censure. Les auteurs prolétariens de poésie et de prose ont commencé à vivre
avec la confiance des écrivains, malgré le petit nombre d’œuvres qu’ils ont
créées. Certains avaient tenté d’adhérer à l’Union officielle des écrivains,
mais ils avaient été catégoriquement refusés. Dans les conditions de
l’émergence et de la maturation de la littérature prolétarienne et du
renforcement des talents d’écrivain, le parti s’est donné pour tâche de former
un syndicat d’écrivains progressistes. L’objectif était de séparer et d’ériger
la stature imposante de la créativité prolétarienne face à la prose, à la
poésie et à la critique bourgeoises. Une forme d’organisation légale était
recherchée pour que le détachement d’artistes prolétariens puisse s’opposer et
agir de façon organisée contre l’influence pernicieuse de l’art bourgeois.
Plusieurs réunions ont eu lieu à l’école de commerce Maika de la rue Lavelé. Les écrivains prolétaires bien connus y ont
pris une part active, ainsi que les adeptes d’alors : Lyudmil Stoyanov,
Dimitar Hadjiliev, Todor Guenov et d’autres. Topentcharov et moi assistions
régulièrement à ces réunions préliminaires — lui en tant que théoricien de
l’esthétique prolétarienne, moi en tant que critique littéraire et théâtral. Le
nom de la future organisation proposée à l’origine était l’Union des écrivains
prolétariens révolutionnaires. Les adeptes s’y sont opposés, principalement
pour des raisons de censure. Certains d’entre nous, ayant lu certaines œuvres
de Lénine, ont compris qu’il s’agissait de réunir les artistes prolétaires et
les adeptes en un tout unique. Il fallait donc chercher un nom plus approprié.
Lors d’une réunion
du secteur prolétarien présidée par Trudin — Sava Ganovski — il y eut de longs
débats. Nous tenions séance dans l’un des cabinets d’avocats de la maison du
Commerce. Dans mon discours, j’ai cité à plusieurs reprises Lénine pour prouver
que dans les conditions de la dictature fasciste avec sa censure draconienne,
l’essentiel est le contenu et qu’il faut donner une importance secondaire à la
forme. Trudin, qui venait de rentrer de Moscou, où il avait eu l’occasion de
passer par la solide école du marxisme-léninisme, me reprocha d’avoir
sous-estimé l’unité inséparable entre la forme et le contenu. Mais en fin de
compte, il accepta le nom que j’avais suggéré, l’Union des écrivains laborieux.
Lors de l’assemblée générale suivante dans la salle Maika en présence du
célèbre agent de police Grozev, le président Ganovski a expliqué, proposé et
persuadé les écrivains, poètes et critiques réunis de voter pour la création
d’un nouveau syndicat créatif — l’Union des écrivains laborieux. L’écrivain
Dimitar Hadjiliev, connu comme le traducteur du roman populaire d’Erich Maria
Remarque À l’Ouest, rien de nouveau, a été élu à l’unanimité secrétaire
général... Il a généreusement offert sa maison comme siège de l’union et a
distribué encore plus généreusement ses solides honoraires de traduction au
groupe d’écrivains prolétaires mal nourris.
La création et le
fonctionnement de l’Union des écrivains laborieux correspondaient à
l’irrésistible montée en puissance de la lutte dans tout le pays. Des dizaines
d’organisations de masse se sont développées et renforcées sous la direction du
PCB, qui était lui-même en train de s’étendre dans les villes et les villages.
Les grèves mobilisaient des dizaines de milliers de gens du travail et
durcissaient leur volonté d’avoir plus de pain et une vie humaine décente.
Environ 40 journaux et magazines dénonçaient les lacunes du système
capitaliste, indiquaient la voie prolétarienne pour sortir de la situation
difficile et appelaient à l’établissement d’un gouvernement ouvrier-paysan. Le
prestige du pays soviétique, s’engageant dans la voie de la collectivisation et
de l’industrialisation largement médiatisée par le journal Pogled, grandissait de jour en jour ; la foi traditionnelle du
peuple bulgare dans la mission de sauveur de la Russie était irréversiblement
renforcée. Les cercles dirigeants ont échoué aux yeux des patriotes honnêtes à
cause de leurs abus criminels, de leurs transactions scandaleuses, de leur
incapacité déclinante à donner quelque chose de nouveau au peuple. Les masses
ouvrières rêvaient et luttaient, en s’inspirant largement du peuple soviétique.
C’est dans ces
conditions que devaient se tenir en septembre 1932 les élections municipales de
Sofia. Une lutte de pouvoir décisive se préparait dans la municipalité de
Sofia. Les forces de la bourgeoisie partaient en bataille divisées : d’un
côté, le Bloc populaire, composé de démocrates, d’agriculteurs, de radicaux, de
socialistes, et, de l’autre, avec des listes indépendantes l’Entente
démocratique, des libéraux, des conservateurs autour du journal Mir et autres. Face à eux, uni et puissant,
se tenait le Bloc travailliste d’honnêtes gens de l’usine, de l’artisanat, du
travail mental et des partisans de la gauche agricole, dirigé par Lazar Stanev.
Le comité régional
du PCB, qui comprenait Ivan Pianechki — secrétaire, Stefan Hristov, Pavel
Popandov, Stefana Klintcharova, Ivaïlo Videnov et l’auteur de ces lignes, a
débattu lors de plusieurs réunions du contenu et des formes de la campagne
électorale. Dans des dizaines d’appels de campagne, le comité régional a appelé
les travailleurs de Sofia à porter un coup écrasant à l’administration
bourgeoise en faillite et à s’emparer du pouvoir municipal. Nous, les auteurs
de ces appels, n’avons franchement pas considéré le rapport de force en notre
faveur. Mais nous avons délibérément lancé des slogans extrêmes ;
l’important dans le processus de la campagne électorale était d’élever la
conscience politique de l’électorat.
Avant la date des
élections, les membres du comité régional ont tenu des centaines de conférences
et de discussions avec des sections communistes dans les usines, les ateliers,
les bureaux et les rues. De nombreux appels et brochures ont été publiés. Des
milliers d’articles ont été écrits dans nos journaux. Des centaines de réunions
ouvertes et secrètes ont été organisées dans les usines, les quartiers, les
institutions. Chaque communiste organisé avait le devoir de faire le tour des
dizaines de non-membres du parti, de leur parler en personne et de les
convaincre de voter avec le bulletin d’argent. Alexander Zhendov a peint une
magnifique affiche — une main de travailleur musclée levée, enroulée dans un
poing puissant, prête à tomber sur la coiffure municipale réactionnaire de
Sofia. Tous ces efforts et bien d’autres ont été concentrés dans un seul appel
courageux : « Votez pour le Bloc travailliste ! »
La bourgeoisie
dirigeante a mobilisé toutes ses forces contre la préparation électorale de la
masse ouvrière de Sofia. Des bandes de policiers ont attaqué les personnes
réunies lors de rassemblements électoraux légitimes, et avec des revolvers, des
sabres et des poings de fer, des coups de poing et des coups de pied, les ont
blessées et dispersées. Il n’est pas une seule figure du Parti des
Travailleurs, des syndicats, de l’Union des jeunes ou des autres organisations
de masse qui n’ait pas éprouvé les griffes des pattes d’ours de la gouvernance
bourgeoise. Même nous, les militants du PCB illégal, ayant participé activement
en tant qu’inspirateurs et organisateurs d’événements publics, avons reçu notre
part du harcèlement policier. Au corps à corps, le secrétaire Pianechki,
Stefana Klintcharova, Pavel Popandov et d’autres membres du comité régional ont
été grièvement ou légèrement blessés. Parallèlement aux rixes barbares, le Bloc
populaire pratiquait des arrestations massives. Durant cette période
pré-électorale, des centaines et des milliers d’ouvriers ont transité par les
cachots des commissariats de quartier de Sofia et de la Direction de la Police.
La terreur noire faisait rage quotidiennement et partout. La censure
confisquait de plus en plus les journaux, les brochures et les appels. Des
gardes, des agents civils et des gangs fascistes déchiraient et souillaient les
affiches et les slogans du Bloc travailliste. Apparemment, quelques heures plus
tard seulement, au même endroit, nos courageux supporters ont de nouveau collé
des affiches et écrit des slogans encore plus vaillants à la peinture épaisse.
La lutte sur les murs des immeubles et les chaussées des rues était menée avec
une persévérance particulière. La classe réactionnaire ne réussissait pas à
fermer la bouche de la justice. La parole du Bloc travailliste a brisé les
mensonges, les calomnies et la démagogie de toutes sortes de gribouilleurs et
orateurs des chemises noires, en répandant la vérité sur l’Union soviétique, la
terre du travail humain libéré, expliquait le programme électoral, éduquait et
appelait au progrès social.
Le jour même des
élections, le 25 septembre, les sommités et les serviteurs de la classe
réactionnaire, comme en prévision de leur honteuse défaite, ont piétiné toutes
les normes de la légalité bourgeoise. Devant de nombreux bureaux de vote dans
les quartiers périphériques, des policiers en uniforme et en civil et des
canailles fascistes furieux ont fouillé les électeurs les plus pauvres. Ils
cherchaient les bulletins de vote du Bloc travailliste. À l’intérieur des
salles obscures elles-mêmes, comme de vrais gangsters, ils volaient les piles
de bulletins de vote en argent qu’ils haïssaient. Le sommet de la déchéance a
été atteint lorsque le maire de Sofia de l’époque, monsieur Nachev lui-même, a
pris part à ces actions de gangsters. Il s’est présenté au bureau de vote de la
rue Regentska — en face du bâtiment de l’actuel théâtre Sofia. Il a demandé à
être informé du déroulement du vote. Sous prétexte d’inspecter toutes les
dispositions de la loi sur le scrutin secret, il entra dans l’isoloir. Là,
comme un escroc ordinaire et un brigand, il ramassa tous les bulletins de vote
en argent et les fourra dans ses poches. Le mandataire et candidat du Bloc
travailliste est entré dans l’isoloir immédiatement après lui et a constaté le
vol flagrant. Démasqué devant tous les membres du bureau électoral et poursuivi
par le ridicule et les protestations d’un groupe d’électeurs honnêtes, le
premier citoyen de la bourgeoise Sofia, comme un chien la queue entre les
jambes, s’est empressé de décamper avec le fiacre municipal.
Les résultats des
élections ont été annoncés depuis le balcon du bâtiment du journal Priaporets sur la place Slaveykov. Leur
annonce a commencé à 21h et a duré jusqu’à 23 h 30. Il y avait beaucoup de nos
camarades parmi les citoyens curieux. Grafa et moi étions également venus
entendre la volonté des électeurs de Sofia. Au départ, les résultats étaient
donnés des sections où le Bloc travailliste récoltait relativement peu de voix.
À un moment donné, il y a eu une longue pause sous prétexte que plusieurs
bureaux de vote comptaient encore les bulletins. Et pendant la pause, la scène
suivante eut lieu. Le directeur de la police a rendu compte au premier ministre
Moushanov, et celui-ci a à son tour informé le ministre Guytchev que, selon les
données préliminaires, les votes du Bloc travailliste dépassaient les votes de
tous les autres partis. La question de savoir quoi faire se posait devant eux
de toute urgence. N’osant pas donner une réponse définitive par eux-mêmes, ils
se sont tournés vers le palais. De là on leur a répondu : « Si vous
pensez qu’il est trop tard pour falsifier l’élection, annoncez les résultats le
plus tard possible dans la soirée pour éviter les manifestations de rue. »
À 22 h 50, le
porte-parole a élevé à nouveau la voix. Sa voix était dépourvue de la fermeté
et de la diction claires précédentes. Il prononçait surtout le nombre de
bulletins donnés au Bloc travailliste d’une manière confuse. On aurait dit que
le porte-parole était personnellement un conseiller municipal déjà battu. La
foule clairsemée sur la place réagissait différemment aux résultats, mais les
cris d’approbation en l’honneur du bulletin de vote en argent l’emportaient. En
vain, le porte-parole a finalement tenté d’éclipser l’éclat de la victoire
électorale de Sofia ouvrière en stipulant que les résultats définitifs seraient
annoncés le lendemain dans un communiqué officiel du ministère de l’Intérieur.
Les électeurs du
Bloc travailliste jubilaient déjà. La nouvelle de la victoire s’était répandue
dans toute la capitale. Des dizaines de rassemblements volants spontanés eurent
lieu ici sur la place même, dans toute la ville et surtout dans les banlieues.
Les orateurs improvisés louèrent avec fougue la victoire. Devant le bureau de
vote du quartier Hadji Dimitar, le cordonnier Stoyan Milev — membre du Comité
régional du PCB — emporté par la joie générale des électeurs en liesse, dérogea
aux règles de base de la conspiration et cria :
— Cette
victoire qui est la nôtre est en fait un triomphe du Parti communiste bulgare,
sous la direction duquel le Bloc travailliste a remporté les élections. Longue
vie et audace à la gloire du Parti communiste bulgare !
Dans la matinée, la
presse gouvernementale avait perdu la boussole. En grosses lettres, elle
donnait des informations sur les conseillers gagnants des partis au pouvoir.
Elle ne réussissait pas à dissimuler la défaite des candidats bourgeois, bien
qu’en aucune façon elle ne soulignait ni même sous-estimait les succès du Bloc
travailliste.
Seul quotidien du
parti, le journal Écho se devait de
répondre de la voix la plus haute à la victoire éclatante, exceptionnelle par
son importance nationale et internationale, des ouvriers de Sofia. Le comité de
rédaction, réuni tôt le matin, a longuement réfléchi à la manière dont nous
devrions couvrir cet événement extraordinaire. En conclusion, il a été décidé
de ne pas publier d’éditorial ce jour-là, afin de ne pas irriter avec notre
joie le gouvernement fasciste blessé et d’avoir le temps de consulter les
camarades responsables du CC du PCB. Compte tenu de la censure, nous avons
adopté la tactique des chiffres secs, mais mis en évidence en conséquence avec
des polices imprimées appropriées. Nous comptions sur le niveau politiquement
élevé de nos lecteurs. Le même jour dans l’après-midi, le Comité régional du
PCB s’est réuni en urgence au domicile du peintre en bâtiment Dimitar Andreev,
à l’angle des rues Nishka et Lomska. Le secrétaire Pianechki a analysé les
facteurs et les forces qui ont déterminé ce grand exploit historique du
parti-dirigeant.
Une question
m’inquiétait depuis la veille au soir — qui s’occupera des 19 élus municipaux
et de la fraction communiste de ce groupe ? Le comité régional ou le CC du
PCB ? Pour moi, la réponse était claire — le Comité central. Le
gouvernement municipal de la capitale ne pouvait pas être l’œuvre du comité
régional. L’événement, de par ses dimensions nationales et internationales,
avait dépassé la compétence d’un comité régional.
J’ai posé la
question presque à bout portant. Il a été immédiatement révélé qu’elle avait
occupé tous les membres du comité régional. Dans la brève discussion, j’avais
raison : tout le monde a soutenu mon opinion selon laquelle seul le CC
peut et doit traiter avec la direction de la faction communiste municipale.
Cependant, jusqu’à ce que la réponse du CC soit connue, nous ne devons pas
perdre le contact avec le groupe. Nous avons immédiatement décidé que Pavel
Popandov établirait un contact et formerait le groupe communiste. Un peu en
avance sur les événements, je dois dire qu’à notre surprise générale et à ma
propre surprise, le CC confia au comité régional la direction du groupe
municipal.
Le soir au club du
Parti des Travailleurs et des Syndicats, non seulement les travailleurs et
travailleuses se sont salués, mais beaucoup d’entre eux se sont embrassés en
l’honneur de la Commune de Sofia. On s’est tous demandé : « Que va
faire le gouvernement ? » L’ancien maire reportait la convocation du
conseil municipal nouvellement élu. Nous avons chargé notre groupe, en cas de
sabotage de Nachev, de prendre l’initiative et de convoquer les nouveaux
conseillers. Nous avons mandaté le nouveau « maire rouge » Stefan
Dimitrov, portier dans une usine de caoutchouc, ancien cheminot et vieux
social-démocrate.
Le 27 au matin,
nouvelle réunion du comité de rédaction, où il fut décidé que : le ton du
journal devait être plus audacieux ; il fallait s’élever au niveau de
l’enthousiasme populaire... Au moment où nous discutions de l’éditorial, la
grande figure d’Encho Staykov est apparue dans la salle — rédacteur en chef du
journal Rabotnichesko Delo et membre
du CC du PCB. Jacques Nathan et Tsvetan Stefanov criaient à l’unisson :
— Voilà
qui va nous écrire l’éditorial sur la commune.
Encho a commencé à
être ironiquement modeste, à nous traiter de lions journalistiques, à nous
assurer qu’il aurait répondu à notre demande s’il n’avait pas à écrire un
éditorial sur le même sujet dans Rabotnichesko
Delo, et qu’enfin il me proposait moi comme auteur, car je devais être au
courant de l’appréciation par le parti de la victoire écrasante aux élections.
Il s’est aussitôt empressé d’esquisser cette appréciation devant tout le monde.
La proposition a été acceptée.
À 10 heures, Kutyo
Panchev nous a apporté la bonne nouvelle — un drapeau rouge flottait sur le
bâtiment de la municipalité centrale. Vasil Kaltchev, Kosta Petkov, Hristo
Hrolev et d’autres camarades de l’imprimerie et de l’administration avaient vu
le magnifique spectacle selon Grafa.
— Est-ce
que le drapeau rouge du parti claque et flotte au vent sur Sofia la
laborieuse !
Ils nous ont dit
qu’une voiture pleine de policiers avait quitté la place devant la mairie sur
la rue Gurko, emportant le drapeau rouge. Réunis en petits groupes, les
citoyens ont commenté l’événement mémorable.
Pendant un certain
temps, la municipalité officielle est devenue invisible. Le maire, qui n’était
plus maire, exerçait son pouvoir illégalement. L’ancien conseil municipal
n’existait pas et le nouveau n’était pas autorisé par la police à se
constituer. Alors le comité régional a décidé que notre groupe de 19
conseillers municipaux devait être déclaré le seul conseil municipal légal et
valide. Menés par Stefan Dimitrov, nos conseillers ont tenté à plusieurs
reprises de se rassembler dans la mairie même.
Le gouvernement
s’est empressé d’anticiper la formation du conseil municipal légitime. Il a
rendu une ordonnance au tribunal régional de Sofia pour établir – ce n’est que
maintenant ! — si les conseillers élus par le Bloc travailliste sont
politiquement fiables.
Contre les manœuvres
du gouvernement, le comité régional a appelé les électeurs de Sofia à organiser
des rassemblements de rue, exigeant que leur vote soit respecté. Des milliers
d’habitants de Sofia ont entendu l’appel et organisé des centaines de
rassemblements volants dans des entreprises et des quartiers. Les conseillers
élus du Bloc travailliste sont devenus d’ardents dénonciateurs de la légalité
bourgeoise et des défenseurs conséquents des intérêts de Sofia la laborieuse.
Au nom du conseil municipal légitime, ils ont annoncé des décisions
importantes : réduire les impôts directs pour les travailleurs et
augmenter les impôts pour les industriels et les grossistes ; fournir
gratuitement des parcelles de terrain aux sans-abri et arrêter la démolition
forcée des maisonnettes construites par les sans-abris ; réduire le prix
du pain de un lev ; renommer la place Vazrazhdane en place Georgi
Dimitrov, la rue Debar en rue Sasho Kofardzhiev, etc.
La décision du
tribunal régional a indigné la Sofia démocratique : sur 19 conseillers
municipaux du Bloc travailliste, seuls quatre ont été approuvés — Stefan
Dimitrov, le facteur Borislav Iliev, l’imprimeur Boris Ignatov et le cordonnier
Ivan Moutev. Les 15 autres conseillers, dont Yordan Milev, Avram Stoyanov, Ivan
Georgiev, Yordan Bratkov et d’autres — ont été déclarés indignes de représenter
les travailleurs de Sofia en raison de « leurs liens avec Moscou » et
d’autres prétextes similaires.
Je n’ai pas l’intention
d’écrire une chronique de mon temps sur ces pages. Mon objectif est plutôt de
faire la chronique de l’âme des personnes que j’ai rencontré, avec lesquelles
j’ai travaillé et combattu. C’est pourquoi je terminerai cette page de ma vie
par un récit sur les choses vécues de Stefan Dimitrov, que j’ai notamment
rencontré, car après Popandov, le comité régional m’a chargé de diriger les
députés travaillistes dans leur mission responsable et difficile.
Stefan Dimitrov
était un membre de longue date du Parti communiste. Participant actif à la
grève des cheminots en 1920, licencié, expulsé du pouvoir, il ne se détache pas
un instant de son idéal prolétarien. Dans les moments les plus difficiles après
1925, baï Stefan dirige avec audace
et sagesse l’organisation du parti communiste illégal dans la région de
Bourgas. S’installant à Sofia, il gagne sa vie comme portier dans une usine de
caoutchouc et rejoint immédiatement les rangs des communistes de Sofia. Élu
conseiller municipal, tous les camarades le désignent comme le futur maire
rouge de Sofia. L’avocat Zhechev, conseiller municipal élu par le Parti
libéral, s’est un jour présenté devant cet humble ouvrier et communiste
convaincu. L’avocat s’est rendu à son appartement de la rue Belasitsa. Arrivé
là-bas dans toute sa splendeur — une voiture de luxe, un chauffeur spécial.
Avec un cynisme inimaginable, ce monsieur se mit à exhorter et à séduire notre
honnête camarade. Il lui dit approximativement les mots suivants :
— Baï Stefan,
permettez-moi de vous appeler ainsi, car nous sommes déjà collègues. Je suis
également conseiller municipal, libéral. Je suis avocat, marié, avec des
enfants comme toi. Comme tu peux le voir, nous sommes humains, nous nous
ressemblons. Bien sûr, tu te demandes pourquoi je suis venu ? Je vais te
le dire directement : pour ton bien. Et pour le bien de ton épouse. Vous
joignez les deux bouts, mais c’est difficile pour vous. Vous devez prendre en
compte chaque centime. Regarde où vous vous êtes blottis pour vivre. Même avec
une épine, tu ne peux rien soulever. Et devrait-il en être ainsi, baï Stefan ? Faut-il acheter du
pain en utilisant un bâton de comptage toute
sa vie ? C’est pourquoi je suis avec toi, pour te sortir de la misère.
Comment ? J’ai mon idée, tant que tu la comprends, tant que tu me
comprends, même si je suis libéral, mais avant de devenir libéral, je suis un
être humain. Et c’est en tant qu’être humain que je viens vers toi
maintenant... Voici ma demande et ma proposition : rejoindre notre groupe
libéral. Le vôtre, celui du Bloc travailliste, est déjà brisé, détruit. Vous
n’êtes que quatre. Vous ne pourrez rien obtenir. Vous ne ferez que du bruit
dans le Conseil. Et si tu te déclares libéral et que tu nous rejoins, nous
deviendrons le groupe le plus fort et nous occuperons le siège de maire.
Maintenant tu comprends pourquoi je suis venu. Tu nous feras du bien, mais nous
ne t’oublierons pas. Si tu viens chez nous, aujourd’hui, si tu veux tout de
suite, tu reçois deux cent mille leva et un acte notarié pour une maison, pour
rentrer chez vous avec la mariée, afin que vos vieux jours soient heureux.
J’attendrai la réponse. On a le temps. Le Conseil se réunira dans trois jours.
Quand et où tu demanderas à nous voir, là je viendrai. Mais rappelle-toi —
l’oiseau bleu du bonheur ne se pose qu’une seule fois sur l’épaule d’un homme.
Baï Stefan l’écouta avec un ennui évident
et lui demanda ensuite : « C’est tout ? »
Zhechev se dépêcha
de lui répondre : « Oui, c’est ça. »
Le vieux
social-démocrate le regarda et dit :
— Monsieur
Zhechev, pour l’instant je peux seulement vous dire que je vivais avec peu
d’argent et que je n’étais pas malheureux. Comment vais-je faire à
l’avenir ? Je ne sais pas. Pour cela, comme vous l’avez dit, laissez-moi
réfléchir.
Ils se sont séparés
en convenant de se revoir deux jours plus tard, rue Belasitsa.
Baï Stefan m’a trouvé dans la rédaction du
journal Écho et m’a raconté dans les
moindres détails comment s’était déroulée la scène cynique de la séduction.
L’avocat Zhechev sentait le salon de coiffure comme une femme de la haute
société ; trois bagues d’or avec des pierres brillantes scintillaient à
ses doigts ; il portait une montre de poche avec une large chaîne en
or ; son visage rose pâle était dodu ; ses yeux bleus jouaient comme
ceux d’un chat. Finalement, baï Stefan
m’a dit :
— Ma
réponse n’était pas sur la langue, mais sur la semelle du pied droit. Je
voulais lui donner un coup de pied et jurer comme un maître chanteur. Mais je
me suis dit : comment puis-je décider sans demander au parti ? C’est
pourquoi je suis venu vers toi.
Après avoir consulté
des camarades du comité régional, j’ai dit à baï Stefan ce qui suit : refuser de manière décente ; si
le monsieur est insolent ou essaie de le faire chanter, chassez-le comme un
sale chaton ; invitez nos supporters à assister au dénouement ; la
femme de baï Stefan devrait également
lui dire qu’elle préfère vivre dans la misère, mais rester honnête.
La dernière scène
avec Zhechev s’est déroulée comme prévu. Face au ferme refus de baï Stefan, l’avocat a tenté de prédire
son incarcération, des tortures pour lui et sa femme. Les voisins du quartier
rassemblés ont poursuivi le séducteur avec des chahuts. Penaud, il s’est
dépêché de se cacher dans sa limousine.
Baï Stefan Dimitrov a eu une belle
vie : dans une bataille avec l’ennemi, il meurt en tant que le plus ancien
partisan bulgare ! Gloire au pur combattant de la justice
communiste !
LES
CONDAMNÉS — FUSILLÉS, LES ASSASSINS – NON INQUIÉTÉS
Des dizaines de
communistes ont été victimes de cette vérité en 1933. La dictature vorace a
mangé leur vie d’une une jeunesse florissante et à l’apogée de leurs forces
créatrices. Des connaissances personnelles célèbres parmi eux étaient — Pavel
Popandov, Petko Napetov, Hristo Traikov, Hristo Hrolev — Grafa.
PAVEL POPANDOV
travaillait comme administrateur du magazine Zvezda, dont le rédacteur en chef était Georgi Bakalov. De taille
moyenne, avec un visage rond et rose, de beaux yeux marron clair et un front
ouvert et lisse, il avait une disposition joyeuse et une âme bienveillante. Il
aimait chanter. Même lors de réunions illégales du comité régional dans les
montagnes de Vitosha, Lyulin ou Lozen, son doux ténor tournoyait parmi les
hêtres et nous attirait, ses camarades sans grandes voix, que nous
accompagnions discrètement. Il acceptait n’importe quelle tâche, même la plus
dangereuse qui lui était assignée par le parti, même s’il reconnaissait souvent
son manque de force pour une performance décente. Pavkata nous captivait par la
pureté de ses pensées communistes. Sa seule présence parmi nous nous rendait
heureux et ennoblis. Nourri au levain d’un passé social-démocrate, Pavel
Popandov avait du mal à accepter la ligne de conduite de la direction sectaire
du début des années 1930. Il insistait sur l’élargissement et le renforcement
de l’éducation marxiste parmi les membres du parti, pour rechercher, cultiver,
surveiller nos liens avec les non-membres du parti. Son métier lui permettait
d’entrer en contact avec différentes couches de la population et il nous
assurait du grand potentiel de notre propagande auprès d’elles. Il n’arrêtait
pas de nous répéter :
— Il
faut être plus intelligents, plus proches de la vie et expliquer patiemment
tout ce qui entoure et émeut les travailleurs. Il faut leur parler de la
situation politique, mais il ne faut pas se contenter de la leur enfoncer dans
la tête. Et c’est souvent seulement ce que nous faisons.
Un matin, Jacques
Nathan s’est précipité dans l’étroite salle de rédaction du journal Écho, extrêmement excité de l’assassinat
de Pavel Popandov. Ils avaient également tiré sur lui. Les tueurs étaient deux
personnes. Ils marchaient un mètre derrière eux. Ils ont tiré à bout portant.
Pavel est tombé, Jacques s’est enfui. Les tueurs ont également disparu...
Ainsi, en plein
jour, dans l’une des rues les plus fréquentées de la capitale[45],
le communiste pur comme un diamant Pavel Popandov a été abattu — membre du
comité régional du PCB et député de Sofia... Les assassins avaient disparu,
insaisissables.
PETKO NAPETOV —
Secrétaire du CC du Parti des Travailleurs — et moi, nous nous sommes
rencontrés au club de la rue Positano. J’avais beaucoup entendu parler de lui.
Élancé, grand, avec des cheveux agités presque blancs, il portait une belle
tête sur ses épaules avec des yeux noirs ardents sous des sourcils noirs luxuriants.
Toute sa silhouette rayonnait de chaleur et de force. Communiste responsable,
il fut atrocement torturé en septembre 1923 et en avril 1925. Son comportement
dur face à la police lui a valu le surnom de « De fer ».
Petko Napetov a été
le premier délégué légal du peuple bulgare en Russie soviétique. Le livre Au pays du socialisme en construction a
été publié sous son nom. Ses discours à l’Assemblée nationale en défense du
pays soviétique, ses discours dans le club du Parti des Travailleurs et devant
des milliers de travailleurs de dizaines d’entreprises de la capitale et de la
province, le livre sur les soviets et enfin son passé et son présent
révolutionnaires ont rendu furieux les forces obscures fascistes contre
l’éminent communiste Napetov. Quelques jours avant son meurtre, baï Petko m’a arrêté sur le boulevard
Ruski. Avec un ton peiné, il m’a confié que deux jours auparavant, il avait été
convoqué à la Direction de la Police et conduit dans un grand bureau rempli
d’étrangers alignés en cercle. Bien nourris, bien lissés. Il y avait deux ou
trois militaires. Il n’a vu aucun policier connu à l’exception du chef
Draganov. Ce dernier lui a dit de ne pas rester près de la porte, mais de
s’avancer et de se tenir au milieu. Tout le monde était silencieux. Ils l’ont
juste regardé de la tête aux pieds, comme s’ils prenaient des mesures pour un
costume. À un moment, Draganov se tourna vers lui :
— Monsieur
Napetov, ne te demande pas où tu es. Ce sont des messieurs qui s’intéressent à
toi. Dis-leur ton nom, où tu travailles, es-tu marié, as-tu des enfants et en
général que sais-tu de toi-même ?
Il leur répondit un
peu brusquement.
— Si des
messieurs s’intéressent à moi, ils savent probablement qui je suis et ce que je
représente.
Et Draganov lui a
dit qu’ils en savaient plus que lui sur lui-même, mais qu’ils voulaient
entendre de sa propre bouche quel genre de personne il était. Petko leur a
répondu :
— Ma
biographie, messieurs, je l’ai écrite plusieurs fois à la police et au tribunal
régional. Elle est à l’Assemblée nationale et vous le savez très bien. Vous
feriez mieux de me dire pourquoi vous m’avez appelé, pourquoi avez-vous besoin
de moi ? Nous ne sommes pas des étudiants et des enseignants pour jouer
aux examens.
Puis l’un des
messieurs a gentiment dit que c’était exactement ce qu’il faisait en ce moment,
qu’en ce moment il passait un examen et qu’ils s’étaient réunis pour voir s’il
était vraiment comme on le décrivait — un vieux communiste de fer endurci, un
dirigeant du Parti des Travailleurs. Un autre, déjà assez grossier,
ajouta :
— Dis-moi
combien d’or tu as reçu de Moscou, pour que depuis ton retour, tu n’arrêtes pas
d’aboyer sur les places et esplanades du paradis soviétique ?
Le ton provocateur
du monsieur le brûla comme une piqûre de guêpe. Le secrétaire du Parti des
Travailleurs décida de ne pas leur permettre de l’insulter et déclara
fermement :
— Si vous
m’avez appelé pour m’insulter, je ne vous dirai rien.
Puis un autre appela
tout doucement :
— Vous êtes un
vieil homme, vous aviez une librairie, petite, mais à vous, la vôtre. Vous avez
honnêtement fait vivre votre famille. Vous avez vécu heureux avec votre femme
et vos enfants... Maintenant, nous nous intéressons à la façon dont vous
envisagez votre avenir, n’envisagez-vous pas de quitter votre chemin actuel,
n’envisagez-vous pas de retourner à la librairie ? Si la sagesse vous
vient, nous vous aiderons à équiper la meilleure librairie de Sofia.
Le vieux communiste
hésita pour leur répondre et d’un ton cassant leur dit :
— Je ne suis
pas passé entre Charybde et Scylla, mais j’ai entendu les voix de diverses
sirènes dans ma vie. Vous m’avez appelé en vain. Je ne peux vous dire qu’une
chose : j’étais communiste et si vous me coupez la tête tout de suite,
vous m’entendrez vous répéter : je suis communiste et je resterai
communiste.
La déclaration de
Petko les avait échaudés comme une douche froide. Après une courte pause, le
premier des messieurs reprit la parole :
— Eh bien,
c’est ce que nous voulions entendre, monsieur Napetov. Et puisque vous avez jugé
nécessaire de déclarer votre foi, je vous rappellerai le proverbe « On
récolte ce que l’on sème ». Vous êtes intelligent, bien que communiste, et
je suppose que vous comprenez ce que je veux dire.
Baï Petko a essayé de lui répondre, mais
Draganov s’est approché et lui a ordonné :
— Tu
es libre, va-t’en !
Tous les messieurs
restèrent à leur place. Aucune des personnes présentes n’a dit au revoir ni
adieu.
Avec son flair
partisan-politique, baï Petko avait
prévu avec justesse les plans infernaux de la convention secrète de la
Direction de la Police. Intérieurement, je m’inclinais devant son pouvoir de
vivre face à une mort imminente. Le camarade condamné n’était plus seulement un
communiste de fer pour moi, il a grandi à mes yeux comme un héros mythologique.
Le brillant et inoubliable baï Petko
Napetov !
Cinq ou six jours
après cette réunion, le premier délégué bulgare au pays des Soviets et
secrétaire du Comité central du Parti des Travailleurs était abattu sur la
chaussée Gornobansko. En plein jour, avec un trafic dense... Les tueurs sont
restés invisibles !
HRISTO TRAYKOV —
cordonnier de profession, député communiste, parent de mon ami Grafa. De taille
moyenne, pâle, bien que jeune, légèrement courbé, extrêmement vif et mobile.
Des étincelles sournoises jaillissaient de ses petits yeux concaves et
allongés. Naturellement intelligent, autodidacte, il fut l’un des députés
ouvriers qui dénonça avec brio les mensonges des vieux parlementaires
bourgeois. Les orateurs des discours parlementaires rompus sélectionnaient et
arrondissaient leurs expressions en sa présence, craignant qu’elles ne tombent
sous le coup de sa langue mordante. Son esprit juteux et fleuri allait de pair
avec son courage civique. Prenant la parole lors d’un rassemblement volant,
Hristo Traikov a été brutalement criblé de coups et couvert de sang.
Ce jeune homme dur
et intelligent, d’apparence peu attrayante, avait grandi aux yeux de la
convention secrète de la Bulgarie réactionnaire comme un véritable épouvantail.
Les forces obscures voyaient en lui, non sans raison, un futur leader ouvrier à
l’échelle nationale. Avec sa soif persistante de connaissance et son esprit
naturel vif, le Hristo était en effet sujet à un grand développement. Homme de
masse né, humble et aimant dans ses manières, il attirait comme un aimant la
sympathie de tous les honnêtes gens. Son prestige dans les cercles du parti et
parmi les travailleurs du pays grandissait comme un jour de printemps. Sa
renommée de dirigeant bon, ferme et sage pénétrait dans les quartiers ouvriers
et les ateliers, les syndicats et les clubs du parti à la vitesse des rumeurs
joyeuses. Deux fois, Hristo a reçu un avertissement par des messagers anonymes.
Les lettres se lisaient comme suit : « Le Conseil suprême de
l’Organisation macédonienne interne révolutionnaire t’a condamné à mort. Nous
t’avertissons : refuse de servir Moscou. Occupe-toi de ta cordonnerie et
ne te mêle pas de politique !
Hristo Traikov a
continué à visiter son atelier de cordonnerie, ne manquait aucune session de
l’Assemblée nationale et rencontrait tous les soirs des camarades et des amis
au club du Parti des Travailleurs et à la Maison des syndicats. Après les
avertissements, non seulement il n’a pas diminué, mais il a renforcé ses
activités de député ouvrier.
Un jour à 11 heures
du matin, il quitta l’Assemblée nationale, traversa la place Al. Nevsky et
descendit la rue du Dounav puis descendit vers la rue Kiril i Metodii, où se
trouvait sa boutique. De plusieurs balles, il a été terrassé au coin des rues
Dounav et Iskar. Encore une fois en plein jour, encore une fois avec une
circulation dense... Les tueurs, comme toujours, s’en sont sortis sains et
saufs sans être dérangés !
HRISTO HROLEV —
GRAFA travaillait comme typographe dans l’imprimerie du journal Écho. On se voyait tous les jours. Nous
étions liés non seulement par des idées, mais aussi par une amitié humaine.
Nous étions amis depuis notre adolescence. Ensemble, nous avons fait nos
premiers pas dans l’art d’acteur. Nous partagions joies, peines, soucis... Du
vivant de Hristo Traikov, son beau-frère, Grafa avait reçu un message anonyme
lui signifiant qu’il avait été condamné à mort. L’avertissement a été répété
après que son parent et ami ait été abattu. Il n’a prêté presque aucune
attention à la première lettre. La seconde le fit réfléchir. J’ai voulu le
calmer et lui ai proposé de déjeuner ensemble à la laiterie de la rue Solun,
près de l’angle de la rue Belchev. Là, j’ai entendu une confession qui m’a
amené à réfléchir sérieusement à la politique du personnel de la direction de
l’époque. Hristo Hrolev m’a avoué :
— Il
est clair pour moi que je suis un autre numéro de la série des condamnés. Une
question que je n’arrive pas à me sortir de la tête : pourquoi se
laisse-t-on tuer ? Mon beau-frère, n’aurait-il pas pu être sauvé ?
Nous avons suggéré aux dirigeants : retirez-nous à la campagne. Là-bas
nous continuerons de travailler pour la cause. Mais tant qu’ils apprendront à
nous connaître dans le nouveau travail, le temps passera. Le courant de
l’extermination de masse peut être modifié. Que nous ont-ils répondu ?
Nous ne devons pas être faibles face à l’ennemi de classe. Nous devons rester à
nos postes. Pour convaincre les bourreaux qu’aucune menace ne nous détournera
du combat... C’est comme si on trahissait la cause comme si au lieu de Sofia on
luttait à Pernik, Varna, Plovdiv ou n’importe où ailleurs. Alors, je ne
comprends pas : pourquoi on se fourre dans la gueule du loup ?
En face de moi se
trouvait le communiste Hrolev. Je le sentais si près de mon cœur que ce serait
un sacrilège de défendre la position du parti, que je trouvais moi-même
intenable. J’étais silencieux, déchiré par les tourments...
Je fus d’une joie
inexprimable lorsque, dix jours après cette conversation, j’entendis Grafa
lui-même me chuchoter : « Je pars. Premièrement — à Plovdiv. Et à
partir de là — peut-être dans la vaste patrie. »
Ma joie était
double : la direction du parti avait écouté la voix de la raison ;
l’ami, l’homme bon, le merveilleux communiste, se sauvait, échappant aux filets
de la dangereuse convention.
Le bonheur devait
être fêté, d’autant plus que ce jour coïncidait avec l’anniversaire de Grafa.
Nous étions alors aussi pauvres que des rats d’Église. Pourtant, nous devions
faire une petite fête. Où ? Dans l’appartement de cinq camarades qui
vivaient dans une chambre miniature d’une maison basse et minable du boulevard
Slivnitsa, près du pont de la rue Kiril i Metodii. Les travailleuses du tabac
Asya et Milka, la cuisinière Penka, l’ouvrière de l’usine de carton Stefana
Klintcharova et l’étudiante Stefka Dragoycheva se sont chargées d’acheter des
fruits et d’offrir un café.
Dehors, le soleil de
l’après-midi était ardent. Il était quatre heures de l’après-midi. Grafa, qui
avait promis de venir à trois heures et demie, ne venait toujours pas.
— Maudit soit
ce Grafa, cria Penka. Notre café va bouillir et refroidir. S’il ne se montre
pas dans un quart d’heure, nous commençons. Mieux vaut cinq dans la main que
dix à attendre.
À ce moment, une
détonation se fit entendre quelque part depuis le pont. Une seule et unique.
Nous avons prêté l’oreille. Soudain, par anticipation, Penka a dit :
« Grafa ! » Nous étions tous sans voix et nous nous sommes
regardés. Le silence dura quelques secondes. Succombant au pressentiment de la
bonne Penka, je lui ai immédiatement dit de sortir et de voir ce qui se
passait, et nous avec Stefana de mettre nos chaussures et d’y aller.
La camarade s’est
envolée de la porte comme emportée par un tourbillon. Alors que nous nous
préparions, notre amie aux yeux noirs est revenue tout échevelée, pâle,
essoufflée, et a dit avec excitation :
— C’est Grafa.
Dépêchez-vous !
Nous courions. Notre
ami était allongé sur le dos à vingt mètres du pont de la rue Tsar Siméon sur
la rive gauche du fleuve. Je me suis penché sur le cadavre et j’ai commencé à
lui parler :
— Grafé,
m’entends-tu ? C’est moi, Borcho... Grafé, dis quelque chose...
Son visage était
blanc, ses yeux fermés, son front encore chaud. J’ai déboutonné son manteau
noir et sa chemise grise, j’ai mis ma main sur le cœur et j’ai écouté. Aucun
bruit, aucun mouvement, aucune trace de sang ou de balle. J’ai compris la
réalité implacable. J’étais déjà debout quand un garde s’est approché de moi.
— Est-ce-que
vous le connaissez ?
Personne ne lui a
répondu. Des femmes, des vieillards, des enfants des maisons voisines
s’approchèrent timidement du cadavre. La pensée m’a transpercé que maintenant,
en tant que membre du comité régional du PCB, je devais organiser la réponse de
Sofia la laborieuse contre l’assassinat barbare de mon meilleur ami Hristo.
Nous nous sommes retrouvés tous les quatre sur le pont : Stefana, Penka,
Stefka et moi. Nous étions accablés de chagrin pour notre ami, mais chez nous
l’impératif du devoir, la voix du communiste, a parlé. Penka a été la première
à demander :
— Que peut-on
faire ?
— Il faut le
communiquer au club du parti, a déclaré Stefka.
— Non seulement
au club, mais aussi aux syndicats, partout — a précisé Stefana.
Surmontant un moment
mon chagrin et rassemblant mes pensées, je dispensais, par habitude, une instruction
à mes camarades. Mon ton était trop pratique et sonnait inhabituel pour
l’atmosphère et mon excitation intérieure :
— Tous, nous
laissons tout tomber : réunions, travail et autres. Toi, Stefke, et toi,
Penke, courez aux clubs Positano et Dom Babichki. Demandez aux camarades de
venir ici immédiatement. Vous leur direz : ordre du Comité régional du
PCB. Mais jusqu’à ce que vous y arriviez, dites à tous ceux que vous rencontrez
que Grafa a été tué, et qu’ils viennent ici sur le pont. En chemin, arrêtez-vous
exprès à l’imprimerie du journal Pogled
rue Tsar Siméon. Qu’ils arrêtent le travail, que les camarades se dispersent et
annoncent l’assassinat. Au club, dites à Yanko Petkov d’envoyer des gens dans
tous les quartiers et de lever des tribunes de protestation partout, de
commencer des manifestations, de venir vers ici. Dépêchez-vous, courez. Stefana
et moi nous allons dans le quartier Gevgelija pour informer les proches de
Grafa. À travers eux, nous allons essayer de remuer tout le quartier. La chose
la plus importante est de faire bouger Sofia à tout prix, pour obtenir une
manifestation de masse. Rendez-vous ici, sur le pont, dans une heure au plus
tard...
La famille de Grafa
vivait dans deux petites maisons à un étage, grises et jaunes. L’une presque devant
la porte d’entrée, l’autre au fond de la cour. La mère, la femme Mara avec un
jeune fils dans les bras et une sœur, assise devant la maison du bas,
tricotaient et parlaient. Nous avons traversé la porte d’entrée et avons
descendu le chemin pavé jusqu’à eux. De quoi nous avions l’air, je ne peux pas
dire. Probablement pas comme d’habitude, car nous n’avions pas encore fait cinq
ou six pas, et la mère a crié :
— Itsko ! Où
est Itsko ! Pourquoi êtes-vous seuls ? Quelque chose est
arrivé ! Ils l’ont tué ! — et se jeta sur moi : — Borcho,
pourquoi es-tu seul ! Vous veniez ensemble, n’est-ce pas ? Dis-moi,
où est mon garçon, mon seul garçon ? Mon fils, Hristo, où es-tu ?
J’ai éclaté en
larmes nerveuses incontrôlables. Elle se glissa sur mes pieds, ordonnant :
— Ils l’ont
tué ! Ils l’ont mangé ! Seigneur, emmène-moi, moi aussi, à lui !
Pourquoi devrais-je vivre sans lui ?!
Tous les proches et
beaucoup d’autres attirés par les cris de la mère pleuraient.
Alors que je
réveillais la mère avec de l’eau et que Mara confiait l’enfant à une voisine,
la cour s’est remplie d’hommes et de femmes. Je me suis retourné et les ai
invités, ainsi que tout le monde dans leurs maisons, à suivre les parents de
Hristo jusqu’au boulevard Slivnitsa. J’ai aussi demandé que l’assassinat soit
annoncé dans le quartier Zaharna Fabrika.
La mère et l’épouse
se sont rapidement habillées et, soutenues par Stefana et moi-même, ont quitté
la cour. Un groupe d’une centaine de personnes nous entourait et nous suivait.
Nous avons marché et de plus en plus de gens nous ont rejoints. La nouvelle de
l’assassinat s’est répandue comme de la poudre à canon et a soulevé des hommes,
des femmes et des jeunes des quartiers Konyovitsa, Gevgelija, Zaharna Fabrika
et Yuchbunar. Lorsque nous arrivâmes à l’intersection des rues Tsar Siméon et
Dimitar Petkov, la colonne comptait plus de deux mille personnes.
La cavalerie et la
police d’infanterie ont tenté de disperser la manifestation. Un huissier a
ordonné aux seuls proches de l’homme assassiné de franchir le cordon, mais son
ordre est resté en suspens. La pression de la colonne de protestation s’est
avérée plus forte que le cordon de police. La manifestation, menée par la mère,
s’est propagée comme une traînée de poudre dans la rue Tsar Siméon. Là, sur le
pont et dans les rues latérales, deux ou trois mille travailleurs et
travailleuses supplémentaires s’étaient rassemblés et protestaient
vigoureusement contre la police en civil et en uniforme.
Avec un cri
déchirant, la mère tomba sur le corps de son fils et l’embrassa :
— Mon enfant
chéri, mon seul Hristo ! Les assassins, maman, ils t’ont massacré pour la
justice, tu n’as voulu que la justice dans ce monde... Dieu les vaincra !
Qu’eux et leurs enfants ne voient pas la lumière du jour !
Le procureur du
tribunal de région, qui semblait être arrivé plus vite que d’habitude, avait
inspecté le corps et ajouté quelque chose à son dossier. À la vue des proches,
il recula jusqu’au fiacre qui l’attendait sur le pont, avec la claire intention
de se cacher plus vite, mais la manœuvre échoua. Les manifestants en colère,
parmi lesquels j’ai remarqué des petits garçons, lui ont lancé des briques
depuis une maison en construction à proximité. À cette époque, au coin de la
rue Aldomirovska, un jeune homme courageux blâmait publiquement les assassins
avec l’approbation générale des admirateurs de Grafa qui l’entouraient. À
l’intersection de la rue Odrin, une autre oratrice enflammée, la travailleuse
du tabac Olga Hranova, appelait les travailleurs à participer à des actions de
masse pour protéger la vie des activistes des travailleurs.
La nouvelle de la
mort du récitateur favori s’était répandue et avait remué la capitale. Dans
tous les quartiers et même au centre, autour de la gare, devant le Bain
central, devant le cinéma Moderen Teatar, à Krasno Selo, Knyazhevo, Gorna
Banya, Poduyane, Nadezhda, Zaharna Fabrika, Banishora — partout une centaine de
tribunes de rue spontanées avec des intervenants bénévoles et anonymes ont été
érigées. Le quartier Tri kladentzi était particulièrement chaud. Jusqu’à 22 h
30, les gens envahissaient les rues et commentaient bruyamment le crime en
groupe. Les conversations dans les cafés, les restaurants, les buvettes
tournaient autour de ce sujet. Tous les quartiers de la capitale étaient bondés
de manifestants conscients et accidentels. Désigné par un traître, j’ai été
arrêté à 11 heures du soir et conduit au deuxième commissariat de la rue
Sofroniy. Le matin, certains d’entre nous ont été emmenés à la Direction de la
Police. Après un interrogatoire accompagné de torture et de passages à tabac,
nous avons été poussés dans la rue. De retour à la rédaction, j’ai lu quelques
journaux bourgeois. Slovo, Svobodna Rech, Zname avaient publié des articles dans lesquels ils mettaient en
garde « La rue a parlé », « Consuls, soyez prudents »,
« Il ne faut pas jouer avec le feu ! » En effet, plus de 25 000
citoyens de Sofia ont pris part aux tribunes de protestation et aux
manifestations. Une véritable action de masse ! Elle a témoigné que la
terreur avait fait déborder le verre de la patience, que la colère des
antifascistes dépassait l’ordinaire et prenait la forme d’une protestation de
masse, aussi spontanée qu’organisée.
La famille et le
Parti des Travailleurs avaient prévu les funérailles pour l’après-midi. Cela promettait
de devenir une manifestation spectaculaire d’une Sofia travailleuse, triste et
en colère. La police effrayée a craché sur toutes les règles humaines et les
normes morales et a commis un blasphème scandaleux : des policiers civils
et en uniforme ont enlevé le corps de la morgue et l’ont enterré à l’insu de
ses proches.
Hristo Hrolev —
Grafa vivant était une menace pour la classe réactionnaire. Mort, il est devenu
un fantôme qui a gelé les mains des bourreaux : la convention secrète de
l’élite dirigeante a été contrainte d’arrêter les assassinats de rue. Grafa a
été l’une des dernières victimes d’une série des condamnés en 1933.
Gloire, gloire
éternelle à l’inoubliable récitateur révolutionnaire Grafa, au pur et modeste
militant communiste HRISTO HROLEV !
FORMATION
THÉORIQUE À LA MONTAGNE LOZEN
Le Comité régional
de Sofia du PCB illégal faisait des efforts particuliers pour la consolidation
politique et idéologique des membres du parti. Dans les conditions difficiles
d’alors, il organisait des séminaires examinant des œuvres notables de la
théorie marxiste — Le Manifeste
communiste, L’impérialisme — la
dernière phase du capitalisme, et certains chapitres du Capital, Les Fondamentaux du léninisme de Ludwig Feuerbach et d’autres. Les
maîtres de conférences et les stagiaires se réunissaient dans différentes
salles. Parfois, ils se rencontraient dans les montagnes environnantes de
Sofia : Vitosha, Lyulin, Lozen, Plana Planina. Le plus souvent, les
orateurs étaient les membres du comité régional eux-mêmes. Je me souviens
comment Marin P. Guéshkov et moi avons préparé une formation de deux jours.
Nous avions préalablement distribué des plans de questions sur deux sujets
principaux : L’impérialisme — la
dernière phase du capitalisme mourant et Qu’est-ce que le marxisme-léninisme. Nous avons également désigné
la littérature sur les sujets, principalement des articles dans notre presse.
Temps de préparation des stagiaires — un mois. Lieu de la formation – la
montagne Lozen. Durée — samedi et dimanche. Participants — camarades des plus
grandes entreprises industrielles : l’atelier ferroviaire, les usines
Fortuna, Berov, Orel, Imprimerie d’État, Knipegraf, Bakish, Bratya
Filipchevi, la chocolaterie Peev, la coopérative du meuble Tonet, la Poste
Centrale, etc. Les noms de certains stagiaires : Anton Tsviatkov, Ivan
Komitski, Todor Zhivkov, Asya, Penka, la couturière Tsanka, la typographe
Sanka, Georgi Tsankov, Penko Stoyanov, Boris Ezekiev, Asen Apostolov, Pavel
Spasov et d’autres — une vingtaine de camarades.
Marin Guéshkov et
moi avons eu une réunion à 6 heures du matin sur l’allée actuelle Peyo Yavorov
dans le parc de la Liberté.
Les stagiaires et
les camarades de la sécurité s’étaient déjà rassemblés à l’endroit désigné.
Nous avons proposé un petit déjeuner collectif. Assis en cercle, nous avons
tous ouvert nos paquets. Il s’est avéré que nous n’étions pas seulement des
personnes partageant les mêmes idées, mais aussi presque les mêmes goûts.
Chacun de nous avait apporté du pain, des œufs durs ou du fromage, des oignons
et de l’ail, seule la cuisinière Penka nous a surpris avec une marmite de
poivrons farcis et Asya — avec de petites boulettes de viande juteuses. Aucun
porte-monnaie n’avait permis d’apporter de dessert, à l’exception du kilo de
halva généreusement offert par la typographe Sanka.
Sans être des
abstinents, personne n’avait osé trahir son faible pour l’alcool. La sécurité
nous avait fourni de l’eau de montagne claire de la source voisine. Avec la
tête propre, nous avons procédé à la partie essentielle du séminaire. Les
stagiaires s’étaient relativement bien préparés, bien qu’à des degrés divers.
Nous avons évalué hautement leurs efforts, car nous savions à quel point il
leur était difficile de concilier leur préparation au séminaire avec leur
emploi quotidien et leurs tâches permanentes en tant que militants du parti et
des syndicats. Nous avons essayé de leur être utiles avec notre connaissance
des sujets, et ils ont obstinément prouvé leur curiosité en nous posant de
nombreuses questions, souvent pas tout à fait directement liées au sujet. Après
deux jours de discussion et de communication amicale, une chose est devenue
claire : nous sommes tous passés par une courte école de
marxisme-léninisme. Deux questions ont occupé une place importante dans notre
réunion : le parti avait-il gagné la majorité de la classe ouvrière et y
avait-il une possibilité de coup d’État contre le gouvernement du Bloc
populaire ?
La première question
a été discutée plus d’une fois au sein du comité régional. En raison des
désaccords entre nous, les membres du Comité régional, nous avons souhaité que
des camarades du Comité central viennent nous expliquer l’avis de la direction
du parti. Marin P. Guéshkov, qui dirigeait l’information et la propagande au
CC, nous a convaincus pendant trois ou quatre heures qu’après la Commune de
Sofia et après avoir remporté les élections municipales dans un certain nombre
de villes et de villages, le CC du parti affirmait à juste titre que nous
avions gagné la majorité de la classe ouvrière et que nous pouvions soulever la
question du pouvoir. Le deuxième membre du CC à nous parler était Andreï
Yuroukov - Victor. Une réunion spéciale du Comité régional était prévue dans
Plana Planina. Elle a duré toute la journée. Victor était plus convaincant que
Guéshkov et pourtant... Marin Petkov Guéshkov et moi n’arrêtions pas de
raisonner : nous avons remporté la majorité par élection, la classe ne
nous suit que sous la forme d’une campagne électorale, mais nous ne sommes pas
en mesure de la mener au combat maintenant pour le pouvoir. Il manque dans le
pays une situation révolutionnaire nécessaire dans laquelle les masses
ouvrières des villes et des villages sont prêtes à se lever pour une lutte
directe pour un gouvernement ouvrier-paysan.
En tant que membres
disciplinés du parti, Marin et moi avons répété aux camarades du séminaire les
arguments des envoyés du CC. Nous ne les avons probablement pas convaincus de
la position du parti, car nous-mêmes n’y croyions pas.
Sur la deuxième
question, je m’en souviens, nous avons tous les deux prouvé avec ferveur et une
profonde conviction intérieure que la théorie des coups d’État était une
théorie étrangère, que la thèse du parti sur le sujet était absolument
correcte, c’est-à-dire que la bourgeoisie ne pouvait pas se faire de coup
d’État à elle-même…
Ces questions ont
excité toute la masse du parti et toutes les personnalités du parti à l’époque.
Par exemple, nous avons soulevé la question de la majorité lors d’une réunion
du Comité de presse du CC du PCB. Nous avons tenu la réunion dans le quartier
Lozenets dans la villa du talentueux journaliste Joseph Herbst, décédé
tragiquement. La quasi-totalité du comité de rédaction d’Écho et les rédacteurs en chef de plusieurs autres journaux
bulgares ont participé à ce comité. Jacques Nathan a présidé. Il défendait bien
sûr la ligne du parti. Guéshkov, Tsvetan Stefanov et moi-même nous sommes
donnés la liberté d’avoir notre propre opinion sur la question.
Une autre réunion de
ce Comité de presse mérite d’être signalée. Le président Encho Staykov nous
parle des tâches de notre presse en ce moment. Il nous a fait remarquer que,
sur la base de l’élargissement de la lutte pour les intérêts immédiats des
travailleurs, nous devons enflammer et élever la lutte pour le pouvoir à un
niveau toujours supérieur. La réunion a également été suivie par Avram
Stoyanov, secrétaire de la direction centrale des syndicats — NRPS — et
rédacteur en chef réel du journal Transporten
glas. Il a timidement, avec des détours, lancé une nouvelle :
— De
temps en temps je vois un ancien social-démocrate. Maintenant, il ne participe
pas à nos organisations, mais il ne refuse pas de nous aider, il achète
toujours des timbres de l’organisation de Secours. Il m’a souvent averti des
barrages de la police et m’a toujours dit la vérité. J’en ai fait part au CC.
Hier, il est venu spécialement à la maison. Selon lui, les nouvelles qu’il
portait étaient très importantes. Je vais vous le dire, mais je dois vous
prévenir à l’avance — je lui ai tout de suite expliqué qu’il s’était laissé
tromper et que la bourgeoisie, malgré ses contradictions internes, était
toujours unie contre nous. Il était d’accord avec moi sur le principe, mais a
déclaré : « ... et pourtant, il semble que les « zvenari[46] »
préparent un coup d’État. » Ils s’étaient mis d’accord avec certains
officiers et allaient bientôt passer à l’action. Maintenant, camarades, je vous
transmets ceci pour voir quelles rumeurs se répandent dans des cercles avec
lesquels nous n’avons aucun lien, et donc nous manquons l’occasion de démasquer
les manœuvres de l’ennemi de classe, a conclu baï Avram.
Il était grand, avec
un beau visage rose, des lèvres rouges juteuses et des cheveux gris. À la fin
du message, il était tout en feu. Il devait essuyer la sueur sur son visage et
son front.
La nouvelle a fait
l’effet d’une bombe. Nous étions tous honnêtement convaincus de l’impossibilité
d’un coup d’État. Certains des plus jeunes membres du comité ont profité de
l’occasion pour donner une leçon d’éducation politique à l’éminent homme
d’action communiste baï Avram. Ils
voyaient un danger non pas dans le coup d’État imaginaire, mais dans le fait
que, dans un organe idéologique du CC, un camarade devenait le porteur de
rumeurs « ennemies ». Ils ont rappelé la résolution du quatrième
plénum du CC du PCB, où littéralement trois lignes ont été réservées au cercle
Zveno et où il a été dit que Zveno ne pouvait jouer aucun rôle significatif
dans notre vie publique. Encho Staykov a terminé la session tumultueuse avec
une sagesse de Salomon :
— Évidemment,
nous ne devrions pas être les diffuseurs de rumeurs. Mais Avram Stoyanov a
raison lorsqu’il insiste pour savoir ce qui se passe dans le camp adverse. Vous
vous souvenez de ce que Marx et Lénine nous enseignent : bien connaître nos
ennemis.
Hristo Radevski a
dit, alors qu’il marchait dans le couloir :
— Nos amis sont
montés sur le Pégase et ont oublié qui était Avram Stoyanov. Bacho Avram ment
peut-être dans ce cas, mais ne devrions-nous pas garder les yeux bien
ouverts ? C’est de la politique. Comment savoir d’où le lapin va
sortir ?
Nous ne savions pas
— oui, nous ne soupçonnions même pas. Peut-être seulement deux ou trois
semaines plus tard, le 19 mai 1934, le cercle politique de Zveno a chassé le
gouvernement du Bloc populaire et a pris les rênes du gouvernement. Le coup
d’État a été une grande surprise à l’horizon politique.
Trois d’entre nous
se sont présentés à la réunion extraordinaire prévue à l’arrêt de bus
Lagera : Docho Kolev, membre du bureau politique du CC et secrétaire du
Comité régional, Dimitar Bakovski, membre du Comité régional, et moi, membre du
bureau du Comité régional. Le secrétaire nous a informés que ce n’était pas le
moment de discuter, que nous devions répondre au coup par un coup, et que bien
que le CC n’ait pas émis d’avis, la situation était claire — il s’agissait d’un
coup d’État militaire fasciste contre lequel nous devions mobiliser les masses
et ce même soir nous devions soulever Sofia la laborieuse à une protestation
puissante. À cet effet, rassembler tous les membres et sympathisants du parti
sur la place Sveti Kral[47] et
brandir des slogans « À bas le coup d’État
militaro-fasciste ! », « Vive le gouvernement ouvrier et
paysan ! », « Tous en grève générale ! »
J’ai accepté les
deux premiers slogans. Mon esprit ne pouvait pas admettre le troisième. J’ai
objecté qu’il n’y avait pas de temps pour se préparer à la grève. Docho m’a dit
que la situation était révolutionnaire et qu’il n’était pas question de
préparation. Les masses étaient politiquement mûres, elles suivraient l’appel
du parti. Toutes les forces devaient maintenant être lancées pour le succès du
rassemblement de ce soir-là, et le lendemain tout le monde serait au courant de
la grève générale.
Ma première tâche
consistait à contacter la section syndicale, que je dirigeais au nom du comité
régional. Elle comprenait Danyo Plochev, Yordan Milev et Yordan Tanev. La
réunion a eu lieu dans une maison au coin du boulevard Hr. Botev et de la rue
Klokotnitsa. Seul Yordan Milev m’a demandé si le mot d’ordre de la grève
générale était coordonné avec le CC du parti. Je répondis que j’avais reçu
l’ordre du secrétaire du Comité régional et qu’il semblait que le CC ne s’était
pas encore réuni.
Yordan Tanev a été
assez critique vis-à-vis des instructions que j’ai données :
— Nous
essaierons de mobiliser les unions des métallurgistes, des maçons et des
peintres, des cordonniers, des tailleurs, mais ce sera difficile pour nous. Le
manque de temps n’est pas si crucial. Dans ce cas, la chose la plus importante
est que nous n’avons pas préparé les masses contre un coup d’État. Jusqu’à
présent, nous avons inondé leurs têtes de théories sur l’impossibilité des
coups d’État, et soudain l’inconnu Zveno, dont nous n’avons presque rien dit
aux travailleurs, prend le pouvoir par un coup d’État militaire. Tu le traites
de militaro-fasciste. N’a-t-on pas accusé le Bloc Populaire de fascisme ?!
Tu vois qu’il y a de la confusion, du brouillard.
Yordan Milev avec sa
netteté caractéristique a coupé :
— C’est
nuageux, brumeux, mais ce n’est pas le moment de discuter. Le parti nous
ordonne d’agir, nous agirons. Finissons la réunion rapidement et laissons
chacun se dépêcher d’accomplir ses tâches.
Aucun des militants
n’a pensé à déjeuner ce jour-là. Nous avons tous couru pour faire descendre
Sofia la laborieuse dans la rue. Dire que nos efforts sont restés en l’air est
peu. Chacun de nous a été vraiment déçu. Nous avons tous senti – ceux qui
mobilisaient et ceux qui étaient mobilisés — que le mot d’ordre d’une
protestation de masse puissante et sans précédent n’était que pour nous
personnellement ; que nous ne pourrions pas le diffuser aux larges masses
non membres du parti au point de les mobiliser dans une impressionnante
manifestation de rue. C’était tragique de voir à quel point nous étions
détachés du peuple quand il s’agissait de l’amener à une action de masse plus
audacieuse.
Le soir, sur la
place autour de l’église Sveti Kral, nous nous sommes vus les mêmes, les
éternels cadres moyens et inférieurs du parti et des organisations de masse,
les « tribuns » permanents. Les intervenants étaient également
célèbres : Sabi Dimitrov, Kocho Daskala, Yordan Bratkov, Todor Stoyanov.
Non seulement les visiteurs des tribunes volantes les connaissaient, mais la
police les connaissait aussi très bien. En tant que responsable de l’action de
ce soir-là, j’ai dû résoudre une tâche difficile : avec nos rangs comptés
— 150-200 personnes — et une force de police dense — environ 100 policiers
civils et cavaliers en uniforme — pour lever une tribune, pour manifester
l’hostilité de notre parti au coup d’État militaro-fasciste. Afin de disperser
au moins une partie des forces de police, j’ai ordonné que deux tribunes soient
érigées en même temps : l’une au coin du boulevard Maria Louiza[48]
et de la rue Dondukov, l’autre devant le séminaire Théologique sur le boulevard
Vitosha. La première avec pour orateur Sabi Dimitrov, la seconde avec Kocho
Daskala. L’ouvrier de Sliven et ancien député Sabi Dimitrov a à peine réussi à
dire : « Camarades, hier soir un coup d’État militaro-fasciste a été
réalisé… » et immédiatement la place retentissait des cris de certains
camarades « À bas le coup d’État fasciste ! » et la meute de
policiers attaquait avec revolvers, poings de fer et matraques l’orateur et le
groupe qui l’entourait. Combat court au corps à corps et la première tribune
s’est dispersée. La seconde, bien que se maintenant plus longuement, connaîtra
le même sort.
Le mot de passe que
j’ai lancé a été secrètement diffusé. L’action continue. Rassemblement à
l’angle des rues Pirotska et Opalchenska.
Yordan Bratkov et
moi sommes arrivés sur les lieux et avons trouvé de nombreux policiers. Nouveau
mot de passe : rues Ovche Pole et Pirotska. C’était relativement propre
là-bas. Nous n’avons pas vu d’agents civils connus, ni de gardes en uniforme.
Nous avons attendu dix minutes que plusieurs camarades se rassemblent. J’ai
attrapé Bratkov par le bras gauche et lui ai ordonné de parler.
Un instant plus
tard, dans le silence tendu de la rue, sa voix puissante retentit. Avec des mots
forts, il a condamné les auteurs du coup d’État et leur complot infernal contre
le peuple, ses droits et ses libertés.
Un type suspect sur
le trottoir d’en face a regardé autour de lui, a sorti un pistolet et a
crié :
— Dégagez. Je
vais tirer.
Il a tiré plusieurs
coups en l’air. Les balles sifflaient et les quelques camarades, au lieu
d’avoir peur, se tenaient comme une haie autour de nous deux. Surpris par
l’empressement à affronter les balles avec nos poitrines ouvertes, l’agent a
commencé à battre en retraite. Des piétons inconnus l’ont poursuivi et il s’est
enfui. Attirés par les détonations, une vingtaine de gardes à cheval ont couru
vers nous depuis la rue Opalchenska. Le rapport de force était clairement en
faveur de la police qui fondait sur nous. La résistance serait folie. Les
camarades se sont cachés dans les maisons des rues avoisinantes. Bratkov et moi
avons traversé les jardins et, excités et mécontents, nous nous sommes dirigés
vers le centre-ville.
J’allais à une
réunion avec Docho Kolev et je sentais déjà à l’intérieur de moi que l’action
de ce soir prouvait à quel point nous étions loin des masses. Je ne doutais
plus, mais j’étais convaincu que le mot d’ordre de grève générale était sans
fondement. Docho n’a pas prêté beaucoup d’attention à mes propos, il a insisté
pour qu’on le fasse à tout prix, même si on ne réussissait pas à cent pour
cent. L’important était de savoir que le parti avait rempli son devoir, appelé
les masses à se battre. Ceci était et serait d’une grande importance pour l’histoire
politique de la Bulgarie.
Docho Kolev était un
merveilleux camarade — loyal, intelligent, modeste. Mais que faire quand
l’opium du sectarisme le transforma en récitateur de formules détachées du
réel ?
Les efforts des
militants se sont heurtés à un hic. La grève générale n’a pas franchi les
seuils des grandes entreprises et institutions de Sofia. La plupart des gens
n’ont pas compris l’expression « situation révolutionnaire »,
« enflammer la lutte pour le pouvoir de toutes nos forces ».
Le gouvernement du
19 mai agissait avec méthode. Il a d’abord liquidé les groupes terroristes de
Vancho Mikhailov pour la satisfaction générale ; plus tard, contrairement
aux lois de la démocratie, il a dissous toutes les organisations progressistes
et ouvrières ; il a interdit 42 journaux et magazines publiés par le
parti, les syndicats et autres organisations de masse. Ils ont aussi arrêté
l’hebdomadaire littéraire RLF, que
j’avais dirigé quatre ou cinq mois plus tôt sans cesser de travailler à l’Écho. Immédiatement après le coup d’État
du 19 mai, nous avons continué à éditer RLF.
Nous croyions qu’en le présentant comme un groupe non partisan d’écrivains
ouvriers-combattants, nous le sauverions d’une interdiction. Illusions naïves,
particulièrement partagées avec persistance par Ivan Rouge sous le pseudonyme
« la travailleuse de tabac Katya ». Avec des calculs très subtils
pour passer à travers les trous d’aiguille de la censure, j’ai édité deux
numéros de RLF qui ont été
confisqués. J’ai commencé le troisième numéro, mais à cause de mon entrée dans
l’illégalité j’ai laissé Ivan Rouge le terminer. Le dernier numéro a également
été confisqué. C’est ainsi qu’a été chanté le chant du cygne de l’hebdomadaire
littéraire du Parti communiste bulgare.
En juillet, une
réunion du Comité régional était prévue à la montagne Lyulin. Avant l’aube, je
suis allé dans la petite prairie éloignée familière, où nous avions déjà tenu
nos réunions plusieurs fois. Docho Kolev était le premier arrivé. Les nouveaux
membres du Comité régional, l’ingénieur Vasil Markov et le jeune homme Asen
Marinchevski sont également arrivés. L’heure dite était passée. Nous avons
commencé à nous inquiéter. Hristo Nikov, Marin Gueshkov, Boris Taskov, Mircho
Spasov, Pavel Spasov, Dimitar Bakovski n’étaient pas venus...
Vers 9 heures, l’un
d’eux, Bakovski, est arrivé. Pas de casquette, pas de manteau, avec une chemise
déchirée et des chaussures poussiéreuses sans chaussettes. À première vue, on
aurait dit : un jeune homme venu couper du bois dans la forêt voisine.
Avec un récit vivant et haletant, il nous a informés que tôt ce matin-là la
police était venue à son appartement pour l’arrêter, mais qu’il avait réussi à
s’échapper en sautant par la fenêtre du deuxième étage.
Le secrétaire Docho
jugea rapidement que la police avait arrêté les membres du comité régional. Il
a averti tous ceux qui étaient recherchés dans leurs anciens logements, de les
quitter.
Je suis descendu du
tramway de Kniajevo au centre de la capitale. Sous-estimant le danger, je suis
allé à la maison de Commerce chez le tailleur Petar Grantcharov. Aussi effrayé
qu’en colère, il m’accueillit avec un reproche, qu’est-ce que je faisais
là ? Ou je voulais les incendier eux aussi. Il m’a fait sortir de la salle
de couture et m’a conduit dans un des couloirs de la maison. Il m’a rapidement
et anxieusement informé que Jacques Nathan, Marin P. Guéshkov, Boris Bogdanov,
Trayana Nenova, Stefana Klintcharova et de nombreuses autres personnalités des
partis communistes et ouvriers avaient été arrêtés. Le bruit courait que les
arrestations continueraient.
J’ai gonflé ma joue
comme pour une rage de dents et l’ai recouverte de mon mouchoir, puis j’ai
repris le tramway pour me rendre au village Nadezhda, où vivait yatachkata[49]
Magda. J’ai appris ma chance par la bouche de Magda — la police m’avait cherché
ce matin-là, 15 minutes après avoir quitté la maison dans le quartier des
logements ferroviaires.
Les jours de la vie
illégale ont commencé. Ici et là, nous avons réussi à organiser une tribune,
une petite grève, à éditer et diffuser des tracts, à écrire des appels
enflammés sur les murs, à attacher un drapeau rouge à un poteau télégraphique.
Dans le même temps, des militants connus se sont écartés et se sont repliés sur
eux-mêmes. Docho Kolev a été arrêté à proximité de la prison centrale, pris en
embuscade et insidieusement trahi. J’ai pris en charge le secrétariat du comité
régional en tant que membre du bureau. Bakovski et moi n’avons pas passé de
nuit à Sofia. Nous avons passé les nuits dans les moyettes et les meules, dans
les champs et les prés aux environs de Sofia. Pendant la journée, nous nous
promenions dans les bosquets, les ruisseaux et les prairies, et le soir nous
entrions dans la capitale pour des rencontres et des réunions.
Par un après-midi très
chaud, nous nous étions abrités à l’ombre d’un grand arbre ramifié quelque part
près du village Simeonovo. Krum Popov, secrétaire du Comité régional du Parti
des Travailleurs, Vasil Tashkov, imprimeur du journal Écho et membre d’un comité régional du Parti des Travailleurs sont
venus nous voir. Popov nous a apporté de la nourriture et un revolver, et
Tachkov du pain puis il s’est excusé auprès de Bakovski, avec qui il était
collègue et ami, de ne pas avoir pu lui trouver de pistolet cette fois, mais dans
quelques jours il le lui livrerait.
En présence de
Bakovski, j’ai ordonné à son collègue de contacter l’ingénieur Vasil Markov et
de l’informer en mon nom, c’est-à-dire Stamen, de se présenter ce soir à 8 h
30, au 5ème km de la chaussée Dragalevsko. Je l’ai explicitement averti de
trouver personnellement l’ingénieur et seulement lui, pour l’informer de la
réunion. S’il échouait, qu’il oublie ce que je lui avais dit.
Ici, je vais
anticiper un peu les événements pour voir à qui j’ai confié la tâche. Tachkov a
trouvé Vasil Markov au café Toushé, notre connaissance de la place des Fêtes.
L’ingénieur était assis à une table en compagnie de son homonyme Vasil Markov,
rédacteur en chef officiel du journal Transporten
Glas. Et là, dans le café, devant les deux Vasil Markov et Tashkov, cet
agent de police, comme il s’est avéré plus tard, lui a indiqué le lieu et
l’heure de la rencontre. À 6 heures du soir du même jour, Netzo Garvanski,
arrêté puis emmené pour être interrogé dans le bureau de Guéshev, où il a entendu
le chef de groupe se vanter auprès de ses subordonnés : « Ce soir,
deux gros poissons tomberont dans notre filet. »
Restant au milieu du
terrain, Bakovski et moi avons voulu tester l’arme. Aucune âme vivante ne
pouvait être vue de près ou de loin. Un par un et à différentes distances, nous
avons tiré sur le tronc du poirier sauvage nous abritant. Nous nous sommes
avérés être des tireurs égaux.
La journée
finissait. Le crépuscule est tombé. Nous avons rapidement fini les restes de la
nourriture et nous sommes dirigés vers nos réunions — lui en ville, moi à la
chaussée Dragalevsko. Nous avons décidé de nous retrouver au bout du cimetière
de Sofia et de passer la nuit dans les champs près du village Orlandovtsi.
Avant de nous séparer, Mitko m’a offert l’arme en tant que senior. Je le
remerciai du geste, mais lui reprochai le formalisme.
— Nous devons
résoudre les problèmes spécifiquement. Tu vas dans une ville pleine de chiens
policiers. Ils peuvent t’attaquer à tout moment. Tu dois avoir quelque chose
pour répondre.
Je ne savais pas et
n’avais pas pressenti que ce serait notre dernière rencontre. La vingtaine de
jours et de nuits passés ensemble dans les environs de Sofia nous avaient
rapprochés plus que les années et les mois passés au club de la rue Positano et
à l’imprimerie du journal Écho.
Bakovski était un jeune homme beau et solide. Comme la plupart des imprimeurs,
son visage était pâle, mais contrairement à ses frères au visage pâle, il
rayonnait d’énergie et de gaieté. Se déplaçant comme un cerf, il ne pouvait pas
rester immobile. Il faisait toujours quelque chose et il devait le faire. S’il
n’écrivait pas ou ne lisait pas, ne coupait pas ou ne faisait pas quelque
chose, il fredonnait, jouait, chantait... Même pendant ces nuits et ces jours
illégaux, il n’arrêtait pas de chanter ses chansons bulgares et soviétiques
préférées. Ayant passé l’école politique des prisons, Mitko possédait une riche
culture marxiste. Sa vigilance et son esprit vif se manifestaient dans les
discussions fréquentes avec les camarades sur une variété de questions. Il
disait : « C’est bien quand on est avec les masses, et c’est encore
mieux quand on est à la tête des masses ; c’est mauvais quand nous les
remplaçons par nous-mêmes et imaginons qu’ils nous suivent. »
Dimitar Bakovski a
été abattu en plein jour dans la rue Nishka, dans son quartier révolutionnaire
préféré, Konyovitsa. La nouvelle de sa mort nous a trouvés à la prison
centrale. Quelques-uns pleuraient en secret. Le soir, nous avons partagé des
souvenirs du communiste pur, du camarade et ami Bakovski. Son image est restée
brillante dans nos cœurs.
À travers champs et
prairies, le long d’étroits sentiers visibles et cachés, j’ai marché sur la
poussiéreuse chaussée Dragalevsko, quelque part au-dessus de l’usine actuelle
Hladilnika. La lune brillait à travers les nuages queues-de-chat et
illuminait la bande blanchâtre de la route et ses environs. Je me suis
retourné, j’ai vu la haute silhouette légèrement voûtée de l’ingénieur Vasil
Markov et j’ai ralenti le pas. Bientôt il me rattrapa et nous continuâmes tous
les deux vers le village sur la droite, côté route au chemin accidenté, aux
endroits envahis par les mauvaises herbes. Sur le côté, toujours à droite, se
trouvait une petite chaumière délabrée aux fenêtres éclairées. Nous avions
dépassé la maison quand nous avons remarqué que sa lumière s’était éteinte.
Immédiatement après, un coup de sifflet a retenti depuis la maison. En réponse,
quelqu’un a sifflé quelque part devant. Bref silence. Je comprends — nous
sommes dans une embuscade. Je n’ai réussi qu’à chuchoter : « Nous
devons être encerclés », et juste devant nous, à une quinzaine de pas, les
fameux policiers Guéshev et Pramatarov se sont levés du fossé et sont partis
droit sur nous. Nous nous sommes rapidement réorientés. J’ai dit tout haut que
j’avais été invité à un mariage, que le garçon d’honneur était un grand
fêtard... Mais ils étaient bien préparés eux aussi. Les deux grands hommes,
d’un pas raide, raccourcissaient la distance entre nous. À trois ou quatre pas
de là, on voyait bien que chacun d’eux tenait sa main droite dans la poche de
son manteau. Les grands yeux de Guéshev nous fixaient tour à tour. Nous nous
sommes croisés et, ô miracle, les bourreaux nous ont dépassé sans nous arrêter.
Mais seulement un mètre plus tard, ils se sont retournés et nous ont crié,
pistolets sortis :
— Arrêtez-vous !
Prêt à tout, j’ai
volé en avant. À ce moment, des dizaines de coups de feu ont été tirés de
toutes parts. Je courais et la seule pensée qui m’a traversé l’esprit
était : « Maman, je meurs pour le communisme ! » Les balles
sifflaient autour de mes oreilles et s’enfouissaient dans la poussière de
l’allée. Je courais, courais... Les balles sifflaient... Trébuchant sur une
partie saillante, je me suis étalé de tout mon corps. Les balles creusaient la
poussière autour de moi comme de grosses gouttes de pluie. Puis un instant plus
tard — le tonnerre s’est arrêté. J’ai essayé de me lever... Trop tard... Deux
ou trois policiers m’ont sauté dessus... Ils ont essayé de me renverser, ils
n’ont pas réussi. Accroupi, rampant presque à la dernière poussée, je me suis
levé, j’ai attrapé le canon d’un fusil avec lequel un agent me menaçait. Mon
intention était de montrer comment un communiste meurt, je voulais attirer le
fusil vers moi et l’utiliser pour le virevolter sur la tête de l’escouade de
police avant qu’ils ne me transpercent comme une passoire. Oui, mais non. Le
fusil a éclaté dans le sol, quelqu’un m’a fait un croche-pied, je me suis étalé
de nouveau, plusieurs policiers m’ont sauté dessus et d’autres m’ont frappé à
la tête avec des pistolets. Les agents enragés et triomphants sautaient,
frappaient et criaient :
— Ta
mère, canaille, tu veux tuer le roi, hein ! Vous voulez lui tendre une
embuscade ? Tueurs ! Brigands !
Voyant leur manœuvre
pour dissimuler la nature de leur action aux villageois qui passaient, je criai
de toutes mes forces :
— C’est vous
les assassins, nous sommes des communistes, de simples piétons.
Tombant dans une
transe cruelle, ils me piétinaient de toutes leurs forces et juraient comme des
déménageurs ivres.
Sans cesser
d’appuyer avec leurs chaussures, ils m’ont attaché les jambes avec une corde,
mis mes poignets dans des menottes de fer et m’ont redressé à moitié pour
m’asseoir.
Une voix ivre
donnait des ordres :
— Fouillez-le !
Appelez Rimski !
Le sang de ma bouche
et de ma tête avait taché ma chemise verte. Je ne ressentais aucune douleur. À
un moment donné, un jet chaud a chatouillé la cuisse de ma jambe gauche. J’ai
touché de mes mains liées, j’ai regardé : du sang, j’étais blessé. J’ai annoncé
ma découverte aux agents debout autour de moi. L’un d’eux a demandé où j’étais
blessé.
Ils ont entendu ma
réponse et ont immédiatement commencé à crier fort :
— Rimski,
Rimski !
Guéshev lui-même,
dont le pseudonyme était Rimski, s’est rapidement approché du groupe. Il
demanda calmement :
— Qu’est-ce que
vous avez à crier ? Vous ne voyez pas que je suis occupé ? Quels
documents avez-vous trouvés ?
Ils lui ont remis ma
carte d’identité. Ils lui ont expliqué où j’avais été blessé. Guéshev a
commencé à clapper de la langue :
— Ah, ah... Il
n’y a rien pour le panser. Nous nous étions préparés pour une autre récolte.
J’ai appelé pour
dire que j’avais une serviette de toilette dans mon imperméable tombé à côté.
Guéshev a ordonné à l’agent Boncho Mehandov de me panser. Le célèbre bagarreur
refusa :
— Et quoi
encore. Communiste, et c’est moi qui vais le panser, non mais !
Guéshev lui a
expliqué qu’ils devraient arrêter mon sang, même si nous les appelions des
suceurs de sang. Après une petite querelle entre eux, Boncho s’est quand même
occupé de moi, mais au bout de cinq ou six minutes j’ai vu la tache de sang
envahir presque toute la partie gauche de mon golf. Je me suis tourné vers la
douzaine d’agents et leur ai dit que je n’étais pas du tout bandé, que la blessure
était sur le dessus, pas sur le genou.
Ils ont encore fait
venir Rimski. Il est venu, s’est assuré que je disais la vérité et a ordonné
que mes menottes soient ouvertes.
— Tenez-vous à
côté de lui et gardez vos yeux ouverts. Qu’il se panse lui-même !
Mon pansement
n’était pas meilleur que celui de Boncho. Interrompu un instant, le sang
continua à couler légèrement. Trop excité, je n’ai ressenti aucune douleur ni
fatigue...
Ils attendaient une
camionnette qui n’arrivait toujours pas. Quand elle est arrivée, soutenu ou
plutôt porté par deux agents, j’ai été poussé à m’asseoir sur l’un des bancs en
bois du camion. L’ingénieur menotté était déjà assis devant moi. Plus d’une
vingtaine de chasseurs de gibier humains nous entouraient.
J’ai été emmené à
l’hôpital Alexandrov. Sur la table d’opération, le Dr Krapchev, neveu du
célèbre mangeur de communistes Danail Krapchev, rédacteur en chef du journal Zora, a examiné ma blessure et... m’a
salué :
— Garçon,
tu as de la chance. Sur dix mille blessures, une seule est comme la tienne. Ni
veine ni artère affectée. Ça va passer comme à un bébé.
Sans le vouloir, le
Dr Krapchev a rendu un grand service à l’organisation communiste de Sofia en
informant son oncle de ma blessure. Le lendemain, le journal Zora publia une note sur la fusillade de
la chaussée Dragalevsko, mentionnant mon nom.
Un agent en civil
est resté dans la chambre d’hôpital pour me surveiller la nuit. Ils ont
commencé à me soigner. La blessure me faisait très peu mal. Sous la couverture,
je bougeais et repliais librement mes jambes. Le lendemain matin déjà, l’idée
de m’évader me vint à l’esprit. L’une des infirmières s’est avérée être la
femme de mon ami Marin Guéshkov. Je lui confiai mon intention et lui demandai
de me dire combien de mètres il y avait de la fenêtre au sol et de prévenir les
camarades de m’attendre dans un fiacre près de l’hôpital. Nous avons convenu
avec elle de gratter la plaie et de l’empêcher de guérir rapidement. Nous
voulions gagner du temps pour organiser mon évasion. Elle a initié une collègue
au secret, qui a également aidé à la tâche.
Les premier et
deuxième jours, j’étais gardé par un seul agent civil. Le troisième jour, un
garde en uniforme s’est ajouté. Les camarades infirmières m’ont dit que la
Direction de la Police avait déjà rendu visite à trois reprises au professeur
associé Dimchev, chef du service de chirurgie, pour exiger qu’il me laisse
sortir. Il a refusé, affirmant que c’était lui, et non la police, qui
déterminait quand un patient était rétabli. Au début, les agents gardaient le
couloir, le troisième jour, ils étaient de garde 24 heures sur 24 dans ma
chambre. Plus tard en prison, Ivan Marinski m’a informé que le Comité régional
et en particulier Bakovski, avaient organisé un groupe tactique pour venir la
nuit et me libérer. Ils ont planifié leur action pour le sixième jour. Mais la
police, probablement avertie par des traîtres, contre la volonté du Dr Dimchev,
est venue me chercher ce jour-même et m’a emmené au sixième commissariat,
boulevard Dondukov et boulevard Stoilov. Là, j’ai été confié aux soins médicaux
d’un infirmier pour chevaux. Deux jours plus tard, il déclara avec autorité
qu’il m’avait guéri et que j’étais apte à l’interrogatoire, c’est-à-dire au
moulin humain du pont Lavov.
Il était 6 heures du
soir. On m’a emmené au bureau de Guéshev. Dans nos cercles, la renommée de
Guéshev était extrêmement surévaluée, aussi la petite taille de son bureau et
la modestie du mobilier me donnaient l’impression d’un poste officiel de cette
personne pas trop important. Le célèbre policier était assis derrière un bureau
ordinaire avec une lampe à abat-jour vert large et rond. Dix ou quinze agents
bien connus de Sofia se tenaient dans différents coins du bureau.
On m’a donné une
chaise pour m’asseoir à côté du bureau de Guéshev. Avec un visage frais et
rouge et un sourire discret, le policier se tourna vers moi d’un ton assez
familier, comme si nous étions amis depuis l’enfance et que nous ne nous étions
pas vus depuis des années :
— Ah,
Boris, toi aussi tu es enfin tombé ici ! Tu as vu un papillon autour d’une
lampe, n’est-ce pas ? Il virevolte, virevolte, voltige, et d’un coup, il
brûle ses ailes. Et toi aussi. Tu n’arrêtais pas de tourner devant nous et de
nous fuir : combien de fois as-tu sauté du tram dans le plus fort trafic ?
Et tes poursuivants perdaient le fil. Maintenant, fin de la poursuite. Tous vos
clandestins sont passés par moi. Je les connais. Ils travaillent un ou deux ans
et viennent nous rendre visite. Tu travailles depuis trois ans, et à Sofia,
sous notre nez. C’est un record.
L’agent Shivarov, un
homme de grande taille qui m’avait emmené à la direction, a dit :
— Il a donné
trois kilos de sang au parti. Combien de leurs dirigeants ont donné autant de
sang ? Dimitrov et Kolarov ont fui le pays et circulent maintenant autour
de Moscou, et ici des gens comme lui paient de leur sang leur luxe.
Je me suis senti
obligé de répondre à une telle provocation :
— Amnistiez-les,
ils rentreront immédiatement au pays.
Guéshev a essayé
d’ironiser :
— Il a raison,
ce sont de grands leaders et doivent vivre richement.
J’ai dû encore
répondre :
— Je n’ai pas
tiré une telle conclusion.
Guéshev, qui était
manifestement de bonne humeur, a immédiatement accepté et a dit que nous ne
nous étions pas réunis pour nous disputer puis il a ajouté :
— Tu es un
garçon intelligent, on va bien s’entendre... Dans votre presse, vous nous
traitez de suceurs de sang, de bourreaux. Parce que je pense que tu es
intelligent, je vais te le dire. Vous avez raison. Nous défendons un système.
Vous le traitez de fasciste. De votre point de vue, c’est ainsi, et vous avez
raison de nous accuser de tous les péchés mortels sur terre. Mais je te
demande : que fera l’un de vous, un enquêteur ou un commissaire rouge,
s’il s’assoit à ma place et que je suis à ta place ? Va-t-il vouloir
m’arracher la vérité ? Pourquoi ? Car, étant à cette place, il ne
pourra rien faire d’autre que chercher, établir la vérité, protéger son pays
ou, comme vous l’appelez, la dictature prolétarienne. C’est comme ça. Il n’y a
pas d’autre alternative. Aujourd’hui c’est moi, demain cela pourrait être toi
ou un autre camarade à toi, peu importe. Il faut répondre. C’est la loi...
Maintenant, comme je te l’ai dit, pour moi, tu es un gars intelligent. Je vais
te traiter comme un homme intelligent. Je te poserai des questions, et toi tu
diras la vérité, rien que la vérité, vous vous battez pour elle aussi, n’est-ce
pas... Tu es membre du parti communiste ?
— Je
suis communiste et membre du Parti des Travailleurs.
— Alors, tu as
bien étudié le ZZD… Tu travailles où ?
— Dans le
journal Écho.
— Est-ce
le seul endroit où tu es payé ?
L’un des agents
ajouta :
— Il reçoit une
double ration de Moscou.
— Puisque le
monsieur en sait plus que moi, demandez-lui.
— Toi, ne te
vexe pas. Tu n’es peut-être pas personnellement comblé d’or de Moscou, mais
beaucoup d’autres ont les poches pleines. Sinon, comment Écho survivra-t-il si vous ne recevez pas de dollars de
Moscou ?
— Vous
avez arrêté l’administrateur Boris Bogdanov. Il vous expliquera.
— Boris est un
vieux renard. Il veut nous convaincre qu’il vit de la vente et du Fonds Écho. Et qu’en penses-tu ? Pourquoi
on vous amène ici ? Pour t’écouter nous raconter le conte des mille et une
nuits ? C’est comme ça ?
— Je
me demande aussi ce qui vous donne le droit de tirer comme sur des chiens
enragés sur de paisibles citoyens bulgares ? De les détenir sans jugement
ni condamnation ?!
— Wow-ho-ho ! L’oiseau
commence à jaser. Il y aura un tribunal et un verdict pour toi et toute votre
bande. J’ai des preuves, des preuves, mon camarade. À ce moment-là, il sortit
un dossier du tiroir, l’ouvrit et, comme un joueur de cartes expérimenté,
éparpilla des dizaines de petits portraits ressemblant à des cartes d’identité
sur le bureau d’un seul coup. — Regarde-les bien et dis-moi lesquels tu
connais ?
Parmi les portraits,
j’ai vu les photographies de Docho Kolev, Marin Guéshkov, Boris Taskov, Jacques
Nathan et de nombreux autres camarades légaux et illégaux.
— Ça c’est
Marin Guéshkov, et ça c’est Jacques Nathan...
— Les autres,
les autres... regarde attentivement et dis...
— Je n’en
connais pas d’autres...
— Celui-ci ?
— Non.
— Celui-ci ?
— Non.
Après ma réponse,
Guéshev m’a remis le portrait d’un camarade illégal bien connu X et m’a demandé
avec curiosité :
— Et
celui-ci ?
Comme avant, j’ai
dit non. À ce moment, le policier expérimenté a tapé sa main sur la table, a
sauté de sa chaise et a crié triomphalement :
— Eh,
maintenant tu as niqué ta mère. Tu t’es complètement pris au piège... — et se
tournant vers l’agent : — Appelez X... Maintenant tu vas voir si tu ne le
connais pas... Un peu de bravoure, mon camarade. Si tu as eu le courage de te
battre, pourquoi as-tu peur d’admettre avec qui tu as travaillé ?
— Je refuse
d’être membre du Parti communiste.
— Patience,
patience. Tu sais, il n’y a pas que les nerfs de Moscou qui sont solides. Les
nôtres perdurent aussi.
Ils ont fait entrer
le camarade X et l’ont retenu à la porte. Je me suis retourné et je l’ai vu un
instant. Il était méconnaissable. Il avait été si cruellement torturé.
Guéshev m’a d’abord
ordonné :
— Ne bouge pas
et regarde-moi ! — Il se tourna vers X en disant : — Et toi, dis-moi
qui est ce monsieur que tu vois devant toi ?
X répondit
doucement :
— Boris Milev,
membre du comité régional.
J’ai sauté de ma
chaise et j’ai crié fort :
— Ce n’est pas
vrai. Je ne connais pas ce monsieur. Nous ne nous sommes jamais vus.
Guéshev ordonna de
faire sortir le camarade et se tourna vers moi :
— J’ai dit que
je te considère comme un gars intelligent et que j’ai l’intention de te
traiter, disons, culturellement. Mais si tu ne comprends décidément rien, je
dois ajouter que je vais te traiter comme les buffles à l’abattoir.
Enthousiasmé par la
confrontation, j’ai suggéré :
— Vous
prouverez donc que nous ne vous avons pas appelés bourreaux en vain.
À ce moment, l’agent
Boncho Mehandov a pris une chaise et a voulu m’assener un coup avec. J’ai
attrapé la chaise et j’ai essayé de la retirer des mains de l’agresseur. Une
dizaine de personnes se sont jetées sur moi de tous côtés et m’ont terrassé. Je
me suis défendu autant que j’ai pu avec mes mains et mes pieds. Trois ou quatre
agents ont pressé mes jambes et ont essayé de les attacher. J’ai donné des
coups de pied de toutes mes forces, mais pas pour longtemps. Ils ont réussi à
piéger mes jambes avec des cordes et mes mains avec des menottes. Des coups
avec des nerfs de bœuf et des bâtons tombaient. Et Guéshev, qui était
personnellement intervenu dans le passage à tabac, m’a attrapé par les cheveux,
a frappé ma tête plusieurs fois par terre, s’est penché près de moi pour que je
puisse sentir son visage en sueur et, me fixant les yeux grands ouverts, a
crié :
— Parle,
parle... Je suis membre du Comité régional... Je connais Boris Taskov, Marin
Guéshkov, Docho Kolev...
Saisissant la
méthode fascinante de Guéshev, je répétai :
— Je suis
membre du Parti des Travailleurs.
Le célèbre agent
Grafa a poussé de côté ses collègues, avec ces mots :
— Je vais
mesurer combien de kilos il pèse...
Il m’a attrapé par
le cou et mes deux jambes, m’a soulevé avec ses bras tendus et m’a jeté au sol.
Je me souviens, le gaillard répéta trois fois son acte héroïque. Ce qu’ils
m’ont fait et comment ils m’ont violenté après ça, je ne me souviens pas.
J’ai commencé à
reprendre mes esprits, voyant d’abord des points et des cercles verts, jaunes,
rouges qui s’entremêlaient et tournaient frénétiquement. Mon regard s’éclaircit
enfin, mais pas ma conscience. J’ai entendu un cri :
— Frappe-le, sa
mère... combattre le mal par le mal.
Il a appelé Grafa et
Shivarov poussait un flacon d’ammoniac dans mon nez. Je me suis retrouvé assis
sur une chaise et entouré d’agents hérissés. Guéshev, déboutonnant le col de sa
chemise, essuyait sa sueur.
Quelqu’un a
crié :
— Le
patron !
Un autre m’a donné
un coup dans le bas-ventre :
— Lève-toi,
bâtard. Le patron !
Même si je le
voulais, je ne pouvais pas bouger. Puis quatre mains de chaque côté m’ont
redressé de force. Resté complètement sans force, les agents m’ont adossé à une
porte intérieure, sans me lâcher.
Draganov, le patron
que je ne connaissais pas, commença de la porte d’un ton « pensif
profond » :
— Oh, Boris, ne
t’en fais pas... Regarde-moi, pendant la guerre mondiale les balles avaient
criblé mes pieds en passoire, et maintenant je vais bien. Et cela te passera
comme à un chien. Mais tu n’as qu’à parler, parler, sinon, si tu vois ces
brutes, ils niquent leur mère, ils vont te manger. C’est tout ce qu’ils
attendent, pour te dévorer... Ne regarde pas Kolarov et Dimitrov. Ils sont au
chaud, et ici tu verses ton sang. Laisse tomber, ne demande pas la lune. Tu es
jeune. Avoue et nous te laisserons partir, et nous te trouverons un travail...
Tu penses encore le cuisiner ? — Il se tourna vers Guéshev.
— La séance est
terminée. Je vous ferai un rapport demain...
Le chef est sorti et
m’a souhaité « bonne nuit ». On m’a ordonné de marcher. Avec effort,
j’ai fait un ou deux pas et je me suis étalé par terre. Je me suis senti mal.
Mon regard s’est fixé sur la grande bouteille d’eau sur le bureau de Guéshev.
La lumière de l’abat-jour vert se reflétait dans la bouteille, rendant l’eau
propre et fraîche. Je brûlais de soif, j’avais terriblement envie de boire.
J’ai léché mes lèvres saignantes avec ma langue sèche, mais je n’ai pas demandé
d’eau... J’étais horrifié par mes mains : menottées tout le temps pendant
les coups, elles étaient gonflées et grises-noires... J’étais toujours allongé
sur le plancher. Les agents m’avaient délaissé, se parlaient entre eux
tranquillement, attendant quelque chose. Deux gardes en uniforme sont entrés.
Ils ont déplié une couverture et m’ont jeté dessus.
Guéshev s’approcha
de moi et ordonna :
— Desserrez les
menottes, ou ses veines éclateront et après ils diront que nous l’avons tué.
Les deux gardes
m’ont enveloppé dans la couverture et m’ont porté dans les escaliers jusqu’au
dernier étage. Chernoto Pavlé, le serrurier de la Direction de la Police, a
ouvert une des cellules et a ordonné aux porteurs de me jeter à l’intérieur.
Ses collègues sauvages obéirent littéralement à l’ordre. Me roulant par terre,
j’ai crié :
— Vive la
révolution !
Les deux compagnons
de cellule m’ont entendu et n’en ont pas cru leurs oreilles ! Je
connaissais l’un d’eux — Todor Kamenov, un délégué du Komsomol de Sofia dans
notre Comité régional. L’autre était un monsieur élégamment vêtu, aux cheveux
grisonnants et au visage intellectuel. Le premier mot que j’ai prononcé était
« eau ». Todor m’a dit que Chernoto Pavlé avait chipé la cruche. Ils
auraient un ami qui ne devrait pas boire. Cela signifiait que le nouveau venu
devait passer par une terrible étape. J’ai demandé quelque chose pour étancher
ma soif. Ils m’ont offert une tomate et quelques poivrons verts.
J’étais allongé sur
le dos sur le sol. Ma douleur empirait. Mon corps se raidissait. Avec
difficulté, Todor et l’inconnu se retournèrent sur mon ventre. Ils ont
retroussé ma chemise collée, toute couverte de sang. L’intellectuel, indigné et
effrayé par les marques sanglantes des fouets et des bâtons sur mon corps
bleuté, recula et cria :
— C’est
impossible. Comment peuvent-ils ? On est tous des Bulgares, n’est-ce
pas !
Il fallait lui
expliquer que les Bulgares étaient divisés en fascistes et antifascistes et
qu’il y avait une lutte acharnée entre eux. Sous les auspices de la Direction
de la Police, cette lutte a duré près de deux mois. Plus de dix fois, j’ai été
emmené pour être interrogé dans le bureau de Guéshev.
J’ai passé la
première nuit à la prison centrale en isolement cellulaire. Le sommeil ne
venait pas. Je me voyais prisonnier pendant au moins 12 ans, et peut-être
condamné à mort : au nom du Comité régional, nous avions lancé des appels
à la révolte des soldats et des officiers — la situation était
« révolutionnaire ». La cellule était une tombe froide : les
murs égratignés et humides, le sol en ciment mélangé à un sorte de pâte de bois
rougeâtre. Apparemment, j’étais un invité inattendu et indésirable — le sol
était nu, mais vraiment nu, sans aucune trace de lit, matelas, tapis ou quoi
que ce soit du genre. Après deux mois passés sur les planches dans l’enfer
policier, il fallait se résigner avec le ciment en prison.
Des milliers de
souvenirs ont afflué dans ma mémoire : de la mère qui pointera du doigt le
fait que son fils « bon à rien » est en prison, de la grand-mère qui
justifiera qu’elle m’a chassé à juste titre de la maison, de Bakovski, qui
positivement continue de mener le combat avec dignité, pour les habitants de
Kapatovo, qui chuchoteront avec fierté et pitié pour le « prof ».
Toutes ces images et d’autres me semblaient aussi lointaines que proches. Détaché
d’elles avec la perspective de nombreuses années, encore une fois à travers
elles je me suis senti attaché à la vie.
À dix heures le
lendemain, on m’a fait sortir de la cellule. Une promenade. De nombreux anciens
et nouveaux prisonniers se promenaient déjà dans la cour, un par un et en
cercle. Mes yeux cherchèrent d’abord et avant tout Docho Kolev. Il n’était pas
là. Exténué, il ne pouvait pas quitter la cellule. Il était actuellement
examiné par l’ambulancier sergent de la prison. J’ai remarqué de nombreux
camarades bien connus : Marin Guéshkov, Yordan Tanev, Boris Taskov,
Jacques Nathan, Hristo Nikov, Asen Marinchevski, Anton Tsviatkov, Ivan
Bliznakov, Mircho Spasov, Vasil Markov, Totyo Saraliev, Netso Garvanski et
d’autres. Les gardes ont disparu quelque part et le cercle s’est divisé en
groupes distincts. J’ai approché Taskov et Guéshkov. Dans la conversation, nous
avons découvert que nous avions marché sur des charbons ardents à la
direction ; maintenant pendant longtemps encore une balançoire nous
balancera ; nous aurons le temps de parler en long et en large de ce qui
avait été et comment cela aurait dû être.
Ma voix m’a surpris.
D’une manière ou d’une autre, avec effort, un son est sorti de ma gorge. J’ai
dû me forcer à émettre un son. À la deuxième ou troisième tentative, des
gouttes de sueur ont coulé sur mon front. Ignorant absolu des maladies de la
gorge, j’attribuais la gêne à une cause passagère et accidentelle. J’ai juste
écouté les camarades qui n’arrêtaient pas de raconter leurs mésaventures.
J’ai passé la
deuxième nuit sur le sol en ciment, avec cette différence que le serrurier
s’est excusé et a annoncé que le lendemain, ils nous déplaceraient dans
l’ancienne salle de couture, qui était située dans une autre cour de la prison.
La salle de couture
mesurait environ 15 mètres de long et 6 à 7 mètres de large. Nouvellement
repeinte, avec de hauts plafonds et de grandes fenêtres avec des barreaux de
fer. Il y avait des lits ici et là près des murs et sous les fenêtres :
des lits simples en fer et des lits faits de chevalets en bois, ou juste deux
caisses avec dessus des tapis de chiffons, des manteaux ou des serviettes. Dans
un coin de la salle, un groupe de jeunes était assis sur des paillasses. Ils
jouaient aux cartes fabriquées à partir des couvercles de boîtes de cigarettes.
Au milieu se trouvait une table étroite entourée de deux chaises en bois.
Les
« anciens » prisonniers ne comptaient pas plus de 20 personnes. Ils
nous ont accueillis comme des invités tant attendus. Malgré leur curiosité
brûlante pendant deux mois, ils se sont montrés extrêmement prudents :
aucun de nous ne s’est vu poser de questions inappropriées. D’ailleurs, nous,
les nouveaux venus, avions convenu de garder entre nous l’expérience de la
police et de ne la présenter par écrit qu’à la direction du parti à l’extérieur
de la prison.
Un jeune homme
grand, beau et maigre nous a aidés à nous installer tant bien que mal. Condamné
à 15 ans pour un certain complot militaire, son nom était Goshkata ou Georgi
Dimitrov — Goshkin. Il servait comme représentant politique devant
l’administration pénitentiaire. Avec lui, rapidement, sa bonne humeur et ses
goûts littéraires me convenaient bien. Il connaissait mes écrits sous le
pseudonyme de Boris Ogin, j’avais lu ses poèmes publiés dans RLF. Mon nom s’est répandu parmi les
jeunes en tant que critique littéraire et de théâtre, dernier rédacteur en chef
de l’hebdomadaire littéraire préféré du parti.
L’activité des
organisations du parti à l’extérieur ne s’arrêtait pas, la terreur policière
s’intensifiait énormément. Au bout de trois ou quatre mois, la salle était trop
petite pour accueillir 180 à 200 prisonniers. Ils ont été obligés de pousser la
moitié d’entre nous dans une autre salle, en face de celle de couture. Les deux
salles étaient situées au rez-de-chaussée, séparées par un couloir qui servait
également de palier à l’escalier menant au deuxième étage. Les noms et les
personnalités des écrivains Georgi Karaslavov, Orlin Vassilev, Krastyo Belev et
les débutants Kamen Kaltchev et Ivan Martinov, les personnalités célèbres du
parti Krastan Rakovski et Ivan Dimitrov — Shishko se sont démarqués dans la
foule ; les membres du Comité central du PCB Gavrail Karev et Kapriel
Kaprielov, des rédacteurs en chef de divers journaux bulgares : Dimitar Liaptchev
— le barbier, Ivan Dimitrov Zoin, le cordonnier Boris Manchev, le villageois
Nasko — le rédacteur en chef le plus ancien d’Écho, l’étudiant Tinchev, le conspirateur militaire Metodi
Karastoyanov, le célèbre pope Rouge — le député ouvrier Rousinov, Stefan Bogdanov
— la jeunesse agitée et le bon joueur d’échecs, le travailleur du tabac de
Haskovo Georgi Dimitrov, à qui des officiers avaient coupé les tibias de ses
jambes avec une scie, etc.
Au vu de la masse
des jeunes, nous avons transformé la prison en université. Nous avons créé des
cercles sur l’économie politique — maître de conférence Jacques Nathan, sur le
léninisme avec le conférencier Vasil Markov, un cercle littéraire dirigé par
Boris Ogin, sur l’histoire du PCB — Boris Taskov et sur l’histoire du mouvement
syndical — Nacho Ivanov et Stamat Ivanov. Le cercle littéraire développa une
intense activité éditoriale : plusieurs numéros de Joupel, Littératuren list
et un recueil littéraire de près de 120 pages densément écrites sous forme de
cahier. Les copistes avec de petites belles lettres imprimées étaient recrutés
surtout chez les jeunes. Dans le recueil littéraire, le barbier Liaptcheto a
publié un long poème sur la vie héroïque et la mort du jeune soldat Alexandar
Voïkov. Goshkin a exprimé ses données poétiques dans le poème dynamique Vers l’échafaud. Ivan Marinski a écrit
une histoire sur la Commune de Paris. Krastyo Belev nous a surpris avec un
poème en prose pour les tisserands. La collection s’est terminée par la pièce
en un acte Gouttes de sang de Boris
Ogin. Toutes les publications ont été lues dans le cercle individuellement et
commentées en groupe. Nous avons choisi un moment pour lire Gouttes de sang devant tous les
prisonniers. Beaucoup n’ont pu retenir leurs larmes. De longs commentaires ont
suivi.
Nous avons sorti
toutes ces publications de prison illégalement. Pour plus de sécurité, selon
Stefana Klintcharova, elles ont été envoyées à Moscou et remises au Secours
Rouge pour archivage. Le sort de ces matériaux reste à ce jour malheureusement
inconnu.
De légers problèmes
sont survenus avec la publication de Joupel.
Dans ses pages humoristiques, nous avons essayé d’être précis. Nous avons pris
pour cible certaines caractéristiques distinctives de camarades individuels et
parfois avec succès, parfois sans succès, nous les avons ridiculisés. Par
exemple, nous avons croisé le fer avec Orlin Vassilev. Dans ses conversations
toujours colorées et originales, il utilisait souvent « pour ainsi
dire », « ça veut dire » et « exactement ». Les
associés de Joupel, pour la plupart
des jeunes, avaient remarqué l’utilisation fréquente de ces trois expressions,
et il ne fallut pas longtemps avant qu’un modèle de discours d’un de nos
camarades bien-aimés paraisse sur le journal. Orlin s’est vu facilement dans le
« modèle ». Il y eut une tempête. Le célèbre auteur de Le cerceau de feu s’est déchaîné comme
le vent de novembre et m’a attaqué spécifiquement pour « trahison
collégiale ». Mais comme tous les grands écrivains, c’était en même temps
un grand enfant : moins de vingt-quatre heures s’étaient écoulées depuis
l’avènement de la bouffonnerie, et nous étions redevenus de bons vieux amis.
Orlin a dû admettre : « Si j’utilise ces mots si souvent, les jeunes
ont raison ! »
Le 1er mai 1935 approchait
et coïncidait avec Pâques. Nous avons décidé de célébrer dignement la fête du
travail. Cela signifiait donner de l’éclat à la célébration. Encore une fois,
notre glorieuse jeunesse nous a fourni cette opportunité en dotant la plupart
d’entre nous d’authentiques rubans rouge foncé, conservés et transmis d’année
en année depuis les temps de la social-démocratie. Les malheureux sans rubans
originaux ont dû se contenter de morceaux de la ceinture rouge de... X.
La direction du
parti a élaboré un plan d’action détaillé. À 8 heures moins cinq précises nous
chantons tous l’Internationale et Vive, vive le travail face aux fenêtres,
sous lesquelles à ce moment passaient les prisonniers criminels — cordonniers
et tailleurs — en route vers le bureau au-dessus de notre salle. Le but était
de connecter l’action avec la masse des criminels. Quand il fut temps d’aller
se promener, nous sommes sortis tous dans la cour habillés de façon festive et
avons accroché des rubans rouges sur nos revers.
Avec sa fraîcheur,
le matin de mai insuffla à nos cœurs une véritable ambiance de fête. Nous nous
sommes félicités avec notre « Joyeuse Fête ! » dès le début. En
plus du fade thé de la prison, nous avons dévoré avec un grand appétit un œuf
de Pâques et un morceau de brioche de Pâques apportés par parents et amis. Le
petit-déjeuner améliora notre humeur. Non seulement dans les yeux, mais comme
dans l’air, l’enthousiasme contagieux scintillait et brillait.
Le jeune Toshkata de
Tonet, qui avait été mis en observation, a couru de la partie ouest de la pièce
et a prévenu : « Ils arrivent. » Nous nous sommes tous tenus en
rangs serrés devant les fenêtres. Les premiers pas des sabots sur les dalles du
trottoir résonnaient dans le silence. Nous avons chanté l’Internationale. La chanson emplissait la salle et arrivait par
vagues à travers les barreaux vers la cour, et au-delà par-dessus la clôture de
pierre, vers les rues voisines. Les tailleurs et les cordonniers ont ralenti.
La chanson — le cri jubilatoire du clan communiste invaincu — était de plus en
plus forte, de plus en plus puissante et chaude. J’avais écouté l’Internationale, chantée par 50 000
prolétaires parisiens au Vélodrome d’Hiver[50]. Je
n’avais jamais entendu ni participé à l’hymne international des travailleurs de
telle façon auparavant. La salle résonnait, je dirais même tremblait, bercée
par la grande puissance de notre chœur vocal, sonnant comme la musique d’un
orchestre géant. Alors que la tête de colonne montait les escaliers jusqu’au
deuxième étage et que les ouvriers remplissaient le couloir entre nos deux
salles, la mélodie virile Vive, Vive le
Travail tonna.
La première partie
de l’action prévue s’est terminée à merveille. Elle a dépassé nos attentes.
Nous étions convaincus que l’effet sur la masse criminelle était important.
Nous avons passé jusqu’à 10 heures dans une excitation générale. Nous avons
tous interprété différemment ce qui a été fait et avons de nouveau prédit
différemment comment se déroulerait la prochaine étape.
À 10 heures
précises, les portes des locaux s’ouvrirent et le surveillant, que nous
appelions la Mort, y apparut. Il a
crié : « Allez vous promener... et pas de chansons ! »
Calmement mais rapidement, nous avons marché devant la Mort, un homme de 50 ans au visage cireux, au nez
extraordinairement long, aux yeux enfoncés et aux sourcils de Méphistophélès,
vêtu d’un costume vert en laine grossière. Pas deux, mais quatre gardes nous
attendaient dans la cour. Des rubans rouges fleurissaient discrètement sur nos
poitrines. Nous avons marché paisiblement et avons eu des conversations
tranquilles. Les yeux des gardes s’écarquillèrent. Ils regardaient et se
demandaient quand ce jardin rouge mouvant avait poussé devant eux. L’un d’eux
est allé à l’administration pénitentiaire. Entre nous, de bouche à oreille,
s’est répandu l’ordre de la direction du parti : « Restez calme, ne
cédez pas aux provocations ! »
Le sous-directeur de
la prison, Pisarev, apparut bientôt, suivi de deux gardiens et d’un sergent,
chef de garde. Il regarda la table colorée en rouge, fit deux ou trois pas sur
le trottoir et s’arrêta devant un groupe de jeunes, dont l’étudiant Joseph de
Chirpan et l’apprenti Toshkata de l’usine Tonet, puis il eut à peu près la
conversation suivante avec eux :
— Les gars,
vous ne savez pas qu’il est interdit de faire des manifestations politiques en
prison ? Pourquoi avez-vous accroché ces rubans ?
— Parce que
nous sommes des travailleurs et que nous avons notre fête.
— Erreur
géographique. Vous êtes en Bulgarie, pas en Russie soviétique.
— C’est
pourquoi nous célébrons la fête du travail, afin qu’un jour nous soyons dignes
de la célébrer librement, comme en Union soviétique.
— Ça
suffit ! Ce n’est pas un club de discussion, mais une prison... Enlevez
vos rubans !
Goshkin est
intervenu dans la conversation en tant que représentant politique :
— Monsieur le
directeur, nous portons des rubans rouges, mais remarquez, nous ne faisons de
mal à personne avec.
— Dehors, il
est interdit aux citoyens libres de manifester ce jour-là, et vous voulez
qu’ici, en prison, moi, je tolère l’action du 1er mai ?! J’en ai assez
dit ! Enlevez les rubans et retournez dans les locaux !
— En tant que
représentant politique, je proteste. Vous empiétez sur l’un de nos droits, le
droit de se promener. Vous n’avez aucune raison...
— Maintenant,
tout le monde rentre, et avec vous nous parlerons au bureau des raisons.
Derrière le coin
gauche du bâtiment, une douzaine de soldats armés sont apparus. Le mot de passe
Vite, dedans se propagea
instantanément. Légèrement poussés par les gardes, nous sommes arrivés vers les
locaux. Quand nous fûmes tous à l’intérieur, nous entendîmes avec horreur le
déclic de la clé sur la seule porte de la grande salle. Cela signifiait priver
plus de 150 personnes d’eau et d’accès aux toilettes. Il était hors de question
de s’accommoder de la mesure honteuse et inattendue de l’administration
pénitentiaire. Nous nous sommes emportés et avons commencé à frapper à la porte
avec nos poings, nos coups de poing, nos chaussures ; nous frappions avec
des gamelles et des bols sur les barreaux de fer des fenêtres. Nous avons
crié : « Ouvrez la porte. Nous avons soif. Il y a des patients avec
des maux d’estomac. Acceptez notre représentant politique. » Par moments,
nous avons arrêté les coups, nos cris se calmant dans l’espoir d’entendre une
réponse. Le silence au-delà de la porte se prolongeait obstinément. Cela nous a
encore plus irrités, et nous avons martelé avec une nouvelle force et
crié : « Meurtriers ! Fascistes ! » À la porte même,
Goshkin, le premier et le plus grand des jeunes tapait et criait. Soudain, de
l’autre côté, ils ont commencé à taper avec les crosses. La voix de la Mort hurla dans le silence :
« Arrêtez. Ne criez pas. J’ouvre la porte. » Et en effet la serrure
résonna et le surveillant de mauvais augure apparut plus vert que d’habitude,
entouré de deux ou trois de ses collègues et d’un sergent :
— Qu’est-ce
que vous avez à crier ? Est-ce que vous oubliez qu’il existe un cachot
pour les désobéissants ? Le directeur a ordonné que vous restiez enfermés
dans la salle.
Goshkin s’avança et
dit :
— Je demande à
être reçu par le directeur.
— Le directeur
est sorti en ville. Quand il reviendra...
— Alors, s’il
vous plaît, que je me présente devant le surveillant en chef.
— Il n’est pas
là...
L’un de nous a
crié :
— Ce n’est pas
vrai. Il est dans le couloir.
— Maintenant,
allez à vos places. Dès que le directeur viendra, je lui ferai un rapport.
Et la Mort essaya de refermer la porte. Le
groupe de jeunes a été le premier à résister. Les serruriers ont poussé fort,
mais les jeunes hommes se sont accrochés à la porte. La mort se mit à marteler de ses poings. Ses collègues le
suivirent. Goshkin et les jeunes hommes ont répondu par des coups. Krastyo
Velev, grimpant sur les épaules de la foule rassemblée devant la porte, ordonna :
— Tenez
la porte. N’abandonnez pas ! Il s’avança et donna un coup de pied aux
serruriers sur la tête.
Il y eut des
cris :
— Fascistes !
Tueurs !
Au milieu du corps à
corps, les serruriers se retirent dans le couloir, étroitement surveillés par
un groupe de prisonniers. Là, une douzaine de soldats avec des fusils braqués
sur nous ont tiré en l’air. Un trouble s’ensuivit. Les derniers ont été les
premiers à fuir. Tout le monde courait se cacher sous les lits, sous les
tables. Certains ont trébuché et sont tombés. D’autres les ont piétinés et ont
sauté par-dessus. Les soldats sont entrés dans la salle et ont continué à
tirer. Des morceaux de plâtre du plafond et des murs nous sont tombés dessus.
Les coups se sont arrêtés. Au fond de la salle, debout sur les lits, les bras
tendus, comme crucifié, se tenait Ferdinand Manolov, blessé par un ricochet de
balle. Du sang coulait sur son visage. Les serruriers se sont précipités après
les soldats. Avec des cris furieux et des fouets à la main, ils se sont précipités
sur ceux qui n’avaient pas réussi à se cacher. Un par un, une douzaine de
camarades ont été retirés de sous les lits, dont Anton Tsviatkov, qu’ils
avaient battu le plus sévèrement en arrachant des mèches de ses cheveux
luxuriants. Des cris déchiraient la pièce.
Les coups de feu,
les bagarres, les gémissements ont surpris et outragé les criminels. En haut,
au deuxième étage et en bas, des tailleurs et des cordonniers ont protesté. Des
cris parvenaient à nos oreilles :
— Ça suffit,
arrêtez ! Arrêtez de les tuer ! En même temps, ils frappaient sur la
balustrade avec des sabots et des marteaux.
Le surveillant en
chef a immédiatement considéré les conséquences de l’intervention des
criminels, et ordonné aux serruriers d’arrêter les coups et d’amener les
criminels malfaiteurs dans l’atelier « sans faire d’histoires ». J’ai
remarqué que le tailleur Georgi Stoyanov, pâle comme un cadavre, était pris en
sandwich entre une tête de lit et le mur, et j’ai demandé au gardien en chef de
nous permettre de le sortir de là.
— Tirez-le !
ordonna-t-il à ses subordonnés. — Apportez deux couvertures. Appelez
l’infirmier !
Ils ont sorti le
camarade inconscient et l’ont allongé sur le sol. Goshkin se pencha sur lui et
commença à l’appeler.
— Georgi, Georgi, tu m’entends ? Où
es-tu touché ?
Georgi gisait les
yeux fermés, le visage pâle cadavérique, sans signe de vie.
La masse des
prisonniers était silencieuse. La voix rauque de l’infirmier, qui s’était
agenouillé à côté du tailleur allongé sur la couverture, brisa le silence.
— Le garçon est
vivant, il respire.
Goshkin a demandé
que le camarade blessé soit examiné. L’infirmier lui répondit sèchement :
— S’il est
blessé, c’est à moi de le dire. Et pour celui-ci vous avez « mort »,
et il me survivra probablement aussi... Que le « blessé » vienne.
Le gardien en chef
se tourna vers les soldats et leur ordonna de rester un moment. En rangs
serrés, ils ont braqué leurs canons de fusil sur nous. Au bout d’un moment,
trois ou quatre serruriers revinrent dans la salle et se jetèrent sur les galettes,
les brioches et les œufs de Pâques entassés dans un coin. Grossièrement et
avidement, ils ont entassé les provisions dans de grands paniers. Ils ont fui
le champ de bataille comme de vrais maraudeurs. Les soldats se sont retirés en
dernier et sans tourner le dos.
Le bilan de l’action
du premier mai ? Plein d’avantages et d’inconvénients. Nous nous sommes
félicités pour la première partie de celui-ci lorsque nous avons chanté
l’Internationale, comme aucun de nous ne l’avait chantée ou écoutée. Nous avons
également apprécié la deuxième partie dans la cour, où nous nous sommes montrés
combatifs et disciplinés. Les inconvénients ont commencé lorsque nous n’avons
pas compris la lâcheté de la tactique de l’ennemi, bloquant notre accès aux
robinets et aux toilettes. Pouvions-nous accepter cette mesure restrictive en
silence, sans résistance ? Il ne fallait pas. Il fallait réagir. Mais
comment et dans quelle mesure ? C’est ça la question. Nous avons admis que
nous avions trop tordu le bâton, au point de le casser. Nous avons rendu
hommage à la protection de la part des criminels. Sans leur intervention
courageuse et opportune, notre sort aurait sans doute été beaucoup plus
funeste. La ligne de conduite de relier l’action avec les criminels s’est
avérée correcte et même salvatrice. Nous leur avons envoyé une lettre spéciale
de remerciements.
Après un court
séjour au dispensaire, Georgi Stoyanov est revenu sain et sauf et plus tard il
a vraiment survécu à l’infirmier. Pendant trois jours, le nez de Ferdo était un
nid dans lequel une balle en plomb était piégée. Et pendant tout ce temps,
l’infirmier militaire a affirmé « avec compétence » qu’il n’avait été
qu’égratigné dans le tumulte. Le troisième jour, Ferdo a apporté « le
trophée du 1er mai » dans sa main. Il s’est vanté et a plaisanté sur le
fait qu’un jour il serait fier du bonbon en plomb.
— J’emmènerai
mes petits-enfants au Musée de la Révolution et leur montrerai la balle :
voyez-vous, petits de grand-père, comment votre grand-père s’est battu contre
les monstres fascistes, dont vous ne lisez l’histoire que dans les manuels.
Il y a une règle
sacrée pour le révolutionnaire professionnel : quand il est libre, il doit
prendre toutes les mesures pour ne pas aller en prison, mais une fois enfermé
dans une cellule de prison, il doit faire l’impossible pour en sortir et
consacrer de nouvelles forces à la cause. L’idée de m’évader m’est venue
sérieusement, en particulier au cours du troisième mois de mon emprisonnement.
Suite aux tortures dans la Direction de la Police, ma voix avait complètement
disparu. Je parlais sans émettre un son profond. Les « soins » de
l’infirmier avaient aggravé la maladie, et non restauré ma voix. L’insistance
répétée du représentant politique de m’envoyer pour examen à l’hôpital Alexandrov n’est passée qu’à côté des
oreilles du directeur. Nous avons donné le signal à la direction du parti à
l’extérieur de la prison. À la fin du troisième mois, le célèbre médecin
oto-rhino-laryngologiste Yankov, frère du dirigeant du parti Kosta Yankov,
décédé lors des événements d’avril 1925, est venu au dispensaire de la prison.
Le médecin m’a examiné minutieusement en présence du directeur et de
l’infirmier. Plusieurs fois, il m’a fait prononcer les lettres i, e, a, o et je
n’arrivais toujours pas à faire sortir un son dense. Il y avait des
ronflements, des chuchotements, mais pas de voix. Le médecin a constaté une
paralysie du nerf droit du larynx et a rédigé une conclusion motivée, qui
recommandait que je sois régulièrement traité dans le service spécial de
l’hôpital Alexandrov.
C’est ainsi que mes
sorties de la prison à l’hôpital ont commencé. Ils me revêtaient d’un manteau
rayé de prisonnier, m’entouraient les poignets de menottes de fer et
m’ordonnaient d’avancer, suivi d’un garde en uniforme, la baïonnette fixée sur
son fusil. Pendant l’examen, le gardien m’enlevait les menottes. Heureusement,
les médecins traitants, Andon Gougoushev et Petar Nastev, étaient mes amis
personnels d’enfance. Ils ont travaillé dur pour restituer ma voix.
Après deux ou trois
mois, quelques améliorations sont apparues. Je pouvais maintenant prononcer à
moitié les sons vocaux, et ma voix avait pris une certaine sonorité faible.
Elle avait retrouvé toute sa force dans des circonstances un peu particulières.
Nous avions organisé une soirée littéraire en janvier. Dans sa partie
artistique, j’ai interprété Septemvri
de Geo Milev. Pendant la récitation, des citoyens et citoyennes à l’extérieur
du mur se sont arrêtés, ont écouté et ont applaudi. Le soldat de garde de la
tour a informé les surveillants de l’attroupement de rue. L’un des serruriers à
la fin de la récitation a grimpé sur le mur et m’a vu par la fenêtre. Quand les
gardes sont entrés dans le local, l’image était plus qu’ordinaire, elle était innocente :
nous étions tous en train de lire paisiblement, de jouer aux échecs et aux
dames, de faire la grasse matinée, de ranger nos affaires dans nos valises.
J’étais personnellement devenu professeur de français auprès d’un groupe de
jeunes. La mise en scène hâtivement établie ne convainquit pas le surveillant
en chef. Il a désigné Docho Kolev, Goshkin et moi et nous a invités à le
suivre. En traversant la cour, nous avons appris la punition : « Vous
allez pourrir au cachot pendant un mois pour vous rendre compte que vous ne
pouvez pas jouer avec nous impunément. »
Le cachot
représentait un trou d’un peu plus d’un mètre de large et trois mètres de long
avec une porte en fer en treillis. Sans fenêtre, avec une lampe faible toujours
allumée. Les murs étaient froids et humides. Seul le sol en bois était chaud et
sentait la vapeur. Aucun dessus de lit ou couverture et aucune trace d’un
matelas ou paillasse. Nous étions debout ou assis par terre toute la journée,
appuyés contre le mur.
Les inconvénients de
l’isolement du cachot étaient exacerbés par l’angoisse morale. Je ne pourrais
probablement plus aller à l’hôpital, ce qui signifiait — qu’une connexion avec
la direction du parti était coupée. Mais Goshkin est venu à mon aide :
« Nous nierons tous que tu as récité. Et tu continueras le jeu du sans
verbe. »
Et c’est arrivé.
J’ai compté sur mes capacités d’acteur et j’ai continué à faire semblant d’être
malade. Les visites à l’hôpital ont repris.
Un jour, j’ai été
désagréablement surpris. Le Direction de la Police était
« préoccupée » par ma santé. Sur ses ordres, j’ai été personnellement
examiné par le professeur de renommée européenne, le Dr Belinov, en présence du
chef de groupe Zhecho Koulev. Mon ami le Dr Gougoushev m’a prévenu de l’examen
et je me suis préparé en conséquence : j’ai mangé deux piments forts à
l’avance pour me brûler la gorge.
Plus d’une dizaine
de médecins s’étaient rassemblés autour du professeur et de son assistant
Boykikev. Non seulement ils ont assisté à l’examen, mais ils ont regardé dans
ma gorge. Deux ou trois fois, le professeur m’a demandé de lui dire quand et
comment ma voix avait disparu. Je lui ai décrit l’évolution de la maladie et
lui ai fait savoir qu’elle avait commencé à la Direction de la Police.
En retrait pour une
délibération, l’équipe médicale a conclu : « Nerf dextre du larynx
paralysé, la gorge a besoin d’un traitement galvanique sérieux : le
patient doit continuer à venir à l’hôpital. »
Le professeur
Belinov a demandé au Dr Boykikev d’écrire un protocole de constatation de leur
consultation et lui a dit :
— Je le
signerai et l’enverrai à la Direction de la Police.
Zhecho Koulev a
appelé grossièrement :
— S’il vous
plaît, Professeur, ordonnez que le prisonnier ne vienne pas se faire soigner
tant que la Direction n’aura pas donné son avis sur votre protocole.
— Un tel ordre
n’est pas de ma compétence. Je suis médecin, pas policier. — Et il se tourna
vers le Dr Boykikev : — Vous, s’il vous plaît, dépêchez-vous avec le
protocole.
Il n’y avait pas de
place pour l’hésitation. Le jeu avait duré trop longtemps. La fin approchait.
Comme je ne voulais pas rater l’occasion de m’échapper, j’ai dû accélérer mon
évasion par moi-même.
J’ai demandé la
permission de m’évader. Le Comité central du PCB a donné son consentement, qui
m’a été communiqué par Nikola Petev[51] et
Stefana Klintcharova.
La matinée d’une
journée d’octobre était agréable, lumineuse, gaie. J’ai mis mon seul costume
bleu. Je lui ai ajouté par-dessus un manteau rayé de prisonnier. Ils m’ont
menotté et m’ont conduit le long de l’itinéraire habituel. Le garde derrière
moi s’appelait Peter Tsolov des villages d’Orhan. Il m’avait conduit plus d’une
fois à l’hôpital, et dans ses conversations il ne cachait pas sa haine du
monarque et du métier de garde, qu’il avait accepté comme chômeur après une
longue famine. Comme preuve de sa sympathie pour les communistes, il prenait le
risque et m’enlevait lui-même les menottes après notre sortie de prison. Avant
et après l’examen à l’hôpital, il me permettait de parler à de nombreuses connaissances
et de partager des collations avec moi. Comme preuve suprême de sa sympathie
pour nous, il a accepté d’introduire du matériel illégal à ma place, qu’il me
remettait dans les toilettes de la prison.
Cher Petre, quand
nous avons quitté l’hôpital Alexandrov
ce jour-là, tu ne savais pas que j’avais déjà décidé de m’enfuir. Tu m’as
traité avec une confiance sans bornes. Tu n’as rien vu de suspect lorsque je me
suis plaint d’avoir mal au ventre et que je t’ai demandé d’entrer dans une
maison de la rue Ovche Pole près de la rue Positano. Nous entrâmes dans la
cour, où de grands draps étaient étalés et derrière eux des toilettes ouvertes
avec une petite porte. Je me suis dirigé vers les toilettes, et tu t’es adossé
au mur d’une maison de la cour et tu as commencé à lire un journal. Nous étions
séparés par les draps. Je jetai mon manteau par-dessus la porte et m’accroupis
derrière elle. À ce moment-là, je me suis dit : « C’est maintenant ou
jamais. Le risque est une noble cause. » Et j’ai ouvert et refermé la porte
avec le manteau par-dessus. Je passai sur la pointe des pieds derrière les
draps et me dirigeai vers la porte de sortie. Tu lisais tranquillement ton
journal. J’ai marché sur le trottoir de la rue Ovche Pole, me suis empressé de
me cacher au coin de la rue Positano et j’ai couru là comme un jeune cheval.
J’ai tourné rapidement dans la rue Morava, je suis sorti dans la rue Nishka et,
au bout d’un moment, je suis entré dans la rue Bregalnitsa. Il était dix heures
et demie. Les rues étaient relativement fréquentées. En traversant la rue
Pirotska, j’ai entendu mon nom. Lazar Milev m’appelait, un cordonnier, une
blouse bleue :
— Que
fais-tu ici ? Je te croyais en prison.
— Lazare, tu
n’es pas à la page. Tu ne lis pas les journaux. Notre procès a eu lieu et j’ai
été acquitté.
— Regarde-moi
ça ! Et tu as raison. J’ai beaucoup de travail, mon gars.
— Au revoir.
La deuxième
rencontre avec un camarade bien connu a eu lieu au bout de la rue Maria Luisa,
près de la gare. C’était Kolyo Transki, un peintre des chemins de fer. Il m’a
regardé et n’en croyait pas ses yeux.
— Et ça
alors ! Qu’est-ce que je vois ? Que se passe-t-il ?
Je l’ai emmené dans
une cour et lui ai révélé :
— Qu’est-ce que
tu me regardes comme un animal ? C’est moi. Je me suis évadé il y a 15
minutes, en revenant de l’hôpital.
— Tu es
fou ! Sais-tu ce qu’il y a dehors ? Y a-t-il quelqu’un pour te
cacher ?
— Laisse-moi
m’en occuper. Donne-moi de l’argent maintenant, car ce que j’avais est resté
dans le manteau.
— Voici tous
les 50 levs que j’ai — et il enleva son imperméable, — Prends-le aussi. Que tu
te changes un peu.
Je suis passé devant
la Stochna gare jusqu’au quartier Hadji Dimitar. Il y avait le logement de
Penko Stoyanov, un coopérateur de l’usine Tonet. Chez Penko, le comité de
région et le deuxième comité de district du PCB s’étaient réunis plus d’une
fois. Nous y avons tenu toute une conférence régionale qui, en octobre 1932, a
élu le comité régional de Sofia du PCB avec Stefan Hristov comme secrétaire.
La maison était à un
étage, avec deux pièces et une cuisine au milieu. Je traversai l’étroite cour
et m’engageai sur le petit porche. J’ai frappé. J’ai été accueilli par la mère
de Penko, une petite femme au visage jaune verdâtre, aux yeux noirs brillants
et qui tricotait dans ses bras. Elle m’a reconnu comme l’un des amis de son
fils.
— Où étais-tu
passé, Borko !... Allez, sois le bienvenu. Viens attendre Penko dans la
cuisine. Il arrive vers 12 heures. Je lui ai demandé de tes nouvelles et il m’a
dit : il est allé à la campagne.
— À Plovdiv, j’ai
trouvé un emploi de comptable. Je suis là-bas maintenant. Je suis venu pour
quelques jours.
— Tu resteras
déjeuner avec nous. Tout ce que Dieu a donné. Tu sais bien, nous subsistons
souvent avec des haricots.
J’ai délibérément
abordé la question du célibat de Penko. C’était le point sensible de la mère.
Comme ça, elle arrêterait de me questionner. Elle pouvait en parler pendant des
heures. Le temps passait.
Dès qu’il m’a vu sur
le canapé de la cuisine et qu’il a vu un sourire sur mon visage, Penko a immédiatement
retrouvé son calme. C’était comme si on s’était mis d’accord pour me demander
où je m’étais perdu jusqu’ici, je n’avais pas donné signe de vie, il apprenait
seulement par des connaissances comment je vivais.
— Je travaille
à Plovdiv. Je vais relativement bien. Je suis venu te voir un moment... Ta mère
se plaint de ton célibat.
— Elle répète
toujours ce qu’elle sait. J’ai le temps...
Penko m’a invité à
prendre un café dans le salon, où je lui ai rapidement raconté mon aventure. Il
m’a tout de suite proposé de m’aider. Je pouvais rester jusqu’à ce que nous
trouvions un abri plus confortable. Je l’ai remercié et j’ai décliné
l’invitation. J’avais vu une nouvelle grosse moto dans la cour. Cela a donné
une autre direction à mes pensées : être hors de Sofia ce soir même. Quoi
de mieux que de disparaître à la campagne ?! Et aujourd’hui,
maintenant ! Mon ami a approuvé mon plan – de m’emmener au village
Stolnik. Il a fixé une condition — partir l’après-midi. Il devait régler
quelques affaires courantes dans la coopérative.
La réactivité de
camaraderie, la chaleur humaine que Penko m’a démontrée avec sincérité et
désinvolture, m’ont plus affecté que des gouttes de valériane. Le calme se
répandit dans mon corps, mes nerfs se détendirent, je m’assoupis involontairement
sur la table du salon.
Penko est revenu à 4
heures moins le quart de l’après-midi et m’a informé qu’on parlait de mon
évasion dans la ville. Muni d’une casquette et enveloppé d’un imperméable, je
m’assis sur le siège arrière. Penko roulait assez vite. Nous avons à peine
remarqué comment nous avons atteint le pont d’Iskar, mais là nous avons
remarqué un spectacle inquiétant : le pont était bloqué par des policiers
en uniforme. Des voitures de buffles s’étaient arrêtées devant le pont et leurs
propriétaires discutaient de quelque chose avec les gardes.
— Tu n’as
sûrement pas de carte d’identité ?
— Je n’ai aucun
document.
— Nous nous
arrêtons. Tu t’assois à une table devant l’auberge et tu commandes quelque
chose. Je vais me promener pour voir ce qui se passe.
Penko a tendu
l’oreille à la conversation entre les villageois et les gardes et est monté sur
le pont lui-même. Je ne perdais pas de vue mon ami. S’il était arrêté, je
m’enfuirais à travers les champs voisins. À ma grande surprise, Penko commença
une conversation avec un policier en uniforme. Au bout d’un moment, les deux
ont commencé à descendre de la route devant le pont, où se trouvaient les
voitures. Je m’apprêtais à me lever pour m’éloigner de la table, mais je me
suis ressaisi. J’ai vu le policier rire et Penko lui taper sur l’épaule.
Penko s’est approché
de la table et a dit :
— Laisse-moi te
présenter mon cousin. Et voici mon collègue de la coopérative, un comptable,
nous allons à Makotsevo.
De pâle, je suis
probablement devenu rouge vif. J’ai essayé de sourire. Le caporal s’assit avec
lassitude et souleva sa casquette par devant.
— Qu’est-ce que
vous offrez ? Ma gorge est sèche. Nous somnolons sur le pont depuis deux
heures. Nous ne faisons que harceler le bétail et les gens... Allez, à votre
santé !
Nous avons bu de la
bière. Si la conversation continuait, je ne sais pas à quels dangers je pouvais
être exposé. Heureusement, un garde du pont a fait un signe de la main et a
appelé le cousin.
Nous avons attendu.
Nous avons bu nos chopes. Penko m’a gentiment ordonné de monter sur la moto et
de ne pas avoir peur.
Mon guide commença à
siffler. J’ai baissé ma casquette encore plus bas. Sur le pont lui-même, nous
nous sommes arrêtés devant le caporal. Penko lui a donné une cigarette et nous
avons continué. Un vieux garde nous fit le salut militaire. J’étais sur le
point d’éclater de rire.
La journée
finissait, mais les ennuis n’étaient pas terminés pour moi. De nombreux bons
amis bien connus vivaient dans le village de Stolnik : les frères
Perenovski, Tsviatko Mehandjiiski, Grigor Nedialkov et d’autres. Ils
travaillaient tous à Sofia, mais j’espérais trouver refuge dans leurs familles.
Nous avons caché la moto dans les buissons et sommes entrés à pied dans le
village vide : la moto, un bien rare à cette époque, pouvait attirer une
nuée d’enfants du village.
J’ai frappé à la
porte d’entrée de la maison où vivait Nedyalko Perenovski. L’hôtesse a répondu,
une jeune mariée rougeaude. Elle a parlé de la fenêtre de la maison de l’étage,
maison qui avait également un rez-de-chaussée. Je m’étais arrêté plus d’une
fois dans cette maison pour parler à Nedyalko, même sa femme nous avait servi
du babeurre frais.
— Qui
cherchez-vous ?
— Je ne cherche
personne. Je viens au nom de Nedyalko. Je suis son camarade.
— Il est à
Sofia. Je ne sais rien. Cherchez-le là-bas si vous le connaissez.
— S’il vous
plaît, ne parlons pas par-dessus la clôture. Venez, ouvrez, que je vous
explique pourquoi je viens chez vous. Ce n’est pas par hasard.
La mariée hésita,
ferma la fenêtre et sortit dans la cour. Elle s’arrêta à côté de l’échelle et
se tourna vers nous.
— Je suis seule
dans la maison. Je ne peux pas vous laisser entrer. Dites-moi qu’est-ce qui
vous amène ici ? Et elle nous invita dans la cour.
Quels que soient les
arguments que j’avançais dans le petit vestibule, elle était catégorique :
je ne vous connais pas ; chez nous beaucoup de gens ont bu du
babeurre ; il y a diverses personnes qui se présentent pour ceci et
cela ; Nedyalko ne m’a rien dit et m’a dit de n’ouvrir à personne ;
il y a seulement une semaine, ils ont perquisitionné ici ; vous, étant ses
amis, pourquoi n’avez-vous pas un mot de lui...
La situation
empirait. J’avais peur de lui dire d’où je venais pour ne pas l’effrayer...
Penko m’a rappelé qu’il devait partir... Désespéré, j’étais sur le point de
renoncer à insister. Il y eut un cri de l’extérieur.
J’ai aperçu une
petite fille en uniforme scolaire par la fenêtre. Alors que je demandais à
l’hôtesse à la rencontrer dehors dans la cour, la jeune fille entra dans le
vestibule.
— Ah, tu as des
invités... Oh, oncle Bore, que fais-tu ici ?... Je ne vous dérange pas,
j’espère ? Je voulais juste te demander un peu de sel.
— Est-ce-que tu
le connais ?
— Eh bien,
c’est un grand camarade de l’oncle Grigor. À Poduyane, il tenait souvent des
réunions dans notre chambre, et parfois il restait dormir chez nous...
— Si c’est le
cas, tu le ramèneras à la maison. Quand ton oncle Nedyalko viendra, laisse-le
s’en occuper.
Le dénouement, aussi
inattendu qu’heureux, convenait à tout le monde : l’hôtesse s’est calmée
et a promis de donner à manger, Penko est parti heureux de me laisser entre de
bonnes mains : la jeune fille était contente de devenir l’héroïne d’un
dangereux complot.
Pendant trois jours,
j’ai suivi les dispositions de Trendafila, la jeune fille merveilleusement
courageuse et intelligente : ne pas se montrer aux fenêtres, ne pas faire
de bruit, ne pas tousser, ne pas ouvrir la porte et ne répondre à personne.
Pendant trois jours, j’ai lu des manuels de la seconde année, avec lesquels la
propriétaire préparait ses cours. Nous avons parlé jusque tard dans la nuit.
J’ai essayé de lui décrire la beauté de la lutte. Trendafila m’a surtout
interrogé sur Paris et la vie en prison. Elle rêva à haute voix :
« Comme j’aimerais être un aigle, mordre et être insaisissable. »
Samedi soir, nous
avons rencontré Nedyalko — un grand homme au tempérament extrêmement vif et
optimiste.
— Comment t’est
venue l’idée de te retrouver à Stotnik, ce village perdu ?
— Les amis sur
lesquels je comptais ne sont pas perdus.
Nedyalko a insisté
pour que je quitte la maison de Trendafila et que j’aille vivre dans une grange
près du village.
C’est ainsi qu’a
commencé ma vie clandestine après mon évasion de prison. Pendant plusieurs
semaines, je suis resté enfoui dans le foin dans un des coins de la grange. Le
propriétaire ne s’est pas douté de ma présence. Il venait une fois par jour,
chargeait sa charrue de foin et fermait la porte d’entrée avec un gros cadenas.
Tard dans la soirée, la brave Trendafila m’apportait de modestes vivres,
qu’elle me servait par une large fente de la clôture en bois.
Avec l’aide du jeune
homme Nikola Velitchkov, j’ai déménagé dans le village de Churek. Il m’a
installé dans sa maison, plus précisément dans la chambre de son oncle Petar
Diavolski, un garde forestier. Là, c’était impossible de se cacher. Toute la
maison se composait d’une grande pièce. Il n’y avait aucun lit. Nous dormions
tous sur le sol d’argile rouge. Mais qui étions-nous ? La mère et le père,
huit filles de 1 à 12 ans et moi. Et parfois, le dimanche, la fille aînée de 13
ans, servante dans une riche famille juive, venait de Sofia. Devant mes
hébergeurs et les voisins, les parents dans tout le village (incroyable, mais
vrai), je passais pour un sous-officier supérieur, un grand ami de la caserne
de Kolyo Velitchkov, venu sur recommandation de médecins pour soigner la
tuberculose dans le pittoresque village de montagne. Je ne sais pas à quel
point ils y ont cru quand ils regardaient mes joues rougies, mais avec Kolyo,
le membre enthousiaste du Komsomol, on n’avait pas pu imaginer un meilleur
mensonge que celui-ci. On m’a souvent vu errer avec un bâton de cornouiller
dans les Balkans boisés... respirer l’air frais.
Il n’y avait pas de
poste de police dans le village. Une fois par semaine, un garde venait de
Novoseltsi (aujourd’hui Elin Pelin) pour savoir ce qui se passait dans le
village. Il se renseignait auprès de l’adjoint au maire, un vieux paysan malade
et presque analphabète, du crieur public du village et, bien sûr, surtout du
garde forestier, le seul homme armé du village.
À l’insu de Kolyo et
sans m’avertir, mon hébergeur, de sa propre initiative, a une fois ramené ce
garde à la maison et m’a présenté comme étant de sa même classe. J’ai
rapidement détourné la conversation de la vie de caserne et je suis passé à la
tuberculose, qui était une maladie terriblement ignoble parce qu’à l’extérieur,
on peut avoir l’air en bonne santé, et à l’intérieur, elle vous ronge comme un
ver mange une pomme rouge. À l’invitation de Petar Diavolski, nous sommes
sortis tous les trois pour boire un coup. Nous avons traversé la rue principale
et nous nous sommes arrêtés au seul petit pub enfumé. Ils ont trinqué pour la
santé avec des bouteilles de gnôle, moi, en tant que « malade », j’ai
bu un peu du verre de limonade froide. J’ai bu, conversé et je ne voyais pas
comment le jeu dangereux joué par le bon baï
Peter finirait. Enfin, mes tourments se sont terminés. Nous avons redescendu la
rue principale et accompagné « le gars de la même classe » jusqu’au
bout du village.
Petar Diavolski me
regarda diaboliquement et m’adressa un clin d’œil :
— C’est fini.
J’ai fermé la bouche de tous les râleurs. J’en ai entendu un ou deux dire de
toi que tu n’as pas l’air malade et qui sait quel genre d’oiseau tu devais
être. Dès qu’ils t’on vu monter et descendre avec le garde et boire de la
limonade avec lui, tous les coléoptères sont sortis de leur tête... C’était mon
idée. Qu’en penses-tu ?
Honnêtement, les
conditions de vie dans le village de Churek n’arrêtaient pas de me déranger et
de m’inquiéter. Je voyais un danger constant d’échec. Mon imagination ne
pouvait pas accepter que tout le village se demande à quel point j’étais malade
et que quelqu’un trouve le moyen de suggérer à la police de me contrôler.
J’éprouvais aussi une grande sollicitude et une réelle angoisse pour le suprême
sacrifice de Petar Diavolski. Il prenait des risques non seulement pour
lui-même, mais aussi pour ses enfants et sa femme malade. J’imaginais, si
j’étais pris avec eux, quelle catastrophe arriverait : baï Petar en prison, la femme et les
enfants internés dans un lieu inconnu.
Dans ma vie de
prisonnier recherché, je me suis réfugié dans différents endroits de la région
de Sofia. Je suis resté le plus longtemps dans le village de Tsarkva et la
ville de Pernik. Ce n’est pas par hasard que je me suis réfugié dans l’actuel
village de Daskalovo. Une vingtaine de camarades de Tsarkva ont passé plusieurs
mois en détention provisoire. Pendant ce temps, je me suis lié d’amitié avec
beaucoup d’entre eux. Face au danger toujours croissant d’être découvert dans
le village de Churek, je me suis souvenu de mes bons camarades Alexander Robov
— Shishko, Stoil Ignatov et Asen Targovski. J’ai été accueilli à bras ouverts.
Ici les conditions matérielles étaient meilleures : nourriture suffisante
et variée, conspiration relativement meilleure. Je dis relativement car je me
cachais au sein de petites familles avec un ou deux enfants. Je passais les
jours et les nuits soit dans une pièce séparée, soit dans la cuisine.
Le village de
Tsarkva appartenait également au district du parti de Pernik. Les habitants de
Tsarkva, selon la procédure, ont prévenu le secrétaire du parti Ivan Garvanov
et il a voulu que je lui sois présenté. Nous nous sommes rencontrés par mot de
passe.
Sur la voie ferrée,
je boitillais en direction de Pernik et je tenais ma casquette à la main. Il
est venu de l’autre côté, a sifflé « Eleno
momé, Eleno... » et portait le journal littéraire Kormilo. J’ai été impressionné par ses grands yeux marron foncé,
son front haut et le gentil sourire lumineux avec lequel il m’a arrêté :
— Nous
sommes des nôtres, camarade. Disons-nous « bonjour », et voyons où
nous arrêter. On a beaucoup à se dire.
Nous avons bien
regardé pour voir si quelqu’un nous suivait, nous sommes sortis du chemin le
long de la ligne et nous nous sommes assis sous un saule dans le terroir du
village de Moshino.
Le compagnon était
un jeune homme de taille moyenne, aux larges épaules, et il avait, du moins je
pensais à ce moment-là, une démarche lourde et minière. J’ai appris plus tard
que mon interlocuteur était un technicien intermédiaire dans les mines.
Nous avons dialogué
pendant environ deux heures. Nous avons établi quand et comment s’impliquer
dans le travail du comité du parti de la région de Pernik. À la tombée de la
nuit, nous nous sommes séparés non seulement en camarades, mais aussi en amis.
Nous nous sommes plu mutuellement. Ivan était direct, avec des centres
d’intérêts multiples et une soif inextinguible pour plus de connaissances. Il
n’avait pas honte d’admettre sa connaissance incomplète d’un sujet et dévorait
tout ce qui lui était nouveau. Ivan était formidable, magnifique dans sa
sincérité. Il se démarquait non seulement par son caractère sincère mais aussi
par sa pensée originale. Ce qu’il disait et savait était profondément raisonné.
Il ne répétait rien qu’il n’ait passé au crible de son propre esprit. Il
n’acceptait pas, je dirais même, il rejetait toute motivation unilinéaire et
unilatérale. Il faisait des expériences intéressantes avec moi. Par exemple,
j’expliquais une thèse de parti. Je donnais des exemples et des arguments qui
défendaient la thèse, en choisissant uniquement des preuves positives. Ivan
défendait la thèse inverse, extrayant des anti-exemples et des anti-preuves.
Avec sa position, il pouvait donner l’impression à son interlocuteur qu’il
n’était pas d’accord avec lui.
Oui, le chef du
parti des mineurs de Pernik était un camarade formidable. Je voyais en ce jeune
homme un futur leader à l’échelle nationale. Il possédait toutes les qualités
politiques, morales et même physiques pour occuper dignement des postes à
responsabilités dans le parti et dans notre nouvel État[52].
Dans la région de
Pernik, j’ai travaillé pour le reste de ma vie clandestine. Je siégeais
régulièrement au sein du comité régional, je faisais souvent des conférences
sur des sujets d’actualité, et de nature éducative, soit devant les sections
des mineurs, soit devant les communistes des villages environnants. Assez
souvent j’étais accompagné et aidé par mon ami Ivan. Nous avons tous les deux
rédigé et édité les appels et le bulletin périodique du comité régional.
C’était à nous d’organiser et de tenir une conférence régionale. Elle s’est
passée dans la cuisine de la maison du camarade Shishko, Alexandar Robev, du
village Tsarkva, région de Pernik. Les secrétaires des sections de la région,
les représentants des syndicats et les jeunes étaient présents, au nombre
d’environ 18-20 personnes. Parmi les personnes présentes, je me souviens, en
plus des camarades de Tsarkva, baï
Ferdo de Pernik, Ognyanov et Zaré de Moshino et Kiril Kovatchev de Sofia. Ivan
a fait un rapport sur la situation politique et organisationnelle dans la
région et les tâches des communistes. Il m’appartenait de rendre compte des
décisions du VIIe congrès de la IIIe Internationale
communiste, prises sur la base du rapport historique du secrétaire général du
Komintern, le camarade Georgi Dimitrov.
Tout au long de ma
clandestinité, je n’ai ressenti ni ennui ni solitude. Le travail dans la région
me fascinait. Mon humeur était bonne. En même temps, quelque part dans les plis
du subconscient, il y avait un certain sentiment d’insatisfaction. Jusque-là,
j’avais travaillé à l’échelle régionale et nationale. Après l’école-prison,
j’imaginais que j’avais grandi politiquement. Dans cette ligne de pensée, je
suis arrivé à la conclusion immodeste que je devais émigrer à l’étranger afin
d’avoir l’opportunité de développer mes forces au maximum. La direction du
parti a accepté.
Faux
passeport ? Où, auprès de qui et comment l’obtenir ? Travail
complexe. L’histoire s’est compliquée en raison de l’éclatement de la guerre
civile en Espagne : la police ne délivrait pas de passeports aux
communistes connus. Nous avons concentré nos poursuites sur un camarade qui
serait bon, honnête, sachant bien garder un secret et que la police ne
connaîtrait pas. Il devait remplir une autre condition : me ressembler en
stature et en physionomie.
Après de nombreuses
prospections, nous avons trouvé le volontaire recherché. Et tout près, au
milieu des glorieux habitants de Tsarkva. C’était Atanas Nikolov, surnommé
Kòlata. Communiste et en plus actif, il avait réussi à se protéger lors de la
découverte de la conspiration de Tsarkva. Les traits extérieurs de sa
silhouette correspondaient à la mienne. Obtenir un passeport n’était pas une
tâche facile. Devant nous, comme un mur étanche, se dressait une condition
terrible, inventée par la police fasciste : pour les citoyens qui lui sont
inconnus, une personne doit garantir sa fiabilité. Pour le meilleur ou pour le
pire, notre sympathique Kòla était inconnu des services de police, mais en même
temps il n’avait aucun contact avec des personnes de confiance des autorités.
Ma vieille connaissance Lichkata a trouvé un moyen de nous sortir de la
situation.
Après deux ou trois
mois, une petite fête a été célébrée dans la maison de Shishko. Kòlata me
tendit solennellement le passeport délivré par la police avec ces mots :
— Si un malheur
arrive, je ne te connais pas, même en photo. Je ne t’ai ni vu ni écouté. Je
l’ai perdu, vous l’avez trouvé près du monument Ruski. Tu es pour moi... terra incognita[53].
C’est comme ça qu’on disait, Shishko ?
— Toi, depuis
que tu vas à Sofia, tu as commencé à parler comme un livre. Je ne sais pas si
c’est terra ou merra incognito. Je te souhaite d’avoir le dos solide en cas de
pépin...
Son passeport est
resté intact ce soir. Il était sur le point de subir une opération
majeure : remplacer le portrait de Kòlata par ma photo et y peindre une partie
du sceau à l’encre. Le médecin qui a pratiqué l’opération s’appelait Zaré, un
photographe du village de Moshino. Ivan Garvanov lui a confié personnellement
la tâche. Il l’a remplie avec une conscience paternelle.
Comme la prunelle de
mes yeux, je gardais le point par lequel je quitterais le pays. Même devant le
secrétaire du comité régional Georgi Avramov en présence de Trayana Nenova,
j’ai caché la vérité. Je m’étais mis dans la tête que l’organisation de Sofia
était pleine d’agents provocateurs, et ainsi, bien qu’avec quelques scrupules,
j’ai trompé le camarade responsable. J’ai indiqué le port de Lom au lieu de la
gare de Dragoman. Je me souviens à quel point Avramov a été surpris quand,
lorsqu’il m’a demandé si j’avais besoin d’une aide financière, il m’a entendu
répondre : « Merci pour vos soins, mais je n’en ai pas besoin. »
Trayana Nenova a
jugé nécessaire d’ajouter : « Le camarade a beaucoup d’amis. »
Elle n’a bien sûr pas dit que parfois elle-même me cachait et partageait avec
moi son maigre repas d’étudiante.
Le jour de mon
départ pour Paris approchait. Il était impensable pour moi de quitter ma patrie
avant d’avoir dit au revoir à mes proches, en premier lieu à ma pauvre mère.
Nous nous sommes vus dans des appartements clandestins à Sofia. Nous nous
sommes souvent embarqués, elle sur des conseils de mère, moi sur des
exhortations de fils. Dans ma personne, elle voyait les communistes en général.
Lors de notre dernière rencontre, elle est arrivée à ses propres
conclusions :
— Je ne
comprends pas grand-chose à ce que tu me dis. Mais si tout le monde est comme
toi, alors vous êtes comme le Christ, vous voulez le bien des gens. Si c’est
comme ça, Dieu lui-même vous aidera. Puissé-je être vivante, mon fils, et
puisses-tu être vivant et en bonne santé, afin qu’ensemble nous puissions voir
le royaume des cieux sur la terre[54].
ON
NE PEUT PAS SERVIR À AUTRE CHOSE ?
Je me sentais bien
dans la France du Front populaire. Je ne regardais pas autour de moi à chaque
pas. Des camarades de longue date et des camarades nouveaux m’entouraient de
soins chaleureux. Dès les premiers jours, j’ai été présenté pour un soutien
financier au Secours Rouge, puis rapidement ils m’ont trouvé un emploi
d’apprenti-couturier et de livreur de costumes et de manteaux prêts-à-porter.
J’ai réussi à me faire régulariser à la Préfecture de Police en tant
qu’émigrant politique sans aucune difficulté. Devant Metodi Shatorov —
Atanasov, représentant du CC du PCB à Paris, j’ai exprimé mon désir d’aller en
Espagne comme volontaire. Il m’a dit d’attendre qu’un nouveau groupe se forme
pour franchir les Pyrénées.
Un jour, j’ai reçu
la visite de Peter Grigorov, l’un des défenseurs du héros du procès de Leipzig.
Après le procès, il a d’abord émigré en Suisse et vit maintenant à Paris. Baï Peter m’a interrogé, en tant que
vieille connaissance, sur les activités du parti dans notre pays, sur mon
évasion de prison et a souhaité me revoir en présence d’un camarade inconnu qui
discuterait avec moi.
La rencontre a eu
lieu dans un café près de la station de métro Miromesnil. La nouvelle personne
était un grand homme de plus de 40 ans, avec de beaux yeux et une jolie bouche,
et un visage pâle et enflé. Grigorov me l’a présenté comme Ivan Petrovich.
(C’était le futur célèbre général Ivan Vinarov.)
Ivan Petrovich a
donné à la réunion un caractère extrêmement professionnel :
— Ce n’est pas
le moment de raconter nos biographies. Je connais la tienne, toi — si nous
sommes vivants – tu connaîtras un jour la mienne. L’important pour une personne
c’est d’écrire sa biographie avec de tels actes, afin que ni lui ni ses
petits-enfants ne rougissent en l’écoutant... Dis-moi maintenant pourquoi
veux-tu aller en Espagne?
— Comment
pourquoi ? Pour me battre.
— Nous sommes
tous bons pour le combat. Voyons si on ne peut pas servir à autre chose...
L’autre chose est
arrivée. Cela m’a éloigné des châteaux espagnols, des musées, de la guerre
civile, d’une république en difficulté, des brigades internationales.
Connu par de
nombreux amis et ennemis de l’émigration bulgare, j’ai été obligé de dissimuler
le vrai pays dans lequel je vivrai et travaillerai. Il était naturel pour un
communiste d’aller en Espagne à l’époque. Encore plus pour moi : beaucoup
connaissaient mes intentions sur cette question. D’un commun accord avec Shatorov
et mon patron Ivan Petrovich, j’annonçai entre amis et connaissances qu’un soir
je partirais pour... l’Espagne. Un groupe impressionnant d’expéditeurs s’est
réuni à la gare de Lyon, dont Petar Grigorov, Metodi Shatorov, Veltcho
Ibrishimov, les tailleurs avec lesquels j’avais travaillé : Ivan Beev et
les frères Dimitrov, Georgi Paskov et sa femme Stella, Stoyna Borisova, la
française Andrée et d’autres. Certaines personnes présentes m’enviaient, disant
que je verrais un pays merveilleux.
J’ai vu aussi des châteaux,
des palais et des musées, mais cependant ils n’étaient pas espagnols mais
polonais. Ma mission m’obligeait à me légaliser devant l’ambassade de Bulgarie
à Varsovie. Avec un passeport de marchand sous le nom de mon ami tailleur
Atanas Tatarov, je me suis présenté au ministre plénipotentiaire Trayanov comme
fils d’une riche famille commerçante de Pazardzhik, venu étudier l’agronomie
pour qu’un jour je puisse gérer les fermes de mon père de manière moderne. En
plus, je suivrais des cours de comptabilité pour contrôler nos énormes revenus
provenant de plusieurs épiceries de Pazardzhik et de Plovdiv.
La fille d’un
sénateur et moi avons étudié la comptabilité ensemble. Les fils d’un flirt
sérieux se sont tissés entre nous. Dans sa famille, j’étais considéré comme un
parti intéressant : un héritier pas tellement laid d’un riche marchand et
propriétaire terrien. Les espoirs de fiançailles plus ou moins avoués de la
mère ont compliqué mon jeu, mais j’ai patiemment tissé ma toile. L’important
était d’atteindre leurs parents et connaissances, qui pourraient devenir
l’objet de ma mission. Ainsi, sur la recommandation de mon amie, pendant les
vacances d’été, j’ai séjourné dans la villa de la famille d’un colonel dans la
célèbre station balnéaire polonaise de Zakopane dans les Tatras. Les vacanciers
étaient de bon niveau : le baron D-ski, le lieutenant P-ski, le cousin de
mon flirt, la femme et la fille du colonel G-ski. Pour la première fois dans un
milieu aussi « haut de gamme », j’ai fait beaucoup d’efforts pour ne
pas montrer que je venais des Balkans. Surtout, je me suis adapté aux manières
extérieures de la société des villas. À chaque rencontre et à chaque adieu, je
me penchais et je baisais les mains des femmes.
Dans la villa, les
conversations étaient centrées sur trois thèmes : les questions
littéraires, l’antisémitisme et les perspectives politiques. Dans le domaine de
la littérature, même polonaise, j’ai essayé de ne pas avoir honte devant les
propriétaires et les colocataires. Je n’ai pas critiqué, mais je n’ai pas
partagé leur antisémitisme enragé et aveuglé, au motif qu’en Bulgarie un tel
phénomène était inconnu. J’ai pris une position neutre sur les perspectives
politiques de la Pologne, de l’Europe et du monde : « Je m’occupe de
commerce — quelque chose de réel, pas de politique – c’est trop
arbitraire. » Naturellement, j’ai regardé et écouté leurs discussions
politiques. Le baron avec son monocle mobile et la femme du colonel, une grande
dame aux colliers coûteux qui changeaient constamment autour de son cou de
pigeon, rêvaient cyniquement d’un… Hitler Polonais. Lui seul sauverait la
Pologne « du danger communiste et de la populace juive ». Le
lieutenant s’opposait à ces vues, en tombant dans un véritable délire
patriotique :
— Je
me demande ce que souhaitent ces messieurs, disait-il. — Vous, monsieur le
baron, en tant qu’ancien colonel, et vous, ma chère dame, en tant qu’épouse de
militaire, ne pouvez que connaître l’état de notre armée. Nous n’avons pas peur
d’Hitler. Les glorieuses troupes polonaises sont en capacité de vaincre toutes
les hordes hitlériennes en trois semaines. La Pologne n’a pas besoin d’Hitler,
mais d’un deuxième Pilsudski pour tenir toute la nation entre ses mains, pour
en faire une poigne de fer dans la défense de l’indépendance polonaise.
Je me souviens de
l’indignation du baron :
— Imaginez,
Lénine a vécu ici dans le village de Poronino[55],
comme clandestin. Il a été arrêté par les autorités autrichiennes. Qui sait
dans quelle prison il aurait pourri pendant la première guerre si les poètes
Jeromski et Kasprowicz n’étaient pas intervenus et ne s’étaient pas portés
garants. Et imaginez qu’il ait été emprisonné comme espion militaire pendant
toute la guerre — nous n’aurions pas eu la révolution d’Octobre, si
catastrophique pour l’humanité ! Quand je sais que des Polonais ont libéré
ce démon communiste, j’ai envie de renoncer à mon nom polonais.
Je ressemblais à un
singe dressé dans un magasin de verre. J’avais besoin d’un vrai sens de
l’équilibre pour ne pas faire un geste malvenu, pour ne pas placer un mot
inopportun.
À Varsovie, j’ai
continué à voir le lieutenant P-ski. Nous avons bu dans les cafés de la
capitale, nous allions au cinéma, à l’opéra, au théâtre ensemble. Nous avons
trouvé un terrain d’entente : la nécessité de lutter contre la peste
brune. Sur cette base, j’ai pris un risque et révélé ma mission. L’écho que
j’ai entendu était encourageant. Le patriote polonais a accepté d’effectuer
certaines tâches. Mes efforts de près de deux ans ont été couronnés de succès.
Ma joie et celle d’Ivan Petrovich étaient méritées. Par malchance, j’ai aussi
fait plaisir à la police polonaise, organisée adroitement par l’ancien maréchal
social-démocrate Józef Pilsudski. Des fileurs désagréables sont apparus sur mes
traces. Dans sa naïveté, la fille du sénateur m’a avoué que le responsable des
cours de comptabilité l’avait avertie de ne pas flirter avec un inconnu. Des
agents en civil ont commencé à monter la garde devant mon logement. Le cercle
s’est resserré. J’ai reçu la permission d’Ivan Petrovich de me présenter pour
faire mon rapport. J’ai pris les mesures appropriées et j’ai échappé à la vue
de la police.
Ivan Petrovich et
moi nous nous sommes rencontrés à Paris à la hâte. Il retournait en Union
soviétique, où des changements drastiques avaient eu lieu dans la direction des
services secrets pour l’étranger.
J’ai repris le
chemin d’un émigrant politique ordinaire. J’ai regagné mon ancien grenier de la
rue Saint-Roch et mon ancien métier de tresseur de chaussures.
Le milieu de 1939.
La guerre, la grande guerre arrivait. Le légionnaire Déat s’écorchait à crier
dans les pages de son journal L’Œuvre :
« Nous ne combattrons pas pour Dantzig ! » Jacques Doriot, un
renégat du parti communiste, l’accompagnait et tentait même de crier plus fort.
L’ambassadeur d’Hitler, Abetz, attirait dans ses filets et berçait la vigilance
d’importants ministres français, des hommes publics, des banquiers et des
industriels.
Le 1er
septembre, la Seconde Guerre mondiale éclata. Je n’avais toujours pas de titre
de séjour régulier en France. Metodi Shatorov a convoqué une courte réunion des
émigrants bulgares. Il a été décidé par tous les moyens légaux et illégaux
possibles de se rendre dans la mère patrie. C’était l’ordre du parti. Raiko
Damianov, Lyuben Hadjiiski et moi avons choisi avec des passeports étrangers
falsifiés par nos soins de partir le plus tôt possible pour la Bulgarie. Mon
grenier est devenu un laboratoire de passeports. Nous avons obtenu diverses
encres et stylos, correcteurs, gélatines pour la copie. Je suis devenu le chef
de laboratoire, ayant passé avec succès l’école de baï Zarè de Moshino. Lyubcho avait obtenu un laissez-passer
bulgare, sur lequel deux visas étaient appliqués — entrée bulgare et transit
yougoslave. Nous travaillions actuellement sur ces deux visas. Nous avons
travaillé dur pour trouver un passeport à partir duquel copier le visa le plus
important – sortie française.
La matinée du 8
septembre captivait par sa douce beauté des derniers jours d’été. La nature
souriait avec son soleil et la douce fraîcheur de l’air. Sa joie naissante
était en dissonance éclatante avec l’atmosphère militaire trépidante qui pesait
sur les gens, les rues, la capitale. Des visages inquiets, découragés et
désespérés se rencontraient à chaque tournant. L’infanterie, la cavalerie et
les unités militaires motorisées rugissaient sur tous les boulevards et aux
abords de la ville. Des Parisiennes et des Parisiens civils accompagnaient les
colonnes militaires pas si élancées avec des regards pleins de pitié pour le
sort peu enviable de ceux qui allaient vers le front.
11 heures du
matin... Je rentrais chez moi par les Grands Boulevards qui, bien qu’encore
animés, n’étaient plus les mêmes. Les fenêtres aveugles des boutiques fermées
et des cafés ici et là, les uniformes militaires de plus en plus courants
avaient changé leur physionomie habituelle. Leur vitalité était assombrie, leur
gaieté ébréchée, leur diversité fanée. Je marchais vers la place de l’Opéra et
je regardais les visages des gens. Un agent en civil et un policier en uniforme
se sont approchés de moi. Nos regards se sont croisés. Vite j’ai voulu les
dépasser. En vain. L’œil aiguisé de la police qui a trouvé un étranger en moi
m’a suivi. L’agent s’est approché et m’a arrêté.
— Vos
documents, s’il vous plaît.
Je lui ai remis ma
carte d’identité non renouvelée.
— Votre carte
n’est pas en règle. Pourquoi ne pas l’avoir renouvelée ?
— Je suis un
émigrant politique.
— Ça je l’ai
lu.
— J’ai été
absent de France pendant un certain temps. La Ligue des droits de l’homme est
au courant de ma situation. Elle a fait les démarches auprès de la Préfecture
de Police.
— Veuillez nous
suivre s’il vous plaît.
J’étais allé plus
d’une fois à l’Opéra de Paris. Je connaissais très bien son pigeonnier. C’est
ainsi que les Français appellent les places du plus haut balcon de la salle de
théâtre. Je n’avais jamais imaginé que j’aurais l’honneur de connaître le
sous-sol de la maison de Garnier, le fondateur de l’Opéra de Paris. Le sous-sol
était bondé de personnes avec des documents non en règle ou des factures non
payées avec des agents des forces de l’ordre. La plupart étaient des étrangers.
Tout le monde avait l’air inquiet. Certains marchaient en silence. Certains des
hommes les plus âgés étaient assis sur le sol en ciment, d’autres fumaient
contre les murs gris moisis. Seul un Portugais de 35 à 40 ans était extrêmement
nerveux. De temps en temps, il frappait désespérément à la porte massive en fer
et racontait pour la énième fois son histoire en public :
— Ce
sont des imbéciles, c’est pas possible. J’étais descendu acheter du beurre et
des œufs et ils m’ont attrapé. Je leur ai dit : montons ensemble à la
cuisine, éteignons la cuisinière à gaz. Ils n’étaient pas d’accord. Je leur ai
donné la clé de l’appartement : tenez, allez éteindre vous-même le poêle.
Ils n’ont pas accepté. Des idiots ! Maintenant, tout l’appartement est
probablement en feu. Et pourquoi ? À cause de la bêtise des gardes, qui ne
comprennent rien... Il y a une caisse de poudre et de munitions dans l’appartement.
Je suis un chasseur. Imbéciles, imbéciles, imbéciles !
Un français
d’apparence ouvrière a dit :
— Tu pleures
pour ton appartement. Je te comprends. Ils ont jeté la France dans le feu et
ils s’en fichent complètement...
Personne n’a osé
reprendre les accusations du Français.
J’étais inquiet
aussi. Ils ont pris ma carte. Ils connaissaient déjà l’adresse et ils allaient
probablement fouiller l’appartement. Il y avait là trois passeports qu’on avait
commencé à refaire. Je comptais sur Raiko et Lyubcho. Ils devaient venir
déjeuner et continuer l’opération sur les passeports. Eux seuls savaient où je
laissais la clé de la porte et où je cachais les documents et les passeports
dans le buffet en bois noir à double fond. Ils découvriront bientôt ce qui
m’est arrivé, rangeront les objets compromettants et disparaîtront.
Après une nuit à la
prison de Fresnes près de l’aéroport d’Orly, le lendemain à 9 heures, j’ai été
condamné à trois mois de prison pour irrégularité de mes documents.
Le Président :
— Votre nom ?
— Boris Milev,
émigrant politique.
Le Président (au
Procureur) : — Qu’avez-vous à dire sur son cas ?
Le Procureur :
— Documents irréguliers. Personne suspecte. Trois mois de prison.
Le Président :
— Admettez-vous que vos documents ne sont pas en règle ?
— Oui mais...
Le Président
(interrompt) : — Assez — (lève le dossier devant son visage),
« consulte » ses deux collègues de côté, baisse le dossier et déclare
avec insistance : — Trois mois !
— Je suis un
émigré politique, je proteste...
Le Président (au
garde) : — Écartez-le... Au suivant !
Le suivant était un
Hongrois, de taille moyenne avec des cheveux gris luxuriants, un artisan
chaisier. Dans un café de la place de la Bastille, il avait prédit la défaite
de la France. Il se justifiait en affirmant qu’il ne parlait pas de la France,
mais de l’Allemagne, devenue très forte, surtout après les accords de Munich
entre Hitler, Daladier, Chamberlain. L’interrogatoire du Hongrois a duré un
temps record — environ 4 minutes. Il a été condamné à sept ans de prison pour
« déclarations défaitistes en public en temps de guerre ».
En 54 minutes, le
destin de 60 personnes a basculé. Vous direz : « La guerre, la
guerre ! » Et je vous comprendrai, mais cela ne m’empêchera pas de
penser que la tragi-comédie qui se déroulait devant mes yeux, dont étaient
victimes 60 personnes, était un jeu cynique de démocratie judiciaire.
La prison de Fresnes
est une prison moderne. Du fer partout : portes en fer, escaliers en fer,
fenêtres en fer. Cet environnement de fer, ce froid de fer, auraient rendu la
vie impossible si les parquets en bois et les murs blanchis à la chaux des
cellules n’avaient pas existé. Ma cellule était individuelle, étroite, avec une
seule fenêtre et un lit de fer mobile, que je n’étais autorisé à abaisser du
mur que pendant la nuit. Dans l’un des coins près de la porte se trouvaient une
petite table en bois utilisée depuis longtemps et une chaise. Dans l’autre
coin... un seau hygiénique sans couvercle.
Au début, j’étais
seul. Nous sommes vite devenus quatre : un jeune compositeur et pianiste
hongrois, un ouvrier algérien grand, maigre, tourmenté par une toux fréquente,
et un Français de près de 50 ans qui avait servi comme sergent dans les forces
coloniales françaises. Ils dormaient tous les trois sur un matelas, recouverts
d’une couverture.
Nous avons été
enfermés dans la cellule pendant quinze jours sans aucune promenade. Nous
n’avions pas le droit d’ouvrir la fenêtre même lorsque nous balayions et
nettoyions notre tombeau. À la fin de la première semaine, malgré la nourriture
relativement bonne et abondante, chacun de nous a constaté que ses compagnons
de cellule étaient très pâles et barbus. Alors la lutte pour un courant d’air
frais a commencé. Nous ouvrions secrètement toute la fenêtre ou seulement ses
ailes supérieures. L’air était pur mais humide et froid. Nous avons été pris
plusieurs fois. Cela s’est terminé par des avertissements sévères et des
menaces de nous envoyer à l’isolement. Le Hongrois et le sergent s’effrayèrent
et, sous prétexte qu’ils avaient froid, se déclarèrent contre l’air pur.
L’Algérien et moi-même, prêts à aller à la cellule d’isolement, ouvrions de
temps en temps la fenêtre pour le bien commun. Le Hongrois et le sergent ont
été très surpris quand j’ai dit une fois au serrurier enragé que j’avais ouvert
la fenêtre contre la volonté de mes camarades, et développé toute une théorie
du droit de respirer l’air frais et insisté pour avoir droit à un régime
politique : écrire, lire les journaux, contacter la Ligue des droits de
l’homme, recevoir la visite d’avocats, de camarades, de connaissances. Le
serrurier marmonna une menace et claqua la porte. Au bout d’un moment, il
réapparut et m’emmena au bureau du directeur. Le directeur avait rejeté ma
prétention à un régime politique. Il m’avait appelé pour attirer mon attention
sur mon comportement. La prison a une capacité de 1 200 personnes, on lui en a
envoyé 5 000. Cependant, il rétablirait bientôt les promenades et nous
pourrions aérer nos cellules.
— Sois
juste patient. Pour l’instant, je vais vous faire apporter le catalogue des
livres de la bibliothèque de la prison.
Le directeur, un
homme relativement jeune et énergique, a tenu parole. Le même jour, j’ai reçu
la liste de la bibliothèque. Le lendemain, un barbier s’est présenté à notre
cellule. Après le barbier, nous avons reçu une invitation pour... un bain. Le
bonheur nous a souri, et pas seulement du bout des lèvres. Nous nous sommes
préparés fébrilement. Nous avons pris une serviette, du savon et avons attendu
à la porte. Lorsqu’elle s’est ouverte et nous avons franchi lentement le seuil
de la cellule. Le serrurier nous a prévenus :
— Vite, sans
traîner. Vous avez 5 minutes pour descendre, prendre un bain et regagner vos
cellules. J’ai dit, en vitesse !
Nous nous sommes demandés
— est-ce possible en 5 minutes ? Mais on s’est vite rendu compte que
c’était possible.
Au cours de l’une de
ces descentes et ascensions marathon, nous avons rencontré le Dr Georgi Stoev.
Nous nous connaissions depuis Sofia. Le deuxième comité de district du comité
régional de Sofia se réunissait souvent dans son appartement de la rue Fridtjof
Nansen. Et lorsque le Dr Stoev a loué un cabinet de dentiste sur la place
Slaveykov, il n’a pas hésité à le céder au comité régional du PCB lui-même. De
nombreux camarades sans le sou sont venus réparer leurs dents ou leurs
prothèses. Dans la plupart des cas, il les traitait gratuitement. Le jeune
médecin, fougueux communiste aux yeux noirs brillants et au front haut et
inspiré, expliquait sa générosité.
— Je mets en
pratique la politique de classe. Pour les clients riches, en particulier les
bourgeois de Troyan ça leur coûte la peau des fesses. Ils paient pour vous,
pour le loyer du cabinet et les timbres du Secours Rouge.
Déjà à Sofia,
j’avais ressenti une profonde sympathie pour ce camarade. Quand il a frappé à
la porte de mon appartement au 10 rue de Lancry à Paris et m’a dit qu’il avait
tout abandonné à Sofia et qu’il était parti se battre aux côtés du peuple
espagnol, ma sympathie pour lui s’est transformée en admiration.
En Espagne, Stoev
est devenu célèbre pour sa deuxième spécialité — chirurgien, sous le nom de Dr
Schwartz. Les Bulgares, les inter-brigadistes et les républicains espagnols ont
loué l’énergie, la camaraderie, le dévouement sans fin et le courage du
communiste Dr Schwartz.
De retour d’Espagne
à Paris, le docteur Stoev — Georges, m’invita plusieurs fois dans la chambre
d’hôtel de la Rue de Montholon pour me lire des pages de son Journal espagnol[56].
Il m’a expliqué le but du journal : « Ici l’Espagne n’est qu’un
prétexte, un cadre. Ma pensée et, si tu veux, mon ambition, est de donner aux
événements et aux personnages un caractère universel. La révolution espagnole,
avec sa complexité, ses luttes internes, ses exploits humains et ses zigzags,
mérite d’être connue dans ses moindres détails par tout communiste. »
Là, sur les marches
de la prison de Fresnes, notre conversation a été rapide comme l’éclair.
— Tu es
condamné à combien ?
— Trois mois.
Et toi ?
— Je suis
encore sous enquête. J’espère sortir bientôt. Ma compagne Denise va m’aider.
— Qu’est-il
arrivé à Raiko, Handjiiski ?
— Tout le monde
est parti avec tes passeports… J’espère te voir dans une promenade...
Ce fut notre
dernière rencontre avec le grand intellectuel ouvrier Dr Georgi Stoev. Il a été
libéré de la prison de Fresnes, admis dans un hôpital parisien, où il a été
infecté lors d’une opération et est décédé subitement.
Enfin nous étions
ravis des promenades tant attendues. La lutte pour un jet d’air s’apaisa. Mais
l’écho de la guerre déclarée, qui n’avait pas réellement commencé, nous venait
et revenait à chaque nouvelle promenade. Moins de trois mois s’étaient écoulés
et le peuple appelait la guerre... drôle de guerre. Ici et là, et très
rarement, les deux armées ennemies se faisaient entendre par une balle de temps
à autre, suffisante pour troubler le sommeil des soldats. Les
« batailles » n’éclataient que dans les pages des communiqués
militaires.
Nous avons d’abord
fait les promenades de 10 à 11 heures, puis on nous a donné deux heures
l’après-midi. Il y avait assez de temps pour que les prisonniers se racontent,
apprennent à se connaître et échangent des nouvelles ou plutôt des suppositions
sur le cours de la guerre et notre destin. Le cercle des connaissances était
limité. Nous avons été forcés de nous promener dans les soi-disant
« préaux » — des cages avec une pelouse de 25 à 30 mètres carrés,
entourés de hauts murs de pierre. Il y avait 15 à 20 prisonniers dans notre
préau en même temps, la plupart étant des étrangers. Parmi eux se trouvait un
groupe de 4-5 Italiens. À la première occasion, ils se rassemblaient et
parlaient à voix basse. Quand ils ont appris que j’étais un communiste bulgare,
l’un d’eux m’a demandé un jour si je connaissais personnellement Georgi
Dimitrov et si j’avais des visites de camarades du parti. J’ai répondu que
j’avais vu Dimitrov en Bulgarie se battre avec la police de Sofia et l’avais
écouté faire des discours, mais que nous n’étions pas des connaissances, je
n’avais pas de visites. Je n’ai pas prêté attention à la question sur le
moment, mais quand j’ai appris plus tard que Palmiro Togliatti était à Fresnes
en même temps, je me suis expliqué la curiosité des camarades italiens. Il est
possible qu’ils aient voulu savoir si je pouvais d’une manière ou d’une autre
communiquer avec l’extérieur l’endroit où se trouvait le chef du prolétariat
italien.
Le sergent a été
bientôt transféré à la prison provinciale de Poissy. À sa place, le communiste
français Fromage a été amené dans la cellule. L’espace vide laissé par le
sergent s’est rempli d’une chaleureuse humanité. Nous avons dévoilé nos
biographies lors de la première promenade. Le nouveau camarade, ayant grandi en
tant que communiste endurci, avait étudié à l’École supérieure du parti de
Moscou. Il avait été arrêté en tant qu’administrateur du journal suspendu l’Humanité. Il m’a confié dans le plus
grand secret qu’au nom du Comité central du PCF, lui et un camarade de la
banlieue de Saint-Denis, Desjardins, arrêté comme lui, s’étaient rendus au
front pour rencontrer Maurice Thorez. Le secrétaire général du parti servait au
front comme chauffeur dans un état-major de régiment. Il leur expliqua qu’il
était traité poliment, observé habilement et écouté attentivement à chacune de
ses paroles. Ils n’ont pas essayé de le provoquer. Selon Thorez, la guerre
avait été mal conçue et encore pire menée par la réaction française. La darde
antihitlérienne de la guerre avait été arrachée. Pour réussir, la guerre devait
devenir antihitlérienne.
Malgré la proximité
de camaraderie établie, Fromage ne m’a pas révélé la mission qui lui était
confiée : je n’ai pas insisté, mais il était clair pour moi que les
camarades s’étaient rendus chez Maurice Thorez pour lui transmettre la décision
de la direction du parti de passer à la clandestinité et d’assumer directement
la fonction de Secrétaire Général du PCF. J’ai supposé que c’était lors de
cette réunion que les termes de son évasion prochaine avaient été convenus.
Aux dires des
visiteurs, à première vue, Paris retrouvait sa vitalité originelle. Les
théâtres donnaient des représentations, les revues du Casino de Paris, Les
Folies Bergères, Mayol rassemblaient chaque soir un public grandissant,
assoiffé de vues passionnantes.
En contraste avec
ces informations rassurantes, nous, les étrangers, avons été confrontés à des
déclarations de volontaires dans l’armée française. Je n’ai pas hésité une
minute. J’ai rempli une déclaration avec un « OUI » catégorique.
Après avoir apposé ma signature sous la déclaration, je me voyais déjà porter
un uniforme militaire. Je me sentais libre, même s’il restait deux ou trois
semaines avant la fin de ma peine. Les derniers jours sont passés doucement,
presque inaperçus.
J’ai dit au revoir
aux bons Fromage et Desjardins et j’ai franchi le seuil de la prison de
Fresnes. C’était une journée ensoleillée de décembre. Ils nous ont poussés dans
la voiture de la prison, nous ont emmenés à grande vitesse et nous ont déposés
dans la cour de la Préfecture de Police qui m’étais familière. Nous nous sommes
alignés devant une table et avons attendu notre tour. Un agent en civil grand,
costaud, aux yeux bleus et aux cheveux blonds regardait préalablement le
dossier de chacun, appelait son nom et lui demandait pourquoi il avait été
condamné et ce qu’il avait l’intention de faire à présent. Selon le dossier et
les réponses, l’agent demandait à l’interrogé de se tenir soit à gauche, soit à
droite de la table. Mon tour est arrivé.
— Tu prétends
être un prisonnier politique, n’est-ce pas ?
— Oui, je suis
un émigrant politique condamné par les autorités fascistes en Bulgarie.
— Et pourquoi
n’as-tu pas obéi aux lois de l’hospitalité française ? Pourquoi n’as-tu
pas renouvelé tes documents ?
— C’était une
faute de ma part.
— Que penses-tu
faire maintenant ?
— Vous avez
dans le dossier ma déclaration de volontaire dans l’armée française.
— Et quand tu
iras dans l’armée française, tu seras toujours politique, tu développeras à
nouveau la propagande communiste, comme en prison... Voici ce que je fais de ta
déclaration — il l’a déchirée et l’a jetée à mes pieds. — Et tu peux essuyer
ton cul avec elle maintenant... Tiens-toi là — il m’a montré le groupe de
gauche.
Celui de droite —
plus petit que le nôtre – ils l’ont mené quelque part dans les étages du
bâtiment de la police. Il se composait de gens soi-disant dignes de confiance.
Certains d’entre eux étaient considérés comme des soldats, d’autres ont reçu
l’ordre de retourner dans leur patrie. Nous, nous étions peu fiables,
indésirables. Nous étions près de 30 personnes. Ils nous ont poussés, beaucoup
plus brutalement que devant la porte de Fresnes, encore une fois dans une
voiture de prison, mais avec des cages en fer individuelles solides. La voiture
est restée près d’une heure dans la cour de la préfecture. Je me tenais debout
dans ma cage et pouvais à peine me retourner. L’air devenait chaud, des gouttes
de sueur perlèrent et coulèrent sur tout mon corps. Je pouvais sentir mes
jambes fléchir, mes yeux clignoter, ma tête s’étourdir. Dans un effort suprême,
j’ai cogné à la porte avec mes poings. J’ai crié : « J’étouffe.
Ouvrez ! ».
D’autres dans ma
position ont emboîté le pas. Il y eut des coups à deux ou trois portes, et des
voix s’élevèrent de beaucoup d’autres cellules :
« Ouvrez ! » Nous nous sommes calmés lorsque le moteur a grondé
et que la voiture a démarré. Le mouvement a créé du vent qui a modifié la
température dans les cellules. Pourtant, devant le terrain de sport de Roland
Garros, des gens tenant à peine sur leurs pieds, au regard flou, aux cheveux
ébouriffés, aux cravates desserrées, aux manteaux, chemises et même pantalons
déboutonnés sont descendus de la voiture. Un homme mince et grand, extrêmement
pâle et à la peau foncée, se tenant à deux mains aux poignées de la voiture,
pouvait à peine descendre et répétait en russe pur : « C’est un
cauchemar ! » Ils nous ont emmenés sous les gradins du terrain.
Épuisés, nous nous sommes vautrés sur la fine couche de paille. L’air pur de la
chaude journée de décembre a répandu des jets vivifiants dans nos poitrines. En
une demi-heure nous connaissions déjà des germes de nos biographies et notre
destin futur — un camp de concentration.
Nous avons passé une
vingtaine de jours pénibles sous les tribunes du terrain de Roland Garros, qui
servait de point de passage. Toutes les deux ou trois semaines, avec un nombre
suffisant de prisonniers, un train se formait pour emmener les détenus dans les
camps de concentration disséminés dans tout le pays.
CAMP
DE CONCENTRATION DU VERNET – ÉCOLE DE COURAGE
De Roland Garros on
est venu nous chercher d’un coup. C’était exactement le jour où les croyants
célèbrent Noël.
Nous avons voyagé
comme on voyage en temps de guerre – longtemps, dans la douleur, avec des
arrêts sans motif et des va-et-vient encore plus imprévus – en avant, en
arrière. Tourmentés par la soif et la faim, nous sommes arrivés, après plus de
24 heures de bousculements sur les principales voies ferrées et gares
françaises, à la ville de Pamiers au pied des Pyrénées. Nous fûmes chargés sur
des camions et à 18 heures nous arrivâmes au camp de concentration du Vernet.
De la route, le camp m’a impressionné par les murs d’enceinte en grillage
épais, avec les vieilles baraques rabattues, et par son... vide. Aucune âme
vivante ne pouvait être vue à l’intérieur. À l’extérieur des murs grillagés,
des gardes armés de fusils, accompagnés de chiens loups policiers, erraient.
Avec un Russe, Kovalev, technicien radio, nous avons été emmenés à la baraque
№ 19. C’était au bout de la troisième rangée de baraques du quartier B,
près du hangar de la cuisine. Le gardien d’escorte a appelé un certain Eladio,
nous a présentés avec les mots « Voici vos nouveaux clients, vous savez
comment vous en occuper » puis il est parti. Eladio, un homme au petit
menton, plus jeune que nous, nous a souri avec ses yeux bienveillants et nous a
demandé une seule chose :
— Quelle
nationalité ?
En entendant les
réponses, il ordonna :
— Toi, le
Russe, tu viendras avec moi. Je vais te conduire chez un de tes compatriotes.
Toi, le Bulgare, tu attendras. Il n’y a pas de Bulgares dans la baraque, mais
des Yougoslaves y vivent. Je demanderai pour une place libre dans leurs loges
et je reviendrai. Attends un peu.
Je suis resté seul à
l’entrée du hangar. J’ai regardé à l’intérieur et j’ai frissonné. Devant moi se
trouvait une jungle de chaussettes, de pantalons, de chemises, de pardessus, de
pantalons, suspendus à des ficelles le long et au milieu de la baraque de 25 à
30 mètres de long. Certains secs, déchirés, rapiécés et jetés sur les cordes,
d’autres mouillés, lavés par une main manifestement inexpérimentée. Aucune
couleur vive. L’obscurité plutôt épaisse à l’intérieur donnait à l’atmosphère
un aspect à la fois fantastique et effrayant. Cette vue était complétée et
animée par des personnes de tous âges assises ou allongées sur les lits de bois
à deux étages ou se déplaçant au milieu du long corridor.
Les gens étaient
pâles, barbus, relativement silencieux. La production de Gaston Baty de l’Opéra de quat’sous de Bertolt Brecht
avec la grande actrice originale Marguerite Jamois au Théâtre de la Gaîté-Montparnasse
m’est venue à l’esprit. Les mêmes vieux haillons, les mêmes martèlements, les
mêmes visages pâles et barbus ! Tout cet enfer feutré et guenilleux sans
flammes m’a sérieusement effrayé. Mais j’ai vraiment frémi quand j’ai imaginé
que je serais jeté dans cet enfer... indéfiniment. J’ai serré les dents et je
me suis dit comme dans le poème Jours et
nuits de Yavorov : « Courage. La vie est un changement constant
de la lumière à l’obscurité, du bien au mal. Jusqu’au moment où tu respires,
espère un meilleur sort ! »
Eladio m’a honoré.
Il m’a offert une place dans son propre logis au... deuxième étage a côté du
milieu de la baraque.
— Ce logis a un
sérieux avantage. Ici, tu peux utiliser la lumière de la seule lampe de la
baraque, m’a-t-il dit. — Si le sommeil ne vient pas, tu liras jusqu’à ce que
tes yeux se ferment... Installe-toi sur la paille. Jusqu’ici nous étions
deux : un Yougoslave et moi. Vous pourrez parler avec lui. Il est
inter-brigadiste. Et toi ?
— Non,
je ne le suis pas, mais beaucoup de Bulgares qui ont combattu en Espagne sont
mes connaissances et mes amis.
— Les Bulgares
sont dans les autres baraques.
Une voix du fond de
l’allée s’est fait entendre en espagnol :
— Mais ils sont
là aussi, camarade. Et il se tourna vers moi : — C’est toi, mon
brigand ? Que fais-tu ici ? Pourquoi tu ne fais pas signe ?
Attends, je viens vers toi pour que tu me racontes ton odyssée.
Cette douce voix de
ténor venait de notre beau camarade Iliya Yanakiev. Immigré politique depuis
1925, il vivait à Paris. Au début, je lui ai appris à tresser des chaussures,
mais plus tard, il est devenu représentant d’une entreprise de lingerie. L’un
des premiers inter-brigadistes bulgares. Une fois au Vernet, il réussit à en
devenir le chef-cuisinier. Il s’était fait pousser une barbe noire
babylonienne, ce qui donnait à sa grande taille élancée et à son beau visage
une noblesse particulière. Nous l’avons appelé Kadiyata[57]
parce qu’il était en fait un ancien juge. C’est lui qui m’a appris dans quel
genre de camp j’étais tombé. Le seul camp disciplinaire en France. Les internés
sont pour la plupart des inter-brigadistes étrangers et des combattants
républicains espagnols. Ils habitent les quartiers B et C. « Notre
quartier » est le B, avec des politiciens incontestés. Les criminels sont
regroupés dans le quartier A. Eux aussi sont sélectionnés. Selon la police, ce
sont des voleurs, des escrocs, des assassins, des proxénètes, des perceurs de
coffres forts notoires et endurcis.
Kadiyata n’a cessé
de m’éclairer. Le régime était strict. J’allais en faire l’expérience. Il était
hors de question de s’échapper. En fait, la direction du parti du camp était
également contre les évasions. Jusqu’à présent, il y a eu de nombreux cas
malheureux. Il y a quelques jours, ils ont abattu un Suisse du quartier C. Il
s’est faufilé sous le grillage, il s’apprêtait à le franchir, mais un garde
sans sommation, comme ça, comme sur un chien, a vidé son fusil sur le brave
homme... Sinon, on survivait. La nourriture n’était pas mauvaise et était
suffisante. Ils donnaient le pain d’un soldat par jour. Et si l’on avait de
l’argent, la boutique était disponible. Ils vendaient des friandises : du
jambon, des fromages français, des sardines, voire des parfums... Il fut le
premier Bulgare du quartier B, mais il n’était plus le seul. Ils en ont amené
deux autres : Ivan Kanev et Nikola Popov. Ils étaient aussi
« Espagnols ». Nous allions les voir dans un instant, mais auparavant
il m’a demandé de lui dire quel vent m’avait amené au Vernet.
Après avoir
satisfait sa curiosité, nous nous sommes dirigés vers la baraque № 8. Je
m’attendais à voir les mêmes chiffons sombres, et alors j’ai été surpris par
l’image : le couloir — balayé et propre ; vêtements, chemises,
gobelets accrochés à des cintres ou à de courtes cordelettes, mais tendues au
fond ou sur les côtés des logis ; en plus de l’ampoule centrale, des
bougies et des lampes de poche scintillaient ici et là, sous la lumière
desquelles beaucoup lisaient, écrivaient, jouaient aux dames ou aux
échecs ; rares étaient les hommes barbus ou mal rasés ; l’air ne
m’étouffait pas. Kadiyata mit fin à mon étonnement :
— Cette baraque
est exemplaire. Près de 99 % de ses occupants sont des inter-brigadistes et en
plus des cadres supérieurs. Des camarades allemands responsables vivent ici:
Franz Dahlem et Heinrich Rau, membres du Comité exécutif de la Troisième
Internationale, le dramaturge Friedrich Wolf, le poète Leonard, les Hongrois
Laszlo Reich et Ferenc Münnich, l’écrivain yougoslave Theodor Balk et d’autres
communistes dirigeants d’élite...
Les camarades
bulgares m’ont chaleureusement accueilli. Au premier regard et aux premiers
mots, mon humeur lourde s’est dissipée. Mon sourire est réapparu. Popov avait
entendu parler de moi par Docho Kolev, et Kanev connaissait mes écrits dans RLF sous le pseudonyme de Boris Ogin. Le
premier, maçon de profession, très instruit, membre actif de l’organisation du
parti de Roussé, assez cultivé, a réussi à atteindre le grade de major dans
l’armée républicaine espagnole. Le second était un jeune communiste de
Kazanlak, également bien instruit, enclin aux débats théoriques et aux
généralisations ; il manifestait un vif intérêt pour la poésie et tous les
arts. Il était lieutenant dans l’armée républicaine. Popov était pâle, même
jaune comme l’ambre, tandis que le visage de Kanev rayonnait de jeunesse et
d’intelligence. Ils avaient tous deux une assurance à toute épreuve, renforcée
par leur qualité d’inter-brigadistes. Ils ont souligné cette qualité plus d’une
fois. Kadiyata a remarqué mes réactions maladroites et a essayé de me protéger
de leur réprimande silencieuse :
— Et
oui, nous en Espagne, d’autres ailleurs. Les secteurs sont différents, le front
est le même. L’important est de rester à son poste.
Alors que nous
quittions la baraque № 8, j’ai soupiré pensivement, tristement.
Kadiyata m’a
rassuré :
— Ils sont
jeunes. Ne leur en tiens pas rigueur. Ce sont nos futurs cadres.
Je n’étais pas en
colère. Intérieurement, j’ai même apprécié ces jeunes communistes, endurcis
dans les feux de la révolution espagnole. En même temps, j’avais un sentiment
différent. « Borko, Borko, tu as raté l’occasion de devenir
inter-brigadiste ! »
Je me suis souvenu
d’Ivan Petrovich-Vinarov et de ses mots : « Voyons si on ne peut pas
servir à autre chose ! » Je n’avais aucune raison de regretter
l’autre chose et pourtant, et pourtant j’avais perdu une qualité dont tout
révolutionnaire serait fier.
Mes colocataires
Eladio et le Yougoslave, ou plus précisément le Slovène Dusan Kveder,
m’attendaient dans la baraque № 19. Ils avaient préparé l’endroit pour
dormir : une épaisse et fraîche couche de paille recouverte d’une
couverture grise déchirée. Des livres et de vieilles chaussures avaient été
cachés sous la paille en guise d’oreiller. Ils m’ont offert une
friandise : une partie du café qu’ils recevaient comme ration quotidienne.
Bien que froid, il était le bienvenu, après le solide dîner que j’avais eu avec
les Bulgares de la baraque № 8. Il est tout de suite devenu clair que je
vivrais avec de sympathiques jeunes communistes. Eladio, au visage de bronze et
aux traits doux, de taille moyenne, était un ancien directeur d’école. Il
parlait lentement, comme s’il mesurait et filtrait chaque mot. Ayant pris les
armes pour défendre la république en tant qu’anarchiste, il a achevé son
baptême du feu en tant que communiste. La légendaire Passionaria, héroïne
rayonnante de la révolution, l’a gagné au communisme par ses appels ardents à
l’unité de toutes les forces progressistes. Avec des penchants artistiques
vifs, Eladio l’a peint en direct lors des meetings en Espagne ; son image
continue de le dominer dans le camp, où il réalise des dizaines de croquis. Il
m’a prévenu de la présence dans la baraque d’un groupe de trotskystes dirigé par
le général Gomez. Ce général jouissait de la confiance du commandant français
du camp. Il y avait des rumeurs selon lesquelles eux, les trotskystes, seraient
bientôt libérés et enrôlés dans l’armée française. Ici, dans la baraque, ils
étaient prêts à faire des provocations, mais la solidarité et l’action unie de
la majorité des résidents de la baraque les respectaient et les forçaient à
s’abstenir de provocations grossières. Outre les Espagnols, un groupe compact
dans la baraque était représenté par des camarades allemands. Beaucoup d’entre
eux étaient membres du Reichstag et tous étaient des inter-brigadistes. Ils se
distinguaient par leur pureté, leur modestie et leur patience stoïque, avec
lesquelles ils supportaient toutes les extravagances, y compris le vol. Le
camarade Dusan me décrirait plusieurs Yougoslaves.
Dusan et moi avons
parlé directement en croate. J’ai découvert sa vie étudiante à Zagreb et à
Paris, ses parents, professeurs à Ljubljana, et son idéalisme d’abandonner la
vie étudiante et de se sacrifier pour la liberté du peuple espagnol. Il a été
blessé plusieurs fois pendant la guerre, heureusement légèrement. Le premier
soir, il m’a fait part de son admiration pour les combattants espagnols. De
vrais héros, jusqu’à la folie. Ils ne cèdent pas aux dangers même lorsque la
résistance est inutile et sans espoir. Selon Dusan, ce n’était pas le manque de
courage et de volonté de se battre, mais le multilinguisme irresponsable et la
diversité des anarchistes et des trotskystes, ainsi que l’absence d’un parti
communiste expérimenté dans les luttes de classe qui étaient les principales
raisons de la défaite temporaire de la Révolution espagnole.
Dusan m’a vraiment
décrit ses compatriotes.
— Andro, un
Slovène, mon compatriote, n’est pas allé en Espagne ; il a été amené ici
en tant qu’homme politique ; bien que barman, il a été secrétaire de
l’Organisation communiste yougoslave dans la ville minière de Lanz ; très
actif, plein d’abnégation et sensé ; avec une pensée extrêmement sobre sur
les questions politiques. Matić — Croate, menuisier de profession,
inter-brigadiste, communiste depuis la Yougoslavie ; grièvement blessé en
Espagne, portant encore des morceaux de bombe dans la tête, tombe souvent dans
des crises nerveuses, probablement dues à la maladie. Drago — un Monténégrin
qui a quitté le Monténégro à pied et a atteint l’Espagne ; berger dans les
montagnes monténégrines ; il est devenu alphabétisé et en plus en
espagnol ; maintenant il apprend le cyrillique ; il n’est pas
communiste et ne veut pas adhérer au parti ; pendant la guerre, il s’est
montré courageux et discipliné; ici loin de nous, les communistes
yougoslaves ; il a quitté l’Espagne, déçu par l’échec de la lutte ;
mal instruit, il ne comprend pas pourquoi les révolutionnaires ne sont pas
unis ; il est fier du titre d’antifasciste ; il peut imaginer que
c’est une sorte de titre ; dans le camp il souffre, suffoque, il est prêt
à se battre ; il n’obéit à personne ; il a l’intention de fuir à tout
prix et maudit la direction du parti de ne pas permettre les évasions ; il
a du chagrin pour les moutons et les chiens de berger avec lesquels il a vécu
et s’est lié d’amitié... Dans les autres baraques, il y a plus d’une centaine
de Yougoslaves, presque tous des inter-brigadistes...
Le jeune homme
m’écoutait avec beaucoup de patience, car au lieu de quelques lignes, mon
éloquence prosaïque s’enfonçait dans les moindres détails. À Fresnes et à
Roland Garros, j’ai parlé, argumenté, persuadé mes colocataires involontaires,
mais je ne m’étais jamais senti aussi proche d’aucun d’eux, pas même de
l’Algérien Jelul, que de cet étudiant slovène, combattant espagnol. Je
déroulais l’orbe de ma vie devant ce jeune communiste yougoslave que je venais
de rencontrer, et je parlais comme si je parlais à moi-même.
Pour sa part, Dusan
Kveder a ouvert les portes de son âme avec la sincérité et la franchise du
Komsomol. J’y suis entré comme chez moi. Dusan n’avait pas plus de 23-24 ans.
Yeux bleu clair avec un regard brillant et pénétrant, front haut droit et
lisse, cheveux blonds agités. Pendant plus d’un an de cohabitation à la baraque
№ 19, la personnalité de Dusan Kveder s’est épanouie devant mes yeux dans
toute sa splendeur communiste. Il parlait correctement cinq langues étrangères
européennes : français, anglais, espagnol, italien, allemand. Il avait
déjà beaucoup lu, pas seulement de la littérature marxiste, et il continuait à
lire beaucoup. Ses connaissances s’étendaient à divers domaines : sciences
sociales et économiques, philosophie, littérature de toutes les époques et principalement
des nations européennes. Il citait par cœur Homère, Rabindranath Tagore,
Goethe, Hugo, Pouchkine, Lermontov, Dante. Il avait joué du piano dans le temps
et, dans le camp, il savourait souvent les douces courbes de son ocarina. Il
chantait avec un agréable baryton mat des chansons folkloriques yougoslaves,
soviétiques et espagnoles. Il m’a appris, et nous formions souvent tous les
deux un duo, nous chantions notre chanson préférée « Mon romarin, vert...
accroché à la fenêtre... ».
Avec sa culture
large et son attitude tolérante envers les opinions des autres, il était un
interlocuteur agréable. Grâce à ses nerfs solides, son esprit agile et pratique
et son comportement sage, Dusan n’a jamais perturbé l’harmonie de notre
coexistence amicale. C’était agréable de vivre avec un tel colocataire, avec
une personne aussi éthique et dotée de principes[58].
Après Fresnes avec
sa discipline oppressante et Roland Garros où il n’y avait pas de place pour
marcher, le camp du Vernet m’apparaissait comme une cage ouverte et
ensoleillée. Dans la vaste cour et dans les larges allées entre les baraques,
on pouvait se promener librement sous les rayons brûlants du soleil du sud de
la France. Mes yeux se sont réjouis de la plénitude du bleu infini du ciel et
de la silhouette masculine des Pyrénées au fond de l’horizon. Mais en même
temps, mon regard était arrêté par les épais grillages, les baïonnettes des
gardes et les dents acérées des chiens policiers. Ma plus grande consolation
ici, c’étaient les gens, les camarades. Des centaines d’internés de tous âges
et de toutes nationalités, avec toutes sortes de caractères, vous comprenez à
peine leur langue et pourtant dans chacun de leurs regards, dans chacun de
leurs sourires, dans chaque rencontre et parole vous sentez que vous vous
déplacez parmi les membres, les frères d’une grande famille. Chaque camarade
ici est des nôtres. Les idéaux sont communs, la peine est commune, les pensées
sont communes, la foi et la volonté de liberté et de lutte sont communes.
J’ai décidé de profiter
du temps forcé passé dans le camp pour commencer à apprendre l’allemand. Le
groupe de députés du Reichstag logé dans la baraque 19 m’a encouragé. Dusan
aussi. Ils sont tous devenus mes professeurs bénévoles et gratuits. Je me suis
surtout lié d’amitié avec un camarade allemand. C’était un journaliste de Die Rote Fahne, le camarade Georg
Shtibi. En échange des cours d’allemand, je l’ai aidé à mieux maîtriser le
français. Le temps en classe était abondant. Beaucoup d’amis allemands
m’encourageaient avec le succès obtenu. Mais plus tard, ils m’ont fait savoir
que je les embêtais avec mes éternelles questions et mes expressions allemandes
ébréchées. De façon polie, ils m’ont rassuré sur mon vocabulaire riche et m’ont
dit « Genug ! »
(Assez !). Autrement dit, je les avais assez dérangés. Malheureusement,
une autre raison est venue pour rompre temporairement mes amitiés chaleureuses
avec Georg Shtibi, Gerhard Eisler, Franz Dahlem, Heinrich Rau, Friedrich Wolf,
Neumann, Adolf Deter, Paul Metzker, Kraus, Heinemann, Baumgarten et d’autres.
Voilà ce qui s’est passé. Aux premiers jours passés au Vernet, les camarades
allemands se sont intéressés à apprendre ma biographie. Ils m’ont senti proche
surtout à cause de mon amitié avec Zlatan Doudov, un réalisateur et dramaturge
bulgare, qu’ils respectaient beaucoup. Ils ont été ravis d’apprendre ma
participation à sa pièce La Peur,
présentée au Palais de Chaillot, et ma visite dans son appartement de la rue du
Dragon. Ayant reçu une confiance absolue, avec la permission de Franz Dahlem,
secrétaire du comité du parti du camp, Shtibi me fournissait du matériel obtenu
illégalement. Il m’a remis une lettre ouverte de Léon Blum et deux articles,
avec pour auteurs Georgi Dimitrov et André Marty. J’ai reçu le premier matériel
sans objections. Nous l’avons d’abord lu tous les quatre avec Eladio, Dusan et
Ivan Stoichkov, et je l’ai immédiatement transmis à Nikola Popov.
J’ai protesté quand
Shtibi m’a secrètement remis les deux derniers articles. « Il est juste,
ai-je dit à mon nouvel ami allemand, de remettre les documents secrets au chef
du groupe bulgare, que vous connaissez. » Shtibi n’a pas accepté mon
objection et a essayé de me rassurer sur le fait que les considérations de la
direction du parti étaient appropriées : « Ne vous inquiétez pas, la
direction sait ce qu’elle fait. »
Je sentais qu’un
gâchis, un gâchis désagréable se constituait entre nous et autour de moi. Le
gâchis s’est manifesté sans tarder sous la forme la plus inattendue.
La journée était
froide et le soir un fort vent froid soufflait. Les internés, bien qu’ayant le
droit de se promener jusqu’à 22 heures, étaient rentrés dans les baraques. Je
m’étais moi-même enveloppé dans la seule couverture militaire et relisais Colas
Breugnon de Romain Rolland. Mon plaisir à apprécier le langage fleuri et la
philosophie de vie du personnage de Roland a été interrompu par Georg Shtibi.
Il avait à moitié grimpé l’échelle de notre logis et m’a demandé de sortir. Il
avait quelque chose à me dire.
— Cher Georges,
j’ai froid et je me suis laissé aller à une grande paresse. Monte et nous
parlerons. Tous ici sont nos camarades.
— Je suis
désolé, mais nous devons parler en privé.
Je me suis sorti de
sous la fine couverture avec une réticence évidente. Il n’y avait personne dans
la cour. Nous nous sommes arrêtés aux fontaines entre les deux baraques 19 et
18. Shtibi était un camarade grand et fort avec des cheveux bouclés et une voix
métallique. Toute sa silhouette rayonnait généralement d’énergie, de courage,
de joie de vivre. Maintenant, ce grand homme était pâle, sa longue barbe
tremblait et sa voix vibrait comme une ficelle tendue par le vent.
— Où
est l’article ? Donne-moi l’article tout de suite. Maintenant, tout de
suite, je dois le recevoir de toi. Où est l’article ?
Pause. Les questions
et le ton insistant me frappaient comme des gifles policières. Je ne sais pas
si je suis devenu pâle ou si je me suis mordu la lèvre. Je me souviens
seulement m’être appuyé contre le mur extérieur recouvert de plâtre de notre
baraque. Shtibi ne comprenait pas ou ne pouvait pas comprendre comment ses
coups verbaux m’affectaient. Pas étonnant qu’il ait expliqué mon silence comme
si j’avais été pris sur une scène de crime. Peut-être. Bien que pendant
quelques secondes, je n’ai plus senti la boue ramper vers moi, mais un gâchis
m’arroser et m’inonder comme un immense ruisseau. La colère et l’indignation
m’ont rempli et m’ont donné envie de vomir à cause de la provocation calculée.
— Qu’est-il
arrivé? Pourquoi une telle angoisse ? Quelle est cette excitation
inhabituelle en toi, Georges ? ai-je murmuré après quelques efforts.
— Je ne peux
pas répondre. J’exécute un ordre du parti. Je viens à toi au nom de la
direction. On m’a demandé que tu me remettes le matériel immédiatement.
— Les camarades
ne l’ont probablement pas encore lu.
— Ce n’est pas
important. À qui l’as-tu donné ?
— À qui en a
besoin.
— Il s’appelle
comment ? C’est dans quelle baraque ?
— Écoute,
Georges. Je connais les règles de la conspiration. Je ne dis à personne de qui
je reçois les documents. J’ai dit « d’un bon camarade allemand »
qu’une seule fois. Ils voulaient ton nom. Je ne leur ai pas dit. Et à toi aussi
je ne dirai aucun nom.
— Pourquoi tu
ne peux pas le dire ? a souligné Georges.
— Je peux, mais
il ne faut pas. Et tu n’es pas obligé d’insister. Vous m’avez fait confiance,
vous m’avez confié des matériaux. Toute conspiration suppose la confiance entre
camarades.
— Et il y a
ceux qui ne la méritaient pas.
— Que veux-tu
dire ?
— Ce que j’ai
dit. Tu ne méritais pas notre confiance. Tu as remis l’article au commandant du
camp et il se trouve maintenant au Deuxième bureau. Mais j’étais spartakiste et
nous sommes tous des communistes-inter-brigadistes et nous n’avons pas peur des
traîtres et des provocateurs...
Pause à nouveau. Je
n’en croyais pas mes oreilles. Je perdais le fil du cours normal des
événements. Mais j’ai vu, vu de mes propres yeux comment mon
interlocuteur-accusateur tremblait de colère, même des gouttes d’écume
s’envolaient de sa bouche, ses yeux grands ouverts, pétillaient d’étincelles,
un poing se refermait comme s’il s’apprêtait à me frapper. La calomnie
m’appuyait comme une meule. Je respirais difficilement. Je pouvais à peine me
tenir debout et j’ai dû m’appuyer à nouveau contre le mur. Silence froid tout
autour. Affaibli par l’accusation, je ne voyais pas d’issue. Pour la première
fois de ma vie, j’étais la cible d’un soupçon aussi monstrueux. La conscience
de mon innocence absolue m’a donné encore la force de réagir.
— Camarade
Georges, permets-moi de t’appeler ainsi, au moins ce soir, je pense comprendre
ton état et ton inquiétude. Si j’étais à ta place, je serais aussi excité que
toi. Il n’est pas facile de se faire reprocher d’avoir fait confiance en faveur
d’un... disons provocateur.
— Dis-moi, à
qui tu as donné l’article et où est-il maintenant ?
— Ce n’est pas
la peine d’insister sur le nom. Les camarades de la direction peuvent
facilement l’apprendre. Qu’ils demandent à celui qui leur a donné des
informations sur moi. Il sait quand et à qui j’ai donné l’article. Aussi où il
est en ce moment. Et à toi, je vais te dire : l’article est dans le camp,
mais pas entre les mains du commandant français. Je te le rendrai dans dix
minutes. Tu peux m’observer. Je ne quitterai pas le quartier B, et en plus je
n’irai pas au bureau du commandant, qui est à l’extérieur du camp. S’il te
plaît, ne me suis pas dans la baraque où je vais prendre l’article. Soit dit en
passant, la baraque est la № 8, où se trouve Dalem, secrétaire du comité
général du parti du camp ...
— Shtibi
m’attendait à bout de nerfs. Je venais de passer la baraque 7, et il s’est
approché de moi.
— Tu
l’as ?
Je lui tendis le
paquet en silence. Il le déplia nerveusement et dit :
— Il est là. Il
est... Merci... Si je ne l’avais pas retrouvé, la menace était terrible, j’étais
exclu du parti.
Je soupirai
profondément et lui demandai de m’écouter avant de nous séparer.
— Ici au
Vernet, nous sommes abandonnés non pas pour un mois ou deux, mais pour des
années, peut-être jusqu’à la fin de la guerre. Dans le camp, comme dans la
prison, les gens ne peuvent pas se cacher d’eux-mêmes, ni des autres. Au final,
ils dévoilent leur nature, bonne ou mauvaise, de toute façon, ils se
déshabillent et on comprend leur prix... Dis aux camarades de la
direction : je ne suis pas en colère, je comprends qu’ils ne puissent pas
croire en moi, l’étranger pour vous, qu’ils croiront celui qu’ils ont côtoyé. À
partir de maintenant, de dures épreuves commencent pour moi. Je vais essayer de
les surmonter. Je suis communiste et je n’ai pas l’intention de devenir un
autre... Au revoir... Georges. Je ne te dis pas, camarade, pour ne pas
t’offenser qu’un traître prononce cette parole sacrée. — Et j’ai pleuré.
Shtibi, visiblement
ému, put à peine dire :
— On se
reverra... on se saluera...
Oui, on se voyait
dans la cour, pendant les devoirs quotidiens, pendant les promenades, on se
disait « bonjour » et « au revoir », et c’est tout. Pas
seulement avec des camarades allemands. Au bout de deux ou trois jours, presque
tous les internés du quartier B, et beaucoup de Bulgares du quartier C,
m’entouraient d’une froideur qui me transperçait à chaque pas, à chaque regard.
La cellule ensoleillée du Vernet est devenue pour moi une sorte de cachot.
J’étais un étranger parmi les nôtres. Je marchais seul, lisais seul, mangeais
seul. Le soutien moral salvateur m’a été fourni par un certain nombre de
camarades, dont certains me connaissaient de Bulgarie : Nikolai Radoulov,
Ivan Stoichkov, Spas Georgiev. Kadiyata et Boris Savov — Pileto, secrétaire du
parti des Bulgares de tout le camp. Sans leur soutien, j’aurais réalisé
probablement les idées folles d’évasion, de suicide et autres lubies fatales.
Ce n’est que lorsque je fus à Paris en 1941 que j’appris avec une grande joie
que mon nom figurait sur une liste de cadres communistes bulgares du Vernet,
quelle que soit la quarantaine dans laquelle j’étais placé.
Bien sûr, la
principale chose qui me protégeait des démarches imprudentes était mon
implication dans la lutte naissante dans le camp. Peu à peu, le commandement
français a réduit et aggravé la nourriture. La boutique était vide de toute
nourriture. Le régime, la discipline, l’arbitraire policier devenaient de plus
en plus insupportables. La ligne commune du parti appelait à lutter contre la
détérioration des conditions dans le camp. Les occasions ne manquaient pas.
L’intendant du camp était un jeune capitaine qui portait rarement son uniforme
militaire. Il avait acheté à bon prix, même à très bon prix, plus d’une
centaine de wagons de topinambours surgelés au marché toulousain. Une fois
bouillis, ils fondaient et le bouillon devenait aussi sombre que de l’encre. Sa
seule qualité était de gonfler et de réchauffer nos ventres creux. Des farceurs
espagnols ont mis des affiches avec des dessins et des inscriptions écrites
avec la soupe en question : « Eureka. Écrivez avec la nouvelle encre
topinambour Vernet ».
Je faisais partie du
groupe qui recevait les produits pour notre baraque le matin. Personnellement,
le capitaine intendant était présent et regardait combien et quels produits
nous étaient destinés. Nous avons mangé l’encre noire sans se plaindre pendant
plus de dix jours. Quand nous avons appris qu’il nous faudrait en avaler
quatre-vingt-dix wagons de plus, nous avons décidé de réagir. L’honneur
d’exprimer l’indignation devant le capitaine tomba sur moi :
— Nous
insistons pour que vous nous autorisiez à tamiser les pommes une par une. Il y
en a des complètement gelées et pourries. Nous ne les acceptons pas et nous
demandons qu’elles ne soient pas comptabilisées dans le poids qui nous est dû.
— Vous prendrez
la marchandise sans la sélectionner. C’est un ordre !
— Nous ne
sommes pas des soldats, le camp n’est pas une caserne, donc vous vous êtes
trompé d’adresse. Vous donnerez des ordres à vos gens, pas à nous... Camarades,
nous de la baraque 19, nous ne prendrons pas les topinambours pourris. Chacun
décidera pour lui-même et pour sa baraque.
Notre refus n’était
pas un coup de tête du moment ni une réaction nerveuse aux manœuvres du
capitaine et du médecin. Il avait été préalablement réfléchi et coordonné avec
la direction du parti.
Nous, les affamés,
avons eu le courage de renoncer à l’encre noire chaude pendant trois jours. Le
deuxième jour, en guise de sanction, le commandant du camp nous a privés de
notre ration de pain. Une délégation spéciale, composée du Dr Friedrich Wolf,
d’Heinrich Rau, de l’Italien Colombo de la baraque 11, de Boris Milev et
d’autres, a protesté contre la saisie arbitraire de pain. Le troisième jour,
notre pain a de nouveau été délivré. Le quatrième, au lieu de topinambours
pourris, nous avons reçu des betteraves fourragères sous la surveillance du
capitaine penaud. Et ça a fondu pendant la cuisson, mais la soupe était légère
et au goût acceptable...
Pendant ce temps, la
Troisième République française s’est effondrée lamentablement. La réaction
française a clairement préféré ouvrir les portes de la France
bourgeoise-démocratique (13 mai 1940) aux hitlériens plutôt que d’appeler les
démocrates, les antifascistes, les communistes à résister sans relâche aux hordes
fascistes. Pour étouffer la démocratie révolutionnaire, les monopolistes
français ont fait venir Hitler et ont poussé les mains et les pieds de la
France entre les pattes des occupants. Le royaume sombre de Pétain et Laval est
arrivé. Le maréchal Pétain, fort de son autorité de vainqueur de Verdun de la
Première Guerre mondiale, devint le promoteur et prêcheur de la théorie
fasciste du retour à la terre, c’est-à-dire que la France devait renoncer à son
industrie et devenir un appendice agraire de la puissante Allemagne
industrielle. Pierre Laval était fier de travailler avec le
« vainqueur » et s’efforçait d’être un ardent défenseur de l’ordre
nouveau avec sa démagogie d’avocat. Par leurs paroles et leurs actes, ces deux
Français, qui ont piétiné leur nom et leur dignité française, ont couvert le
vol de grand chemin que commettaient les occupants. Le mark allemand était
annoncé coûter 20 francs. Et tous les soldats du Troisième Reich portaient des
marks allemands dans leurs sacs à dos et ballots. Ils venaient en camion devant
un magasin et achetaient « légalement » des centaines et des milliers
de kilogrammes de marchandises et d’articles qu’ils envoyaient vers
l’Allemagne. Ainsi les occupants hitlériens ont vidé la France certainement
riche de cette époque.
Nous, les
prisonniers du Vernet, ressentions très fortement les conséquences de ce vol
organisé : la boutique était fermée ; ils ont réduit la ration de
pain à 120 g par jour ; la viande, pas plus de 100 g, apparaissait dans
nos gobelets une fois par semaine ; le café ressemblait à un jus de
chaussettes, les betteraves fourragères ne remplissaient pas toujours nos
boîtes de conserve. En réponse à la famine systématique, les Italiens ont
commencé à s’offrir les chats qui parcouraient le camp. Les Allemands ont
attaqué les chiens. Les Espagnols ont attrapé les rats, les ont éventrés, les
ont écorchés, les ont crucifiés et les ont rôtis séchés... sur une brochette.
L’histoire du chien
du Vicomte Dubois mérite d’être notée. Le commandant venait habituellement dans
notre quartier, menant un gros chien Saint-Bernard nommé Cléo attaché avec une
chaîne épaisse... Ce gros chien était beau et avait une magnifique peau brune.
Il avait l’air plus heureux que féroce. Son dos arrondi, gras, large de deux
pieds. Même rencontré dans les rues de Paris, ce fauve domestique engraissé
pouvait rendre jaloux un chômeur qui ne soit pas né chien. Et surtout au camp
du Vernet, pendant la période d’une telle famine ! Comment et quand des
camarades allemands ont traqué le chien du vicomte est resté un mystère. Une
fois, le bel Adolf Deter, facteur et ancien membre du Reichstag, m’a
mystérieusement invité dans la cuisine et, avec un sourire encore plus
mystérieux, m’a offert un très gros morceau de viande, que j’ai dû manger sans pain
et rapidement. Je l’ai dévoré, sans me soucier de ses origines. Le lendemain,
j’ai également eu droit à la viande mystérieuse, mais déjà averti de prendre ce
qu’il me restait du maigre morceau de pain. Au bout de deux ou trois jours,
j’ai réalisé d’où venait la viande du festin. Le vicomte lui-même l’a compris,
ainsi que tous les officiers du camp qui ont été informés de la mort peu
glorieuse du chien Cléo. L’histoire est restée lettre morte. L’état-major du
camp a été contraint de devenir sourd et aveugle, car s’il prenait des
sanctions contre les « tueurs », cela reviendrait à reconnaître qu’il
y avait une famine dans le camp. À cette occasion, Adolf Deter a déclaré une de
ses pensées :
— C’est
ce que je veux. Que je sois accusé. Qu’ils intentent un procès contre moi.
Puis, sans avocat, je leur dirai pourquoi nous avons trompé, fait bouillir et
dévoré leur Cléo. Que tout le monde sache ce qui se passe au Vernet.
Soit dit en passant,
il n’y avait pas que des histoires de chiens, de chats et de rats qui se sont
produites au Vernet. Il y avait ici des luttes pour la liberté, la dignité, la
démocratie. Une de ces luttes a été initiée par le chef éminent des communistes
italiens, Luigi Longo, également connu sous le nom de camarade Gallo, l’un des
chefs des brigades internationales en Espagne. Jusque-là, le commandant du camp
nommait les chefs des baraques. Il les choisissait soit parmi les trotskystes
et anarchistes espagnols déclarés, soit au milieu de quelques éléments ayant
déposé les armes. Même par démagogie, le commandant n’avait pas jugé nécessaire
de nommer au moins un communiste à la tête de la baraque du quartier B. Sa
tactique consistait à diviser les internés, à créer des querelles entre eux.
Longo nous a demandé de nous opposer à cette tactique. Sa thèse était
parfaitement valable :
— La majorité
des gens des baraques sont des communistes. Les chefs de baraque actuels
poursuivent la politique du commandant et ne défendent pas nos intérêts. Je
pense qu’il est temps de demander au commandement du camp de faire élire les
chefs par les habitants des baraques eux-mêmes. Ainsi, nous pourrons imposer
plus facilement nos revendications et, en cas de lutte, être plus solidaires.
Le point de vue de
Longo-Gallo a été accueilli avec enthousiasme. Des délégations de toutes les
baraques, conduites par nos camarades, se sont présentées devant les
lieutenants commandant les quartiers. La délégation du quartier B était
composée de Franz Dahlem, Friedrich Wolf, Eladio, Luigi Longo.
À la suite de nos
actions, le colonel — commandant du camp, a accepté de tenir des élections à
des fins expérimentales dans deux baraques — 9 et 19.
Une véritable
campagne électorale a commencé. Cela a duré une dizaine de jours. Pendant ce
temps, les noms des candidats devaient être déposés. Ma surprise et ma joie ont
été sans bornes lorsque j’ai appris que la direction du parti du camp m’avait
nommé pour notre baraque № 19 et Luigi Longo pour la baraque № 9.
La nouvelle m’a été apportée par Georg Shtibi. Il était presque aussi heureux
que moi.
— Cher Boris,
fin de l’isolement. La direction témoigne sa grande confiance en toi. Toutes
mes félicitations.
Je l’ai remercié
avec enthousiasme et lui ai demandé de transmettre ma profonde gratitude au
comité du parti.
Le chef de notre
baraque était le général de l’armée catalane Gomez, célèbre anarchiste et
trotskyste. Près de 50 ans, taille moyenne, avec un visage maigre de couleur
sable et de très petits yeux verts rétrécis. Le seul Espagnol de la baraque il
dormait en pyjama et se rasait tous les jours. Il recevait souvent des visites
de l’extérieur et recevait de solides colis de nourriture, qu’il partageait
avec un groupe d’amis personnels. Il parlait peu et montrait de l’arrogance
vis-à-vis de tout le monde dans la baraque. Il jouissait d’une grande autorité
parmi ses partisans. Il évitait la polémique, contrairement à ses compatriotes
qui ne cessaient d’analyser les raisons de la défaite de la République
espagnole. Il ne cachait pas ses relations avec les officiers du camp, mais il
les soulignait, comme s’il en était fier.
Le général Gomez
s’est également présenté. Les occupants de la baraque № 19 étaient
confrontés à deux candidats : un général célèbre et un communiste inconnu.
Mais comme la majorité des occupants de la baraque était aussi communiste, la
force de ma candidature était justement mon affiliation communiste. Le rapport
de force était clairement en ma faveur. Le commandant vicomte ne s’est pas gêné
pour menacer mes partisans éventuels de la détérioration de leur situation dans
le camp s’ils votaient pour moi, ce qui prouverait qu’ils sont avec les
communistes, c’est-à-dire avec les ennemis de la France. La manœuvre n’était
pas profonde. Elle s’est brisée comme une bulle de savon dans la maturité
politique des combattants de la baraque № 19. Infructueux sur le plan
politique, il a transféré ses attaques contre moi personnellement. Il a laissé
entendre que je n’étais pas un combattant, que ce serait une humiliation pour
la baraque, qui comptait des officiers supérieurs, de tolérer à sa tête un
interné qui n’avait même pas servi comme soldat. Gomez me tuait de manière
démonstrative avec ses regards méprisants, ne daignait pas m’accorder un mot et
me calomniait en tant qu’agent provocateur, aventurier et pervers des bordels
parisiens. Toute cette campagne boueuse n’a pas ébranlé nos camarades. Ils
m’ont défendu en tant que communiste évadé de la prison centrale de Sofia et en
tant qu’émigrant politique persécuté par les autorités françaises. Certains
d’entre eux ont utilisé des arguments étranges. Dans sa langue espagnole, le
jeune homme de Pologne passionné, le mineur Kubatski, dont les cheveux
luxuriants évoquaient l’image de champs de blé mûrs se balançant dans le vent,
m’a défendu, par exemple, comme suit :
— Vous,
qui ne savez pas qui est le compañero
Boris, taisez-vous. Et ne me faites pas décrire sa vie de A à Z. Il suffit de
vous dire qu’il est du peuple de Georgi Dimitrov. Bulgare,
comprenez-vous ? Ensuite, le parti l’a approuvé tandis que votre général
boit son café avec le commandant fasciste. Je suis pour Borkata, pour les
Bulgares, pour qu’on ait un chef de baraque, pas une putain de général.
La lutte a continué.
Les camarades Dalem et Luigi Longo m’ont conseillé de ne pas me disputer avec
mon rival ou ses partisans. Il y avait certains camarades pour veiller au bon
déroulement de la campagne et au succès de l’élection.
Dès le lendemain
matin de l’élection, j’ai découvert la responsabilité et la complexité de mon
nouveau poste. Je sifflais à 7 heures pour le lever, à 8 heures pour le petit
déjeuner, je répartissais les groupes pour la nourriture, pour l’hygiène du
camp et de la baraque, j’écoutais les demandes individuelles des occupants de
la baraque, j’intervenais devant le commandement du camp, je réglais les
conflits de place sur les étages de la baraque, puis, avec l’afflux de nouveaux
internés du camp de concentration, il y en avait trois, c’est-à-dire que nous
avons commencé à loger les nouveaux arrivants directement sur le sol sous le
premier étage. Nous, les occupants des deux étages supérieurs, n’étions pas
bien, nous dormions presque sur les planches, car il n’y avait pas toujours
assez de paille, mais ceux du parterre se sentaient à juste titre extrêmement
mal. En bas, l’humidité du sol et des fondations en pierre de la baraque les
pompaient, une faible lumière pénétrant à peine dans leurs logis même pendant
la journée, bref, ils étaient vraiment les plus malheureux.
Les internés des
camps de concentration étaient invités par une délégation hitlérienne venue
spécialement à aller travailler en Allemagne. Ils ont refusé de répondre à
l’appel à devenir une force de travail dans l’industrie militaire allemande. Et
dans la situation où la nourriture dans le camp diminuait de façon
catastrophique. Les officiers français ne cachaient pas leur satisfaction face
à notre antifascisme obstiné. En tant que chef, j’ai décidé de profiter des
circonstances favorables. Je me suis présenté devant le lieutenant Detilleul,
commandant du quartier B, et j’ai commencé :
— Vous avez
constaté hier l’échec de la mission allemande ?
— Je ne
m’attendais pas à un tel revers.
— À noter que
les internés refusent uniquement pour des raisons idéologiques. Parce que quand
il s’agit de savoir où nous serons matériellement mieux — en Allemagne ou au
Vernet, vous admettrez que la situation ici s’aggrave de jour en jour. Et
pourtant... les gens ont refusé de renforcer la machine militaire
hitlérienne... Il me semble... j’ai une idée... je pense que cela vaut la peine
de réfléchir sur la question de savoir : si les internés du camp décident
de se procurer avec leur propre argent des denrées alimentaires des marchés des
villes voisines, est-ce que le commandement du camp donnerait son aval ?
Bien sûr, nous sélectionnerons des personnes qui ne s’enfuiront pas pour ne pas
compromettre le commandant. Et pour vous, en tant que Français, ce sera un vrai
geste, quelque chose comme une récompense pour nous qui refusons de renforcer
vos occupants.
Moins de deux jours
plus tard, le permis était obtenu. Sous ma responsabilité personnelle, j’ai
présenté à Detilleul le groupe qui sortirait du camp. La plupart d’entre eux
étaient des Bulgares, dont j’étais absolument sûr. Mais j’ai emmené Dusan et
Eladio avec moi. Ils nous ont donné un camion pour nous emmener à la ville de
Pamiers. Un garde du nom de Napoléon nous a accompagnés et nous a soûlés avec
ses histoires idiotes et ses idées perverses sur le cours des événements dans
la France occupée.
Les expéditions de
marché se sont poursuivies au premier trimestre de 1941. Mais fin mars et début
avril, il ne restait plus que des céréales sur les marchés de Pamiers et de
Foix. Dernièrement, nous avons acheté du blé, de l’avoine, de l’orge, du seigle
et nous sommes arrivés à la fin à chercher même de la nielle des blés. Pendant
cette période, des intendants allemands parcouraient la zone dite libre de la
France et balayaient tout ce qu’ils trouvaient dans les magasins, les
entrepôts, les granges, les caves. Ils ne se souciaient pas des prix car ils
payaient avec des billets en papier.
À cette époque,
notre camp reçut la visite d’un représentant de la légation bulgare à Vichy. Il
nous énonça sa tâche : dresser une liste de citoyens bulgares afin de
demander aux autorités françaises de les envoyer en Bulgarie. Il a expliqué
qu’il ne nous suffisait pas personnellement de vouloir revenir. L’important
était que la police bulgare nous permette d’entrer en Bulgarie. Ce diplomate a
fait en sorte que les interrogatoires aient lieu non pas au camp, mais à
Pamiers. Un camion spécial emmenait 7 à 8 personnes chaque matin. Cela a
commencé avec les camarades du quartier C, où les Bulgares étaient les plus
nombreux. Le tour de notre groupe du district B est arrivé. Il comprenait le
mécanicien Nikolai Radoulov. En tant que vieille connaissance, il m’a confié son
intention de s’évader. Il savait comment se rendre à Toulouse. Là, un camarade
surnommé Gandhi l’aiderait à se rendre à Paris. Il m’a demandé mon avis. Je lui
ai donné mon avis dans le plus grand secret. Je me souviens lui avoir conseillé
de ne pas parler lorsqu’il était dans le camion, car son beau français sans
accent attirerait l’attention des gardes naïfs ; s’habiller non pas avec
sa veste en cuir, son pantalon et son pardessus, mais avec les vêtements les
plus ordinaires.
Sur le chemin,
Nikolai n’a pas dit un mot, il somnolait béatement dans l’un des coins du
camion, couvrant son visage aux joues rouges de sa main. Non seulement à cause
de l’excitation, mais aussi à cause des doubles pantalons et des triples
chemises qu’il portait, il transpirait et s’essuyait le visage, le front et le
cou d’un air endormi.
L’employé de la
légation conduisait les discussions dans le bâtiment d’une des écoles primaires
de la ville. Dans le couloir du deuxième étage, il y avait un long banc sur
lequel nous nous étions assis — interrogés ou attendant de l’être. Le monsieur
faisait son travail très consciencieusement. Il gardait chacun de nous pendant
au moins 20 à 30 minutes, et parfois plus. Pendant ce temps, nous nous
promenions, nous fumions, nous parlions, nous nous asseyions et nous nous
levions du banc, en général... nous attendions. L’un de nous a demandé à être
emmené aux toilettes. D’autres l’ont rejoint. L’un des gardes les a escortés
jusqu’à l’urinoir sur le trottoir opposé dans la rue. Alors que le premier
groupe était déjà en bas, après avoir échangé des regards avec Nikolai, j’ai
demandé au gardien dans le couloir de permettre à ce camarade, qui ne savait
pas le français, de rattraper le groupe. Le garde hocha la tête. En bulgare,
j’ai chuchoté à Nikolai : « Tu peux essayer. » Il a essayé, pris
des risques et réussi.
L’évasion de Nikolai
nous a tenus en alerte pendant plus de deux semaines, tandis que par
l’intermédiaire de l’ingénieur Atanas Bratanov du quartier C, nous avons reçu
le mot de passe que les femmes toulousaines étaient très belles et...
agressives. L’écho de la fuite du Bulgare, cependant, s’éteignit bientôt. Mais
une autre évasion suscita de longs commentaires et des retentissements.
Officiers, gardes et internés parlèrent longuement de lui. Le héros était notre
Drago monténégrin.
Belle journée de
mars. Les rayons du soleil faisaient fondre les corps froids et affamés des
internés du camp de concentration, qui sont retournés à contrecœur aux baraques
pour le repos de l’après-midi. En tant que chef de baraque, j’ai regardé tout
le monde entrer dans ses logis jusqu’à 2 heures. Le dernier que j’ai convié
était Drago. Il se promenait dans la cour entre les deux rangées de baraques.
Sa tenue était plus que misérable : un manteau de soldat gris court et en
lambeaux, un chapeau militaire usé avec une visière noire et des espadrilles
françaises, une chemise à motifs, débraillée et usée. Son visage était pâle,
émacié, avec des mâchoires très saillantes. Comme d’habitude, ses yeux
pétillaient. Drago m’a répondu d’un ton brusque qu’il connaissait l’emplacement
de la baraque et savait quoi faire. Un peu surpris par cela, j’ai essayé de lui
rappeler avec attention que les gardes vérifiaient si nous étions rentrés à
temps, et que nous, de la baraque 19, devions être particulièrement disciplinés
pour éviter toutes sortes de provocations. Avec une colère à peine contenue,
Drago me regarda et me dit presque autoritairement :
— Va, Bulgare,
dans ta tanière. Dors et sois sage... pour l’amour de Dieu.
Je connaissais le
caractère particulier de ce jeune et bruyant Balkanique. Je n’ai pas protesté
et je suis retourné respectueusement dans ma baraque.
Il y avait un
silence relatif à l’intérieur. Ceux des occupants qui ne dormaient pas,
lisaient, reprisaient ou écrivaient. Soudain, il y eut des coups de feu dehors,
suivis d’aboiements de chiens. Tous dans la baraque ont frémi. Nous avons
attendu en silence pendant une minute ou deux. La voix d’Adolf Detter se fit
entendre dans le silence :
— La meilleure
chose à faire est de rester ici. Que seul le responsable de la baraque aille
voir ce qui se passe à l’extérieur.
Je suis sorti le
premier, mais bientôt les têtes de Deter, Dusan, Machado, Kubatski et d’autres
sont apparues à la porte de la baraque. L’image suivante s’est déroulée sous
nos yeux. Deux gardes allongés sur la route tiraient sur un détenu du camp qui
fuyait de toutes ses forces à travers le champ vers la ligne de chemin de fer à
proximité. De la porte principale du camp, un groupe de gardes se précipitait
pour prendre en chasse le fugitif. Le train de voyageurs qui passait à ce
moment ralentissait. Des mains et des serviettes s’agitaient des fenêtres des
wagons. Drago, parce que c’était justement notre Drago, s’approchait déjà du
train, mais à une vngtaine d’enjambées de la ligne de chemin de fer, trois ou
quatre gros chiens policiers l’avaient déjà rattrapé et lui barraient le
passage vers les wagons. Les gardes couraient à travers champ et tiraient.
Drago se défendait des chiens, agitant son manteau dans toutes les directions.
Mais soudain, il tomba ou s’agenouilla, entouré de chiens qui n’arrêtaient pas
d’aboyer et de l’attaquer. Le train s’arrêta complètement. Les policiers ont
rattrapé Drago, certains dispersaient les chiens, d’autres lui tapaient dessus
avec leurs crosses. Les passagers du train sifflaient d’indignation. Ils ont
été rejoints par de nombreux internés du quartier C, debout à côté des
grillages le long de la route. De nombreux occupants de notre quartier étaient
déjà sortis et protestaient eux aussi. Les gardes conduisaient Drago vers
l’entrée principale du camp, suivis de la meute de chiens. Au début, nous avons
tous supposé que, dans son désespoir, Drago avait réussi à détaler devant le
garde à l’entrée principale, traversé la route, tenté de rattraper et monter
dans le train en mouvement. Le seul témoin de l’évasion était le Russe Yosif,
grand collectionneur de timbres et d’enveloppes du front. Il est sorti de la
baraque № 6 pour aller aux toilettes au milieu de la cour. Il nous a dit
ce qu’il avait vu de ses propres yeux.
— Je regardai
un détenu se mettre à courir à environ 50 mètres des barbelés. Je pensais qu’il
s’arrêterait là. J’étais ahuri de le voir sauter sur les filets et sauter
par-dessus les cinq rangées de grillages de piquet en piquet comme une vraie
chèvre. J’ai fermé les yeux avec mes mains parce que j’étais sûr qu’à un moment
il allait s’étaler crucifié sur les piquants aiguisés. Quand j’ai ouvert les
yeux, oh, miracle ! Il traversait déjà la route. À ce moment, le soldat de
la tour de gauche a commencé à tirer le premier. Les chiens ont couru après le
fou. Car, camarades, ce que j’ai vu de mes propres yeux, je le considère comme
une folie, une grande folie inaccessible.
Pas une centaine,
mais des centaines de fois devant des centaines de personnes, Yosif dut répéter
dans différentes versions ce qu’il avait vu. Certains le croyaient et d’autres
contestaient, d’autres l’accusaient d’hallucinations en plein jour. Une chose
était indiscutable : Drago avait effectivement sauté par-dessus les grillages
au prix de sa vie, il avait voulu sauter dans le train qui passait, mais les
chiens policiers avaient déjoué son exploit...
Des événements ont
rapidement suivi qui ont révélé la cruauté et la brutalité du régime du camp
dans toute sa nudité. Un matin, les groupes des aliments ont accepté la ration
de viande tant attendue, les yeux consciemment fermés ; ils gardaient le
silence tout en constatant que la viande était gangrenée par endroits. N’ayant
pas vu de viande dans leurs gobelets depuis longtemps, ils ont accepté de se
débarrasser en partie de la gangrène pour ne pas perdre même les maigres
portions de viande. Leur geste n’a pas été bien compris. Au bout d’une journée,
la générosité de l’intendant s’est de nouveau manifestée. Mais cette fois-ci les
parties gangrenées étaient plus nombreuses que les parties saines. Les
responsables de l’alimentation, y compris les chefs de baraque, se sont
disputés avec l’intendant. Ils ont catégoriquement refusé les rations de
viande. Monsieur l’intendant a essayé de se cacher derrière l’autorité du
médecin du camp.
— Gangrène,
dites-vous. C’est vrai. Mais voici monsieur le docteur. Laissez-le vous dire si
le fait de manger cette viande présente un danger.
Le médecin présent
était bien intervenu, mais son intervention ressemblait plus à une tournure
d’avocat qu’à une argumentation de médecin.
— La viande est
gangrenée. Cela est évident. Mais d’un point de vue médical, une fois bien
cuite ou bien grillée, elle ne présente aucun danger. Nous, dans la cantine des
officiers, nous en mangeons aussi. Bien sûr, ce n’est pas agréable à l’œil ni
au goût, mais la rareté à l’extérieur est grande, et ici pour vous c’est encore
plus aigu, alors je vous conseille de ne pas refuser la ration.
Les assurances, les
sortilèges et l’éloquence des deux militaires furent vains. Les internés ont
tenu bon. Ils ont accepté le pain et les légumes verts, mais ont refusé la
viande.
Le lendemain, le
capitaine intendant a refusé aux internés le droit de contrôler le poids des
rations. Les contrôleurs des baraques 47 et 48 du quartier C ont vigoureusement
protesté contre l’arbitraire. En réponse, le capitaine les a punis de trois
jours de cachot, ce qui a provoqué une indignation générale des groupes
alimentaires. Il n’osa pas arrêter ses camarades sur-le-champ. Il crut prudent
de les faire sortir de leurs baraques. Mais quand ils les ont cherchés dans le
quartier, ils s’étaient dilués et évaporés comme de la fumée dans la masse des
milliers d’internés. Le lendemain matin, l’intendant n’a pas donné de nourriture
aux deux baraques, puis à tout le quartier sous prétexte de remettre les
contrôleurs pour qu’ils purgent leur peine. Tout le camp était ému par la
provocation policière prévue. Les internés du camp étaient bien conscients que
les forces entre eux et l’administration du camp étaient mises à l’épreuve.
Mais on ne pouvait maintenir le statu quo au prix d’une trahison des camarades.
L’unanimité était complète dans les deux quartiers C et B — mieux valaient la
faim et le combat avec toutes leurs conséquences que la trahison et la
capitulation. La solidarité entre les deux quartiers est née immédiatement et
spontanément. Des misérables miettes de pain (120 g), les camarades du quartier
B en réservaient la moitié à leurs frères du quartier voisin. La résistance de
la faim a duré trois jours. Sans défaillance, personne ne s’est incliné,
personne n’a supplié l’ennemi pour une miette de pain ! Informés par le
parti, les Français et les Françaises formèrent des délégations auprès du
préfet et du commandant de la garnison militaire de Toulouse. Les délégués ont
déclaré qu’ils étaient sérieusement préoccupés par la situation dans le camp du
Vernet, où des milliers de personnes mouraient de faim. Au lieu d’écouter la
voix de la raison, les autorités civiles et militaires de Toulouse et du camp
tombèrent dans une rage aveugle et décidèrent de briser par la force l’héroïque
et digne résistance. Selon un plan préétabli, le quatrième jour, ils
renforcèrent la garde du camp, augmentèrent le nombre de mitrailleuses, apportèrent
même deux canons de campagne et encerclèrent le camp avec des soldats de la
garnison toulousaine. Vers 17 heures, une forte unité militaire, dirigée par le
colonel du camp, accompagné de son état-major et d’un important cortège de
policiers civils, s’est dirigée vers la porte grillagée du quartier C, fermée
depuis trois jours. Fusils et revolvers au poing, tout le groupe s’est dirigé
vers les 47e et 48e baraques. Leurs intentions étaient tout à fait
transparentes — arrêter leurs occupants, tous des inter-brigadistes, et ainsi
vaincre l’unité et la résistance de masse. Avertis qu’un groupe armé
envahissait le quartier, les internés ont commencé leur protestation avant que
les soldats n’atteignent les baraques désignées. Des civils, des officiers, des
gardes et des soldats se sont rués sur les internés et ont chassé les
manifestants et ceux qui protestaient jusqu’aux baraques avec leurs crosses,
des pistolets et des coups de feu en l’air. Ceux qui ont été atteints, étaient
brutalement battus et piétinés, beaucoup ont été immédiatement emmenés à la
porte d’entrée du quartier. Ils ont également tiré sur des camarades du
quartier B, qui sont sortis et se sont accrochés au mur grillagé entre les deux
quartiers. Des cris, des hurlements et des huées provenaient des baraques du
quartier C. Des soldats, des gardes et des civils sortaient par la force des
groupes d’internés de chaque baraque. Au même moment, une autre unité militaire
envahissait le quartier B, des groupes de gardes et de civils menés par des officiers,
dont Dubois et Detilleul, que nous connaissions, et le garde Napoléon.
Des policiers, des
soldats et des officiers enivrés et tonitruants ont pris d’assaut toutes les
baraques. Aux cris de « Voleurs, criminels, nous allons vous montrer qui
nous sommes », ils se sont jetés sur les internés avec des crosses, des
pistolets, des matraques et ont frappé brutalement et sans discernement. Leur
vandalisme n’a pas effrayé la masse désarmée. Nous avons tous réagi et protesté
à notre manière. Des cris ont retenti contre leur barbarie. « À bas les
fascistes de Vichy ! À bas les collaborateurs de la Gestapo ! »
Le commandant
vicomte Dubois a mis fin à l’action répressive dans la baraque 19. Tout rouge
et son chapeau légèrement incliné vers l’arrière, il entra avec une liste à la
main. Il n’appela que deux noms : Vasil Kovaliov et Boris Milev. Le
commandant ordonna :
— Ceux qui ont
entendu leurs noms, venez me voir !
Dans le silence qui
suivit, je ne fis que quelques pas sans m’approcher de monsieur Dubois.
Kovaliov partit du fond de la longue baraque d’un pas parfaitement calme. Un
groupe de civils nous attendait dehors, en nous donnant des coups de pied et de
poing ils nous sortirent du quartier B. Devant nous et derrière nous, des
gardes et des agents, enragés par les bagarres, ont exercé leur force physique,
frappant à coups de matraque le dos et la tête des internés qui protestaient.
Nous avons été poussés dans l’un des bureaux des officiers. Là, les gardes
avaient formé un « tunnel » sous lequel nous passions tous plus ou
moins marqués par les coups de crosse, de pistolet et de poing. Avant que nous
regardions où nous étions et qui nous étions, ils ont commencé à nous appeler
un par un dans le bureau voisin. Là, il y avait un soi-disant tribunal
militaire. Avant « l’interrogatoire » ou « l’enquête », des
agents civils alignés à la porte et aux murs avec des coups de poing et de pied
transféraient les hommes d’une main à d’autres mains comme un ballon de
football. Après que le jeu ait préparé psychologiquement la victime, le
sauveteur-enquêteur, assis derrière une table sur laquelle des dossiers étaient
éparpillés, intervenait.
— S’il vous
plaît, messieurs, arrêtez. Il est possible que le monsieur soit innocent ou
prêt à se repentir de sa passion... S’il vous plaît, votre nom...
Et ainsi de suite et
ainsi de suite. Pendant 5-10 minutes. La raillerie de l’enquêteur était cynique
et absurde. Il nous accusait d’être les meneurs de « l’émeute dans le
camp », de menacer leurs camarades de « disparition », de meurtre,
s’ils n’acceptaient pas la rébellion et la révolution. Le « numéro »
s’est déroulé un peu différemment avec moi. Dès qu’ils m’ont emmené dans la
salle d’interrogatoire, des dizaines de coups ont plu sur ma tête, auxquels
j’ai répondu par la même chose, frappant selon ma force. À mon insu, j’ai
attrapé l’un des agents par la tête et lui ai tordu le cou pour qu’il
gémisse : « Au secours ! » L’enquêteur a rejoué son numéro
de sauveteur, mais cette fois il a sauvé un de ses chiens qui couinait sous mon
bras. Puis il s’est tourné vers moi d’un ton plutôt fâché :
— Souvenez-vous
de ce que je vais vous dire. La révolution que vous avez prévu d’amorcer au
Vernet a échoué. Nous l’avons étranglée dans son ventre. Ceux qui sont à
l’extérieur attendront en vain votre signal rouge. Nous vous condamnerons et
vous disperserons dans les prisons pour que personne ne marche sur vos traces.
Non seulement
c’était inutile, mais c’était insensé d’objecter. Ils m’ont emmené. À ce
moment, j’ai regardé autour de moi et j’ai vu qui étaient mes camarades de
destin en plus de Kovaliov. Les Italiens Nicola, Alberganti, Colombo, Eugenio,
le Portugais Santos, les Allemands Franz Dahlem, Heinrich Rau, Gerhard Eisler,
le Yougoslave Sergei Dimitrievich, le Polonais Bronstein, l’inter-brigadiste Shimon
et d’autres dont je ne me souviens pas les noms, en tout 15-16 personnes du
quartier B.
Toute personne
revenant de l’enquêteur était forcée par deux gardes à faire face au mur et à
lever les mains. Dans cet état, nous écoutions ce qui se passait dans la cour
et dans les bureaux voisins. Là, le harcèlement continuait contre les camarades
du quartier C. Des gémissements douloureux, des cris stridents, des
protestations audacieuses, des indignations justes nous parvenaient. On
entendait le plus souvent la chose terrible : « Assassins,
fascistes ! » Parmi ceux amenés du quartier C, se démarquaient le
général yougoslave Ilitch, l’Allemand Neumann, l’ingénieur bulgare Atanas
Bratanov et de nombreux autres inter-brigadistes. Les coups ne se sont calmés
que vers une heure du matin. Nous ne pouvions même pas penser au sommeil. Nous
sommes restés immobiles, les bras tendus vers le haut pendant 14 heures,
jusqu’au matin. Pendant ce temps, beaucoup d’entre nous risquaient de tomber.
Le plus âgé d’entre nous était l’italien Nicola, un vieux syndicaliste aux
cheveux blancs, fondateur du parti communiste italien, aimé et respecté de tous
les internés. Contre sa volonté, j’ai osé demander au garde de faire une
exception pour lui, lui permettre de retirer ses mains pendant au moins
quelques minutes et lui permettre d’aller aux toilettes. Le gardien a rejeté ma
demande très froidement et m’a averti de ne pas ouvrir la bouche même si un
incendie se déclarait. À un moment, Nicola m’a chuchoté : « Ils ont
dépassé Mussolini avec l’huile de ricin. »
Le matin, ils ont
appelé Franz Dahlem. Il est revenu après une conversation d’une heure avec le
commandant du camp. Il nous a raconté comment s’était déroulée la conversation.
Son interlocuteur n’était pas très intelligent. Il affirmait par exemple très
sérieusement que nous voulions déclencher une révolution dans tout le sud de la
France et que l’insurrection éclaterait d’abord au Vernet. Il lui a demandé de
conseiller les camarades du quartier C de remettre les contrôleurs recherchés,
en échange de quoi il donnait sa parole d’officier de mettre fin aux poursuites
contre les détenus. Dahlem lui a donné une réponse digne :
— Augmentez et
améliorez la nourriture, libérez les arrêtés et alors vous n’aurez plus besoin
de voir le début de la révolution où il n’y a que la fin de la longue patience
de milliers d’antifascistes menacés de famine.
À midi, Dahlem a été
de nouveau sorti et ramené dans sa baraque. Le commandant voulait éviter que
l’on écrive que le collègue d’Ernst Thelmann et la personne de renommée
internationale Franz Dahlem avaient été jetés au cachot au camp du Vernet. Les
autres nous avons été poussés dans le cachot. Il y avait des cellules séparées,
mais elles étaient toutes remplies de criminels du quartier A. Nous étions enfermés
dans une pièce avec des lits de bois des deux côtés, avec un sol en ciment, au
milieu duquel l’eau coulait 24 heures sur 24 dans un caniveau, qui nous servait
à nous débarrasser de toutes les saletés et ordures. Nous y avons trouvé
plusieurs habitants du quartier A.
Pour les camarades
du quartier C, ils ont aménagé un semblant de procès. Ils ont été envoyés
purger leurs peines de 15 jours à 3 mois à la maison d’arrêt de la ville de
Foix. Parmi eux se trouvaient notre bulgare Atanas Bratanov, le général
yougoslave Ilitch, l’allemand Neumann et bien d’autres.
Jetés sans jugement
ni condamnation, nous nous étouffions dans le cachot. Nous n’avions droit à
aucune promenade. Ils ne nous ont pas permis d’envoyer ou de recevoir des
lettres de nos proches. Toutes les visites de l’extérieur ont été interrompues,
même celles des avocats. Ils ont refusé de soigner les malades.
La population du
cachot se distinguait par sa diversité. Les politiques étaient relativement
mieux habillés et, avec un esprit fort, ils résistaient mieux aux difficultés
meurtrières du régime carcéral. Heinrich Rau, Friedrich Wolf, Alberganti et
Nicola notamment montraient une étonnante vitalité. Rau et Wolf s’entraînaient
chaque matin avec des mouvements lents. Alberganti et Nicola marchaient aussi
lentement, comme dans une cage de loup. Shimon montrait son habileté à
fabriquer de magnifiques chaînes de montre avec des fils de différentes
couleurs et une bobine en bois avec 6 clous à une extrémité.
De nombreuses autres
images ont été observées dans ce cachot. Tous les jours de 13 h à 14 h, nous
devions tous nettoyer nos affaires : vêtements d’extérieur et
sous-vêtements, chapeaux, chaussettes, chaussures, cahiers et autres. Le Dr
Wolf, remarquant l’abondance envahissante de poux, nous a entretenus sur le
danger d’être infectés par le typhus. Nous avons accepté son offre de nous
occuper seuls de la calamité parasitaire qui nous menaçait, en organisant un
massacre chaque jour. Notre cruauté n’a pas été particulièrement récompensée.
Pendant une heure ou deux nous avons vécu dans l’illusion que le massacre était
total, mais aussitôt après nous avons découvert des dizaines et des centaines
de spécimens de la famille inépuisable des poux... Le plus diligent de tous
dans l’extermination des invités insolents était le Portugais Pereira du
quartier A. De profession artisan de plafonds en plâtre, il eut autrefois des
comptes en suspens dans la ville de Bordeaux. Il fut accusé du meurtre du
séducteur de sa femme, mais il résista aux épreuves physiques dans les
souterrains de la police et fut acquitté. Il ne pouvait pas oublier le faux
témoignage d’un policier. Après avoir été libéré de sa détention provisoire, il
a attendu le policier en question et lui a rendu la pareille en le frappant
rudement. Pereira a payé cher sa vengeance — cinq ans de prison ferme.
De petite taille,
les yeux noirs brillants, les lèvres pincées, les cheveux ébouriffés et pâle
comme un cadavre, l’artisan plâtrier était assis toute la journée sur le sol en
ciment, blotti contre le mur près du caniveau. Il ne parlait presque à
personne. Il passait son temps à combattre les bestioles.
Connaissant la
triste histoire de sa vie, habitué à ses mouvements monotones et à sa place
constante, je l’ai en quelque sorte détourné de mon attention. Il y avait
tellement de types intéressants à observer, de conversations curieuses et
instructives à avoir, tellement de choses à méditer ! Ma surprise et mon
horreur ont été terriblement grandes lorsqu’un jour j’ai été témoin d’un
spectacle sans précédent - le pauvre ouvrier portugais du district criminel A
attrapait ses poux, les tuait et... les avalait. Je n’en croyais pas mes
yeux ! Je me suis penché derrière le dos d’un camarade et je regardais
discrètement. Cinquante minutes ! C’est un fait ! L’homme mangeait
ses propres poux. Je ne pouvais pas attendre et j’ai partagé mon excitation
avec le vieux prisonnier italien Nicola. Il m’a dit :
— Pereira
s’imagine qu’il va mourir de faim. Il raisonne comme ça : ils boivent mon
propre sang, pourquoi est-ce que je ne le récupérerais pas à mon tour ?
Le mois de cachot se
termina. Ils nous ont ramenés aux baraques. Nous avons trouvé des changements
majeurs. Une partie des Bulgares était transférée au camp Des Milles près de
Marseille pour être rapatriée de là en Bulgarie. Des centaines d’Espagnols et
de nombreux Allemands ont été emmenés en Algérie et au Maroc pour être
transférés au Mexique et aux États-Unis. J’ai retrouvé Dusan et Ivan Stoichkov
dans notre logis. Eladio était parti. Gerhard Eisler et d’autres camarades
allemands avaient également pris le chemin de l’Amérique. La baraque était
presque vide. Le général trotskiste avait repris la place de chef.
Le même jour, Dusan
m’a dit que Dalem voulait me voir. Je suis allé à la baraque 8. J’y ai trouvé
le secrétaire du parti, entouré de cinq ou six camarades de nationalités
différentes. Ils m’ont félicité pour ma libération du cachot et m’ont informé
qu’ils me cooptaient comme membre du comité général du parti du camp qui
s’était réuni à ce moment-là. Le secrétaire a parlé de la situation
internationale, du déroulement de la guerre et des activités dans le camp. Il a
critiqué le refus criminel des dirigeants de Vichy d’utiliser notre volonté
antifasciste de combattre, a exposé les perspectives du camp — la famine — et a
expliqué la position de la direction du parti de « liquider » Vernet
indirectement : certains camarades à rapatrier, d’autres à aller en
Amérique, le reste — la majorité — à accepter d’aller travailler en Allemagne.
Leur devoir suprême doit être de faire tout leur possible pour atteindre leurs
pays et d’unir leurs forces dans les rangs des unités des partisans. Il a cité
l’exemple de Luigi Longo[59], qui
a réussi à s’enfuir en se rendant en Italie et qui est aujourd’hui à la tête de
la Résistance italienne.
J’appartenais au
groupe des rapatriés. J’ai fait les démarches appropriées auprès de la
direction. Elle a promis d’examiner ma demande. À la façon dont le lieutenant
Detilleul m’a reçu et renvoyé, il était clair qu’il profiterait de ma demande
pour se débarrasser de moi au plus vite. Entre nous, j’avais aussi envie de
m’éloigner de son regard perçant et haineux et de son sourire satanique. Plus
d’un mois s’est passé pour obtenir une réponse. Pendant ce temps, mon camp
s’est découvert sous un aspect nouveau, sans précédent. Avant des milliers
d’internés, maintenant il n’en restait que des centaines. Dans la baraque 19,
au lieu des quelques 200 occupants bruyants, seule une vingtaine de personnes
se profilait. On n’entendait pas le baryton dense de l’ouvrier boucher Machado,
qui chantait ses chansons préférées Los
Cuatro Generales et Jogos Verdes,
avec admiration ; Dusan et moi étions également réticents à chanter notre Rosemariné, moi zeleni avec
enthousiasme, mais nous le fredonnions de temps en temps. Seul Ivan Stoichkov
chantait à voix haute des extraits de l’air du torero de Carmen. Adolf Deter était également parti, lui qui nous rebattait
les oreilles régulièrement avec son « salud
compañero ! » Il y eut une
accalmie dans l’une des baraques les plus animées et, je dirais, les plus
joyeuses. Les gens se rafistolaient, s’ôtaient les poux, lisaient, écrivaient,
se taisaient. Nous vivions presque tous avec le sentiment d’une issue proche de
chaque cas personnel. Seul le Russe Vasil Kovaliov ne se faisait pas d’illusions.
Les interventions les plus vigoureuses de l’ambassade soviétique s’étaient
heurtées au refus intransigeant des autorités françaises de reconsidérer son
cas ou d’accepter de le rapatrier. Il sentait l’inutilité de son destin, mais
cela ne l’empêchait pas d’être calme et d’endurer les difficultés. Ayant appris
des espagnols la fabrication de petits avions en aluminium, il leur consacrait
la majeure partie de son temps.
Ma dernière
rencontre au Vernet était avec Dalem, Rau et Nicola. Les deux premiers m’ont
donné rendez-vous à Moscou à l’hôtel International. Nicola m’a invité quelque
part ou très probablement dans l’Italie libérée du fascisme... Non seulement
dans le ton, dans les yeux, dans la démarche, mais dans toute l’apparence de
Dalem et Rau rayonnait la bonne volonté au prix de tous les sacrifices de
rester fidèles à leurs idéaux. Sans s’accrocher à leur propre vie, ils
croyaient qu’ils vivraient pour voir la fin de l’enfer fasciste. Nous ne nous
sommes pas revus après la guerre à Moscou, mais nous nous sommes rencontrés
avec Heinrich Rau à Berlin en tant que vice-Premier ministre de la RDA et avec
Franz Dahl, venu dans notre capitale en tant que ministre de l’Enseignement
supérieur. Du Vernet, ils ont été capturés par les nazis et jetés dans un camp
de concentration en Allemagne. Là, avec le consentement du Parti communiste
allemand, des camarades ont rejoint l’armée hitlérienne afin de mener des
activités antifascistes. Ils ont suggéré que tous les deux profitent de la
décision du parti. Ils ont catégoriquement refusé l’uniforme d’Hitler.
Je me suis séparé du
camp de concentration du Vernet comme d’un cimetière — je n’ai pas regardé en
arrière. Mais je ne lui ai pas jeté la pierre. Pour moi, le camp disciplinaire
niché au pied des Pyrénées était une véritable école — une école de courage et
d’héroïsme, une école de fraternité communiste. Dans mon esprit, Vernet vit
avec des taches d’instabilité humaine, mais en même temps, surtout, son image
brille des milliers de marques de la solidarité révolutionnaire, de la chaleur
humaine des relations de camaraderie.
Au cas où nous
oublierions vite Vernet par hasard, l’administration du camp ordonna au
spécimen de garde Napoléon de nous accompagner jusqu’au nouveau camp. Nous
avons voyagé, un groupe de Bulgares : Ivan Stoichkov, Atanas Bratanov et
d’autres, pendant plus de deux jours, changeant souvent de trains de troisième
classe, d’autobus défoncés et même de charrettes.
Le camp des Milles,
à six kilomètres de la ville d’Aix-en-Provence, ne ressemblait pas du tout à un
camp. C’était un énorme bâtiment solide de trois étages. Avant la guerre,
c’était une usine de production de tuiles et de briques. Les étages utilisés
pour le séchage de la production n’avaient pas de cloisons et étaient reliés
aux deux extrémités par des élévateurs en caoutchouc de 50 à 60 cm de large
pour les briques et les tuiles. Le groupe bulgare était logé au deuxième étage.
Le camp des Milles
n’avait pas la diversité nationale du Vernet, et la composition politique
n’était pas la même. La plupart des internés étaient de riches juifs allemands.
En échange de pots-de-vin fabuleux, ils ont persuadé les autorités hitlériennes
de quitter l’Allemagne et de rester aux Milles pendant qu’ils arrangeaient leur
départ pour l’Amérique. Ils mangeaient copieusement à leurs frais, dormaient en
pyjama, se rasaient tous les jours et beaucoup d’entre eux accomplissaient des
rites de prière tous les après-midi. Il y avait une froide aliénation entre eux
et nous. Ils nous regardaient avec une arrogance non dissimulée, nous qui dans
des boîtes de conserve avalions de l’eau tiède appelée soupe. À leurs yeux,
nous passions pour des barbares quand nous avons commencé à couper des
élévateurs en caoutchouc pour en faire des sandales.
Le régime des Milles
était radicalement différent de celui du Vernet. C’était un camp de personnes
qui étaient en fait en dehors des lois de la France, car leurs gouvernements
respectifs ou certains pays étrangers avaient exprimé leur volonté de les accepter
sur leurs territoires. Chaque interné avait le droit de sortir à l’extérieur du
camp. Nous ne nous tenions pas droits et alignés deux heures avant et deux
heures après midi devant la baraque et sous les rayons brûlants du soleil du
sud. De nombreux membres du groupe bulgare travaillaient dans différents
ateliers. Nikola Savov Atanasov était devenu le chef de l’atelier
mécanique-technique, Kiril Velitchkov réparait des chaussures, Spas Georgiev et
Tabacheto s’occupaient des fleurs devant la direction, Georgi Andreev était en
charge de la cuisine, Atanas Mikhailov travaillait à l’administration.
Fidèles à nos
habitudes de parti, nous menions une vie d’organisation régulière. Le
secrétaire du parti Boris Savov nous réunissait souvent et parlait de la situation
en France et en Bulgarie. Nous vivions au rythme des grands événements actuels
et futurs. Nos pensées volaient de plus en plus souvent et de manière
incontrôlable vers la patrie.
Seules deux œuvres
bulgares avaient survécu aux innombrables perquisitions dans les camps :
le roman de Krastyo Belev La Percée
et le recueil Qu’il fasse jour de
Hristo Smirnenski. Ils nous ont aidés à nous réunir deux fois et à converser de
sujets littéraires. J’ai lu tout un exposé, comme on l’appelait à l’époque, sur
la poésie de Smirnenski. J’ajoutai aussi à ma causerie des souvenirs personnels
du poète prolétarien que j’étais le seul, parmi les internés des Milles, à
avoir vu. D’une manière inexplicable pour moi, j’ai conservé jusqu’à ce jour le
manuscrit du discours. En voici la conclusion : « Comme hier et
aujourd’hui, plus qu’hier, l’humanité ouvrière a besoin de la foi enthousiaste
de notre poète dans le Prométhée russe, dans la force d’acier de son poing
prolétarien blindé... S’immerger dans les jus vivifiants de la poésie de
Hristo, s’abreuver de ses délices aux heures de notre dure vie de camp — tel
est, entre autres, le but de cette modeste revue de l’œuvre admirable du jeune
homme de génie, auteur de Johann, Mineur de charbon, La révolte de Vésuve et de nombreux autres chefs-d’œuvre
littéraires. »
Le 2 juin 1941, nous
avons organisé une fête de Botev. Un chœur improvisé sous la direction de Boris
Savov a chanté Hadji Dimitar et La pendaison de Vassil Levski. Les
choristes sont devenus récitants et ont interprété la récitation collective Nous de Hristo Smirnenski. Des
performances individuelles ont été réalisées par Boris Savov avec le chant de Ma prière et Fugues, Spas Georgiev avec À
mon premier amour, Ivan Kanev avec le poème Hristo Botevou de Smirnenski et enfin j’ai récité Lutte et Adieu ! Des souvenirs ont été racontés en relation avec les
journées de Botev en Bulgarie.
La réponse tant
attendue au rapatriement est arrivée. Mon nom manquait sur la liste de ceux qui
partaient pour la Bulgarie. Il n’y avait pas de temps ni de place pour hésiter.
Je suis parti « en vacances » à Marseille et je ne suis pas revenu au
camp des Milles. Avec l’aide de camarades du parti, je me suis caché dans une
famille hongroise pendant environ une semaine. L’homme et la femme étaient des ouvriers
du Komintern à Moscou et des combattants en Espagne. Le vieil homme aux cheveux
gris, avait participé à la commune hongroise, un ami personnel de Béla Kun et
Georgi Dimitrov, s’appelait Gyoza, et son amie Charlotte était grande et
beaucoup plus jeune que lui. Le communard Gyoza était particulièrement
préoccupé par le cours des événements. Il ne croyait pas à la durabilité du
pacte de non-agression germano-soviétique. Il raisonnait :
— Quiconque
comprend la politique sait que l’Allemagne fasciste ne peut pas se sentir la
maîtresse de l’Europe si le flambeau de la révolution avec son Armée rouge
brûle sur la terre russe sans fin.
Charlotte a amené
dans l’appartement un Brésilien présenté sous le nom de Gonzalez. Elle nous a
laissés seuls pour nous mettre d’accord sur comment, quand et où transférer la
ligne de démarcation entre la zone occupée et la zone dite libre de France. Le
jeune Gonzalez m’a conseillé de patienter quelques jours. Il espérait obtenir
les informations les plus récentes sur un passage réservé uniquement aux
camarades responsables.
À la fin de ma
semaine de séjour, Gonzalez m’a fait plaisir :
— La route est
dégagée. Sois prêt. À quel nom et de quelle nationalité souhaites-tu que nous
rédigions le document de voyage ?
— Yougoslave.
Je serai Juro Petrovich. Représentant de la parfumerie Rosa, Avenue des
Gobelins, Paris.
Gonzalez était aussi
joyeux et vif qu’une alouette et aussi précis qu’une horloge. À l’heure dite,
il me remit le document promis et me fit jurer de le détruire dès que j’aurais
passé la ville de Mâcon. Il m’a décrit dans le plus grand détail le passage que
je devais suivre et m’a dit :
— Dors bien
pour ta dernière nuit à Marseille. Charlotte t’accompagnera à la gare demain
matin. Bon vent !...
Gonzalez m’a
embrassé. J’ai senti la chaleur de la solidarité communiste omniprésente.
J’ai exécuté toutes
les commandes de mon Virgile brésilien. Après Mâcon, j’ai quitté la route et
j’ai attendu la nuit au pied du pont de la ville de Chalon-sur-Saône. En effet,
à 22 heures, un vieux garde français est sorti de la cabine et, toussant, il
s’est dirigé vers le village voisin. Jusqu’alors, les informations de Gonzalez
s’étaient réalisées. J’ai décidé de tenir jusqu’à 23 heurs. Je me suis approché
du pont et j’ai essayé de m’assurer qu’aucun autre garde n’était resté dans la
cabine... Il n’y avait pas âme qui vive. Tout ce qui arrivait jusqu’à moi,
c’était le coassement d’innombrables grenouilles et le doux murmure des eaux
lentes de la rivière à plein débit. La nuit nuageuse me protégeait par son
obscurité... J’ai attendu que les aiguilles de ma montre indiquent 23 h 30 et
j’ai marché avec confiance mais tranquillement sur la toile de fer du pont. Je
fis quelques pas, m’arrêtai et écoutai ; rien que le coassement des
grenouilles, le bruissement silencieux de l’eau et la faible brise nocturne...
Je continuai à marcher sur le pont qui faisait plus de cent mètres de long.
J’avais fait plus de la moitié du chemin. Je pouvais voir l’autre bout du pont.
Pas de lumière dans la cabine d’en face... Tout à coup l’aboiement affreux d’un
chien ! Et un grand cri humain : « Halt ![60] »
J’ai frissonné et je m’apprêtais à reculer. En vain ! Le chien policier
bloquait déjà mon chemin, essayant de me sauter dessus. Je me suis défendu avec
l’imperméable, mais le chien devenait encore plus féroce. Le soldat allemand
qui a couru avec un fusil à la main m’a sauvé des dents du chien. Il criait
avec excitation : « Contrebandier ! Les mains en
l’air ! »
C’est là que la
langue allemande étudiée au camp du Vernet m’a aidé. Conduit à la cabine de
garde, je répétai à plusieurs reprises que j’étais bulgare, donc citoyen d’un
État allié.
— Donnez-moi
vos papiers.
— Je n’en ai
pas. Les Français me les ont pris. Je suis un fugitif d’un camp. Je suis un
grand marchand de meubles à Paris. J’ai trois boutiques boulevard
Saint-Antoine, près de la place de la Bastille. Mes rivaux français voulaient
prendre mes boutiques et m’ont dénoncé au début de la guerre comme sympathisant
du IIIe Reich. Maintenant, j’ai fui pour regagner mes magasins avec
votre aide allemande...
— Êtes-vous un
marchand ?
— Oui, un
marchand de meubles près de la Bastille, trois boutiques pleines.
— N’êtes-vous
pas juif ?
— Qu’est-ce que
vous racontez ? Bulgare orthodoxe de race pure.
— Vous
expliquerez cela à l’enquêteur demain. Dormez maintenant, car je serai remplacé
à 4 heures du matin et ensuite je devrai vous emmener en garde à vue...
J’ai inventé
l’histoire du riche propriétaire de meubles d’un coup, sans réfléchir. J’ai été
étonné et en même temps content de moi quand j’ai remarqué son effet bénéfique
sur le soldat allemand ordinaire. Je fermai les yeux pour évaluer ma situation.
Le beau Gonzalez avait clairement raison, mais jusqu’à la moitié du pont. Je
n’avais aucune raison de douter, et je ne doutais pas de son honnêteté. Il y a
eu un changement soudain, dont il n’était absolument pas responsable ...
J’ai eu l’impression
de m’être endormi parce que j’ai été surpris par les aboiements de chiens et
les voix humaines. Un autre soldat était entré dans le poste de garde, et ils
parlaient à haute voix de... moi. J’ai été ravi de constater que le premier
expliquait au second : « Un grand marchand. Il n’est pas juif.
Bulgare. »
DANS LA PRISON DE CHALON SUR SAÔNE
Dans le noir, nous
avons marché en silence pendant 10 à 15 minutes. Nous sommes entrés dans la
cour d’une petite prison. Les cellules de ses deux étages étaient éclairées.
Mon guide m’a fait entrer à l’étage du bas, m’a ordonné de m’asseoir à une
table, m’a remis à un autre soldat et s’en est allé dormir.
À 9 heures, un
inconnu m’a ordonné de le suivre. Nous avons grimpé les escaliers en bois
jusqu’au deuxième étage et nous nous sommes dirigés vers la gauche dans un
couloir étroit. Nous nous sommes arrêtés devant un grand groupe de personnes —
tous mes confrères. Nous attendions d’être convoqués pour enquête. Ici, j’ai
appris que les peines allaient d’une semaine à trois mois et pour les
récidivistes, six mois.
Quand ce fut mon
tour, j’entrai dans une grande salle avec des bancs et un tableau noir. Le
tribunal était composé d’un seul membre, un jeune lieutenant blond avec une
cigarette à la bouche. Le greffier avec des lunettes et un cuir chevelu léché,
était assis dans l’un des coins.
Le lieutenant
parlait un français pur :
— Vos
papiers ?
— Malheureusement,
je n’en ai pas. Je me suis évadé d’un camp français.
— Que
diriez-vous pour vous justifier ? Veuillez être bref.
Dans les termes les
plus concis, j’ai répété l’histoire fictive et ajouté que je brûlais de
patriotisme de retourner en Bulgarie et qu’en tant qu’ancien capitaine de
l’armée bulgare, je voudrais retourner dans ma patrie pour remplir mon devoir
patriotique d’officier dans les rangs de notre armée alliée.
— Je veux bien
vous croire, mais vous n’avez pas de papiers... et il se tourna vers le greffier :
— Deux semaines !... et puis vers moi : — Vous êtes libre.
S’il n’avait pas
porté l’uniforme hitlérien, je l’aurais remercié à haute voix, comme je l’ai
remercié mentalement. Je me suis contenté de reculer silencieusement.
Ma cellule avait
l’air convenable : lumineuse malgré la fenêtre grillagée et sale, avec un
plancher en bois, des matelas en coton, éventrés à certains endroits et deux
couvertures. Les murs fraîchement peints ne comportaient aucune inscription.
J’ai partagé la cellule avec un jeune homme chinois nommé Tin Lai. Nous nous
sommes dit « bonjour » et avons appris à nous connaître. Il avait été
également condamné à deux semaines aujourd’hui. Je l’ai invité à faire une
promenade dans la cour. Il a répondu qu’il préférait rester ici.
Je suis descendu
seul parmi les prisonniers. La cour dans laquelle nous nous promenions était
petite pour plus de 150 personnes de tous âges et de nombreuses nationalités.
Les juifs allemands et français prédominaient. J’ai rejoint un groupe au centre
duquel se trouvait un Espagnol d’âge moyen. Il expliquait que franchir la ligne
de démarcation deviendrait de plus en plus difficile pour deux raisons :
les Allemands resserraient le contrôle et les passeurs français, entre lesquels
une sale rivalité naissait, commençaient à se trahir entre eux. Dans un autre
groupe, où les Italiens étaient les plus bruyants, on insistait sur le fait que
les nazis saisiraient des prisonniers et les forceraient à travailler en
Allemagne, et que leurs femmes seraient données de force aux régiments
allemands comme marchandise de plaisir.
J’ai raconté à mon
compagnon de cellule ce que j’avais entendu dans la cour. J’ai partagé ma
surprise que tous ces gens ne parlent pas de l’essentiel — la guerre — comment
et où elle va.
Pendant les deux ou
trois jours suivants, Tin Lai et moi avons eu des conversations sur divers
sujets. La sincérité et la confiance se sont installées entre nous. Nous avons
partagé la nourriture et le partage a toujours été en ma faveur. Tin Lai m’a
raconté son histoire. Il étudiait à l’Institut des Arts et Métiers de Paris. Sa
subsistance était assurée par deux de ses cousins. En hiver, ils vendaient des
châtaignes, et maintenant, en été, ils vendaient des cravates en soie, des
rubans, des écharpes, des mouchoirs. Les marchandises étaient achetées à Lyon
et transportées dans des valises à travers la ligne de démarcation jusqu’à
Paris. Là, ils les vendaient dix fois plus cher aux Allemands. Cette fois, on
lui demanda de participer à l’expédition. Mais un malheur arriva. Les soldats
allemands ont tiré sur le bateau et le passeur a été contraint de faire marche
arrière. Ils ont confisqué tout leur argent. Les enquêteurs les ont soumis à un
examen extrêmement minutieux et humiliant : ils les ont déshabillés, leur
ont frotté dans l’anus avec un objet dur et ont déchiré les coutures de leurs
vêtements, chaussures et chapeaux.
J’ai demandé une
fois à Tin Lai s’il connaissait, par hasard, un de ses compatriotes, Hua, et je
lui ai raconté les aventures de la prison de Namur dont j’avais connaissance.
Il s’est étonné de ma question, disant qu’il ne connaissait pas Hua
personnellement, mais qu’il avait entendu parler de son histoire avec le coffre
et de sa fuite à travers la frontière belgo-luxembourgeoise. Après une pause,
Tin Lai m’a demandé :
— Êtes-vous
l’homme blanc qui l’a aidé à sortir du cercle vicieux ?
J’aurais pu
continuer à jouer à la conspiration, mais je sentais l’inutilité d’un tel
comportement. J’ai admis que j’étais l’homme blanc. Tin Lai sauta, frappa dans
ses mains et fit deux ou trois pas de ballet :
— Maintenant,
moi aussi je vais me promener dans la cour.
Je le regardai
perplexe, je ne comprenais pas le lien entre notre conversation et ses cris. Le
jeune homme se pencha et me murmura presque :
— Tu ne sais
pas pourquoi je ne sors pas de la cellule, n’est-ce pas ?
Et il continua sur
le même ton mystérieux :
— Je peux te le
dire maintenant. Tu vois cette petite mallette en carton très usée ?
— Tu veux dire
ton oreiller ?
— Oui. C’est
l’argent qui est dedans, qu’ils ont cherché et qu’ils n’ont pas trouvé.
— Alors, il y a
un double fond ou des doubles parois ?
— Non, pas du
tout. En fait, ils l’ont percé avec un couteau. Regarde.
La mallette portait
vraiment des traces de fentes allongées. Elle était presque vide : une chemise,
une paire de chaussettes et un livre en chinois. Se cachant dans un coin pour
qu’ils ne le voient pas de la porte, Tin Lai s’est confié à moi :
— Ici, dans
cette poignée de la mallette se trouve l’argent. 50 mille francs, 10 billets de
cinq mille. Je n’osais pas sortir, j’avais peur pour la mallette. Maintenant tu
vas rester dans la cellule pendant que je me promène.
Nous avons attendu
patiemment la fin des deux semaines. Certains changements n’ont pas échappé à
notre attention. Le personnel allemand était resté silencieux pendant un jour
ou deux. Aucune conversation bruyante ne se faisait entendre dans les couloirs
et les chambres. Les chants rauques et les marches militaires des soldats et
des officiers ont cessé de nous tenir éveillés jusqu’à 11 h – minuit le soir.
Nous étions également étonnés que les nouveaux attrapés fussent gardés dans une
salle militaire et qu’aucun contact n’était autorisé avec eux. Pendant trois
jours, nous n’avons plus reçu de journaux de Vichy. Lorsqu’on demandait
pourquoi on répondait par un haussement d’épaules et un faux « Je n’en
sais rien ». Des rumeurs controversées ont fait surface : « Des
avions britanniques ont bombardé Berlin et l’ont rasée. Les troupes allemandes
ont débarqué et ont encerclé la capitale anglaise. L’Union soviétique est
intervenue aux côtés de l’Allemagne nationale-socialiste. »
Derrière les murs de
la prison, l’angoisse de l’inconnu a duré trois jours. Le quatrième jour au
matin, des serruriers égayés distribuaient de nombreux journaux presque gratuitement.
En première page, de gros titres en six colonnes annonçaient
solennellement : « Dans la nuit du 21 juin, l’armée allemande
victorieuse est entrée à 150 km en Russie soviétique. Mille deux cents avions
russes abattus, 5 000 chars détruits, plus d’un million de prisonniers
soviétiques. L’Armée rouge est vaincue... Dans trois semaines, le chef
militaire génial Hitler sera à Moscou ! »
Nous étions tous
surpris, stupéfaits. La guerre prenait un nouveau tournant. Il ne fallut pas
longtemps avant que des prophètes effrayés ne poussent comme des
champignons : « La Russie est finie. Conquérant l’Europe
industrielle, Hitler traversera la terre russe avec ses innombrables chars et
sera probablement à Moscou dans la troisième semaine. »
Plus instinctivement
qu’avec une réflexion politique, j’en suis venu à la conclusion : Hitler a
enfin trouvé son maître ! Dispersé dans toute l’Europe, engagé à l’est, à
l’ouest et au sud, il réitère l’erreur de Napoléon. Avec l’attaque contre
l’Union soviétique, il unit les forces de toute l’humanité progressiste. La
lutte sera dure et longue, mais la perspective est que les hordes
hitlériennes seront vaincues.
J’ai cherché des
alliés pour clarifier les esprits confus des masses carcérales. Je les ai
trouvés dans deux Français qui ne se cachaient pas d’être membres de la CGT,
les syndicats révolutionnaires français. Roger – mécanicien dans un petit
studio privé, 40-45 ans ; Simon — patron d’un grand garage ; ils
avaient tous deux l’intention de gagner Marseille et de là, par la Corse, de
rejoindre les rangs de la « France libre » sous le patronage du
général de Gaulle. Au début, comme tout le monde, ils étaient choqués par
l’avancée impétueuse d’Hitler.
Il y avait un accord
tacite entre nous trois – de souligner la nature très temporaire des succès
d’Hitler, d’élever la foi dans la victoire finale des forces démocratiques. Au
bout d’un moment, nous avons réussi à obtenir de la plupart des masses
carcérales qu’elles adressent des critiques sur la presse de la propagande de
Goebbels. Simon n’arrêtait pas de répéter qu’Hitler n’était pas Napoléon et que
Staline ne ferait pas honte à Koutouzov.
Dernières minutes en
prison.
La porte de la
prison a claqué derrière nous et nous avons marché sur le trottoir d’une grande
place. Tin me regardait sournoisement. Il m’a d’abord invité à boire un verre,
puis à manger et ensuite seulement nous poserions des questions sur le train...
Nous sommes arrivés
à la gare de Lyon dans la matinée. J’ai trouvé Paris changé. Soi-disant les
mêmes Parisiens mobiles et joyeux, mais des non-dits dans leurs blagues et
leurs sourires. Le plus important : des uniformes verts partout.
Tin Lai et moi nous
nous sommes quittés en tant qu’amis. Les dix jours que nous avons passés
ensemble ont confirmé nos meilleurs sentiments. Nous sommes restés avec les
souvenirs d’une chaleur humaine qui nous a bercés temporairement dans son
câlin.
Une nouvelle vie
parisienne commençait pour moi. Les conditions étaient difficiles. La France
gémissante sous la botte de fer de l’occupant. La guerre avec ses cruautés et
ses misères se faisait sentir partout. Les magasins et les vitrines que je
connaissais auparavant, pleins de produits attrayants, étaient maintenant
vides. La nourriture constituait déjà un problème. Les rations prescrites de
250 grammes de pain par jour, 150 grammes de viande et 40 grammes de fromage
par semaine, 500 grammes de sucre par mois étaient des rations de famine. Pour
réduire les conséquences douloureuses de la famine officielle, les gens
recouraient au marché noir. Ils voyageaient dans les villages où il y avait
encore des restes, s’approvisionnaient pour une courte période, et repartaient
à la recherche de vendeurs paysans consciencieux ou prédateurs.
Les patriotes
français ne luttaient pas seulement contre la pauvreté de la vie quotidienne.
Ils luttaient également contre les oppresseurs et les traîtres à la patrie. Des
tracts étaient distribués appelant la population à préserver sa dignité
française, à lutter par tous les moyens possibles, à ne pas coopérer avec les
occupants verts et leurs agents. Les fenêtres des bureaux de recrutement
allemands pour des travailleurs en Allemagne étaient brisées ou incendiées. Les
tableaux de bois pour les directions des routes vers les villes et les villages
étaient déplacés et brisés.
Le sabotage de la
production était organisé sous la direction du Parti communiste français
illégal. Des attaques contre des unités militaires des occupants étaient
menées, des représailles étaient lancées contre les traîtres et les
collaborateurs de la Gestapo.
Qu’ai-je appris des
Français et des Bulgares rencontrés le jour de mon arrivée à Paris ? Dès
le 6 juin 1940, avant que le général de Gaulle n’appelle le peuple français à
résister aux oppresseurs depuis Londres le 18 juin, le Parti communiste
français, par l’intermédiaire du professeur Georges Politzer, remet au ministre
des Travaux publics de l’époque, Anatole de Monzie, les propositions pour la
défense de Paris :
1. Changer la nature
de la guerre en la transformant en une guerre nationale pour l’indépendance et
la liberté.
2. Libérer les
députés et militants communistes, ainsi que les dizaines de milliers de
travailleurs emprisonnés ou internés.
3. Arrêter
sur-le-champ les agents de l’ennemi, qui s’agitent au sénat, au parlement, dans
les ministères, et même dans l’état-major, et les fusiller.
4. Ces premières
mesures susciteront un véritable enthousiasme populaire et rendront possible le
soulèvement des masses, qui doit être décrété immédiatement.
5. Le peuple de Paris
doit être armé et Paris doit devenir une forteresse imprenable.
Aucune réponse à cet
appel à une lutte unie et résolue contre l’invasion hitlérienne. Les traîtres,
s’enfonçant profondément dans le bourbier de la trahison nationale, espéraient
qu’Hitler les sauverait des communistes, qui étaient en fait les patriotes
français les plus cohérents. La bourgeoisie française de 1940 a agi d’une
manière peu originale. Leurs grands-pères en 1793 et leurs pères
en 1871 ne se sont-ils pas unis aux ennemis les plus féroces de la France pour
réprimer la Grande Révolution française et la première puissance prolétarienne
du monde, la Commune de Paris ? Maurice Thorez avait cent fois raison
lorsqu’il écrivait dans le journal clandestin L’Humanité du 27 avril 1940 : « Ceux qui dirigent la
chorale aujourd’hui vendent la patrie ; demain, comme hier, ils sont prêts
à s’unir avec n’importe qui, à demander l’aide de n’importe quel chef d’État
capitaliste, à n’importe quel prix, pour briser la résistance populaire. »
La voix sobre de la
vérité communiste était alors incapable d’éclairer la conscience de la nation,
dupée, trompée, embrouillée par les moyens puissants de la presse, de la radio,
du cinéma, des chaires professorales, des chaires d’Église. Le complot contre
le peuple triomphait momentanément. Paris avait été déclarée ville ouverte,
c’est-à-dire qu’elle renonçait à ses traditions révolutionnaires de 1793 et
1871.
Le 15 juin, le
drapeau hitlérien à la croix gammée flotte sur la tour Eiffel. Peu de temps
après, l’avion personnel d’Hitler se pose sur les pavés de la vaste place de la
Concorde. L’ermite de Berchtesgaden et sa suite partent sur les Champs-Elysées
jusqu’à l’Arc de Triomphe, sous lequel Napoléon passa autrefois. Le 22 juin, à Rethondes, près de la ville de
Compiègne, le vainqueur à Verdun de la Première Guerre mondiale, le maréchal
Pétain, offrit la capitulation de la France dans la même voiture qui signa la
défaite de 1918 de l’Allemagne du Kaiser.
Le mot
« collaboration » avec l’occupant a été utilisé pour la première fois
après la rencontre entre Hitler et Pétain à Montoire le 24 octobre 1940. Le
maréchal de France tend alors la main au chef des nationaux-socialistes
allemands et l’assure de sa sincère volonté de coopérer à l’édification du
« nouvel » ordre en Europe. Selon cette nouvelle donne, la France
d’une future Europe « sera essentiellement agricole et rurale[61] ! »
Pétain est devenu le principal agitateur de la politique « Retour à la
terre ». Jusqu’en 1943, les autorités d’occupation et de Vichy avaient
fermé 10 000 entreprises industrielles. Bref, les patriotes français étaient
confrontés à une situation difficile : un occupant étranger qui fait
preuve de démagogie pour un nouvel ordre, et des collaborateurs français qui
persécutent les vrais patriotes.
Le secrétaire du
groupe du parti bulgare, l’inter-brigadiste Dimitar Guénchev — Bateto, m’a posé
des questions sur la colonie bulgare. Après le départ d’Atanasov — Shatorov,
nos liens avec la représentation à l’étranger du CC du PCB étaient rompus.
— Mais la ligne
de notre comportement est claire — m’a dit Bateto. — Ceux d’entre nous qui le
peuvent doivent retourner en Bulgarie ; ceux qui restent ici doivent
rejoindre la Résistance française. À toi on t’a refusé l’admission au pays.
C’est clair, tu agiras à Paris. Dans un premier temps, nous devrons t’installer
quelque part dans un appartement et te trouver un emploi.
Bateto était un
camarade sérieux et énergique. Même dans le camp Des Milles Karamfila —
Halatchev et Tchitchoto — Pergelov m’avaient parlé de lui comme d’un jeune
cadre fiable. Mes impressions coïncidaient complètement avec leur référence.
Dimitar Guénchev — petit, à la peau plutôt foncée — dégageait une énergie
physique visible de sa silhouette trapue. Son baryton métallique témoignait de
sa force intérieure et de son caractère ferme. Il jouissait d’une autorité
naturelle parmi nos émigrés. Avant la guerre civile espagnole, il était employé
municipal à Roussé, et maintenant il travaillait comme tresseur de chaussures.
Il vivait près de la place Nation dans un appartement au rez-de-chaussée avec
la femme bulgare Jana, une veuve avec deux garçons.
Après avoir rendu
visite à une dizaine de familles amies, de nombreuses portes se sont ouvertes
devant moi, le fugitif. Pour des raisons évidentes, je ne suis pas resté
longtemps dans un appartement. Dans certains foyers, je revenais plus souvent.
Il s’agissait du 26 rue de Crussol avec Katerina Zuibarova, qui vivait avec sa
sœur Rosa et sa fille Aimée ; rue du Champ de l’Alouette dans l’appartement
de la bienveillante sœur Andrée Coquet ; rue de La Jonquière avec Madame
Dionys ; dans la banlieue de Vélizy près de la gare de Chaville avec Boris
Kazakov et sa femme Dora ; dans la ville de Saint-Denis avec Madame Yvonne
Chaumas.
Comme dans toute
guerre, il y avait une pénurie de main-d’œuvre à l’arrière, surtout des
hommes ; il y avait beaucoup d’acheteurs sur le marché même pour les
produits de piètre qualité. J’ai pensé à créer une coopérative de chaussures
tressées. J’ai présenté mon idée à Vlado Shtarbanov, Bateto, Kosta Dramaliev —
Maistora, Nikola Marinov et Nikolai Zadgorski, qui était revenu de Pologne. Ils
l’ont accueillie à couteaux tirés. Nous avons longuement discuté. En fin de
compte, nous avons pris la décision de la créer, bien qu’à des fins
expérimentales. Tout le monde a emprunté de l’argent à des amis et amies, nous
avons nommé le citoyen français Kosta Dramaliev comme directeur devant les
autorités et nous avons commencé la production avec une seule presse pour
couper les semelles de cuir. Nous avons installé la machine dans l’une des
pièces du rez-de-chaussée de l’hôtel au 88 rue de la Mare et avons transformé
la chambre de Vlado en atelier.
Notre production de
qualité médiocre était placée entièrement et à bon prix. Les acheteurs
cherchaient simplement plus de marchandises et n’étaient pas pointilleux sur la
qualité de fabrication. C’est ainsi que la coopérative... a réussi.
En l’honneur des
principaux coopérateurs — Vlado Shtarbanov, Nikola Marinov, Kiril Dramaliev et
Boris Milev — nous n’avons pas glissé sur la pente de l’enrichissement facile.
Nous réservions une partie des bénéfices à l’organisation du parti et à l’aide
aux inter-brigadistes. La coopérative a servi d’excellente couverture à nos
activités de conspiration. Des matériaux illégaux étaient apportés ici,
distribués et de là, les coopérateurs allaient parmi les émigrants bulgares et
les familles françaises connues pour les familiariser avec les discours des
communistes français. Le groupe du parti se réunissait régulièrement dans
l’atelier.
Plus tard, parmi les
déchets de semelles de cuir, du cuir et d’autres matériaux, nous cachions des
revolvers, des bombes, des machines infernales et d’autres armes avec lesquels
nous avons agi en tant que combattants de l’organisation de Résistance
« Francs-tireurs et partisans français ». Presque seuls les
communistes ont rejoint cette organisation ; elle était dirigée par le
Comité central du Parti communiste français en la personne de Jacques Duclos et
Benoît Frachon.
Au début de 1942, la
propagande de Goebbels assourdissait les oreilles des gens désorientés par les
victoires des armes hitlériennes. La presse française, au service de l’occupant
dans les deux régions, reprend honteusement les louanges de Goebbels. Beaucoup
de nos émigrants ouvriers étaient enclins à croire à la victoire de l’Allemagne
hitlérienne. Contre le poison de la propagande qui assombrissait l’esprit des
bons sympathisants, nous, les coopérateurs, nous menions un patient travail
d’explication. Chaque communiste avait un certain périmètre d’action.
La demeure et la
petite manufacture de Madame Anavi étaient situées rue Compans, près de la
place des Fêtes. C’est comme ça qu’on l’appelait tous, c’est comme ça que ses
voisins et clients l’appelaient dans le quartier. Ayant envoyé de bonne volonté
son fils Bouco défendre la République espagnole, elle est devenue proverbiale
grâce au stoïcisme avec lequel elle a survécu à la mort de son garçon. La
générosité et la bienveillance de Madame Anavi envers les inter-brigadistes ne
connaissaient pas de bornes et suscitaient l’amour universel pour cette petite
femme un peu grassouillette aux yeux vifs et au sourire éternel. Et voici que
cette mère rare et merveilleuse camarade était embarrassée par le cours des
événements.
J’ai essayé de la
calmer du mieux que j’ai pu. J’ai surtout insisté sur un moment important dans
le développement de la guerre : les démocraties s’unissent déjà contre
l’Allemagne fasciste ; démocrates, patriotes, antifascistes se renforcent
pour porter un coup décisif. Et Hitler... s’éclate et perd de plus en plus de
troupes. Le jour viendra où le monstre géant d’Hitler s’effondrera sous les
coups de l’Armée rouge et des peuples insurgés.
De tels mots et
d’autres similaires étaient prononcés par tous les coopérateurs. Nous avons
essayé de remonter le moral de ceux dont la foi vacillait. Nous-mêmes avons
souvent manqué de preuves convaincantes. Les interlocuteurs notaient la
pauvreté de nos arguments, mais réfléchissaient à la pureté de nos convictions.
Ils nous respectaient pour la sincérité avec laquelle nous servions nos idéaux.
Beaucoup soupçonnaient qu’en plus des mots, nous combattions d’autres manières.
Et ils avaient raison. Vladimir Shtarbanov, Nikolai Radoulov et Nikola Marinov
ont commencé en premier. Ils étaient déjà impliqués dans une forme de lutte
plus élevée que celle consistant à répandre des tracts, à déplacer et à casser
les panneaux routiers allemands aux carrefours, à écrire des slogans sur les
murs. Un soir, ils posèrent une bombe devant la vitrine du Bureau de
recrutement des travailleurs français pour l’Allemagne, situé boulevard de la
Villette, entre la rue Lepage et la cité Henin. Ils menaient des actions
similaires dans d’autres quartiers de la capitale.
PREMIERS
PAS DE LA RÉSISTANCE FRANÇAISE
À Paris et dans la
campagne, communistes et patriotes français se battaient jusqu’à la mort contre
les occupants verts. Amoureux de leur France natale, ils sabotaient la
production, le commerce, les transports, l’administration ; publiaient,
distribuaient et collaient des slogans et de la littérature antihitlérienne
partout ; les traîtres étaient exécutés ; ils détruisaient la force
vive de l’oppresseur national. Avant que les cloches ne sonnent pour Noël en
1941, les sinistres affiches allemandes dans des cadres nécrologiques
apparaissaient pour la première fois dans les rues de Paris. Elles rapportaient
l’assassinat du patriote français Jacques Bonsergent « pour avoir attaqué
un membre de l’armée allemande ». Le jeune métallurgiste,
l’inter-brigadiste Pierre Georges, plus tard connu sous le nom de colonel
Fabien, a abattu avec un pistolet l’aspirant Moser de la marine allemande le 21
août 1941, vers 9 heures du matin, à la station de métro Barbès - Rochechouart.
Le 25 septembre, dans la ville de Quiéry-la-Motte, dans le nord de la France,
une cinquantaine de soldats et officiers en uniformes allemands sont morts à la
suite du déraillement du train dans lequel ils avaient mangé, bu et chanté.
La résistance ne
faisait pas que grandir, elle s’organisait et se renforçait. L’organisation
spéciale du Parti communiste pour le sabotage et l’action armée se sont
transformées au début de 1942 en l’organisation des Francs-tireurs et partisans français (FTPF) sous la direction pour
la région parisienne de la troïka de Raymond Losserand, Henri Rol-Tanguy et
Lucien Carré. Le journal France d’Abord
couvrait les exploits des combattants et des partisans. Ils suscitaient
l’admiration des patriotes et faisaient comprendre aux hésitants la grande importance
de la devise du journal : « La liberté n’est pas donnée, elle se
gagne en luttant pour gagner ! » Et un nombre croissant de patriotes
prenait les armes. Avant que la radio londonienne, où de Gaulle prononçait ses
discours, n’annonce leur existence, des groupes de partisans, composés
majoritairement de communistes, commençaient à opérer dans la montagne du Jura
et de la Maurienne. C’était au début de l’année 1942.
Dès à présent, je
voudrais signaler une spécificité de la Résistance française. Elle a été créée
comme une résistance contre les oppresseurs nationaux — les occupants
hitlériens. Elle était basée sur la libération de la nation de l’occupant
étranger. La libération nationale attirait et fédérait la quasi-totalité des
Français, souvent quelles que soient leurs convictions, leur statut social et
leurs croyances religieuses. Une chose est vraie — les premiers dans la lutte
contre les occupants nazis étaient les membres du Parti communiste français,
qui, même avant la guerre, étaient les combattants les plus conséquents contre
l’agression fasciste croissante en Allemagne et en Italie. En tant que
secrétaire général de la Troisième Internationale Communiste, notre leader
mondialement connu du peuple bulgare, Georgui Dimitrov, avait dit : « Le
fascisme, c’est la guerre. » Les communistes français partageaient cette
vérité évidente avant même la guerre, et c’est pour cette raison que, lorsque
l’Allemagne d’Hitler a occupé leur pays, ils étaient les premiers à appeler le
peuple français à la lutte armée contre l’occupant fasciste et qu’ils ont été
les premiers à mener des actions militaires contre l’occupation hitlérienne.
Mais une quantité d’autres patriotes français de diverses organisations
politiques, professionnelles, scientifiques et religieuses s’est également
soulevée dans la lutte armée. En 1942, la Résistance française devient
véritablement massive. La nécessité d’unir les forces fragmentées de la
Résistance a été reconnue par l’ensemble du mouvement de résistance. Les
organisations syndicales des socialistes et des communistes furent les
premières à donner l’exemple de l’unité dans la lutte. En avril 1943, leur
centrale syndicale fusionne en une Confédération générale du travail (CGT).
Leur exemple a été suivi par les organisations de résistance du sud de la
France sous le titre général de « Mouvement uni de résistance »
(MUR). Peu de temps après ce mouvement d’unité par le bas, l’ancien préfet Jean
Moulin, personnellement mandaté par le général de Gaulle, parvient à surmonter
les difficultés sur la voie de l’unité des forces patriotiques et crée le 27
mai 1943 le très convoité et indispensable Conseil national de la Résistance
(CNR). 26 organisations de Résistance sont devenues membres de ce conseil. Il
représente tous les partis démocratiques, y compris le Parti communiste
français, les syndicats, les comités et organisations de Résistance
nouvellement formés et les individus connus pour leur démocratie constante et
leur antifascisme. Un certain nombre de comités et de commissions chargés de
tâches particulières sont créés au sein du Conseil national de la Résistance.
Le plus important des comités est le Comité d’action militaire (COMAC). Il est
également responsable de l’état-major général des Forces Françaises de
l’Intérieur (FFI), qui comprend des représentants de toutes les organisations
de Résistance.
Réunie sur la base
étendue de la lutte contre l’occupant national, la Résistance française s’est
suffisamment renforcée pour devenir un facteur sérieux et primordial de
conquête de la libération nationale. Les différences de classe subsistaient et
elles émergeraient peu après la fin de la guerre.
LE
GROUPE DE COMBAT BULGARE À PARIS
Par un frais
dimanche matin, je quittais mon confortable appartement rue de Crussol. Le
boulevard Voltaire, sur lequel je marchais jusqu’à la place de la République,
était d’une solennité déprimante avec ses volets baissés et ses trottoirs
déserts. J’ai regardé ma montre — il me restait exactement 15 minutes pour
prendre le métro de la place de la République et me rendre à l’immeuble rue de
la Mare. Je suis descendu à la station de métro République en direction de la
Porte des Lilas. Les passagers qui montaient et descendaient étaient très peu
nombreux. Au bas de l’escalier, j’ai remarqué... des policiers allemands et français
en uniforme. Les passagers s’identifiaient. Je n’avais pas le temps de
réfléchir. Revenir, c’était me trahir. Je continuais à descendre calmement les
marches. Un garde français m’a demandé ma carte d’identité. Je lui ai tendu
silencieusement un laissez-passer allemand pour un chantier de construction.
Le garde a essayé de
lire le texte, mais n’a apparemment pas compris le contenu du laissez-passer et
m’a demandé ce qu’était ce papier.
Imperturbable, j’ai
fait semblant de ne pas comprendre le français et j’ai répondu : « Je
ne comprenez pas. »
Le garde montra le
laissez-passer aux deux policiers allemands. Ils l’ont lu, m’ont jeté un coup
d’œil à trois ou quatre mètres, se sont dit quelque chose et ont rendu le
laissez-passer au garde français en disant : « Laissez-le
partir. »
L’épreuve était
sérieuse. Pour la première fois, j’ai montré le laissez-passer que m’avait
remis l’inter-brigadiste Ivan Petrov, qui travaillait comme technicien de
construction dans l’organisation militaire allemande Todd.
Je suis allé à la
coopérative pour une réunion. Pour cette rencontre Bateto m’avait confié :
— Il y aura du
nouveau.
Je pensais que la
nouveauté concernait le développement de la guerre : soit une nouvelle
offensive soviétique, soit la Grande-Bretagne et les États-Unis déclarent
ouvrir le deuxième front. Je m’étais trompé. Il y avait quelque chose de
vraiment nouveau, mais ce n’était pas dans la direction de mes pensées.
Je suis arrivé
avant-dernier à la réunion. Nikola Radoulov est arrivé après moi. Bien nettoyée
par le locataire Vladimir Shtarbanov, la petite chambre d’hôtel accueillait à
peine tous les camarades. Outre Vlado, inter-brigadiste, charpentier de
profession, émigrant politique en Yougoslavie et en URSS, étaient également
présents Dimitar Guénchev — Bateto, Nikola Marinov — inter-brigadiste, frangin
écrivain, faible et petit, Georgi Radoulov — inter-brigadiste, tailleur, pâle
et maigre, Nikolai Radoulov — le fugitif du Vernet, Tsvyatko Kiryakov —
émigrant économique, tailleur, marié à une Espagnole, Nikolai Zadgorski — ayant
abandonné ses étudiants à Prague, parti se battre pour la défense de la
République espagnole, puis revenu blessé et avec la permission du parti est
allé travailler en Pologne en tant qu’ingénieur civil.
Bateto a ouvert la
réunion par un bref discours d’introduction. Après un rapide rappel des actions
du front de l’Est et du déploiement des forces en France — vaincue mais
insoumise — il a précisé que le Comité central du Parti communiste français
lançait un appel à tous les communistes étrangers pour former des groupes de
combat. Les Polonais, les Yougoslaves, les Juifs et d’autres étaient déjà
devant nous. La question était posée sur la base du volontariat. Nous, en tant
que groupe du parti, étions également obligés de désigner des volontaires.
Les derniers mots
nous ont surpris et aussi il semblait que nous les avions sentis venir. Il y
eut un silence. J’ai dû pâlir et avoir des sueurs froides. J’ai regardé les
autres — certains fixaient le sol. Bateto a allumé une cigarette. Pour faire
quelque chose, j’ai aussi demandé à fumer.
Bateto rompit le
silence.
— Laissez-moi
commencer en premier. J’ai dit à mon camarade du Parti communiste français que
j’étais volontaire si je ne pouvais pas aller en Bulgarie. Et souriant, il
ajouta : « Je crois que vous ne doutez pas de mes paroles. Maintenant
c’est votre tour... ».
Nikola Marinov a dit
à haute voix :
— Qu’est-ce qui
se passe ?! Battez-vous en Espagne, ici, il y encore du combat !
Nikola Zadgorski lui
a répondu :
— L’ennemi est
le même, le fascisme international.
Shtarbanov se fit
entendre :
— Et encore
nous contre lui... Près de 20 ans en Bulgarie, trois ans contre Franco, et
maintenant ici... qui sait combien de temps ça va durer ?
Georgi Radoulov a
lancé :
— Es-tu
sérieux, vieux loup, de poser une telle question ?
— Et toi, tu me
demandes sérieusement ? Ne vois-tu pas que nous sommes tous silencieux sur
la question principale.
Les répliques
frappaient mon esprit. Il me semblait que tout le monde me regardait. J’ai
senti une tempête dans ma poitrine, mais j’ai dit très doucement :
— Si c’est ce
qu’il faut...
Vlado et Kolyo
Marinov m’ont regardé de travers et avec une surprise évidente. Je n’avais pas
encore réussi à gagner leur entière confiance. Ils connaissaient vaguement ma
biographie.
Shtarbanov se tourna
vers Bateto :
— C’est moi que
tu regardes toujours... D’accord, écris-moi aussi.
— Je te
regardais, dit Bateto, parce que c’est ce que je m’attendais à entendre.
Les deux Nikola —
Marinov et Radoulov — se sont également portés volontaires.
— Je pense que
nous avons assez de camarades pour un groupe, a déclaré réjoui Bateto. — Je
peux avouer qu’ils voulaient trois combattants de nous, les Bulgares. Nous
avons dépassé le quota. Cela vaut la peine de se féliciter !
Ni le secrétaire ni
l’hôte ne s’étaient préparés à arroser l’événement, et cela valait bien un
verre. En cette fraîche matinée parisienne, dans le modeste hôtel du 88 de la
rue De la Mare, les fondations du premier groupe de combat bulgare ont été
posées[62].
Restés seuls avec
Bateto, nous, les combattants nouvellement convertis, avons procédé au choix de
notre patron. Presque naturellement, nos regards se sont tournés vers Vlado, le
garçon blond des villages d’Iskar. La proposition de Bateto pour Vlado comme
futur chef a été acceptée à l’unanimité. Une seule question se posait :
comment va-t-il communiquer avec les étrangers qui parlent français ? Nous
avons décidé que je l’accompagne aux réunions en tant qu’interprète. Nous avons
pris une autre décision : rester fidèles à la coutume bulgare et arroser
l’événement. Pour le plus grand plaisir des propriétaires, M. et Mme Artik,
nous sommes descendus au café de l’hôtel. Nous n’étions pas de gros buveurs et
nous faisions rarement la queue à côté du comptoir de zinc. Cette fois, notre
humeur s’était améliorée et à la surprise de la famille française, nous avons
tous bu l’un des apéritifs les plus chers.
La première
rencontre avec Roger, responsable militaire des groupes de combat Main-d’œuvre
immigrée (MOI) de la région parisienne, a lieu au parc des
Buttes-Chaumont. Vlado a posé plusieurs conditions sur comment se déroulera la
rencontre. Nous allons nous asseoir sur un certain banc dans l’allée du parc,
parallèle à la rue Botzaris. Il n’y a pas de buissons autour du banc. Une
petite prairie verte s’étend devant. Le camarade passera devant nous et
s’éloignera. Cela nous permettra de voir si quelqu’un ne suit pas ses traces.
Dix minutes plus tard, il sera de retour, et si nous ne sommes pas partis, il
s’assiéra sur le banc et ouvrira un volume du roman de Stendhal Le Rouge et le Noir. C’est nous qui
entamerons la conversation. La forte expérience conspirationniste de notre
commandant était évidente dans l’organisation de la rencontre.
À 6 h 30 du soir
nous nous sommes assis sur le banc. Le camarade, à qui j’avais été présenté
auparavant par Bateto, passa sans nous regarder. Après lui, nous n’avons
remarqué aucune filature effectuée par la police. Son chapeau gris doux, ses
gants, son apparence soignée, sa démarche énergique ont fait forte impression
sur Vlado. Quand il est revenu, Roger nous a trouvés sur le banc. Vlado m’a
chuchoté de le rassurer qu’il était propre.
En bon français,
Roger nous a expliqué brièvement :
— Les groupes
de combat des émigrés sont formés par nationalité. Le vôtre ne restera en
contact qu’avec moi. Lors de ces premières réunions, on me demande
toujours : « Quand recevrons-nous des armes ? » Vous êtes
probablement aussi intéressés par la question. C’est naturel. Nous pouvons
donner un pistolet à votre groupe tout de suite. Je vais être honnête. Je ne
compte pas vous fournir plus d’armes prochainement. Le parti a décidé que
chaque combattant se fournisse en arme. Par qui ? Par les hitlériens
eux-mêmes. Nous en sommes maintenant à ce stade — armez-vous comme vous pouvez
et en premier lieu aux dépens de l’ennemi. Vous devrez également réfléchir à
quand, où et comment vous approvisionner. Finalement, Roger a demandé :
« Est-ce que tout est clair ? »
Vlado a répondu que
c’était clair et a demandé à qui donner le revolver en premier.
Le responsable des
émigrés a été obligé de répéter certaines choses. En conclusion, il a donné des
instructions d’un ton autoritaire :
— Avec ce
revolver, vous pouvez obtenir une arme pour vous tous. Réunissez-vous et décidez
où et comment mener la campagne « d’auto-approvisionnement ». Faites
le tour des banlieues le soir. Là, les Français ne vous gêneront ni ne vous
trahiront. Je vous donne une semaine. Je vous souhaite bonne chance.
Après avoir reçu le
revolver, notre confiance en nous en tant que combattants de la Résistance
française avait grandi. Nous avons décidé d’agir le lendemain soir. Nous avons
fait des groupes de deux : Vlado et Nikolai Radoulov sortiront avec le
revolver, Nikola Marinov et moi avec des marteaux et des couteaux de
cordonnier. Nous suivrons la périphérie de la capitale.
Pendant la journée,
nous travaillions comme d’habitude, penchés sur des bancos du cordonnier.
La soirée était
fraîche et douce. Enveloppés dans nos vêtements de dessus — Kolyo dans un
imperméable léger, moi dans un pardessus de gabardine verte — nous n’étions pas
différents des piétons français. Nos vêtements servaient aussi de couverture à
nos outils : chacun de nous portait un couteau, un marteau et un poinçon
dans ses poches. Nos calculs et nos espoirs nous ont conduits au quartier Porte
des Lilas, autour de la caserne des Tourelles sur le boulevard Mortier. Nous
avons déambulé dans les petites rues à proximité et en face de la caserne, nous
avons tourné en rond et fumé d’innombrables cigarettes. Avec leur vide et leur
faible éclairage, les rues donnaient à notre présence un aspect mystérieux. Les
rares passants nous regardaient de biais et nous prenaient à coup sûr pour des
agents. Nous regardions et écoutions attentivement, impatients de trouver des
hitlériens civils. Les heures passaient imperceptiblement, ce qui ne voulait
pas dire que nous n’étions pas fatigués. Deux fois, nous sommes allés dans de
petits cafés pour soutenir nos forces avec du café et des sandwichs. Nous avions
déjà erré de la Porte Ménilmontant à la Porte Chaumont. Nous avions parcouru
tout le quartier du Pré Saint-Gervais. La chance ne nous avait pas souri. Une
fois on avait aperçu deux officiers sortant du grand café à l’angle de la rue
Belleville et du boulevard Sérurier, mais ils se dirigeaient droit vers la
caserne voisine, traversant la place plutôt animée de la Porte des Lilas.
Inutile de penser à une quelconque attaque. Le moment approchait pour nous de
prendre rendez-vous avec les deux autres « chasseurs ». Nous ne
voulions pas nous présenter à eux les mains vides. Au risque d’être en retard,
nous avons continué à déambuler dans les ruelles des boulevards extérieurs.
Nous étions désespérés par notre chasse infructueuse et nous nous dépêchions
d’aller à l’endroit convenu. Vlado et Nikolai ont souri mystérieusement lors de
la rencontre au café La Marquise au coin de la rue Belleville et de l’avenue
Bolivar. Notre patron commanda :
— Buvez
vite votre bière, parce que l’on sort. Comment est la récolte ?
Kolyo Marinov
murmura avec lassitude :
— Nulle.
Dommage pour tant de route.
— La nôtre est
riche !... L’addition, garçon ! s’écria Vlado.
En marchant le long
de la longue rue des Pyrénées, nous avons entendu une histoire vraiment riche.
Ils quittèrent tous les deux l’appartement de Nikolai au 51 rue Riquet,
tournèrent dans la rue de Crimée et posèrent le pied sur le boulevard Jean
Jaurès. Il était environ 6 h 30. À cette heure-là, la circulation sur le
boulevard des ouvriers était assez animée. Ils se dirigèrent vers la banlieue
d’Aubervilliers. Soudain, deux gardes de terrain allemands avec de grandes
plaques de fer sur la poitrine sont apparus sur le même trottoir. Nos gars ont
voulu les dépasser, mais les gardes leur ont bloqué le passage et ont demandé
leurs cartes d’identité. Nikolai Radoulov s’est immédiatement rendu compte
qu’il devait agir et, pour gagner du temps, il a commencé à chercher ses
papiers dans sa poche intérieure. Au lieu des documents, il a sorti son
pistolet et a tiré contre l’un des gardes, qui est tombé au sol comme un
cadavre. Il a appelé Vlado pour courir derrière lui. Il a reculé de quelques
pas et a tiré sur le deuxième garde sans le toucher, car il a également reculé
à côté d’une vitrine et a commencé à faucher avec son fusil automatique
Schmeisser. Des piétons, hommes et femmes, criaient et se cachaient dans les
boutiques, dans les maisons, derrière les arbres. Vlado a traversé le boulevard
et s’est mêlé à la foule en fuite, il a réussi à atteindre le passage de Menin
et est entré dans la rue de Meaux. Nikolai s’est glissé dans la rue Moselle et
s’est perdu sur le quai de la Loire. De là, il est rentré chez lui rue Riquet,
a déposé son arme et s’est rendu à l’appartement de sa voisine Charlotte pour
entendre des commentaires sur le meurtre d’un garde allemand et d’un étranger.
— J’ai
tout de suite pensé à vous, cher Nikolai.
— Vous me voyez
vivant et en bonne santé. Et y a-t-il quelqu’un d’autre de tué à part le garde
allemand et qui le revendique ?
— La boulangère
au coin du trottoir en face du boulevard. Elle a tout vu. Il y avait deux
civils. L’un d’eux a traversé le boulevard et s’est échappé, les Français l’ont
laissé passer, et l’autre a été tué par le deuxième garde.
— Les yeux de
la peur sont grands, commenta Nikolai satisfait. — Tout le monde a vu ou pense
avoir vu des choses différentes. L’important, c’est qu’un boche est allé voir
Saint-Pierre.
C’était important,
mais le plus important était le baptême du feu de notre groupe. Un début
vraiment brillant.
Après avoir écouté
notre histoire le lendemain, Roger a commencé à se frotter les mains avec
plaisir, comme si nous étions sur le point de partager avec lui le grand prix
de la loterie nationale. Il s’émerveillait de notre calme relatif.
— Vous ne
semblez pas soupçonner le sens de votre exploit, a-t-il déclaré. — Vous avez
prouvé que la lutte directe ici, à Paris, dans la rue et au grand jour contre
les forces humaines des hitlériens est possible.
Shtarbanov lui a
rappelé que les Français l’avaient déjà prouvé depuis longtemps.
Roger poursuivit sa
pensée.
— Justement les
Français. Et parmi nos émigrants, il y a une théorie selon laquelle nous, les
étrangers, nous ne pouvons pas nous engager dans de telles actions directes.
Depuis quand j’essaie de convaincre notre direction des émigrés que nous avons
le devoir de nous élever au niveau des Français. C’est admirable !
Félicitations de la part de l’état-major de la Main-d’œuvre immigrée de la
région parisienne ! Les camarades du CC du parti français seront eux aussi
satisfaits... Nous annoncerons l’événement dans la presse clandestine...
Nous étions à
l’époque où les groupes de combattants avaient le droit et la tâche de
rechercher eux-mêmes leurs propres objectifs. Livrés à nous-mêmes, nous avons
commencé, comme cela arrive d’habitude, de ce qui est le plus proche et du plus
familier pour nous. Nikolai Radoulov vivait rue Riquet, qui croise la rue
Aubervilliers, où se trouvait l’une des principales brigades de
sapeurs-pompiers de la capitale. Les troupes allemandes avaient occupé la cour
et les locaux des sapeurs-pompiers. Le matin, la cour servait de champ de tir
pour les exercices militaires. Nikolai a suggéré que nous examinions l’objectif
et réfléchissions à la façon dont nous pourrions l’attaquer. Nous observions
tous les quatre le champ de tir, les locaux, les sorties et les entrées, le
mouvement des militaires à différents moments de la journée. Qu’avons-nous
constaté ? Le terrain s’étendait entre les rues Riquet, Labois-Rouillon,
Aubervilliers et Curial. Les soldats allemands venaient du métro Jean Jaurès,
traversaient la place du Maroc et, empruntant les rues de Tanger et Curial,
pénétraient dans la cour par une grande porte de la rue Curial. Dans la cour,
ils posaient leurs fusils en pyramides et tournaient autour d’eux pendant qu’on
leur servait du café ou du thé. Cela se passait entre 6 h 50 et 7 h 00. De
l’autre côté, rue Aubervilliers, se trouvait un immeuble de deux étages où une
compagnie allemande passait la nuit. À 7 heures précises du matin, la compagnie
quittait une petite cour et se dirigeait dans la même rue jusqu’à la gare de
l’Est.
Après plusieurs
jours d’observation, nous avons convenu que l’objectif méritait d’être attaqué.
Mais comment ? Nous avons mis au point un plan selon lequel nous devions
diviser l’action en deux étapes. L’une consistait à enterrer le mouvement
d’horlogerie à un certain endroit sur le sol, exactement là où les soldats
posaient leurs fusils en pyramides. La seconde — mettre du matériel inflammable
devant la porte de la rue Aubervilliers, en l’attachant avec de la ficelle à la
poignée de la porte. Lorsque la poignée est pressée de l’intérieur, le cordon
avec le matériel glisse et explose. La compagnie en rangs serrés à côté de la
porte sera victime des éclats de fer...
La veille de
l’action, Nikolai a gentiment invité sa femme, la Française Marcelina, à passer
la nuit chez ses parents. La seule pièce et la cuisine étaient nécessaires à un
groupe de patriotes français pour une réunion de nuit. C’est nous qui
« étions réunis », bien sûr. Mais nous ne nous sommes pas simplement
réunis. Avec un gros appétit presque nuptial, nous avons dévoré le ragoût
délicieusement préparé par le « cordon bleu » Nikolai. À en juger par
la consommation de nourriture et de bouteilles de vin, ainsi que par un sommeil
sain, qui nous a assommés jusqu’à 5 heures du matin, on peut dire à juste titre
que ces hommes bulgares n’étaient pas à la veille d’un jeu avec la mort, mais
d’un travail régulier dans la coopérative.
Réveillés par le
réveil à 5 heures puis par le café chaud de l’hôte, chacun de nous à l’heure
dite a commencé à accomplir sa propre tâche. Vlado a pris le revolver, les deux
Nikola ont agrippé les deux boîtes en fer enveloppées dans des torchons, et
j’ai porté la troisième boîte enveloppée dans du papier d’emballage. Le premier
couple est descendu dans la rue. Vlado et moi nous avons suivi à 50 à 60
enjambées. De la rue Riquet, nous avons bientôt tourné et sommes entrés dans la
rue Aubervilliers. À cette heure — 6 heures et 40 minutes — dans Paris dépeuplé
et dans ce quartier isolé, les rues étaient désertes. Radoulov et Marinov se
sont arrêtés devant la haute clôture en bois qui entourait la zone du champ de
tir de ce côté. À travers une fente pré-arrangée (le soir, nous avons décloué
une large planche et l’avons attachée de sorte qu’elle ne tombe pas pendant la
nuit), Radoulov s’est glissé dans le champ de tir avec les deux paquets. Kolyo
Marinov est resté sur le trottoir pour des raisons de sécurité. Vlado et moi,
regardant autour de nous et écoutant ce qui se passait dans le local où la
compagnie passait la nuit, nous nous sommes arrêtés à la porte. Je devais
attacher la corde. J’ai essayé une fois — elle glissait et ne tenait pas. Ma
deuxième tentative a également échoué. Vlado a mis le revolver dans ma main et
a commencé à attacher lui-même la corde. Il n’a pas réussi non plus. J’ai
repris la corde. Pendant ce temps, Vlado tenait nerveusement le poids d’une
main et agrippait le pistolet chargé de l’autre. Enfin la corde a tenu. La
boîte était suspendue dans les airs à 40-50 centimètres du sol. Le retard de
2-3 minutes a tendu nos nerfs à l’extrême. Vlado s’est immédiatement dirigé
vers la fente et est entré dans le champ de tir. J’ai attaché la planche après
pour qu’elle n’ait pas l’air déclouée. Seuls Kolyo Marinov et moi étions debout
dans la rue. Il marchait sur le trottoir d’en face près de la rue
Labois-Rouillon. Soudain, un camion ouvert, rempli de soldats allemands, s’est
arrêté à l’intersection de la rue Riquet. À notre peur et à notre surprise, le
camion s’est arrêté à côté de Kolyo lui-même, et le chauffeur lui a demandé
dans un français approximatif : « Monsieur, s’il vous plaît, un
hôpital Bernard ? ». Kolyo a déclaré avec un accent français correct
qu’il ne savait pas. Le moteur ronronna, recula, s’arrêta devant moi, et le
chauffeur perdu me posa la même question. Avec une courtoisie hâtive, j’ai
expliqué comment ils trouveraient le plus facilement l’hôpital. Le moteur a de
nouveau ronronné et Kolyo et moi nous nous sommes regardés comme si nous venions
de parcourir un très long chemin.
Au bout d’un moment,
j’ai regardé par la fente. Les hautes herbes près de la clôture à l’intérieur
m’empêchaient de voir mes camarades, mais heureusement ils étaient près de moi
et je les ai entendu me demander : « Est-ce que c’est propre
dehors ? » Sans me retourner, je leur ai assuré qu’ils pouvaient
sortir... Vlado et Kolyo Marinov étaient les premiers à s’élancer rue
Labois-Rouillon. Nous nous sommes éloignés tous les quatre d’un pas rapide,
d’abord dans deux puis dans quatre directions...
Radoulov s’est
présenté au point de rassemblement, notre coopérative, à 9 heures. Son histoire
nous a rendus... à moitié heureux. La porte de la cour devant la rue
d’Aubervilliers était intacte. Le seul changement — un soldat allemand était de
service. Sa voisine Charlotte racontait avec enthousiasme l’action au champ de
tir ; le propriétaire du café en face de la porte sur le terrain de la rue
Curial a entendu le matin des bruits plus forts que d’habitude, mais les a
attribués aux exercices des Allemands. Plus tard, une ambulance est venue et a
pris les blessés ou les tués — elle n’a pas vu.
Nous avons examinés
longtemps et sous toutes les coutures notre baptême du feu collectif. Nous
avons convenu de continuer sur la même voie, à la recherche de nouveaux
objectifs.
Une autre action
nous attendait. Nous avons cherché l’objectif nous-mêmes et l’avons trouvé
nous-mêmes. C’était un grand garage de réparation de voitures et de camions
allemands sur l’avenue Bolivar entre la rue Gauthier et la rue Des Dunes. Le
garage était proche de notre coopérative. Cela facilitait la tâche — nous
partions souvent en visite : le matin, à toute heure de la journée, tard
le soir jusqu’au couvre-feu. Qu’avons-nous trouvé ? À droite — une petite
cour, à gauche le garage touchait un vieux bâtiment solide, siège du service de
santé municipal. Devant, c’était un mur conique, non peint et écaillé au milieu
avec deux portes : une grande, en fer, montante, et l’autre simple. Le
garde français fermait la large porte à l’intérieur avec un levier de fer, à la
fin courbé comme un crochet, la petite à clé de l’extérieur. Il quittait le
garage à 20 heures et les ouvriers français à 18 heures. Un sous-officier
allemand assez gras était de service dans le garage pendant la journée. Il
inspectait les travaux, recevait et renvoyait des soldats et des officiers
allemands à la porte, laissant des camions et des voitures pour les
réparations. L’inspecteur allait souvent seul ou en compagnie au café d’en face
pour tremper sa gorge dans la bière de guerre. À 17 heures, une voiture gris
acier s’arrêtait devant le garage et emportait le gros. Il y avait un arrêt de
bus sur le même trottoir, juste à droite de la porte du garage. Selon
l’horaire, le bus passait toutes les 12 minutes jusqu’à 22 heures. Toutes ces
informations sur la vie extérieure du garage ne nous satisfaisaient pas. Vlado
a insisté pour que nous nous assurions qu’il y ait des chiffons, des fils de
coton pour essuyer, de l’essence et de l’huile de machine à l’intérieur, afin
que nous n’ayons pas à les transporter dans les rues et à prendre des risques
inutiles. Roger recula et accepta de nous attribuer une camarade qui, avec l’un
de nous, en l’occurrence moi-même, viendrait sous un prétexte quelconque et
verrait de ses propres yeux ce qui nous intéresse.
Lors de la rencontre
prévue, la camarade s’est présentée comme Bianca. D’après plusieurs réflexions
que j’ai échangées à propos de la prochaine visite, j’ai eu l’impression de me
trouver face à une intellectuelle. Français parlé sans accent. Nous avons
envisagé divers prétextes pour notre visite au garage. On s’est mis d’accord
sur le plan suivant : elle portera un filet à provisions avec une assiette
enveloppée en bas, un paquet dessus et deux bouteilles d’eau-de-vie de raisin,
je me procurerai un sac d’avocat pour avoir l’air d’un employé. Nous entrerons
à 17 h 30 pour ne pas rencontrer le sous-officier allemand et pour que les
Français puissent se détendre dans les explications que nous aurons à nous
donner. Elle portera un bout de papier avec l’adresse exacte du garage et un
nom breton fictif ; forcément un des noms sera Yves — typique de la région
bretonne ; nous annoncerons que nous sommes ses cousins et que nous
portons des provisions des vieux parents : poulet, etc.
Au cours de ces
années de guerre affamées, l’effet du poulet et de l’eau-de-vie était
stupéfiant. Les ouvriers amusés rassemblés autour de nous se sont presque léché
les babines. Tout le monde regrettait qu’un Breton aussi intéressant, Yves
Kazar, ne travaille pas parmi eux.
J’ai laissé Bianca
parmi le groupe des travailleurs et je me suis approché d’un travailleur âgé
penché sur un moteur. Je lui ai demandé :
— Y-a-t-il
beaucoup de boulot ?
— Le travail
n’a pas de fin. Il augmente toujours et ne diminue jamais. Qu’ils les abîment
ou que d’autres les abîment, je n’en ai aucune idée, mais les voitures
n’arrêtent pas d’entrer dans le garage. L’inspecteur allemand, telle une
panthère fait la navette parmi nous et ne connaît qu’une chose, son Schnell[63] !
— Les
voitures sont-elles uniquement à des boches ?
— Il y en a
d’autres, leurs collaborateurs.
Je me retournai
encore une minute ou deux pour voir la chose la plus importante : au fond
se trouvait une pièce avec une porte, sans fenêtre, bourrée de pneus usés, et à
côté de la porte un tonneau ouvert, presque plein d’huile moteur. Je n’ai pas
remarqué de fils de coton pour essuyer, mais des chiffons étaient éparpillés
partout.
Bianca se sentait
comme un poisson dans l’eau. Des rires et des taquineries se faisaient déjà
entendre dans son groupe. À un signe, elle s’est excusée de les avoir dérangés,
et nous nous sommes dit « au revoir » dans la meilleure des humeurs.
Nous nous sommes éloignés d’un pas normal puis, nous nous sommes arrêtés et
avons pris le premier taxi que nous avons croisé.
Trois semaines se
sont écoulées depuis que nous avons étudié l’objectif et l’avons menacé à haute
voix et en sourdine. Lorsque nous avons annoncé notre décision à Roger, il nous
a pris pour des fous et a voulu voir par lui-même si notre plan était possible.
Le plan était vraiment original et audacieux. Il consistait à faire ce qui
suit. À six heures précises de l’après-midi, les ouvriers sortent du garage par
la large porte et se dispersent dans différentes directions vers le métro ou le
bus. Le garde pendant ce temps est généralement dans la cabine ou devant
celle-ci. À ce moment, alors que tout le monde sort et est pressé, un homme
courageux peut se faufiler sans se faire remarquer et se cacher derrière un
camion qui est toujours près de la porte. La visite que nous avons faite un
soir à six heures avec Roger s’est transformée en répétition générale. Touchant
le mur à l’extrémité droite de la porte, j’ai clairement montré à mon
interlocuteur que maintenant je peux me faufiler sans me faire remarquer.
Pauvre Roger ! En tant que commandant militaire, il persuadait et
encourageait généralement les combattants à recourir à des actions plus
audacieuses. Pour la première fois, il s’est senti dépassé par un groupe, alors
il a jugé nécessaire de nous retenir. Il s’est retourné et m’a demandé pourquoi
nous n’essayions pas à nouveau d’obtenir une empreinte de la serrure de la
petite porte.
— Nous avons
essayé trois fois avec des empreintes à la cire, nous avons échoué.
— J’enverrai
mes techniciens. Attendons qu’ils nous transmettent leur expérience.
— Nous ne
voulons pas que l’action soit connue d’un large éventail de personnes. Certains
se sont même opposés à Bianca.
— D’accord. Si
ce n’était pas votre groupe, je ne serais pas d’accord... Je vous apporterai
l’aide que vous souhaitez. Un camarade agira avec vous trois à l’intérieur,
deux autres, armés, garderont l’extérieur jusqu’à ce que vous ayez fini.
— Qui
et quand serons-nous mis en contact avec eux ?
— Je vous les
amènerai cinq minutes avant l’action. Quant à Bianca, dis à tes camarades
qu’elle n’est pas par hasard dans le mouvement et que je ne l’ai pas envoyée
par hasard pour vous aider[64].
Ayez plus de confiance dans les autres.
La confiance est une
bonne chose, mais la prudence, voire exagérée, aussi n’est pas superflue. Il
est possible que notre groupe, et Vlado en particulier, ait exagéré, obsédé par
les mesures de précaution, mais il est très difficile de dire ce qui est le
plus nécessaire : la confiance ou la conspiration dans des circonstances
aussi dangereuses.
Notre prudence
exagérée explique que nous ayons reçu l’aide des services techniques deux jours
avant et loin des lieux de l’action. C’est de notre faute si nous avons craint
les matériaux pendant deux jours entiers : un rouleau de coton imbibé de
pétrole et de paraffine pour entretenir le feu, un cordon Bickford et un bidon
d’essence. Nous avons recouvert tout cela de déchets divers, des bouts de
semelles de cuir, de cuir et de carton dans la pièce au rez-de-chaussée de la
coopérative, où, je vous le rappelle, se trouvait la presse à couper les
semelles.
Vlado nous a
rassurés en affirmant que même s’ils étaient découverts, nous dirions qu’il
s’agit d’une provocation de la part d’un de nos rivaux, un fabricant de
chaussures. Le deuxième jour, ils ont effectivement été découverts. Ils ont été
découverts par notre propre ami et coopérateur Kosta Dramaliev :
— Qu’est-ce que
vous faites, têtes de chien ? Et faites-les sortir d’ici, parce que, vous
savez, nous donnons la clé à Madame Artik, et elle peut fouiller la pièce à
tout moment.
Notre commandant le
rassura :
— Collègue, le
coup va bientôt partir, sois confiant !
Et effectivement,
cette nuit-là, le garage a pris feu !
À 17 h 30, Vlado
nous proposa de tirer au sort pour savoir qui sera le premier à entrer dans le
garage. Nous étions trois dans la coopérative : Vlado, Kolyo Marinov et
moi. J’ai survécu à ce tirage au sort avec beaucoup de peur. Des trois, j’étais
le plus grand ; donc le plus inadapté à l’action en question. J’ai plissé
les yeux et attrapé l’un des trois bouts de papier avec le simple mot
« oui ». J’ai sorti et déplié le papier du destin. C’était propre...
C’était au tour de Kolyo Marinov. Calme, il a dit que la chance était
maintenant soit celle de Vlado, soit la sienne. Il préférait que cela soit lui.
Et Kolyo lâcha sa main musclée au fond de la casquette de Vlado. À ce moment,
mon ami Kolyo, avec ses yeux pétillants et ses cheveux luxuriants,
m’apparaissait comme le Mucius Scævola
romain, mettant la main sur le feu pour prouver que les Romains étaient prêts à
mourir pour la ville sainte. Il a rapidement retiré sa main, a déplié le papier
et a crié :
— Je
vous l’ai dit, que cela porte bonheur !... Vlado, donne-moi le pistolet,
et vous avec Boris attrapez des couteaux et des marteaux et soyez prêts à me
défendre. Je répète l’arrangement : s’ils me trouvent, je tire et cours
dehors vers la rue Des Dunes. Soit vous vous retirez, soit vous venez à mon
aide...
Nous n’avions pas le
temps de remâcher le plan convenu des centaines de fois à la minute et à la
seconde près et dans les moindres détails.
Nous avons quitté la
coopérative à 18 h 15. Par la rue des Pyrénées et l’avenue Bolivar nous sommes
arrivés jusqu’au garage en sept minutes. Nous marchions séparés les uns des
autres, Kolyo sur la gauche, Vlado et moi sur le trottoir de droite. Nous
étions tous les trois habillés comme des Français ordinaires. Nous avons
regardé Kolyo. Il s’est arrêté au coin de la rue Gauthier, puis a tourné un
instant devant l’arrêt d’autobus et s’est tenu finalement contre le mur du
garage près de la porte. Au bout d’un moment, les ouvriers ont commencé à
sortir. Soi-disant, nous attendions tous les deux le bus pour être le plus près
possible de « l’écrivain », comme Vlado appelait notre formidable
camarade. Nous savions qu’il y avait exactement vingt-sept ouvriers. Kolyo
devait se faufiler à l’intérieur après que le vingtième ouvrier ait quitté le
garage. À mon tour, je comptais aussi les ouvriers, et de temps en temps je
jetais un coup d’œil à Kolyo, qui s’approchait de l’extrémité droite de la
porte en fer. Nous échangions des regards significatifs avec Vlado. Jusque-là,
tout allait bien. Personne ne soupçonnait le lien entre les trois citoyens
ordinaires, dont deux n’étaient pas montés dans le bus qui venait de passer.
D’apparence discrète, petit, sec, Kolyo passait inaperçu au milieu des ouvriers
sortants, trop occupés pour quitter au plus vite le garage. Je comptais les
travailleurs, mais je me suis trompé. La place de Kolyo était vide. J’ai
regardé Vlado. Ses yeux bleus riaient. Il m’a fait un clin d’œil comme à une
fille de village. Je me suis réjoui sans que la tension ne me quitte.
Involontairement, j’ai serré le couteau de cordonnier dans ma poche droite.
Alors maintenant, un dénouement terrible pourrait se produire : il
pourrait être trouvé, attrapé ou poursuivi, il pourrait appeler à l’aide et
nous devrions nous précipiter à l’intérieur du garage. Silence. Le dernier
ouvrier sortit, attendu par sa femme ou sa maîtresse venant juste d’arriver,
ils s’embrassèrent et s’éloignèrent. Silence. Dans la rue mouvement des piétons
ordinaires des deux sexes et de tous âges. Parmi eux se trouvaient des gardes
en uniforme qui avaient terminé leur service de la journée et retournaient au
poste voisin. Le gardien du garage est sorti par la petite porte, a regardé sur
le trottoir, a craché, a fumé une cigarette et s’est caché à l’intérieur.
Suivra-t-il son
emploi du temps quotidien aujourd’hui ? Oui, dix minutes plus tard, il
arrive, pousse et ferme la grande porte. On l’écoute mettre le levier de fer
avec le crochet à l’intérieur. Maintenant nous sommes deux à l’extérieur, ils
sont aussi deux à l’intérieur ; l’un se cache comme une souris, l’autre on
ne sait pas ce qu’il fait : est-ce qu’il nettoie, mange, boit, dort,
lit ?
Le temps passait.
Nous avons marché devant le garage, nous nous sommes tenus sur le trottoir
opposé, nous sommes même entrés dans le parc voisin des Buttes-Chaumont et nous
avons également regardé de là.
Dix-neuf heures
approchaient. Vlado s’est rendu compte qu’il était temps de disparaître et a
proposé d’aller à la coopérative, à la fois pour un alibi et pour nous mouiller
la gorge.
Vers 20 heures, nous
étions de retour à notre poste sur le trottoir d’en face devant le garage. Le
garde est resté fidèle à son emploi du temps. Il sortit par la petite porte, la
ferma à clé et emprunta la rue Gauthier, comme d’habitude, la tortueuse rue
Rébeval jusqu’à son appartement de la rue Atlas. Nous l’avons suivi
discrètement jusqu’à son café habituel au coin de la rue Vincent. Là, il ne
s’attardait habituellement pas plus de 15 minutes et se dirigeait vers la
maison. En le voyant s’enfoncer dans la longue entrée voûtée d’une vieille
maison à trois étages, nous nous sommes calmés. En remontant la rue Rébeval, nous
sentions la faim familière de nos jeunes années nous gratter l’estomac. Vlado
n’a pas eu à répéter sa suggestion de s’arrêter et de dîner au restaurant grec
de la même rue. Nous avons mangé copieusement. L’argent n’avait aucune valeur
pour nous à ce moment-là.
Selon l’arrangement,
à 22 h 05, Kolyo mettrait le journal Le
Matin sous la grande porte. Cela signifierait : « Tout va bien,
je tirerais la porte 20 minutes plus tard. Nous devions répondre par deux coups
que nous étions prêts.
Tout a fonctionné comme
sur des roulettes. Kolyo a sorti le journal et nous sommes allés au
rez-de-chaussée de notre coopérative. Nous avons dû nous dépêcher pour être de
nouveau devant le garage 20 minutes plus tard. Tout le monde a pris un paquet –
Vlado le cordon Bickford, moi le rouleau de coton et le bidon d’essence — nous
sommes rentrés à l’heure. Roger nous attendait sur la rue Gauthier et l’avenue
Bolivar. Il désigna un petit jeune homme en imperméable blanc à deux ou trois
mètres de côté.
— Il
ira à l’intérieur. Là, vous lui direz ce qu’il doit faire. La sécurité est
maintenant sur le trottoir d’en face. Une fois que vous serez entrés, ils
s’installeront ici... Courage ! Au revoir et à demain.
Nous nous sommes
approchés du garage. Nous avons donné les deux coups convenus et la porte
coulissante s’est ouverte. Nous nous sommes glissés à l’intérieur avec les
paquets. Le jeune homme à l’imperméable s’est faufilé derrière nous. La porte
s’est refermée.
Kolyo nous
accueillit avec joie et murmura :
— J’en ai marre
de rester immobile. J’ai fait une inspection. Beaucoup de chiffons, nous
utiliserons également des vêtements de travail. J’ai déjà enduit beaucoup de
moteurs et de sièges avec de l’huile de machine.
— Vite
maintenant... En silence ! Vlado a commandé.
J’écoute attentivement.
Dehors des pas – ils passent et repassent.
Tous les trois, nous
connaissions nos tâches. J’étais chargé de dire au nouveau camarade quoi faire.
J’ai commencé à lui expliquer en français. Il m’a posé une ou deux questions.
Je l’ai reconnu à son accent — un Polonais.
Kolyo et moi
marchions silencieusement de machine à machine. Nous enduisions partout d’huile
que nous écopions avec des seaux et des entonnoirs. Avec nos couteaux, nous
déchirions les sièges et l’intérieur des portes des voitures et des camions.
Vlado montait et descendait des voitures, coupant les sièges et mettant des
mèches à l’intérieur et à l’extérieur. À un moment donné, il nous a crié de
faire attention à ne pas nous salir. Il plaisantait, mais son avertissement est
venu à temps. Pour Kolyo et moi, c’était un vrai problème — comment ne pas se
salir pour sortir et avoir l’air décent. Nous avions les mains déjà bien
huilées, mon imperméable était déjà très abîmé, nous avons commencé à protéger
nos costumes. J’ai regardé notre ami polonais. Il était trop tard pour le
prévenir — il avait complètement sali son imperméable.
La quinzième
minute ! Nous avons continué à salir fiévreusement, jetant partout des
morceaux de coton, des chiffons et des vêtements de travail. Vlado a
commandé :
— Ouvrez toutes
les portes des voitures. Que les flammes entrent partout... Arrosez le tout
d’essence. La cabine du garde aussi. Si c’est amusant, qu’il en soit
ainsi !
La vingtième
minute ! Nous terminions. J’ai éclaboussé le reste de l’essence sur le mur
du bas. Vlado nous a ordonné de nous laver les mains. Il y avait un lavabo près
de la porte en bas. Nous avons trouvé du savon et une serviette sale. Nous nous
sommes lavés et essuyés tant bien que mal.
Kolyo et moi avons
allumé les mèches sur le côté. Dans cinq ou six minutes, elles brûleraient et
leur étincelle atteindrait le siège de deux voitures. Vlado a allumé une mèche
menant au baril d’huile de machine renversé et une autre à la cabine. Les
flammes montaient lentement.
Nous sommes sortis
un par un. Kolyo s’est attardé un peu. Il ajusta de sa main gauche le crochet
du levier pour tomber droit dans le cerceau de fer et serrer la large porte.
Vlado tapota l’épaule du jeune Polonais avec une salutation espagnole :
« Saludo compañero ! »
Nous signalâmes aux deux hommes de la sécurité que tout était fini.
Selon l’arrangement,
les trois Bulgares, d’une manière différente et la plus courte possible,
retournèrent au repaire commun de la rue de la Mare. Nous étions heureux de
nous revoir vivants et en bonne santé. Nous nous sommes nettoyés, lavés et
avons parlé.
— Nous avons
fait du bon travail, a déclaré Vlado.
— Est arrivé,
ce qui devait arriver ! Demain, les Deutsches grinceront des dents, mais
ils resteront un doigt dans la bouche — Kolyo sourit.
— Je ne regrette
qu’une chose, dis-je. — J’ai pensé, mais je n’ai écrit nulle part « À bas
le fascisme ! » Cela ...
— Ce n’est pas
si simple, interrompit Vlado. Les flammes sont nos slogans ! » Ne
regrette pas, ils sauront à qui appartenait le feu...
Le lendemain, je suis
allé travailler à une heure normale, mais dans une humeur inhabituelle, un
prolongement de la joie de la nuit dernière. Vlado nous a dit qu’il était
impatient et a pris un bus passant devant le garage tôt le matin. Il y avait
des gardes. À l’intérieur, il a aperçu les squelettes de fer de nombreuses
voitures brûlées.
Vers 10 heures,
Kolyo et moi avons également marché devant le lieu de l’action de la nuit
précédente. Nous avons vu des restes de fer tordus de camions parfaitement
brûlés dans le garage, deux camions sur le trottoir et trois voitures
relativement peu brûlées sur la voie de l’avenue. Le mur extérieur était brisé,
vraisemblablement pour ménager une ouverture pour les pompiers et les voitures.
Mais nous n’avons pas vu le garage brûler. C’est ce que nous a raconté la femme
bulgare Tyrion[65],
qui habitait avenue Bolivar en face du garage, après la libération de Paris en
1944.
Roger,
habituellement sévère et critique, n’a pas retenu ses louanges cette fois. Il
criait juste :
— C’est
formidable !... C’est formidable !
Vlado l’a arrosé
d’une douche froide. Il lui a dit qu’on ne voulait pas de compliments, mais des
armes. Qu’il ne nous raconte pas des balivernes, n’en trouverait-il pas au
moins une ? Ou les autres groupes étaient-ils comme nous, avec une seule
arme ?
— Alors malheur
à nous ! — a conclu notre bon chef Vlado.
Roger fronça les
sourcils, se tut et devint très sérieux, nous parlant longuement dans l’esprit
suivant :
— Vous êtes
communistes, vous êtes dans le mouvement depuis longtemps et je vais être
honnête avec vous... Il y a quelques mois le CC du Parti Communiste Français a
appelé nos camarades responsables émigrés. Il leur a dit que vous, les
étrangers, deviez également participer aux groupes de combat. Et savez-vous ce
qu’il leur a donné au début ? 300 francs et cinq revolvers. Ne
pouvions-nous pas accepter, objecter ? Nous étions communistes, nous
devions faire preuve d’initiative. Je ne divulguerai pas un secret du parti en
vous disant — nous avons obtenu assez d’argent grâce à ces cinq pistolets. Mais
on est quand même mal avec les armes... Vous avez raison d’insister. Mais
n’oubliez pas qu’il existe des groupes de combat sans armes à feu. J’avoue que
vous avez pris beaucoup de risques dans cette action avec un seul revolver.
Mais vous vous êtes bien comportés, vous avez bien agi et les résultats sont
excellents : plus d’une vingtaine de voitures détruites, le garage
paralysé pendant au moins une semaine. Encore une fois, au nom de l’état-major
de la région Parisienne, je vous salue et vous dis « Bravo »... Et
maintenant, à quand la prochaine action ?
Vlado était un peu
ennuyé par la question et m’a demandé de donner la réponse suivante non
seulement abrupte, mais aussi sèche :
— Quand nous
trouverons un objectif approprié et quand nous le déciderons.
Trois jours après
cette réunion, le même Roger m’informa que le Comité central du Parti
communiste français qualifiait de brillante l’action de l’avenue Bolivar. Il
s’excusa pour la nervosité de l’autre jour et ajouta :
— Dites à
Gaston (pseudonyme de Vlado) que vous pouvez agir quand, où et comme bon vous
semble. Vous êtes tous politiquement mûrs, bien préparés et avec une grande
expérience de la conspiration. Enfin, il a promis de livrer un deuxième
revolver pour la prochaine action.
À ma grande
surprise, Roger étirait la rencontre et la conversation, ce qui était en
contradiction avec sa manière énergique de mener les affaires. Il m’interrogea
sur la coopérative, sur nos revenus, sur la perspective d’existence de la
coopérative en l’absence grandissante de semelles de cuir et de clous
(massivement saisis et transportés en Allemagne), sur mon état civil en France,
sur certains moments de mon passé (profession principale, postes de direction,
manifestations de combat, prisons, Espagne, etc.). Échaudé, voire piqué par des
traîtres, j’essayais d’être le plus retenu possible dans mes réponses. Je me
suis séparé de Roger un peu perplexe : ne devrait-il pas, en tant que
chef, connaître mon passé, communiqué à la direction du parti ?
Il y a eu une courte
période de repos, pendant laquelle nous avons continué à chercher des objectifs
et sans trouver ceux qui nous convenaient. Nikolai Radoulov nous a sauvés de
cette situation difficile. Il avait travaillé dans un atelier mécanique dans la
banlieue de Montrouge et l’avait quitté dès qu’il avait commencé à travailler
exclusivement pour les besoins de l’occupant. Il le connaissait comme sa poche.
À l’intérieur se trouvaient des tours précieux, des fraiseuses et des
perceuses, des appareils de mesure et d’autres appareils. Les dommages se
chiffreraient en millions si nous pouvions le détruire. Des voitures chères
Mercedes, Opel, Lancia et autres étaient constamment garées dans la cour.
L’éternel critique
Vlado voulait que quelqu’un d’autre vérifie si l’objectif méritait notre
engagement. À l’insu de Nikolai, il m’a ordonné d’entrer dans l’atelier et de
rapporter ensuite ce que j’avais vu. J’ai exécuté la commande sous prétexte de
faire réparer ma voiture « privée », à moi, le « représentant de
parfums ». J’ai longtemps supplié le chef de l’atelier — un Français
énergique d’une quarantaine d’années, aux cheveux roux. Il m’a avoué que si
cela ne tenait qu’à lui, il accepterait volontiers de me servir, mais il lui
faudrait demander l’autorisation préalable à l’observateur allemand, un
lieutenant ingénieur. Dernièrement il avait toujours refusé, alors il m’a
conseillé de ne pas insister et de ne pas venir une seconde fois.
Après ma visite,
j’ai confirmé les informations de Nikolai. Nous avons décidé d’agir. Nous étions
confrontés à deux difficultés : premièrement, l’atelier était à plus d’une
heure de route de notre fief, la coopérative ; deuxièmement, nous ne
pouvions pas penser à casser la porte ou les vitres aux cadres de fer. Des
gens, des policiers et des gardes militaires allemands passaient presque
constamment sur l’avenue Aristide Briand, où se trouvait l’atelier. La deuxième
difficulté a été surmontée relativement facilement. Nikolai Radoulov nous a
fourni un passe-partout. Nous avons testé avec succès cette invention
médiévale.
Nous étions fiers de
l’action réussie du garage. Nous avons pris un très gros risque par rapport à
la première difficulté — l’éloignement de l’objectif. Que signifiait cette
difficulté ? Il fallait transporter les matériaux incendiaires — coton
roulé imprégné de paraffine, cordon Bickford et un bidon d’essence – de la
coopérative du métro des Pyrénées, voyager avec eux et les deux revolvers
jusqu’à la station Châtelet, là après un très long couloir souterrain les
matériaux en main embarquer dans les wagons du train pour la Porte d’Orléans. À
la dernière station du même nom, descendre et marcher le long de la longue
avenue Aristide Briand. Tout ce voyage ressemblait à une véritable promenade
sur des charbons ardents. À tout moment, nous pouvions tomber sur une
perquisition policière, souvent pratiquée dans le métro, et dans les rues, sur
les autorités d’occupation, Roger nous a proposé de nous remettre les matériaux
à proximité du lieu de l’action. Le chef de notre groupe a catégoriquement refusé.
Il ne faisait pas confiance à l’entourage de Roger, pas même à Roger, et Vlado
lui-même a soulevé la question de la confiance :
— Si vous nous
croyez, vous nous donnerez les matériaux où nous voulons. Lorsque nous
déclencherons l’incendie, nous vous montrerons l’endroit pour vous en assurer.
Traduisant les
termes de mon commandant direct, je me suis permis d’ajouter qu’il nous a donné
un ultimatum : « Si vous êtes d’accord avec Roger, faites l’action
sans moi. »
Roger se résigna
avec un soupir.
— Nous devons
travailler avec les combattants tels qu’ils sont… Agissez. Je vous souhaite
bonne chance !
Vlado poursuivait
ses idées obstinément. Il m’a demandé de lui transmettre notre gratitude pour
le deuxième revolver et de lui rappeler de ne pas oublier le troisième et le
quatrième ; pour lui dire de ne pas s’inquiéter pour nous, nous ne nous
laisserons pas attraper vivants. À quoi Roger a répondu :
— La
lutte a besoin de combattants vivants, pas de héros morts.
Le chef militaire
avait raison. Nous avons nous-mêmes naturellement pris toutes les mesures pour
éviter une victime prématurée. Nous nous sommes longuement disputés, par
exemple, à quelle heure de la journée ou de la soirée transférer les matériaux.
Vlado a exclu le taxi : le chauffeur pouvait se souvenir de nos visages,
il pouvait avoir des doutes sur les colis, notamment sur le bidon d’essence.
Dans le métro, d’accord, mais quand exactement ? D’après nos observations,
l’heure la plus propice était de 18 h à 19 h, aux heures de pointe, lorsque les
perquisitions policières et les embuscades se faisaient plus rares.
Décidé — fait. Nous
voilà réunis, dans une soirée parisienne d’été étouffante, nous trois — Vlado,
Kolyo Marinov et moi, chacun avec un paquet à la main — sortant de notre
repaire de la rue de la Mare, traversant la rue des Pyrénées et nous enfonçant
dans la station de métro. L’ordre est clair : nous voyageons en deuxième
classe, toujours dans la même voiture, sans échanger de mots entre nous — ne
pas trop nous éloigner les uns des autres ; Charles, c’est-à-dire
moi-même, sera le premier à sortir de la voiture et des gares ; quand ils
essaieront de nous arrêter en chemin, peu importe où, Vlado et moi tirerons et
dans le tumulte, laissant les colis, tout le monde se sauvera du mieux qu’il
pourra ; rendez-vous au restaurant grec de la rue de la Harpe dans le
quartier Saint-Michel.
Oui, nous avons
voyagé. Non sans excitation et... non sans accidents. Kolyo est descendu de la
voiture à la station Châtelet en dernier, et en raison de la grande bousculade
des passagers, son paquet s’est déplié, le rouleau de coton s’est étiré le long
du quai et il a essayé en vain de le rembobiner. Le train est parti. Le quai
s’est vidé de ses passagers. Vlado a poussé une injure bulgare à Kolyo et est
venu en même temps à son aide. Le paquet emballé au mieux, ils se dirigèrent
vers la sortie du quai, où je les attendais, brûlant d’impatience et de colère.
Mais je n’avais pas le droit de juger aussi sévèrement mon camarade maladroit.
Nous avons traversé rapidement le long tunnel souterrain en direction de la
ligne Porte d’Orléans-Clignancourt. Dans la hâte devant le train arrêté à
l’instant, j’ai trébuché et je me suis effondré sur le bidon renversé. Certains
passagers m’ont grondé, tandis que d’autres ont condamné mon arrogance de
voyager avec de tels bagages aux heures de pointe. Vlado m’a lancé un regard et
un sourire qui trahissaient sa pensée : « Des apprentis écrivains
ratés — et ils ont entrepris de renverser le royaume d’Hitler. »
Nous sommes sortis
de la station Porte d’Orléans en toute sécurité. Nous avons emprunté l’avenue
Aristide Briand sur différents trottoirs. Je devais atteindre la porte de
l’atelier en premier. J’ai regardé autour de moi et j’ai écouté pour voir s’il
y avait du bruit dans la cour. J’ai laissé le bidon devant la porte et j’ai
traversé le trottoir soi-disant à la recherche d’un homme dans un café voisin.
Les deux derrière moi se sont arrêtés à la porte. Vlado l’ouvrit avec le
passe-partout et ils se glissèrent à l’intérieur avec les paquets et le bidon.
Je suis resté dehors pour la sécurité, pour surveiller, signaler et agir si
nécessaire.
Après m’être
débarrassé du bidon et après que Vlado et Kolyo aient disparu derrière la porte
d’entrée, j’ai poussé un soupir de soulagement.
Pendant les dix
premières minutes, ma tension s’est graduellement apaisée. Sur le comptoir du
café d’en face, j’ai bu un verre de bière les yeux fixés sur la porte du
studio. La circulation piétonne se raréfiait. Un couple de patrouilleurs
allemands est passé sur mon trottoir. La patrouille elle-même n’était pas
dangereuse, mais elle rappelait le danger constant. J’ai marché lentement après
le couple, qui marchait presque négligemment sur un certain itinéraire. Je suis
retourné et j’ai marché sur le trottoir de l’atelier. J’ai regardé ma montre.
Les camarades agissaient pendant près de 20 minutes. Dehors, tout était normal.
Les gens, en couple ou individuellement, marchaient avec leurs soucis et leurs
pensées. L’atelier était au coin de l’avenue Aristide Briand et d’une rue
sombre. Je m’approchai des petits carreaux des fenêtres et à travers la vitre
brisée de l’une d’elles je chuchotai que tout allait bien dehors. Vlado de
l’intérieur, d’une voix sifflante, m’a dit de déguerpir et j’ai continué ma
tournée.
La montre indiquait
la trentième minute. Fin du jeu ! Oui, mais les personnages ne sortaient
pas pour se montrer. Je m’approchai à nouveau du verre brisé. J’ai de nouveau
chuchoté : « Une demi-heure s’est écoulée. Terminez ! » Le
chef a répondu : « Nous savons. »
La finale a duré
cinq ou six minutes. Kolyo est sorti le premier. Après lui, Vlado, en tant que
véritable propriétaire, a calmement fermé la porte. Ils traversèrent bientôt le
trottoir d’en face. Nous nous sommes rencontrés tous les trois peu de temps
après à la Porte d’Orléans. Mes amis étaient de bonne humeur. Sur la suggestion
de Kolyo, nous avons pris un taxi. Vlado a accepté à cause des armes...
Nous sommes
descendus du taxi à la station Botzaris, loin de la coopérative. Nous nous
sommes dépêchés de cacher les revolvers dans les restes des semelles de cuir de
notre chambre au rez-de-chaussée. Vlado et Kolyo se sont lavés et rafraîchis.
Nous avons tous les trois terminé la soirée par un bon dîner dans un restaurant
grec, pas dans le quartier Saint-Michel, mais rue Rébeval. En se régalant avec
son vin Beaujolais préféré, Vlado nous a révélé qu’il s’était assuré que le feu
engloutisse tout dans l’atelier. En même temps, il a profité de l’occasion pour
détruire plusieurs machines délicates. Kolyo s’est également vanté d’avoir
détruit deux ou trois fraiseuses et perceuses. Entre autres, ils ont tous les
deux cassé tout appareil, qui leur paraissait délicat et précieux…
Les échos sont venus
de nombreux côtés. Roger, seul ou par l’intermédiaire d’autres personnes, avait
constaté les grands dégâts causés. Nikolai Radoulov, qui se serait trouvé par
hasard dans la maison d’un ancien collègue, nous a apporté la très bonne
nouvelle : l’atelier ne fonctionnera pas pendant un mois. Nikolai
Zadgorski, venu parler à la coopérative, nous a transmis les jurons d’un de ses
supérieurs dont la voiture a complètement brûlé dans le garage de l’atelier.
— Ce patron à
moi est un baron bavarois et est terriblement indigné par les « moyens de
lutte indignes » que les Français utilisent. Il s’était plaint toute la
journée que c’était une nation dégénérée de lâches et de scélérats. « Nous
les avons vaincus au front. Qu’ils essaient de nous vaincre, mais pas par des
embuscades, mais là, encore une fois sur les champs de bataille d’honneur — armée
contre armée. »
Kolyo Marinov frappa
plus fort avec le marteau de cordonnier et conclut :
— Eux, les
Deutsches, n’ont pas entendu parler de nos Levski et Botev, mais maintenant ils
comprendront que les peuples se battent contre les oppresseurs nationaux où et
quand ils les trouvent et comme ils le peuvent.
Il était clair
désormais que nous étions devenus de grands conspirateurs en dix minutes.
Zadgorski, doué d’un esprit alerte et d’une perspicacité aiguë, nous a regardés
réagir à l’histoire, comment nous nous sommes regardés et avons souri, et
soudain il s’est cogné le front et s’est écrié :
— Eh bien,
votre peau de partisan, il paraît que c’est toi le français qui a visité
l’atelier hier soir !?
Nous avons de
nouveau souri. Kolyo et moi nous nous sommes regardés avec une fierté cachée et
nous étions prêts à nous trahir. Vlado, sentant le danger de loin, nous a
arrêtés sur le chemin d’une brûlante franchise amicale :
— Eh
bien, chacun devrait s’occuper de son travail. Toi le tien, nous le nôtre.
Et de nouveau nous
nous sommes penchés sur le banco du cordonnier et avons travaillé avec nos
marteaux et nos poinçons courbés.
La rencontre
suivante avec Roger eut lieu rue Alphonse Karr dans le 19e arrondissement. Il
nous avait indiqué cette rue dans un but précis. Elle est courte, bordée de
part et d’autre de deux grands ensembles immobiliers populaires. Ses habitants
sont des ouvriers ordinaires ou des fonctionnaires subalternes. Cette fois,
Roger portait une casquette et une écharpe grise autour du cou. Il avait pris
des mesures pour se fondre dans le paysage environnant. Vlado et moi ne
différions pas beaucoup des habitants de cette rue prolétarienne.
Roger a commencé la
conversation avec des compliments pour nous :
— Vous
connaissez l’attitude de la direction envers vous. À ses yeux, vous êtes un
groupe d’élite. Elle pense qu’il est temps de passer à des formes supérieures
de lutte. Suivez-moi le long des rues de Cambrai et Corentin-Cariou
jusqu’à la Porte de la Villette. Là nous nous arrêterons pour attendre les bus
pour la banlieue d’Aubervilliers et je vous expliquerai la nouvelle marche à
suivre que nous vous proposons.
La rue Corentin-Cariou était relativement fréquentée. Les gens sur les trottoirs
se pressaient dans deux directions. Il était environ sept heures et demie du
soir. Le mois de septembre justifiait nos imperméables.
Roger s’arrêta
devant le premier arrêt de bus, sans faire la queue derrière les quelques
personnes qui attendaient. Alors que nous nous approchions du chef militaire
pour allumer nos cigarettes, il suggéra :
— Regardez
exactement où le bus s’est arrêté. Suivez-moi à nouveau sur le boulevard
Macdonald. Là, je vais vous expliquer ce dont vous avez besoin.
Nous sommes restés
debout quelques minutes, avons regardé le bus, les passagers, jeté un coup
d’œil sur les chauffeurs et les contrôleurs, et avons continué après Roger.
Sur le côté droit du
boulevard, de hautes habitations municipales s’élevaient comme un mur coloré
avec leurs briques jointées rouges et vertes. Roger a ralenti son pas, nous
l’avons rattrapé et avons marché ensemble. Il y a eu une conversation entre lui
et Vlado.
— Avez-vous
vu où le bus s’est arrêté ?
— Oui.
— Pouvez-vous
deviner pourquoi je vous ai amenés voir par vous-mêmes ?
— Ce n’est pas
le moment de jouer aux énigmes.
— Tous les
matins à sept heures précises, un bus militaire part de ce même endroit. Seuls
les officiers et sous-officiers allemands y montent. Il les emmène à l’aéroport
du Bourget. Demain matin vous irez seuls observer quand et comment s’effectue le
départ.
— Vous voulez
qu’on largue des bombes ou qu’on tire sur les hitlériens ! N’est-ce
pas ?
— Et nous y
viendrons, mais maintenant nous proposons une forme inférieure. Il s’agit de...
mettre deux machines infernales sous le bus.
— C’est autre
chose. Mais on y pensera aussi. Nous observerons seuls pendant une semaine ou
deux. Ensuite, nous nous prononcerons.
— Nos gens ont
retracé cet objectif dans les moindres détails. Le bus arrive du Bourget à 7
moins le quart. Les boches commencent à arriver à 7 heures moins sept ou huit
minutes. Certains avec des voitures, d’autres avec un petit vol. À sept heures
précises ou au plus tard à sept heures et une ou deux minutes, le bus part. En
tout cas, à sept heures moins une ou deux minutes, tout le monde est monté et
attend : ils lisent des journaux, fument, conversent. Cela a été établi
après presque dix jours de recherche.
— Nous ne nous
laissons pas conduire par des étrangers. Jusqu’à ce que nous ne suivions pas et
ne jugions pas par nous-mêmes s’il est possible d’agir, nous sommes libres...
Et quand aurons-nous les machines infernales ?
— Votre
camarade Jean-Pierre (Nikolai Radoulov, recruté au service technique de
l’état-major) vous les remettra quand vous le lui direz.
Nous avons
personnellement inspecté le site, un par un, deux par deux, et tous ensemble au
moins une douzaine de fois. Nous y sommes allés non seulement le matin, mais
aussi le midi et le soir, lorsque le bus revenait de l’aéroport. Nous avons
trouvé que le matin était en fait le meilleur moment. Alors, pendant environ
cinq minutes, le bus était plein de passagers et immobile. Le soir, à peine
arrêté, ils étaient pressés et se retiraient en une ou deux minutes.
Nous sommes parvenus
à un accord général pour agir le matin. Mais quand exactement ? Cela
devait être calculé à la minute près. En fait, nous n’avions que cinq
minutes : le bus arrive à sept heures moins le quart et s’arrête à sa
place. Les uniformes verts commencent à arriver cinq ou six minutes plus tard.
Nous devions agir dans cet intervalle, de 7 heures moins le quart à 7heures
moins dix. Une particularité : deux fois au cours de la période observée,
l’Allemand — un conducteur énergique et engraissé — est descendu pour marcher
sur le trottoir et allumer son cigare. Autre difficulté : dans le même
temps, ouvriers et ouvrières passaient, quoique rarement, quoique pressés. Nous
avons commencé quelque chose comme une répétition générale : Kolyo Marinov
et moi nous nous sommes agenouillés à côté du bus pour attacher nos chaussures
dénouées — cela s’est avéré un succès. Ni le conducteur ni les passants ne
prêtaient attention à ce que nous faisions. Cela a suffi à nous convaincre de
la possibilité d’agir. Avant de définir le jour, ou plutôt le matin, nous avons
accepté la proposition du plus vieux des parisiens Jean-Pierre : patienter
quelques jours, le mois d’octobre est d’ordinaire maussade et pluvieux, son
épaisse obscurité matinale sera notre protecteur naturel.
Lors de la dernière
rencontre avant l’action, Vlado a posé à Roger une condition catégorique :
deux pistolets de plus, car nous devons tous les quatre pouvoir agir en cas de
besoin. Et si on nous donne une grenade à main, ce ne sera pas superflu. Le
chef militaire, généralement colérique, constata sérieusement :
— Vous dites ça
à la dernière minute.
— Il n’y a pas
de dernier moment. Le moment de l’action dépend de nous.
— Plus d’un
mois s’est écoulé, vous faites juste des recherches et vous n’agissez pas.
— À la fois
quand nous pensons et quand nous examinons, nous agissons aussi. Si tu as étudié
la dialectique, tu sauras que tout est lié.
— Ce n’est pas
le moment d’examiner qui a étudié quoi. L’important est de servir la cause...
D’accord. Je vais vous prêter provisoirement deux revolvers. Vous les recevrez
par Jean-Pierre et par lui vous les restituerez.
Restés seuls tous
les deux, le paysan de la vallée de l’Iskar sourit sournoisement :
— Il les verra
à la Saint-Glinglin, une fois qu’ils tomberont entre nos mains.
Plusieurs jours
passèrent. Le temps devenait plus sombre. Notre arrangement était : si la
nuit s’annonce pluvieuse, nous agirons le lendemain matin.
Un jour, des pluies
torrentielles ont commencé à tomber dès l’après-midi. Nikolai Radoulov a couru
dans la coopérative tout mouillé malgré l’imperméable bleu et épais en
gabardine. Sans un mot, nous avions compris d’un coup d’œil — l’action devait
se dérouler le lendemain matin.
— Dis à ta
femme que les patriotes français auront encore besoin de ta chambre, ordonna
notre chef. Et si tu fais ton ragoût, nous ne t’offenserons pas en le refusant.
Le vin est pour moi.
Ce n’est pas que
pour le délicieux ragoût que nous nous sommes rendus à l’appartement rue
Riquet. Machines et armes y étaient entreposées, et de là il fallait se
déplacer rapidement tôt le matin et, on l’espérait, marcher sans obstacles dans
les rues peu fréquentées du quartier prolétarien jusqu’à la porte de la
Villette.
Le soir, nous avons
mangé et bu dans une bonne humeur générale. C’était comme si nous nous
préparions pour un long voyage. En fait, c’était une opération très risquée,
plus dangereuse que de lier et d’enterrer les bombes de la rue d’Aubervilliers
et du champ de tir. Maintenant avec sans doute plus de passants et en très peu
de temps, environ 5 minutes, il fallait pouvoir mettre les machines emballées
dans des journaux dans le fossé sous le bus. Bien sûr, Vlado, toujours
extrêmement prudent, nous a enjoints de n’agir que lorsqu’il donnerait le
signal et lorsque nous, Kolyo Marinov — Pierre, et moi — Charles, serions
convaincus du plein succès de l’action.
Le septemvrietz Vlado a expliqué :
— Le
risque est élevé ici. S’ils nous trouvent et nous poursuivent, nous devrons
mener toute une bataille. Et si nous commençons à tirer, nous ne savons pas qui
sera la victime. Par conséquent — extrême prudence. Si les conditions ne sont
pas réunies aujourd’hui, nous essaierons demain, un autre jour. Nous n’avons
pas l’obligation d’agir la première fois.
Ce que le chef a dit
était tout à fait clair pour nous. Nous avions la conscience d’être prudents.
Cela coïncidait avec notre désir de nous en tirer vivants, à la fois pour la
lutte et pour la vie elle-même, avec toutes ses douceurs, ses épreuves et ses
amertumes.
Réveillés à temps
par l’hôte matinal, nous nous sommes précipités avec un appétit juvénile vers
le petit déjeuner délicieusement préparé.
Le temps renfrogné
empêchait au matin de découvrir son visage à travers les lourds nuages
pluvieux.
Deux par deux, nous
sommes sortis de sous l’arche de la maison de Nikola et nous nous sommes
acheminés silencieusement et à pas pressés dans les rues. Divisés par paires,
nous avons marché sur les deux trottoirs. Au bout de la dernière rue, Vlado a
ralenti et nous l’avons entendu répéter son signe convenu : « La main
gauche sur l’oreille gauche — tu agis, la droite sur la droite — tu continues
avec les paquets. »
Une centaine de
mètres devant la gare routière, nous nous sommes regroupés : premier
Gaston, deuxième Pierre, puis Charles et dernier Jean-Pierre. Arrivés sur les
lieux, nous avons trouvé un concours de circonstances idéal : nuages bas,
pluie légère, passants très rares et pressés ; le bus était garé sur le
trottoir, le chauffeur fumait tranquillement son cigare sur le siège, aucun
Allemand n’était visible aux alentours. La montre indiquait sept heures moins
12 minutes. J’ai regardé le chef, sa main gauche se grattant l’oreille gauche.
Pierre semblait anticiper le signe, il s’était déjà penché et laissait le
paquet. J’ai fait la même chose avec un peu de retard. Avant que je me
redresse, ma main droite saisit le pistolet chargé dans ma poche.
Je suivais
rapidement Gaston et Pierre qui s’éloignaient. Jean-Pierre marchait lentement
derrière moi. Je le remerciai intérieurement. Il était toujours derrière moi et
à côté de moi, et je n’avais aucun doute sur sa volonté de me protéger au prix
de sa vie. Nous sommes retournés tranquillement à la coopérative.
L’état-major a aimé
notre action. À la place de notre exposé, Roger nous rapporte que notre
connaissance Bianca a vu à 7 h 30 le bus avec une partie arrière complètement
détruite et la partie avant penchée sur le trottoir. Des gardes allemands
montaient la garde et détournaient les piétons afin de contourner la chaussée
de la place. L’ambulance était là aussi. Les passagers des sièges arrière et de
la plate-forme arrière ont été les victimes. Vers huit heures, le bus a été
emmené quelque part et la circulation sur le trottoir a été rétablie.
— La direction
évalue l’action comme réussie. Il apparaît qu’une seule des deux machines
infernales a explosé. Nos techniciens apprendront à mieux travailler.
L’essentiel dans votre action est le rôle de la technologie. De toute évidence,
nous pouvons et devons compter sur l’action indépendante de la technologie, et
pas seulement sur les combattants. Je sais ce que vous allez répliquer :
sans les combattants, la technologie n’est rien. C’est évidemment le cas, mais
le courage, l’habileté, l’intelligence du combattant deviennent infiniment plus
efficaces lorsqu’ils sont combinés avec des moyens techniquement perfectionnés.
Je suppose que pour la première fois Gaston est d’accord avec moi.
— J’ai
étudié l’art militaire, et je serais stupide de dire le contraire.
— Très
bien !... Et maintenant, à quand la prochaine ?
— Si vous êtes
pressé, vous devrez nous signaler des objectifs. Nous travaillons toute la journée
et seulement le soir ou tôt le matin ou le dimanche, nous cherchons quelque
chose d’approprié.
JE
QUITTE LE GROUPE DE COMBAT DES BULGARES
La nouvelle pour moi
ne m’a pas été donnée par Roger, mais par Hervé, membre de la Commission des
émigrés du Comité central du Parti communiste français. Hervé était un petit
homme agile, avec une tête chauve démesurément grande et de petits yeux bleus.
Son visage blanc rayonnait de fraîcheur et ses mains étaient aussi propres que
celles d’un vrai docteur. Cet homme de petite taille occupait une position
importante dans les rangs du Parti communiste et de la Résistance française. Il
était extrêmement à l’aise avec moi, comme si nous étions liés par une vieille
amitié. Il avait bien étudié ma biographie, alors il ne m’a pas invité à lui
raconter mon passé[66].
Presque sans introduction, il m’a annoncé la nouvelle :
— Je
n’ai pas à te convaincre que le parti valorise ses cadres. Il les place et les
déplace selon les besoins de la lutte et, bien sûr, selon leurs qualités... La
direction a suivi de près tes manifestations. Elle s’est dite : un jour il
faudra retirer ce camarade des rangs des combattants réguliers. Ce jour est
venu. Cher Charles ; le parti te nomme responsable politique de
l’état-major des combattants émigrés en région parisienne.
La rencontre avec
Hervé a eu lieu à la place des Ternes. Nous avons tous les deux continué sur
l’avenue de Wagram jusqu’à la place de l’Étoile. Nous avons traversé l’Arc de
Triomphe et sommes entrés dans l’avenue Kléber, plus calme que le chemin
parcouru jusque-là, les lézards verts y étaient moins fréquents. On pouvait
supposer que le dirigeant avait délibérément choisi ce coin peu fréquenté de la
capitale pour me confier le grand secret. La confiance du parti me consolait
comme une douce caresse.
Il y eut une pause.
La conscience de la responsabilité est née en elle. Membre de l’état-major
général, responsable politique de la zone centrale et la plus vaste de la
Résistance française ! Je me voyais au sommet de ce poste à responsabilité
et mon cœur commença à battre avec une force inhabituelle. J’ai ralenti mes
pas. Mon compagnon jeta un coup d’œil interrogateur à travers son pince-nez
doré. Avec un peu d’effort, j’ai dit :
— Je voudrais
poser une question ou plus précisément plusieurs questions : Pourquoi vous
êtes-vous arrêté sur moi ? Pourquoi n’avez-vous pas choisi Gaston, qui
occuperait ce poste plus dignement que moi ?
— Tu peux être
sûr, de nombreux noms ont été avancés sur la table verte. Et ce n’est qu’après
mûre réflexion que la direction a pris cette décision. Ne t’étonne pas, et pour
toi aussi il y avait des voix pour et des voix contre.
— Est-ce clair
que nous, toute notre unité de combat, devons retourner dans notre patrie dès
que possible ?
— On ne t’a pas
refusé l’admission dans ta patrie ?
— Légalement
oui, mais un moyen illégal peut être trouvé.
— Dès qu’une
telle opportunité te sera présentée, nous en discuterons. Dois-je te demander
si tu acceptes ?
— Je ne sais
pas. J’accepte non sans une certaine crainte. Je n’ai jamais été dans l’armée.
Et un responsable politique de groupes de combat d’une telle ampleur ne devrait
pas être étranger aux équipements militaires, aux opérations militaires...
— Ton ignorance
technique militaire t’a-t-elle empêché de participer aux combats ? Notre
lutte obéit à d’autres lois que les lois des arts militaires classiques. Et ces
autres lois, tout communiste ayant une expérience révolutionnaire les maîtrise
vite... Allons boire dans l’un des cafés de la place du Trocadéro et parlons de
votre coopérative !...
Très peu d’uniformes
verts occupaient les tables dans l’après-midi de ce jour d’automne. La plupart
des visiteurs étaient des dames et des messieurs âgés, certains d’entre eux
étaient venus avec leurs petits-enfants, d’autres s’amusaient avec des petits
chiens. Nous nous sommes assis dans un coin reculé de la terrasse. Hervé a
commandé une bière et a demandé, avec une légère ironie dans le ton, que je lui
explique comment nous, dans cette coopérative qui est la nôtre, réfutons la loi
fondamentale de la philosophie communiste : « L’existence détermine
la pensée ». Il avait entendu parler de nos fabuleux bénéfices et se
demandait comment nous pouvions être des combattants exemplaires de la capitale
française. Mon interlocuteur se distinguait par un esprit vif, et après une
très courte explication de ma part, il comprit le but particulier de la
coopérative, qui nous fournissait la nourriture, soutenait le parti et cachait
notre activité de partisans. Je lui ai assuré que comme nous l’avions créée,
nous pouvions l’enterrer.
— C’est
de ça que je parlais. Au moins, tu dois d’abord la quitter. Ton nouvel emploi
nécessite un travail à temps plein. Tu deviens permanent[67].
Ma démission
« coopérative » n’a pas surpris Vlado et Kolyo, qui avaient entendu
quelque chose de Roger. Les règles de la conspiration m’obligeaient à ne pas
divulguer mon nouveau poste. Je leur ai obéi non sans regret.
J’étais chargé de
trouver un lieu pour la première réunion de l’état-major général. Je me suis
arrêté à l’appartement de la Bulgare Jana, qui habitait rue Meslay, parallèle à
l’un des Grands Boulevards, près de la place de la République. Jana était
coiffeuse et avait transformé le salon de son appartement en salon de coiffure.
Elle accepta de nous recevoir, mais ne posa qu’une seule condition : de se
réunir le dimanche matin de 10h à 12h, car alors le portier de la maison se
rendait à l’église.
Au jour dit, Roger
et un ami sont arrivés juste à temps. Vêtus de vêtements nouveaux et repassés,
l’un avec un bouquet et l’autre avec une bouteille à la main, ils ressemblaient
à de bons bourgeois français visitant une jeune famille respectable.
Sans dire leurs
noms, les camarades ont serré la main de l’hôtesse. L’étranger pour moi lui a
remis le bouquet avec un sourire à l’occasion de la connaissance anonyme.
Jeanne — Pour moi tu
seras monsieur Bouquet.
Roger — Alors je
serai monsieur Bouteille.
Charles — Et nous
appellerons tous Madame « La belle coiffeuse ». Et si elle nous sert
une tasse de café avec du cognac, ça ne nous dérangera pas, n’est-ce pas,
messieurs ?...
L’état-major se
composait du déjà familier Roger, du nouveau camarade Louis et de moi-même. Nos
postes nous étaient attribués : responsable politique (commissaire) —
Charles, responsable militaire — Roger, responsable technique — Louis. Roger et
Louis m’ont présenté l’état général des groupes d’émigrés combattants en région
parisienne. Nous avons parlé longtemps et n’avons pas remarqué comment les deux
heures se sont écoulées.
Louis était tchèque.
De petite taille, il avait un visage allongé avec des yeux bleus enfoncés. Dès
les premiers mots échangés, son extrême modestie sautait aux yeux. Il se
plaignait de douleurs au ventre et rappela brièvement combien il souffrait de
la fatigue quotidienne : de nombreux rendez-vous le jour aux quatre coins
de Paris et en dehors de la capitale et un travail technique intensif la nuit.
Il a signalé la taille très insuffisante de l’appareil technique et m’a demandé
de réfléchir à cette difficulté, qui pouvait conduire à l’échec de certains
camarades, et même à un plus grand malheur.
Le nouveau poste
consommait tout mon temps, toutes mes pensées. Il ne pouvait en être autrement.
Vers le haut, j’avais des contacts réguliers avec trois camarades — Hervé et
les Français, Yves[68], le
chef militaire des groupes de combat de la région parisienne, et Lapierre[69],
le responsable politique des groupes de combat et des unités de partisans en
zone occupée de France. Je rencontrais périodiquement Bruno, secrétaire de la
commission des étrangers au CC du PCF, l’Italien Fernand, membre de la
commission. Vers le bas — avec les responsables politiques des détachements
nationaux : les détachements italiens, espagnols, juifs, roumains et
mixtes : Bulgares, Polonais, Hongrois, Arméniens. J’avais des réunions
séparées avec le chef du service de renseignement, qui s’est avéré être une
connaissance — Bianca du garage de l’avenue Bolivar, avec le chef des cadres
Laporte[70],
avec le Dr Wild, chef du service de santé. Au début, on me donna deux
secrétaires : la roumaine Viviane pour les contacts avec les camarades
dirigeants et les services, la polonaise Catherine pour les contacts avec les
détachements. Plus tard, la jeune fille française Danielle[71]
est devenue secrétaire dactylographe et la pharmacienne polonaise Solange est
devenue l’agent de liaison avec les camarades français et certains
détachements. Je présentais régulièrement des informations politiques au
commandement de chaque détachement, je parlais avec chaque nouveau venu dans
nos rangs et à tous les combattants qui montraient des signes d’hésitation,
violaient les règles de la conspiration ou se préparaient à une action. Roger
et moi nous inspections les lieux des actions et les voies de retraite,
établissions les plans d’action et délivrions les ordres correspondants. Je
recevais et lisais les communiqués et les rapports des détachements, et à mon
tour je rédigeais des rapports et établissais des communiqués à destination de
la direction du parti et de l’état-major français des combattants parisiens. À
propos de ces rapports et communiqués, Benoît Frachon[72],
venu au IIe Congrès des syndicats bulgares, alors et jusqu’à sa mort
membre du bureau Politique du PCF, dira : « Ils étaient parmi les
plus significatifs que la direction recevait pendant la Résistance. »
DANS
LA RÉSISTANCE SUR UN FRONT PLUS LARGE
Quand je suis passé
à un emploi rémunéré, j’ai perdu le droit de circuler parmi mes compatriotes.
Mais d’après mon expérience personnelle et celle d’autres personnes, je savais
que même les plus grands conspirateurs violent parfois les règles de base de la
conspiration. De temps en temps, j’apparaissais parmi les Bulgares et voyais
surtout mes compagnons d’armes. On parlait rarement d’autres d’affaires. Notre
sujet principal était la Résistance. Gaston et Pierre ont été affectés à un
groupe national qui comprenait des Latino-Américains, des Roumains et des
Yougoslaves. Une fois, ils ont posé une question délicate devant moi. Gaston
parla le premier.
— Écoute,
Charles. Tu dois avoir maintenant une vision plus générale de la Résistance.
Dis-nous, que font les Français ? Car jusqu’à présent nous ne voyons et
n’agissons qu’avec des étrangers.
— Je peux vous
dire et vous assurer qu’ils réalisent de grandes actions. La conspiration ne
permet pas aux groupes de combat d’être en contact les uns avec les autres.
Chaque groupe est constitué par nationalités. Nous, les étrangers, agissons en
toute indépendance. Si vous me demandez, c’est très bien pensé : les
Français se connaissent, on se connaît aussi. De cette façon, le risque d’échec
est réduit. Mais nous coordonnons chacune de nos actions avec la direction
française. Elle dirige et contrôle le travail de tous les groupes de combat.
— Mais nous ne
savons toujours pas s’il existe des groupes de combat français.
— Vous ne lisez
pas l’Humanité ?
— On
lit, mais on ne dit pas quelle action par quel groupe de combat a été
effectuée : étranger ou français.
— C’est bien
qu’ils ne l’écrivent pas. Imaginez, qu’ils rapportent : le groupe de
combat bulgare a largué des bombes sur l’Hôtel Impérial et les victimes sont
nombreuses ? Qu’est-ce que tu penses ? La police ne demandera-t-elle
pas qui des Bulgares est capable de telles actions ? Et aura-t-elle du mal
à retrouver nos traces ? Et maintenant, il est écrit : « Le groupe
de combat X, Y a effectué telle ou telle attaque. » Allez découvrir qui
elle est et de quelle nationalité elle est.
— Tu
t’es séparé de nous et tu as commencé à t’éloigner de la réalité. Et je te le
dis : on ne peut pas se battre avec enthousiasme si on n’est pas convaincu
que les Français se sacrifient comme nous.
— Tu en
doutes ?
— Je n’en doute
pas, mais tu connais nôtre slogan bulgare : « Voir, c’est
croire ».
— Qu’est-ce que
tu veux dire exactement ?
— Nous avons
une action à venir, nous allons encore incendier un garage, mais pour y entrer,
les gardes à l’intérieur, un homme et une femme, doivent nous l’ouvrir. Ton
Roger...
— Il est autant
à moi qu’à toi...
— ... Vous êtes
ensemble maintenant... il est plus à toi. Il dit que nous devons sonner et
demander avec notre français de nous ouvrir la porte. Ce que je veux ? Je
veux que des Français viennent avec nous, qu’ils parlent en français avec les
gardes, qui eux, les croiront sûrement en tant que Français.
— Et quelles
sont les considérations de Roger pour justifier son point de vue ?
— Tu le
connais, il cale comme un âne sur un pont. Il dit « C’est une violation de
la conspiration, nous n’avons pas le droit d’interférer avec les
Français », mais nous avons le droit de mourir pour eux, non ?
— Nous luttons
contre l’hitlérisme comme un mal mondial, pas seulement pour la liberté de la
France. Si nous mourons, nous mourrons pour la liberté de la Bulgarie et pour
notre idéal communiste.
— Ah, que de
grands mots. Nous les connaissons mieux que toi. Toi, dis à qui de droit, à
Roger ou à quelqu’un d’autre, de trouver les Français pour ouvrir la porte.
Pour le reste, pas d’objections. Nous avons brûlé et nous brûlerons encore les
garages des fritz verts.
J’ai promis de
transmettre leurs considérations, que j’ai trouvées correctes. Pierre est
intervenu avec tempérament :
— Attends,
alors tu lui annonceras autre chose... Tu sais, nous travaillons avec ce rageur
de Roger depuis longtemps. Sa bouche ne s’arrête pas. Et il sait tout. Il nous
fait la leçon sur le marxisme et la lutte comme à des enfants. Il essaie de
nous commander comme des robots. Et nous ne l’avons jamais vu venir avec nous,
rôtir sur le feu. Il est notre chef. On ne sait pas quel genre d’oiseau il est.
Pour lui faire confiance, on a envie de le voir en action, à côté de nous, avec
nous, risquer sa vie comme nous... On lui présente maintenant une occasion
pratique de prendre part à l’action. Ensuite, nous le reconnaîtrons comme chef.
Je suis tombé sur
des strates psychologiques qui formaient chez ces grands combattants une
attitude préjudiciable envers leur non moins excellent chef. Je devais me plier
à la situation.
La conversation avec
Yves, le chef français des Francs-tireurs et partisans de la région parisienne,
a été courte et pleine de sens. Il m’a dit :
— Les règles de
la conspiration ne sont pas pour nous des formules figées, des schémas
pétrifiés. Je ferai une exception pour cette action. Je vous enverrai deux
Français. Je le fais parce que je respecte les sentiments des combattants. Un
combattant ne doit pas être rongé par le doute ou l’incrédulité ; cela
affaiblit sa préparation au combat. Les camarades doivent être persuadés que
les Français participent à la lutte avec moins d’expérience que les vôtres,
mais pas avec moins de volonté de se battre et de se sacrifier. Je te préviens,
je vous donne les deux Français à la condition qu’ils ne contactent que toi, et
que toi seul leur expliques la tâche et leur indiques le garage. Personne
d’autre que toi ne doit les voir. Ils seront armés. Ils mettront des masques à
l’intérieur du garage. Mon contact te les remettra personnellement, quand et où
tu diras. Ce sont des jeunes inexpérimentés mais courageux... Bonne chance,
cher Charles.
Roger et moi n’avons
pas parlé longtemps non plus, mais il a réagi... violemment :
— Quel genre de
communistes sont tes amis ? Ils ne m’ont pas cru, ils ne m’ont pas vu en
action ? C’est le parti qui m’a mis à ce poste. Est-ce qu’il s’arrêterait
sur une personne qui a peur ? En fait, ils ne font pas confiance au parti.
Et puis, qu’imaginent-ils ? Qu’eux seuls sont courageux et loyaux, qu’eux
seuls sont prêts à se sacrifier ?... Tu peux leur dire que moi, comme eux,
j’étais illégal dans ma patrie, que comme eux, j’ai combattu sur le front de
Madrid... Bien, je serai avec eux, ils me verront « en action » comme
ils disent.
Le garage en
question était situé sur la rue de Laborde près de l’église Saint-Augustin. À
l’intérieur se trouvaient les voitures de l’organisation de construction Todd.
L’intérieur du garage était divisé en cinq étages et pouvait contenir plus
d’une centaine de voitures.
Le soir convenu, le
contact d’Yves — une jeune femme blonde — m’a remis les deux combattants
français sur la place de Narvik, près du lieu de l’action. Elle m’a dit :
— Yves a
insisté pour que je te répète : personne d’autre que toi ne doit
rencontrer les jeunes hommes. Tu leur expliqueras leur tâche et comment se
comporter.
Les deux hommes
étaient vraiment jeunes. Ils portaient des imperméables bleus. La casquette de
l’un trahissait sa profession ouvrière, le chapeau de feutre de l’autre
témoignait d’un service dans une entreprise commerciale ou de fonctionnaire. La
première question que je leur ai posée était : ont-ils jamais participé à
une action armée ? Celui avec la casquette a répondu qu’il avait
participé, et l’autre que c’était la première fois, mais qu’il avait terminé
son service militaire et pouvait tirer.
— Vos camarades
vous ont déjà avertis de porter des masques, ai-je dit. — C’est très
important... Votre tâche est la suivante : vous allez sonner à la porte
d’un garage allemand. S’ils ne vous ouvrent pas tout de suite, vous sonnerez
une deuxième fois, et dès qu’ils appelleront de l’intérieur, vous
répondrez : « Police. » Les gardes, hommes et femmes, sont des
Français d’âge moyen. Une fois à l’intérieur, vous pointerez vos revolvers sur
eux et leur ordonnerez « Levez les mains », puis vous les forcerez à
tourner le dos et à ne pas bouger. En leur liant les mains avec cette corde,
elle est fine mais solide, vous mettrez vos masques et l’un de vous les
conduira dans leur local. Là, vous les garderez face au mur. L’un de vous
restera près de la porte. Lorsqu’on sonnera deux fois et frappera une fois à la
porte, il ouvrira pour nous permettre d’entrer. Ils transportent tout le nécessaire
pour enflammer le garage. Vous ne parlerez pas dans le local du gardien,
surtout à haute voix. Il y a un téléphone là-bas, vous couperez son cordon avec
un couteau. Si vous êtes fumeur, vous pouvez fumer. Une fois l’action terminée,
vous sortez en dernier. Vous détacherez les gardes, mais les avertirez de ne
pas sortir avant que les flammes ne se soient propagées aux étages. Menacez-les
en disant que vous resterez devant la porte du garage pendant au moins un quart
d’heure. Courage et bonne chance ! Après l’action nous nous retrouverons
ici tout près, dans le jardin Bergson, à droite de l’église.
Ils m’ont laissé
aller en avant, ont ralenti leur pas, ont regardé autour d’eux, la rue était
vide, ils l’ont traversée en oblique. Celui avec la casquette a sonné une fois,
a attendu, et a sonné une seconde fois. Il a attendu de nouveau et a crié un
peu fort : « Police ! » La porte s’ouvrit à peine et les
deux jeunes hommes s’enfoncèrent rapidement à l’intérieur. J’ai attendu trois
minutes, n’ai rien entendu de spécial et je suis redescendu rue de Laborde.
Roger est apparu. Nous avons échangé le seul mot, « Agissons ». Nous
nous sommes séparés avant l’intersection de la rue de Miromesnil. Il a tourné à
gauche et j’ai tourné à droite. Je me suis écarté un peu, je me suis arrêté et
j’ai vu trois camarades entrer dans la rue avec des paquets à la main derrière
Roger. Quatre autres combattants, dont nos Gaston et Pierre, se sont dirigés
également vers le garage du côté du boulevard Malesherbes.
Après environ
quarante minutes d’errance nerveuse dans les rues autour de la gare
Saint-Lazare toute proche, j’entrai dans le jardin Bergson, où le contact
d’Yves m’attendait. Un couple s’étreignait sur l’un des bancs. Cécile s’est
approchée de moi et m’a fait une vraie surprise : elle m’a embrassé et m’a
tiré vers un autre banc. Elle me murmura doucement.
— Ne
devons-nous pas déjouer l’ennemi ?
Après tout, je lui
ai proposé, nous les « amants », d’attendre les jeunes à l’extérieur
du jardin. Elle a répondu « Je suis d’accord » et a ajouté :
— Tu sais, Yves
est trop inquiet. Il dit : « J’ai fait cette exception, mais cela
doit rester une exception, un cas isolé. » Je t’en prie, n’insiste pas
pour que cela se répète.
L’avertissement
était inutile. Je n’avais pas l’intention de briser la conspiration une seconde
fois. Au bout d’un moment, lorsque nous avons rencontré les combattants
français dans la rue, ils ont répondu à ma question « Comment ça s’est
passé ? » avec un enthousiasme pétillant :
— Super !
Très bien !
Je les ai salués au
nom de l’état-major général et leur ai souhaité bonne nuit.
L’action avait été
totalement réussie. Près d’une centaine de voitures ont été incendiées et
endommagées, et le garage a été entièrement détruit. Les combattants sont
sortis indemnes de l’épreuve.
Il y a des moments
curieux dans la vie. Vous voyez un ami amoureux, enjoué, heureux, prêt à toute
générosité, il se sent au septième ciel. Au bout d’un moment, vous le
rencontrez minable, mou, mal rasé, silencieux.
C’est ce qui nous
est arrivé après la merveilleuse action de la rue de Laborde. Nous nous sommes
tous réjouis : Gaston et Pierre du courage de Roger, Roger de la confiance
et du respect gagnés par les deux « mauvais » Bulgares, Yves de
l’heureuse exception, l’état-major de l’action magnifique, jusqu’à... jusqu’à
ce que nous apprenions la fin tragique des deux jeunes français.
Lors d’une réunion
suivante, Yves m’a raconté :
Dans leur quartier,
autour de la place d’Italie, des patriotes ont attaqué un officier hitlérien,
l’ont tué et lui ont pris son arme. Dès la nuit même, la Gestapo procéda à des
arrestations dans le quartier. Nos jeunes, qui n’avaient rien à voir avec
l’assassinat, faisaient partie des personnes arrêtées. Mais à la préfecture de
police, les agents ont inspecté les détenus. Parmi les personnes qui
examinaient figuraient les portiers du garage. Ils les ont reconnus et
identifiés comme impliqués dans l’incendie.
— Les jeunes ne
portaient-ils pas des masques ? Je leur avais dit de ne même pas se parler
à haute voix afin de parer toute éventualité !
— C’est ça, ils
ont enlevé leurs masques, trompés par le « patriotisme » de ces
Français ordinaires. La femme a commencé à maudire et injurier les boches,
affirmant qu’elle et son mari participaient aux sabotages, etc. Ils sont allés
jusqu’à boire du café, fumer et critiquer le gouvernement de Vichy pour sa
coopération avec les occupants. Lorsqu’on leur a de nouveau lié les mains,
cette lâche gardienne leur a promis de dire lors de l’interrogatoire à la
police ou à la Gestapo que ses agresseurs semblaient être des étrangers, voire
des Allemands. « Pour qu’ils se cassent la tête, qu’ils poursuivent le
vent » — les a-t-elle rassurés, la future traîtresse... Je les ai
critiqués d’avoir enfreint tes instructions et les miennes, mais pas assez. Je
supposais que les gardiens étaient de vrais patriotes. Puis quand même,
l’action s’était terminée brillamment... Je n’avais pas le cœur de me montrer
abrupt... Une grande leçon pour nous. Nous devons être intransigeants envers
quiconque sous-estime les lois de la conspiration. Sans préciser le lieu de
l’action, tu peux citer le cas dans tes contacts avec les responsables
politiques et les combattants réguliers. Dommage pour leur jeunesse, soupira
Yves. — Mourir bêtement... Quelle horreur !... Le père de l’un d’eux
participe aussi à la Résistance...
Si je ne les
connaissais pas, le récit d’Yves ressemblerait à de la littérature cruelle.
Mais je les avais vus, je leur avais parlé, ma main pouvait encore sentir leurs
poignées de main saines et chaleureuses. Mon chagrin était double : pour
leur prime jeunesse et pour la mort de deux purs combattants.
Pas un instant je
n’avais cessé de penser à de nouvelles recrues au groupe de combat bulgare. Je
cherchais toujours. Au bout d’un moment, je me suis arrêté chez Georgi Stoyanov
— membre du parti depuis la période des socialistes de gauche, ayant participé
à la grève des cheminots en 1920, militant dans les syndicats révolutionnaires
français, effectuant des missions secrètes au nom du Parti communiste français,
un homme aux deux professions : tourneur et barbier. Je l’ai présenté à
Vlado, qui après l’avoir rencontré m’a dit :
— C’est
évident, vieux, bon camarade à nous et il est déterminé à mourir. Il a une
famille et il est prêt à la sacrifier. Mais il a un défaut. J’ai remarqué qu’il
traînait un peu une jambe. Je lui demande : « Seras-tu capable de
courir si tu es poursuivi ? » Et il me répond honnêtement :
« Je ne peux pas beaucoup courir », mais il dit : « Peu
importe, la mort ne me fait pas peur ! » Il ne sait pas que nous nous
ne sommes pas d’accord pour que nos camarades meurent en vain... Bien qu’il
soit bon, voire très bon, je ne l’accepte pas à cause de son défaut... Mais tu
dois l’utiliser pour un autre travail plus approprié.
Georgi connaissait
très bien Paris et ses environs, il parlait bien le français. Il s’est montré
comme un très bon officier du renseignement et est devenu un membre actif du
Bureau du renseignement de notre état-major. Lui, Martin, marchait à pied toute
la journée avec la Roumaine Bianca et la Polonaise Odette. Ils ont trouvé,
inspecté et proposé divers objectifs : jeter des bombes dans des hôtels,
des restaurants, des bus, attendre et attaquer des pelotons et compagnies
allemandes se déplaçant sur un certain itinéraire, détruire certains officiers
et individus hitlériens de haut rang, des Français qui sont devenus des
collaborateurs des occupants, etc. Les objectifs mentionnés par eux étaient
d’abord évalués de manière exhaustive par nous trois : Roger, Louis et
Charles. Le commandement militaire des détachements alors acceptait ou rejetait
l’objectif. Le plan opérationnel était finalement approuvé par Roger et
moi-même. Nous examinions les projets d’actions les plus significatives avec
Yves ou Lapierre du commandement français.
UNE
PURE PROUESSE DE GRANDE CLASSE !
Pendant un certain
temps, la direction de la Résistance a ordonné à nos groupes de combat
d’attaquer les sentinelles aux entrées des casernes, des hôtels et des
institutions publiques. Son raisonnement était basé sur des informations selon
lesquelles un officier militaire tué dans la rue était rapidement enlevé et
dissimulé sous divers prétextes — soit il était parti soudainement pour le
front, soit il aurait été chargé d’une mission secrète. Les chefs Hitlériens
utilisaient de tels mensonges pour maintenir le moral de leurs troupes. Mais
notre parti poursuivait l’objectif contraire – faire douter, saper l’esprit
combatif de la populace hitlérienne. La mort d’un gardien en plein jour était
inévitablement apprise par des centaines et des milliers d’hitlériens dans les
hôtels ou les casernes. Les actions contre les sentinelles avaient un autre
sens : elles témoignaient du courage fou des combattants français, qui ne
pouvait qu’effrayer les occupants complaisants et inspirer le respect à
l’ennemi insaisissable pénétrant jusque dans leur tanière.
Nous avons décidé de
commencer l’exécution de la tâche avec un coup de tonnerre. Nous nous sommes
arrêtés à l’hôtel du Louvre, situé sur l’une des places les plus fréquentées de
Paris, la Comédie Française. À cet effet, nous avons sélectionné de braves
jeunes combattants : Pavel (Paul) — mécanicien de profession et Tchèque de
nationalité, Tommy — étudiant, Hongrois, et Rajman — tailleur, Juif polonais.
Pavel et Tommy devaient agir et Rajman devait les protéger. Les trois ont
examiné les lieux plusieurs fois à différents moments de la journée et ont
déterminé l’heure de l’action entre 18 h et 18 h 30. À cette heure, la
circulation était extrêmement animée en raison de la fin de la journée de
travail dans les institutions publiques et les entreprises privées
environnantes. Les combattants considéraient la circulation intense comme une
couverture très pratique. Rajman a jugé que l’action était risquée, mais son
effet serait énorme. Des milliers de Français verront la Résistance en action,
et les boches trembleront qu’on ose les exterminer dans les quartiers de luxe.
Roger et moi avions
de nombreuses années de plus que les jeunes hommes, mais notre enthousiasme
n’était pas moindre que leur volonté juvénile pour un exploit. J’avais un lien
direct avec les trois combattants. Je savais exactement quand ils agiraient. La
première tentative a échoué. En tout cas, ils tournaient autour de la
sentinelle, cherchant un moment propice pour se faufiler inaperçus dans la
foule et ne pouvaient toujours pas trouver de solution. Ils ont répété
l’expérience sans succès. J’ai accepté une troisième tentative et s’ils
échouaient, je leur ai dit que nous abandonnerions l’objectif. Lors de la
troisième rencontre, ils avaient l’air triste, comme s’ils revenaient des
funérailles d’un ami proche. J’ai tenté de les convaincre de l’extrême
difficulté de l’action, fait une autocritique de la part de la direction et
leur ai assuré qu’il existe d’autres objectifs non moins fascinants.
Plusieurs jours
passèrent. Lors d’une réunion, mon contact Catherine m’a amené Pavel et Rajman.
Ils sont repassés devant l’hôtel, ont examiné à nouveau la situation et m’ont
dit qu’ils ne pouvaient pas se résoudre à abandonner une action aussi spectaculaire.
Catherine a osé me conseiller de ne pas accéder à la demande des jeunes, qui
était une pure folie. J’ai déçu ma camarade raisonnable. J’ai averti les jeunes
enflammés par l’action d’être prudents et s’ils n’étaient pas sûrs à 99 %, de
ne pas agir. L’expérience sera absolument la dernière. Ils étaient contents et
m’ont sincèrement remercié.
Ce soir-là, Rajman
m’a rapporté, perplexe :
— Tu as raison.
Nous n’avons pas pu surmonter les difficultés de l’objectif.
— Ce n’est pas
un problème. Un mal pour un bien. On dirait que nous avons élevé trop haut la
barre.
— Ne vous
précipitez pas dans la critique ou l’autocritique. Pavelet moi avons fait un
autre travail. Je te laisse juger si nous avons bien ou mal fait.
— Sois bref...
— Comme tu
sais, nous avons fait le tour de l’hôtel Rohan, de la place du Palais Royal,
des rues Saint-Honoré et de Rivoli. Soudain, devant nous sur le trottoir de la
rue de Rivoli, deux gros officiers apparurent comme des hiboux. Tous deux avec
de larges pèlerines vertes doublées de drap rouge. Un avec un monocle. Nous
allons vers eux. Un éclair, une pensée m’est venue à l’esprit. Je les vois,
nous sommes seuls : nous et eux. Je murmure à Pavel: « Est-ce qu’on
tire ? » Il dit : « On tire ! » J’ajoute :
« Par derrière, quand on les dépasse. » Nous nous sommes croisés,
sans qu’ils nous remarquent. J’ai dit d’une voix sifflante :
« Prêt ! » Nous nous sommes retournés et avons tiré à bout
portant à la hauteur du cœur. Tous les deux se sont étalés par terre comme des
grenouilles. Nous avons caché nos revolvers, couru à l’intersection de Rivoli
et de Rohan, et avons ordonné aux passants effrayés : « Courez. Ils
tirent. » Les voitures sur la rue de Rivoli se sont arrêtées, nous avons
traversé la rue et sommes entrés dans le jardin des Tuileries...
Qu’y avait-il à
juger ?! Une pure prouesse de grande classe ! Les jeunes —
admirablement courageux, débrouillards, magnifiques ! ...
LES
STATIONS DE RADIO SOTTENS, MOSCOU ET LONDRES
COMMUNIQUENT…
Nous avons abandonné
le projet de la sentinelle devant l’hôtel du Louvre. Nous partîmes pour une
autre action. Le service de renseignement nous avait décrit dans les moindres
détails le parcours d’une compagnie d’honneur allemande gardant le Palais du
Luxembourg rue de Vaugirard[73].
Seuls de jeunes lieutenants et sous-lieutenants de l’armée de l’air servaient
dans la compagnie. Ils quittaient le palais à 12 heures précises, et après la
rue Vaugirard ils entraient dans la rue Monsieur-le-Prince, atteignaient le
carrefour de l’Odéon et descendaient à la station de métro du même nom. Les
semaines d’observation de Martin et Odette leur avaient permis d’établir, avec
une exactitude allemande absolue, le passage de la compagnie le long de
l’itinéraire désigné. Ils ne nous ont pas recommandé de méthode d’action. Avec
Roger et Louis, nous l’avons choisie nous-mêmes. Pendant trois jours
consécutifs, nous avons dû voir la compagnie de nos propres yeux et déterminer
l’exactitude des données et la possibilité d’une action future. Contrairement à
la circulation bruyante devant l’hôtel du Louvre, ici on s’est réjoui du vide
de la rue. Sur un des trottoirs se trouvait l’arrière de la faculté de médecine
sans portes et avec des fenêtres camouflées. De l’autre côté, de la rue Casimir
Delavigne au carrefour de l’Odéon, il y avait des antiquaires et des magasins
de musique fermés ou déserts. Après quelques discussions, nous avons décidé
d’une action combinée : deux machines infernales seront placées sur les
deux trottoirs de Monsieur-le-Prince à une distance d’environ 30 mètres, de la
longueur de la compagnie (20 rangées de quatre personnes). Trois à quatre
secondes, après l’explosion des bombes, deux combattants attaqueront les
officiers survivants avec des grenades, et un Schmeisser rugira de l’escalier
opposé du passage Dubois. La retraite des combattants à la grenade aura lieu
dans les rues Delavigne et Crébillon, l’homme au Schmeisser — dans la rue de la
faculté de médecine à côté du musée de Cluny, où une voiture l’attendra.
On sait que même les
plans les plus géniaux ont besoin d’exécuteurs qualifiés. Par conséquent, la
question de savoir auquel des combattants confier cette tâche responsable nous
a pris beaucoup de temps. Rajman et Paul, qui avaient été brillants ces
derniers temps, étaient irréprochables. Nos Gaston et Pierre ont été
mentionnés, mais ont été écartés en raison de leurs supposées objections. On
cherchait des camarades qui embrasseraient l’action avec enthousiasme. On ne
pouvait pas les trouver soudainement et facilement. Nous n’avions pas d’autre
choix que de les créer. J’ai eu l’honneur d’être leur créateur... On m’a
présenté... Tommy, une connaissance à moi de l’époque des préparatifs de
l’action contre la sentinelle devant l’Hôtel du Louvre. Que savait-on de ce
jeune Hongrois grand, mince, doux, blond et bouclé ? Il était issu d’une
famille d’intellectuels ; père professeur, mère musicienne.
L’environnement familial était bohème. Il avait travaillé activement dans
l’organisation du Komsomol, avait livré des exposés, avait dessiné des croquis
et des affiches, s’était distingué par son intelligence précose. Il fut un
excellent élève au Lycée Louis Le Grand, mais le quitta à cause des
manifestations bruyantes des racistes fascistes. Il écrivait de la poésie,
aimait la musique. Il avait embrassé le drapeau des combattants parisiens avec
un peu de réticence : il se préparait à un concours à l’Académie des
Beaux-Arts. Il estimait que par l’art il servirait plus efficacement la lutte
contre l’occupant.
Son ami proche Pavel
avait signalé de légères hésitations de Tommy lors de l’action devant l’hôtel
du Louvre. Après avoir vu comment Pavel et Rajman agissaient et réussissaient,
il avait l’ambition romantique de devenir un héros.
L’information de
Pavel était révélatrice pour moi, ne parlait-elle pas d’une évolution positive
chez ce jeune de 18 ans ? Néanmoins, je prévoyais des difficultés et des
surprises dans la conversation à venir avec Tommy. Je ne m’étais pas trompé.
Deux semaines après l’exploit de ses amis, il avait changé d’humeur et de
comportement. Avant que je ne commence à lui révéler l’action future et son
rôle dans celle-ci, le jeune homme, plus pâle que d’habitude, s’excusa de
m’importuner avec une question personnelle. Je supposais le pire : quitter
les rangs de la lutte. Il a commencé assez confiant :
— Je sais par
les livres que Marx et Engels étaient contre la terreur individuelle. Pourquoi
nous qui sommes communistes la pratiquons ? Je m’empresse d’ajouter que
les populistes russes, le frère de Lénine, par exemple, ont attaqué des tsars,
des ministres, des gouverneurs. Et nous, ce qui se met en travers : des
sous-officiers, de simples soldats. À mon avis, les vengeurs du peuple russe
ont fait ce qu’il fallait. Je comprends et suis d’accord avec une telle
terreur, mais si elle touche Hitler, Goebbels, Himmler...
En face de moi se
trouvait un jeune qui cherchait, s’interrogeait, s’inquiétait, éprouvait.
J’avais quelques minutes pour aider et sortir le jeune combattant des ses
questions enchevêtrées et pensées sous-entendues. J’ai essayé d’éviter les
termes inconnus et les phrases creuses, de sorte que dans mon désir de le
sortir des jugements instables, je ne le poussais pas dans les arguments et les
raisonnements à consonance vide. Je lui ai demandé :
— Connais-tu
les rangs des officiers fusillés rue de Rivoli ?
— Je ne sais
pas.
— Un général et
un colonel.
— C’était un
coup de chance. Sinon, selon le plan, nous devions abattre un sous-officier
ordinaire.
— La cible
n’était pas la sentinelle. Pour nous, le sous-officier était un moyen, un moyen
pour atteindre un but : ébranler le moral des occupants. Schmid, Fritsch
ou Fritz dans leur vie privée peuvent être des hommes bons et ordinaires.
Devant l’hôtel du Louvre, ils ne sont qu’un symbole de l’idée hitlérienne de
domination mondiale de la nation allemande. En tant que communistes, nous
sommes contre la terreur individuelle. Mais nous ne frappons pas sur Schmidt ou
Fritz. Dans ce cas, nous tirons sur une idée monstrueuse. En supprimant la
sentinelle, nous dérangeons les occupants autosatisfaits, nous ébranlons leur
morale, nous prouvons la haine de toute une nation, de toute une humanité
progressiste.
— Les
terroristes russes, lançant des bombes sur les rois, ont également tiré sur
l’idée d’autocratie, insistait sur son idée Tommy.
— Mais ils
avaient tort de penser qu’en tuant le roi ils aboliraient le tsarisme.
— Et nous,
allons-nous briser l’hitlérisme en effaçant le Schmid sans nom ?
— Nous n’avons
pas de telles illusions. L’hitlérisme ne sera détruit que par les coups de
l’Armée rouge, aidée par les troupes alliées et les forces des peuples en
lutte. Ici en France, nous jouons un rôle de soutien dans le grand duel. Mais
ce rôle est aussi crucial. Nos actions minimes, souvent à peine perceptibles et
sans retentissements, infligent des dégâts importants au moral des dégingandés
verts pavanés. Bien sûr, lorsque nous frappons des hauts gradés, nos coups sont
plus fructueux. Penses-tu qu’il sera facile de trouver des remplaçants dignes
et tout aussi valables pour le général et le colonel déchus ? Tu peux
répliquer : à la fin, ils mettront des suppléants à leurs postes. Correct.
Mais cela prendra du temps, amènera le chaos, relâchera la discipline,
augmentera l’incrédulité, affaiblira l’ennemi. Multipliées cent, mille,
dix-mille fois, ces piqûres sur le corps de la force ennemie vivante
représentent les fourmis attaquantes qui renversent les éléphants géants.
Nous avons fait le
tour de tout le quartier Montparnasse pendant environ une heure. La froide
journée de décembre nous a incités à marcher vite et avec agilité. Vus de côté,
on aurait dit : un père et un fils, engagés dans des conversations
familiales.
Il serait
prétentieux de ma part de supposer que c’était du tout cuit. J’ai proposé de
nous voir une deuxième fois. Tommy a refusé :
— Inutile. Il
m’est apparu clairement quelque chose que tu n’as pas mentionné, mais qui dans
ce cas est décisif : la guerre, la situation militaire. Dans ce contexte,
les choses changent : la terreur individuelle disparaît et se transforme
en une cause collective, en un torrent de cascade puissante... Quant à l’action
et ma participation à celle-ci, j’en parlerai à Pavel et il te dira oui ou non.
Son ami Pavel
m’apporta un oui avec un sourire compatissant. Je me sentais satisfait :
je n’avais peut-être pas créé de combattant, mais il me semblait que j’avais
guéri un malade.
Au moment de
l’action, Tommy s’est révélé avec toute la splendeur du romantisme de sa
jeunesse. Après l’explosion des machines infernales, Tommy et Pavel ont jeté
des grenades sur les Allemands désorientés. À peu près au même moment, le
Schmeisser de Rajman, debout près de la balustrade de l’échelle de la rue, a
crépité. Les coups combinés ont non seulement abasourdi les officiers pris dans
le piège à feu, mais ont déchiré et fauché plus de 20 personnes tuées et encore
plus de blessés.
Les deux jeunes
hommes se retirèrent calmement le long de la rue Crébillon et tendirent leurs
revolvers à la camarade qui les attendait. Ils arrivèrent sur la place devant
l’église Saint-Sulpice et entrèrent dans un café, où ils prirent avec appétit
un petit déjeuner de croissants et du café. Rajman, cachant son Schmeisser
encore chaud sous son imperméable bleu, se retira tranquillement dans la rue de
la faculté de médecine, traversa le Boul’Miche et monta dans un taxi qui
l’attendait à la porte du musée.
Rajman a raconté à
la camarade Viviane dans le taxi :
— Tout s’est
déroulé comme sur des roulettes. Les machines infernales au début et à la fin
de la colonne ont explosé à temps. Beaucoup tombaient comme des poires,
d’autres tombaient sur le ventre. Les grenades de Pavel et Tommy atterrirent au
milieu de la compagnie. Mes deux décharges ont achevé quelques-uns des Fritz
rampant sur le trottoir ou se tenant à côté des portes et vitrines des
magasins...
Les résultats de
cette action ? La même Viviane à 13 heures s’est rendue sur les lieux.
Elle nous a transmis ce qu’elle a vu. Toutes les rues environnantes étaient
bloquées par des policiers français et allemands. Des ambulances sont arrivées
et ont emmené les morts et les blessés. Tout le quartier parlait avec
enthousiasme de la « terrible bataille de rue entre soldats allemands et
partisans français, faisant des centaines de victimes des deux côtés ».
Deux heures après
l’attaque, Radio Sottens, Suisse, a rapporté l’événement. Le lendemain, Moscou
et Londres saluaient l’exploit des combattants parisiens qui sont passés à
l’offensive contre les occupants hitlériens en plein jour.
Dans une
conversation avec moi, le jeune homme Tommy, ayant passé avec brio son baptême
du feu, me confia sa découverte :
— Dans les rues
de Paris, je me sens comme un combattant du front de l’Est.
La flamme dans l’âme
des combattants brûlait. Le romantique Tommy faisait pression pour participer à
une nouvelle action dès que possible. Pavel s’est contenté de déclarer sincèrement
et simplement : « Toujours prêt ».
LE
COMBATTANT PAVEL SIMO — LA PREMIÈRE VICTIME
La belle Odette du
service de renseignement désigna la cantine des officiers hitlériens dans la
banlieue d’Asnières. La cantine n’était ouverte qu’à midi et représentait une
vaste salle au rez-de-chaussée avec une grande fenêtre d’un côté du boulevard,
le long duquel s’étendaient deux rails de tramway. On entrait dans la salle en
passant par une porte simple en fer et après une douzaine de pas on atteignait
une entrée étroite de deux mètres. Les quelques jours d’observation d’Odette
nous ont apporté des informations précieuses : une cinquantaine
d’officiers jusqu’au grade de commandant mangent à la cantine. Ils viennent
tous entre 12 h 05 et 12 h 20. Ils commencent à sortir à 12 h 45 au plus tôt. À
cette heure-là, la circulation piétonne sur le boulevard est très rare. L’arrêt
de tramway est à une centaine de mètres. Le tramway circule toutes les douze
minutes à grande vitesse. Sur la recommandation de l’expérimentée Odette,
l’heure d’action devait se situer entre 12 h 25 et 12 h 35, quand tout le monde
était à la cantine, les piétons s’apercevaient à peine et le tramway ne passait
pas.
Pendant deux jours
d’affilée, Tommy, Pavel et moi avons vérifié les données du renseignement de
nos propres yeux. Elles se sont avérées consciencieusement exactes. Notre seul
souci concernait les conditions de la retraite. La première intersection du
boulevard était à 70-80 mètres de la cantine. Cela supposait qu’après avoir
jeté les bombes, les combattants devraient courir le long du boulevard pendant
20 à 30 secondes avant de virer dans la rue parsemée de vitrines de produits
coloniaux, de produits laitiers, de pains et de confiserie. Au coin de la rue,
ils remettront leurs armes à la camarade Catherine, qui à son tour prendra le
tram en direction de la capitale.
Nos jeunes ont
accepté l’action avec enthousiasme. Tommy était impatient d’agir. Il m’a assuré
de sa vitesse de cerf en tant que coureur, comment il disparaitrait dans un
croisement en seulement 10-15 secondes, et comment il allumerait et fumerait
calmement sa cigarette. Pavel était plus calme. Contrairement à son ami, il se
lançait dans l’attaque imminente avec la conscience d’un soldat en mission de
combat.
Pavel et moi étions
liés par quelque chose de slave, une forme particulière de fatalisme au service
d’une idée supérieure qui transcende nos personnalités. Hitler avait destiné
les slaves à être l’engrais de la race allemande au pouvoir. Pavel, le jeune
homme de vingt ans, et moi avions conscience que notre sacrifice dans la lutte
servait non pas d’engrais, mais de tremplin pour la victoire sur le dragon
fasciste. J’avais des sentiments paternels pour ce pur combattant, et il a plus
d’une fois témoigné de mon affection filiale : il m’a écouté et cru
jusqu’au moindre mot, m’a surpris par ses gâteries, a cédé son logement soit
pour des réunions, soit pour des nuitées. Lors de nos réunions, nous nous
sommes souvent plongés dans les vagues de mes souvenirs révolutionnaires ou
dans les descriptions rapides de sa courte vie de travailleur. À l’âge de
quatorze ans, il a remplacé le banc d’étudiant par le métier à tisser de
l’usine. En tant qu’apprenti, le maître français lui a appris non seulement le
métier de mécanicien, mais aussi... du communisme. Pavel est devenu un membre
actif du Komsomol. Une fois, il a même participé à une grève pour protéger son
maître, que les propriétaires voulaient expulser. Lorsque les hordes d’Hitler
ont envahi la Tchécoslovaquie, son père ne lui a pas permis de rentrer chez lui
et de lutter contre les envahisseurs étrangers. Restant à Paris, le jeune
patriote tchèque a juré de se venger de tout fasciste, où qu’il se trouve.
C’est pourquoi l’appel de son compatriote Louis, notre responsable technique, à
rejoindre les rangs des groupes de combat a résonné en Pavel comme une
invitation à participer à un festival de la jeunesse tant attendu.
Maintenant, je vois
Pavel — avec son visage arrondi, pâle, ses sourcils gais, ses yeux bruns
enfoncés et son sourire gentil, portant un costume vert-gris décent, avec une
écharpe parisienne colorée... J’imagine son destin tragique — notre premier
combattant décédé pendant une action et... ma main refuse de glisser sur le
papier blanc... Je donne la parole à son inséparable ami Tommy, avec qui nous
nous sommes retrouvés deux heures après l’action dans une des ruelles de la
forêt de Boulogne.
Tommy était très
excité, plus pâle que d’habitude, avec un pantalon légèrement froissé.
— Ne me regarde
pas d’un air surpris — dit-il doucement — et ne me demande pas pourquoi je suis
seul.
— Et pourtant,
dis-je, il fallait que vous veniez tous les deux...
— Il fallait...
— Qu’est-il
arrivé ?
— Pavel... On
ne le reverra probablement plus, acheva douloureusement le jeune homme.
— Raconte...
Tommy était
silencieux. Il luttait pour contrôler l’apparition du chagrin et des larmes.
Ils ont terminé la
tâche comme nous l’avions prévu. Le boulevard était presque vide. Loin derrière
eux, devant l’arrêt de tramway, deux ou trois personnes attendaient. Sur le
trottoir d’en face, deux vieillards marchaient lentement en direction de la
ville. Tommy a jeté la bombe en premier. Pavel après lui. En courant il est
allé se cacher et a tourné à gauche sur le même trottoir. Pavel le suivait.
Catherine a pris son revolver et il a essayé d’allumer sa cigarette, mais à ce
moment Pavel l’a rattrapé et a crié : « Cours ! » Il venait
de dire cela et un énorme camion s’est précipité dans la rue en faisant du
bruit. Le chauffeur, sorti de la moitié de la cabine, a crié et les a pointés
du doigt : « Retenez les assassins... les jeunes !... Celui-ci
et celui-là ! Assassins… »
Clients et artisans
sont sortis effrayés des boutiques et des magasins... Tommy a couru en avant
dans la rue... Il a entendu un coup de feu. Il s’est retourné et a vu Pavel
courir sur le trottoir avec son pistolet dégainé. Des portes de magasins se
fermaient. Le camion a suivi Pavel de près, le chauffeur a crié « Arrêtez
les assassins »... Un groupe d’hommes et de femmes a tenté de barrer la
route à Tommy. Il leur a crié : « Je suis un combattant
communiste. » Ils l’ont laissé passer. Il a été confus pendant un moment.
Le camion est monté sur le trottoir et menaçait d’écraser Pavel, qui se tenait
à côté d’une vitrine. Il a clairement vu – Pavel n’a pas tiré. Il se sentait
impuissant sans arme. Il courait tête baissée sous les regards curieux des
rares piétons. Il passait d’une rue à l’autre. Il regarda autour de lui —
personne ne le poursuivait. Il arriva et entra dans un cimetière. Il se cacha
entre les tombes pendant environ un quart d’heure. Il atteignit un mur. Il
tendit l’oreille — il n’y avait pas de circulation automobile derrière, pas de
pas ou de voix humaines. Il décida de sauter par-dessus. Il s’égratigna les
bras et les genoux, mais sans rien se casser. Il erra dans les rues de la
banlieue. Il demanda à une fille dans quelle direction se trouvait le métro
parisien le plus proche... Bien sûr, il n’y est pas monté. Il a juste compris
comment il pouvait se rendre à notre lieu de rendez-vous.
Le premier taxi en
temps de guerre que nous avons rencontré, alimenté au gaz carbonique, nous a
emmenés dans le quartier bruyant autour du cinéma Gaumont Palace. Mon but était
de distraire le jeune, agité par la douleur aiguë, et de rassembler mes propres
pensées. Il avait déjà répondu, mais je lui ai demandé à nouveau :
— D’où venait
ce camion et ne l’aviez-vous pas remarqué avant ?
— Nous l’avons
vu immobilisé devant l’arrêt du tram. Il était arrêté là dès le début de notre
arrivée. Nous ne nous attendions pas à ce qu’il parte juste au moment de
l’action. Le conducteur s’en est rendu compte après l’explosion et a accéléré
la voiture. Salaud ! Eh bien, crois-le ou non, – un
Français !
— Il y a encore
de tels Français. Des cas rares, mais érigés comme des épines à la honte d’une
France combattante.
Tommy a pris le
petit déjeuner avec une portion maigre de pommes de terre et de riz, on a bu un
verre de bière et on s’est séparés. Il est parti dévasté. Mes consolations
n’étaient assurément pas du baume pour son jeune cœur blessé jusqu’au sang.
Je ne me suis
volontairement pas présenté à deux rencontres : j’ai décidé d’aller à leur
repêchage. Je voulais rester avec moi-même. Assis sur les chaises de fer devant
les sculptures en marbre du jardin d’automne du Luxembourg, je voyais, écoutais
et parlais à mon Pavel.
Oui, jeune
Pavel ! Et maintenant j’écoute ton sincère et simple « Toujours
prêt ». Toujours prêt à l’action, à l’exploit et au... sacrifice !
Ah, j’ai parlé, persuadé Tommy de ne pas être pressé de penser que Pavel était
attrapé, abattu, irrémédiablement perdu, et en mon for intérieur je n’avais
aucun espoir. Même s’il est tombé vivant entre les mains de la police fasciste,
son sort était prédestiné : exécution immédiate ou mort certaine chez les
assassins d’Hitler.
Du vieux combattant
Charles, accepte, toi, jeune combattant Pavel, un dernier adieu ! Tu
vivras dans son cœur comme l’image d’un fils mort prématurément !
Lors de notre
rendez-vous du soir, Catherine confirma ma conviction : le revolver de
Pavel ne tira qu’une seule fois et s’enraya. Le camion a coincé le combattant
confus contre la vitrine d’une boulangerie. Devant les Français rassemblés,
Pavel a répété : « Je suis un Français, un combattant parisien »
et s’est adressé au chauffeur : « Si tu es un Français, tu me
laisseras m’échapper. » Des hommes et des femmes ordinaires l’ont soutenu
en disant au chauffeur : « Laisse-le ! Ne sois pas un
tueur ! » Le chauffeur du camion enragé a sorti une arme à feu, l’a
tournée au-dessus de sa tête et a crié : « C’est mon affaire qui je
suis. Dégagez ou je vous arrête tous. » Il a commencé à souffler dans un
sifflet de police. Catherine a accidentellement attrapé le regard de Pavel, qui
a duré une fraction de seconde, et s’est éloignée alors qu’un policier en
uniforme s’approchait du boulevard. Pour venger le jeune combattant, elle
mémorisa le numéro du camion[74].
Tommy avait
raison : avant d’être fusillé au camp de concentration de Romainville,
Pavel n’a trahi personne malgré les tortures inhumaines qu’il a subies.
L’ENNEMI
DOIT ÊTRE A-NÉ-AN-TI !
Est-ce suffisant de
dire : l’ennemi était cruel, impitoyablement cruel ? Il me semble que
sa cruauté n’était qu’un des traits déformés de sa versatilité répugnante. Il
avait répandu des tentacules de pieuvre sur les pays européens et africains et
menaçait d’étouffer toute l’humanité. Le fascisme horrifiait par son présent
sanglant, mais il glaçait beaucoup plus le cœur des honnêtes gens par son
avenir : une sinistre nuit séculaire pour la culture, la science,
l’économie, en un mot, une obscurité impénétrable de l’histoire humaine.
Le dilemme
était : pour ou contre les ténèbres, pour ou contre la lumière. Mais la
conclusion pour nous, les combattants du front invisible, était une
seule : une lutte cohérente, minute par minute, omniprésente contre
l’ennemi. Quand et où il était rencontré, quels que soient les formes et les
états dans lesquels il apparaissait ou se déguisait, il devait être a-né-an-ti.
L’agent de
renseignement de notre état-major, le Bulgare Martin, nous a indiqué un objectif
en apparence... délicat : l’hôpital Rothschild dans le 19ème
arrondissement, entouré des rues Manin, Philippe Hecht, Georges Lardena et de
l’avenue Mathurin-Moreau. La rue
raide et en escalier Barrelet-de-Ricou
menait vers la partie arrière de la maison hospitalière depuis la rue Philippe
Hecht. Cette partie abritait un grand dépôt d’armes et les officiers hitlériens
portaient des blouses d’hôpital en guise de couverture.
L’objectif a été
approuvé par notre état-major non sans discussion. Deux considérations ont été
exprimées : l’une — comment expliquerons-nous que l’attaque a été dirigée
contre le dépôt d’armes, et la seconde — nous ne devons pas abandonner devant
la moindre manœuvre de l’ennemi, même si elle était recouverte d’une blouse
d’hôpital. La deuxième a prévalu.
Selon leur
tempérament et leur consolidation idéologique et politique, les combattants
percevaient la tâche différemment. Mais le Bulgare Gaston et le Roumain Étienne[75]
étaient d’accord avec le Hongrois Edgar[76], qui
a conclu le débat par ces mots :
— N’oubliez
pas les têtes de bébés écrasées contre les murs devant les mères russes.
Puisque le parti l’ordonne, c’est nécessaire !
Étienne, tanneur de
profession, de taille moyenne, avec barbe et nez pointus, nous lançait un
regard flamboyant sous ses épais et longs sourcils noirs. Constamment mobile et
nerveux, il frissonnait de colère et de haine contre les inventeurs des camions
à gaz. Lors de nos fréquentes rencontres, il se mettait à parler avec
admiration de la peinture française de différentes époques. Il était fasciné
par la littérature française, aimait la poésie prolétarienne de Paul
Vaillant-Couturier et devenait muet devant le génie de Balzac. Il ne professait
pas ses passions littéraires, mais il voyait déjà le mouvement de la Résistance
comme une source inépuisable d’œuvres littéraires. Il était toujours en
délicatesse avec les règles de la conspiration. Trop souvent, il regardait
attentivement en arrière et était parfois en retard aux réunions.
Edgar — grand, avec
des cheveux noirs bouclés, un front haut, des yeux grands ouverts et une
démarche souple masculine. Toujours vêtu d’un costume sombre, d’une propreté
exquise et parfaitement repassé[77], son
visage brun pâle brillait d’un sourire éclatant. Il avait de belles lèvres
rouges. Il s’est engagé dans des discussions relativement longues sur la
situation politique. Ancien combattant des brigades internationales, il
acceptait avec douleur la défaite de la République espagnole. Il se demandait
timidement si le fascisme n’échouerait pas aussi dans cette guerre. Ces timides
insinuations ont fait l’objet de longues explications de ma part. Après tout,
la croyance en la victoire a prévalu et a brûlé le doute dans l’âme de ce noble
communiste. Edgar dégageait une simplicité humaine éclatante et une volonté
convaincante de se sacrifier pour son idéal. Il n’impressionnait pas, mais
captivait simplement son interlocuteur par sa sincérité charmante et sa
spontanéité.
Étienne et Edgar —
deux ouvriers, deux inter-brigadistes, deux merveilleux combattants de la
Résistance française !
C’était au début de
janvier 1943. Là-bas, sur le front de l’Est, les courageux combattants de
Stalingrad se battaient et mourraient héroïquement. Stalingrad n’était pas
encore tombé. Paulus n’était pas encore capturé, son armée de 300 000 hommes
n’était pas encore vaincue...
L’action du groupe
de combat mixte a réussi, avec un petit accident. Étienne a courageusement,
agilement et avec précision lancé la première grenade à travers l’une des
fenêtres de la chambre d’hôpital. Gaston a également lancé sa bombe dans la
deuxième fenêtre avec une force particulière, mais malgré la distance
rapprochée, elle a légèrement accroché l’un des dormants de la fenêtre et a
explosé au moment de l’impact. Les morceaux de la bombe ont explosé à
l’extérieur, dans la rue, où ils ont brisé les vitres des fenêtres d’en face.
Gaston se coucha instinctivement et resta intact. Mais Edgar, debout sur le
trottoir d’en face pour protéger Étienne et Gaston, ne s’est pas couché et a
été légèrement blessé par les éclats.
BIANCA,
MARTIN, ODETTE, TROIS ABEILLES MELLIFÈRES DU QUARTIER GÉNÉRAL
La lutte –
l’inégale, l’acharnée — continuait. Le plus souvent, à pied, les camarades du
service de renseignement traversaient la capitale plusieurs fois par jour avec
des yeux scrutateurs. Comme des chiens de chasse silencieux, ils s’aventuraient
et traquaient des officiers de haut rang ou des unités militaires ; comme
des limiers, ils parcouraient les repaires, les institutions, les
établissements hitlériens connus, traquant les heures d’entrée et de sortie, la
nature de l’activité, l’importance du service et des personnes, etc.
Le chef du service
s’appelait Bianca. Le premier mot échangé avec elle vous révélait une
intellectuelle, avec une excellente maîtrise de la langue française, avec un
accent légèrement différent de celui de Paris. Cet accent pourrait vous dire
qu’elle vient des villes de Lille, Limoges, Lyon, Bordeaux, et vous ne
soupçonneriez jamais qu’elle est une vraie fille de sa ville natale de
Bucarest. Ses cheveux blonds, dans une coiffure souvent changeante pour des
raisons de conspiration, lui donnaient une allure joviale. Pas tout à fait
grande et pas tout à fait élancée, elle attirait les regards des hommes avec
son joli visage frais d’étudiante mûre[78]. Ses
yeux verts perçaient comme des flèches et fixaient comme les yeux d’un
hypnotiseur ! Je supposais que pour inspecter un objet donné, Bianca se
contentait probablement d’un ou deux regards sur l’environnement. Sa forte
imagination arrangeait et façonnait ensuite le reste des données. Une fois, à
ma question « Comment sais-tu que ce sont des documents
importants ? » (il s’agissait du sac d’un général), elle a répondu
par une question : « Et pourquoi le général, pas un instant, ni le
matin ni le soir, ne se sépare-t-il pas du sac et ne le donne-t-il même pas à
son aide de camp, qui est en plus lieutenant-colonel ? »
Par une tranquille
soirée d’automne, nous nous promenions le long des quais de la Seine. On
parlait de miracles. J’affirmais qu’ils n’existaient pas, que derrière chaque
« miracle » il y avait des faits réels, des données concrètes, avec
lesquelles, une fois connues, le miracle n’était plus qu’une conséquence
logique et dépouillée de son côté miraculeux.
Bianca me répondit
d’un ton étonnamment vif :
— Eh bien, moi,
je suis étonnée que tu ne sois pas surpris par des choses ordinaires, des
miracles de la chimie ou de la technologie. Je pensais que tu étais jeune, mais
tu es déjà vieux. L’émerveillement est donc lié à la jeunesse de l’humanité. Heureux
est l’homme qui peut être surpris ! La jeunesse, et non les jeunes, est
continuellement surprise parce qu’elle rencontre et découvre tout le temps de
nouvelles choses. Et cela la maintient vraiment jeune... Cher Charles, quand
demain toi et moi nous nous rencontrerons main dans la main sur la lune, alors
tu ne seras pas surpris ?
— Si nous
survivons à l’enfer d’aujourd’hui et que nous ne nous retrouvons non pas sur la
lune, mais seulement sous le clair de lune du Bois de Boulogne, je croirai
encore aux miracles !
Oui, la cheffe du
renseignement à l’état-major des combattants MOI était une interlocutrice
intéressante ! Mais lequel des membres de ce service ne suscitait pas la
sympathie et l’admiration ?
Martin ? Le
vieux social-démocrate, le bel homme aux grands yeux noirs, le cheminot,
l’émigré politique, la figure active des Syndicats français et du Parti
communiste, le père et le mari, qui a sacrifié les siens et s’est entièrement
consacré à l’une des tâches les plus dangereuses ? Était-ce lui qui, bien que
légèrement boiteux, se promenait dans les rues de Paris huit à dix heures par
jour ? Était-ce lui qui n’avait jamais refusé de faire le travail qui lui
était confié ? Était-ce lui qui, pendant un mois, obstinément,
inlassablement, marchait chaque matin d’un bout du bois de Boulogne à la porte
d’Auteuil pour observer le décor dans lequel le commandant de Paris von
Stülpnagel faisait sa promenade matinale ? Était-ce lui qui, une fois
arrêté par les agents de la Gestapo en raison de ses fréquents allers-retours
dans le coin de forêt désigné, avait poursuivi seulement deux jours plus tard
ses observations dans le même voisinage ? Pourquoi cette obstination,
pourquoi ce défi au destin ? Parce que Martin était un soldat du parti,
prêt à mourir à son poste. Comment ce combattant sans nom sur le front
invisible ne pouvait-il pas nous émerveiller[79] ?
Le troisième membre
du Bureau de Renseignement, non en termes de mérite ni de responsabilité, était
la Cracovienne Odette, Micheline, Marianne, Michèle, Henriette, Louise et je ne
sais combien d’autres pseudonymes qu’elle changeait comme les gants de ses
doigts rose clair fusiformes. Sur son visage, rond et dodu comme une pomme,
deux sourcils fins et incurvés s’arquaient au-dessus de ses yeux vifs et
charbonneux. Sa couleur de cheveux d’origine était probablement noire ou brune.
De taille moyenne, agile et débordante de santé, comme les trentenaires matures
de Balzac, elle était la seule à convenir à mes grands pas. Membre du parti
communiste polonais avant même la guerre, elle avait dirigé des groupes du
Komsomol à Paris dans les années 1939-1941. Au cours du premier mois de
l’occupation hitlérienne, ses groupes ont commencé à répandre des appels
antifascistes dans les rues de Paris, dans les jardins, dans le métro, ils ont
commencé des actions de sabotage, en parsemant rues et boulevards de pointes
triangulaires en fer, en effaçant ou déplaçant des panneaux de signalisation en
allemand, en arrosant d’essence et en incendiant les voitures, bus et camions
des occupants stationnés devant les hôtels. Parfaitement à l’aise en allemand
avec un pur accent viennois, Odette rejoignit l’activité spéciale AMI
(anti-guerre) du Parti communiste. En raison de la nature de sa tâche, la belle
communiste a dû rencontrer et même flirter avec des officiers jeunes et moins
jeunes afin d’ébranler leur foi dans l’idée délirante de la domination du
monde. Certains des officiers se sont avérés « étanches » ;
lorsqu’elle s’est révélée à eux comme antifasciste, ils ne l’ont pas trahie,
ils ont même accepté d’introduire des tracts dans les locaux et les boîtes aux
lettres de leurs collègues. Sans vous en apercevoir, vous pensez déjà :
« Quelle brave femme polonaise ! »
Ah, Odette, Odette ! Elle ne brillait alors pas que par son
courage, qui débordait d’elle. Elle se distinguait par sa conflictualité et...
sa tendance à s’amouracher. Étant en contact fréquent avec notre responsable
militaire, elle avait appris à le connaître et… le détestait. Elle en voulait à
son ton dur, à ses critiques souvent dévastatrices et à son absence totale
d’autocritique.
Odette était
dévouée, courageuse, sympathique, mais incapable de vaincre son étourderie.
Parfois, elle était en retard pour les réunions, et il y avait même des fois où
elle les manquait complètement. Roger n’était pas enclin à chercher longtemps
les raisons de cette faiblesse, et grondait la modeste camarade comme un
officier gronde un soldat sot avec des mots durs. La combattante communiste
Odette supportait très douloureusement ces reproches, ou plutôt elle ne
supportait pas du tout ce genre de critiques, et se heurtait constamment au
chef militaire. Odette avait trouvé une alliée en la personne de sa compatriote
Daniela – le contact du détachement juif, également une noble combattante. Les
deux ont mené une campagne contre le « cruel » Roger. Les accusations
de cruauté étaient en fait une protestation contre son exigence excessive.
J’ai dû intervenir
dans leurs différends en tant que commissaire politique. Qu’est-ce qui s’est
avéré ? J’ai été soulagé de constater que la « cruauté » de
Roger n’existait pas, qu’il était justifié d’insister pour qu’un groupe de
combat accomplisse une certaine tâche ; qu’il reprochait justement,
quoique durement, à Odette son retard ; que par nécessité il avait fait
travailler 24 heures sur 24 le service technique afin de fournir dans les plus
brefs délais aux combattants de fausses cartes d’identité ou du matériel de
combat ; que les trois parties en conflit étaient de merveilleux
combattants communistes. Quels ont été les résultats de mon intervention ?
Roger n’a pas modéré son ton dur, Odette n’a pas cessé d’être en retard,
Daniela a continué à se plaindre du chef militaire « impossible ».
L’échec de mon intervention produisit néanmoins un résultat que je n’attendais
ni ne souhaitais : Odette montra... son penchant pour tomber amoureuse.
Soutenue par sa camarade, elle écrivit une lettre à la Commission pour le
travail avec les émigrés du CC du Parti communiste français avec les mots les
plus élogieux sur le commissaire politique qui... etc.
Bianca, Martin,
Odette ! Trois communistes, trois maîtres du renseignement, trois abeilles
mellifères de l’état-major !
Lequel des trois
nous a indiqué la station Pont de l’Alma ? Je ne m’en souviens plus, mais
l’objectif a été bien découvert et examiné. Il s’agissait du train qui quitte
la gare des Invalides, s’arrête au premier arrêt, Pont de l’Alma, et se dirige
vers Versailles. La ligne de chemin de fer souterrain suivait le lit de la
Seine. Le quai de la gare était accessible par de larges escaliers couverts en
béton. Les observateurs avaient constaté que chaque matin à huit heures le
train pour Versailles part de la gare des Invalides. Le wagon arrière est
réservé uniquement aux officiers et sous-officiers des forces d’occupation. À
la gare du Pont de l’Alma, le train arrive à 8 h 03 et s’arrête une minute. Là
montent 4-5 autres officiers et un civil, également allemand. Une Française et
un Français attendent sur les bancs du quai et montent dans le premier wagon à
côté de la locomotive. Pendant les deux semaines d’observation, une seule fois
le vendeur de billets a quitté son comptoir au-dessus du pont et est descendu
pour reconduire le train. Habituellement, le conducteur se montre de la
locomotive, vérifie que tous les passagers sont dans les voitures, siffle et
ferme automatiquement les portes. Le train part parfois dix ou cinq secondes
plus tôt, parfois plus tard. Nos hommes doivent attendre que les portes
claquent, que le train avance de deux ou trois mètres, puis agissent avec des
grenades. Il faudra que la sécurité se place en haut des escaliers pour
éventuellement paralyser le garde s’il tente de descendre. La voiture avec
notre chauffeur devra attendre à proximité sur le quai Branly, car il y a
beaucoup de militaires hitlériens dans le quartier.
L’état-major a
approuvé le plan, a ordonné que l’opération soit confiée à un groupe de combat
du détachement juif.
Le commissaire
politique du détachement portait le pseudonyme de Richard. Il serait venu
depuis Buenos Aires pour combattre dans les rangs des inter-brigadistes.
Tailleur de profession, toute sa silhouette témoignait de son humble statut
professionnel. Quand il parlait, sa voix, ses gestes, son regard vif
rayonnaient d’une forte flamme intérieure.
Lors d’une réunion,
Richard m’a parlé avec un enthousiasme particulier :
— J’ai examiné
l’objectif. Je suis entièrement d’accord avec le plan d’action proposé. Nous
avons les bons combattants pour l’action. Nous trouverons un chauffeur de taxi.
Maintenant, je voudrais que tu prennes en considération un de mes souhaits.
Cela me tourmente depuis longtemps. Je sais, la discipline est cruciale et
c’est pourquoi je l’ai étouffée... Je veux participer directement à l’action.
Je m’empresse de te le dire, les jeunes Jean et Gilbert étaient très contents
que je sois avec eux...
— Tu
leur as déjà parlé ?
— J’y ai fait
allusion, mais ils ont compris.
Nous avons ralenti.
Nous sommes passés sous l’arche de fer de la tour Eiffel et nous nous sommes
assis sur un banc du parc du champ de Mars. La question pour moi était
compliquée. En effet, Roger a participé à l’incendie de la rue Laborde, et
pourtant il serait incorrect de faire de l’exception une règle. Je lui ai
demandé pourquoi il voulait agir lui-même.
— Si tu n’es
pas juif, tu ne me comprendras probablement pas, m’a répondu directement
Richard. — En tant que communiste, je dois lutter contre les fascistes. Et
c’est pourquoi j’étais en Espagne et maintenant je suis un combattant de la
Résistance. Mais je suis aussi juif. En tant que Juif, j’ai mes propres raisons
particulières. L’hitlérisme a détruit des millions de mes compatriotes. Mon
frère a été enlevé un matin et est mort dans un camion à gaz. Depuis, je suis
rongé par le chagrin, le chagrin terrible, le chagrin de la vengeance.
Toute la tirade
était dite sur un ton profondément sincère. Richard était l’essence même de
l’honnêteté et de la gentillesse. Ses yeux brillaient et s’humidifiaient. La
cigarette dans sa main tremblait. Il mettait tout le sens de sa vie dans sa
requête. Dans cet état d’esprit je doutais de sa discipline. J’étais sûr — avec
ou sans ma permission il participerait à l’action.
— D’accord —
j’ai accepté, — sous certaines conditions. Pas un mot à quiconque. En plus,
vous transporterez l’arme avec le taxi, vous la cacherez dans le taxi après
l’action. Tu diras à Jean et Gilbert que tu agis de ton propre chef... Je n’en
sais rien, sinon nous souffrirons tous les deux plus que d’être fusillés, nous
serons expulsés du parti.
— Merci et je
n’oublierai jamais...
Deux jours après
s’être quittés à neuf heures du matin, nous nous sommes retrouvés avec Richard
dans le parc silencieux Saint-Lambert du XVe arrondissement de Paris. Sans
permission, il avait amené avec lui Albert, le responsable militaire du
détachement juif.
— Maintenant,
je peux mourir en paix, dit joyeusement, presque solennellement, le commissaire
politique. — J’ai vengé mon frère plus de dix fois. Je suis heureux... Les
jours que je vivrai dans le futur seront faciles pour moi.
Et il m’a dit que
l’action s’était déroulée selon nos prévisions. Enfin, il donna la parole à
Albert pour compléter son histoire.
Albert était un
homme grand, blond et mûr avec un visage pâle et bouffi. Il a en effet
poursuivi :
— En tant que
chef militaire du détachement, cette action me convenait bien. Si tu n’avais
pas permis à Richard d’assouvir son sens de la vengeance sans le demander à toi
et à Roger, je serais parti avec lui... Je dois te dire que nous sommes amis
d’enfance. Maintenant que nous travaillons ensemble dans le groupe, nous nous
sommes promis de combattre ensemble à la vie et à la mort... Nous avons décidé
que l’un de nous devrait voir les dégâts de ses propres yeux. Une camarade et
moi attendions le train au prochain arrêt, La Bourdonnais. L’écho des explosions nous parvenait à peine... Le
train avait du retard. Il n’est arrivé qu’après environ 20 minutes... De
nombreux passagers ont sauté sur le quai. Deux agents des chemins de fer de la
gare ont couru vers le conducteur de la locomotive. Les trois se sont immédiatement
dirigés vers le dernier wagon. Plusieurs boches blessés s’étaient déjà tirés de
là. Certains boitaient, d’autres se tenaient la tête à deux mains, couverts de
sang... Nous nous sommes également approchés du wagon accidenté... Il y avait
beaucoup de cadavres déchirés... Bientôt 7-8 policiers en uniforme et en civil
sont arrivés en courant, et dès la porte de la gare se sont mis à crier :
« Tous les passagers libérez le quai. » Nous nous sommes prudemment
repliés... Moi et Richard sommes des loups expérimentés et on ne se prend pas
la tête, mais le succès de l’action est vertigineux. Je pense que le
détachement et surtout le groupe de trois combattants doivent être récompensés
par votre état-major, voire par le CC du Parti français.
— Le
succès est indiscutable, ai-je admis. — Quant à la récompense... la question
doit être considérée de tous les côtés... Si nous regardons de plus près
l’action, nous trouverons... des poins fragiles. Tout d’abord, je réprimande
sévèrement Richard pour avoir initié une camarade à l’action.
— Tu te trompes
d’adresse, m’interrompit Albert. — Je l’ai prise sous ma responsabilité.
J’aurais aimé que nous soyons plus de témoins. Elle ne savait rien. Je l’ai
appelée sans rien révéler. D’ailleurs, même si je l’avais prévenue, il n’y
aurait eu aucun danger. C’est une vieille camarade, expérimentée depuis la
Pologne, et en plus juive. Et tu sais qu’un espion ou un traître juif ne peut
pas être...
— En
général, dans cette action, nous avons pris des libertés, ai-je dû juger à voix
haute. — Richard n’aurait même pas dû t’avouer ce que je lui ai ordonné de
faire. Toi, à ton tour, tu inities une autre personne à l’action... Elle serait
une bonne camarade. En principe, nous sommes tous bons. Cela ne veut pas dire
bafouer les lois de fer de la conspiration, fruits de luttes de longue date.
Quant aux juifs, permettez-moi de vous rappeler une chose dont vous m’avez
vous-même informé : « Un certain nombre de juifs ont été libérés du
camp de Drancy après avoir signé une déclaration selon laquelle ils serviraient
la Gestapo. »
— C’est juste
une tactique pour se sauver, tenta Albert pour justifier ceux qui ont capitulé.
— Pas tous,
réfuta sèchement l’honnête Richard. — Il y a des salauds. Ne trahissent-ils pas
aujourd’hui nos familles, n’extorquent-ils pas leurs compatriotes de sommes
fabuleuses ? Charles a raison et tu le sais... Maintenant, dis-moi
pourquoi je t’ai amené et je présente des excuses à mon chef.
— Nous sommes
tes subordonnés, commença le chef militaire Albert. – Tu sais qui nous sommes.
— Autant qu’il
faut...
— Tu connais
aussi notre relation avec Roger.
— Richard m’a
parlé sur ce sujet plus d’une fois. J’espère que tu comprends...
— Moi aussi,
mais peux-tu parler à une pierre ?
— Notre
responsable militaire, dis-je, est un communiste et un chef consciencieux.
— Pour vous,
pour la direction, car il sait probablement s’adapter.
— Le travail,
pas les courbures de sa colonne vertébrale, est notre mesure.
— D’accord, je
ne discute pas... Depuis trois mois, je l’ai nommé mon adjoint : Gilbert,
un inter-brigadiste, un combattant formidable... Roger ne veut même pas en
entendre parler. Il ne nie pas ses qualités pour me remplacer, mais il refuse
catégoriquement de prendre en considération ma demande. Mes motivations
seraient de petit bourgeois. Qu’y a-t-il de mesquin à vouloir travailler plus
dur pour rembourser mes dettes qui traînent d’avant la guerre ? En tant
que militaire, je suis obligé d’inspecter tous les objectifs d’action, pour
m’assurer que les combattants maîtrisent les différents types d’armes. Tout
cela me prend du temps. La femme fait des scandales sans fin. Les ouvriers
tailleurs et couturiers, ils se plaignent parce que je ne leur fournis pas
assez de matériaux, je ne leur fournis pas de travail. Mon atelier est petit,
mais si je m’y consacre davantage, je gagnerai et rembourserai mes dettes... Je
n’abandonne pas la lutte. Bien que je sois tailleur, je suis politiquement
éclairé et j’ai envie d’écrire. Je propose que le parti m’utilise dans la
presse illégale pour les Juifs.
J’ai déclaré à ce
candidat voulant devenir riche mon accord avec l’avis de Roger. En plus, à sa
grande horreur, je lui ai rappelé d’accomplir l’ordre de longue date de devenir
ouvrier payé comme Richard, car lui seul parmi les responsables militaires de détachements
continuait à exercer son métier.
— Vous avez
oublié notre morale prolétarienne, rétorqua Albert avec colère. — Comprenez,
mes créanciers sont principalement des ouvriers. Je suis honnête. Le parti m’a
appris à ne jamais mentir à la classe ouvrière, même dans la vie privée.
— Les ouvriers
te pardonneront tes dettes, dès qu’ils apprendront un jour, que tu as lutté
dans les rangs des combattants. Tu peux en être sûr.
— Et j’essaie
de lui expliquer la même chose — ajouta son ami Richard. — Il s’agit du sort de
l’humanité en ce moment, et lui, il réfléchit à quelques petites dettes.
— Je suis tombé
entre vos dents, allez, mangez-moi tout entier. Ça va, ce n’est pas pour rien
que vous êtes tous les deux commissaires politiques. Mais pour vous prouver que
non seulement vous, mais aussi moi, je suis un révolutionnaire, ici je déclare
devant vous : dans deux ou trois mois, je passerai en travail permanent
dans le détachement.
Une bonne humeur
s’est créée, nous avons quitté le parc, marché pendant dix minutes dans les
rues calmes du quartier, parlé des actions futures, des batailles autour et à
Stalingrad. Avant de nous séparer, Albert sans rime ni raison me demanda soudain :
— Camarade
Charles, il est possible qu’à tout moment l’un de nous tombe fauché dans la
bataille contre l’hitlérisme. Et me voici maintenant, près de toi, je suis
saisi par un désir particulièrement fort. Je veux savoir de quelle nationalité
tu es. Tu peux ne pas répondre si tu as décidé de rester fidèle à la
conspiration. Mais je te le demande parce que je sens que tu es un communiste
de longue date. Comme tu peux le voir, Richard n’est pas le seul à pouvoir
t’aimer... Mais il brûle aussi du même désir, seulement il a peur de
l’admettre...
— Nous avons
suffisamment enfreint les règles de la conspiration ce matin... Priez pour que
nous survivions jusqu’à la fin de la guerre. Ensuite, nous ouvrirons nos cartes
d’identité.
Je gardais ma
nationalité très soigneusement. Sur cette base, la police pouvait facilement me
retrouver, puisque seuls quelques Bulgares participaient à la Résistance
parisienne. Mon extrême prudence s’est avérée salvatrice. Vers la fin de 1943,
Albert a été arrêté. Tombé entre les mains d’officiers expérimentés de la
Gestapo, il a échoué honteusement : il a accepté de sauver sa vie en
trahissant la direction des groupes de combats MOI à Paris ! Mais gloire
aux services de renseignement du Parti communiste français ! Deux heures
seulement après la capture d’un camarade, le CC du parti apprenait le
comportement de la personne arrêtée. Albert est resté silencieux, dans le déni
pendant cinq ou six heures, puis il a capitulé. Capitulé non pas sous les coups
du fouet, des cerceaux électriques, de l’immersion tête baissée dans une
bassine d’eau chaude, mais sous la pression du harcèlement moral. L’habile
enquêteur de la Gestapo a réussi à faire comprendre à sa pitoyable victime que
son avenir (opulent et somptueux) serait garanti si... etc.
La police a arrangé
son... évasion, mais elle ne soupçonnait pas avant même qu’elle ne soit mise en
scène, que le parti était déjà au courant pour lui...
« L’évasion »
a eu lieu sur le boulevard Jean Jaurès entre les rues Barbusse et Villeneuve
dans la banlieue Clichy. La voiture de la prison s’est arrêtée sous prétexte
que la batterie était morte. Les deux policiers et les prisonniers sont
immédiatement descendus pour pousser la voiture. Apparemment par hasard, les
deux gardes se tenaient sur le côté gauche de la voiture. Albert, à droite, fit
signe à ses compagnons de se taire et se perdit rue Villeneuve. Menotté, il a
frappé à l’appartement d’une famille juive. L’hôtesse l’a accepté comme un
héros et a immédiatement appelé son mari. Le « fugitif » demanda que
l’on organise un rendez-vous avec Hervé, Charles et Roger.
Nous envoyâmes
Richard pour l’assurer que lesdits camarades le verraient dans trois jours.
À l’heure et au lieu
désignés (21 heures, forêt de Meudon près de Paris) Albert ne vit que X, chargé
de l’enquête et... de l’exécution avec l’aide de deux combattants juifs...
Plus tard, la police
a compris pourquoi seuls ses limiers se sont présentés à la rencontre avec
l’agent nouvellement recruté Albert et... elle est devenue furieuse. Elle a
fait irruption dans les maisons de dizaines de familles juives, a renversé tous
les meubles, a demandé doucement ou brutalement, si quelqu’un avait vu le
meilleur ami du propriétaire de l’atelier de couture...
Illégal, Richard a
dû s’enfoncer dans une illégalité encore plus profonde. Nous avons décidé de
lui donner les moyens financiers et les documents nécessaires et de quitter le
terrain brûlant de Paris. L’ordre était catégorique : Richard doit
disparaître immédiatement de la circulation parisienne. Et il disparut, mais...
pas selon la lettre et l’esprit de l’ordre... Un grand cœur battit dans la poitrine
tuberculeuse de Richard, qui avait été comprimée par l’insupportable travail de
couture ! Il est devenu un piège dans les dents duquel est tombé son
propre noble propriétaire. Il avait une machine à coudre. Avant de partir pour
la campagne, il engagea deux porteurs et emmena avec eux la machine dans le
grenier d’une de ses amies. Il voulait faire une agréable surprise à sa
compatriote, mais il a été désagréablement surpris par la police qui
l’attendait derrière la porte ! En vain, il a essayé de se défendre —
quatre bras et jambes solides l’ont cloué au mur devant l’horreur de la
couturière abasourdie. Ainsi se terminèrent les jours heureux que vécut Richard
après l’action à la station du Pont de l’Alma. C’est ainsi que le cœur d’un
communiste mort aux mains des tueurs d’âmes de la Gestapo a cessé de battre
sans prononcer un mot dénonciateur[80] !
MISSAK
MANOUCHIAN ET SA PREMIÈRE ACTION
La route du combat
était jonchée de victimes très chères. De lourdes pertes ! Mais cette
lutte était épique – à la place des morts des milliers de nouveaux héros se
levaient !
Un jour, Hervé m’a
amené à rencontrer, rue Paradis, dans le 9ème, un homme de 30-35 ans, à la peau
foncée, mince, au nez pointu, aux yeux pétillants, aux sourcils épais et à la
moustache fine. Son costume noir luisait d’usure, ses cheveux foncés et épais
mettaient en valeur un front haut et saillant, et ses mains, légèrement
rugueuses, témoignaient d’un travail physique.
Hervé m’a dit :
— Il est envoyé
par le groupe de langue arménienne. Fixez tout de suite un rendez-vous et après
l’avoir écouté, tu décideras où et comment l’utiliser… Je vais passer un peu
devant, pendant que vous vous mettez d’accord.
L’inconnu m’a
demandé d’indiquer l’heure du rendez-vous pour les jours choisis, par exemple
lundi et jeudi, parce que les autres jours il était occupé. Il m’a demandé de
l’appeler Georges. Sans lui poser aucune autre question, je lui ai dit de venir
le lundi exactement à 17 heures dans l’étroite et tortueuse petite rue Varet
dans le 15ème. Nous nous sommes séparés en nous serrant la main. La main
d’ouvrier du nouveau combattant m’a semblé chaude et douce.
J’ai rattrapé Hervé.
On se voyait avec lui au moins une fois par semaine. Le plus souvent, il
m’informait sur le cours de la guerre et plus spécialement sur la Résistance en
France. Dans ces rencontres nous parlions régulièrement des actions réalisées
et à venir. Les combattants — leurs émotions, sentiments, pensées, avis,
objections, leur situation à la maison, leur discipline au combat et dans la
clandestinité étaient naturellement au centre de notre attention. Avant de
parler, comme d’habitude de ces questions, Hervé m’a donné quelques
explications sur le camarade qu’il venait d’amener :
— Je vais te
dire quelques mots sur le nouveau combattant. Jusqu’à présent il faisait partie
du petit groupe militant de l’émigration arménienne. C’est un travailleur
idéologiquement et politiquement préparé. Tous les autres de son groupe du
parti sont des propriétaires orfèvres, commerçants, artisans. Certains d’entre
eux sont assez riches… Nous leur avons demandé de proposer un ou plusieurs
combattants. Jusqu’à présent ils n’ont pas répondu. Maintenant ils nous
proposent le seul travailleur d’entre eux. Là-dedans il y a quelque chose de
beau, de logique. Mais je sens une certaine réaction du camarade. Comme s’il
lui manquait de l’enthousiasme, si nécessaire pour les nouveaux convertis… Il
faut bien le comprendre, sentir son pouls…
Avec Georges nous
avons fait connaissance le lundi suivant. Je me suis rendu à la rencontre avec
un peu de retard. Georges était à l’heure, ce qui était un bon signe. Je ne lui
ai pas posé la question de routine : « Quelles sont les incitations
qui t’ont poussé à entrer dans les rangs des partisans parisiens ? »
J’ai décidé de passer vers une attaque psychologique frontale et je lui ai
dit :
— Je suis
content de te féliciter comme un des nôtres. Chaque nouveau venu dans la lutte
contre les occupants hitlériens est une contribution importante. Et j’ai ajouté
directement :
— Dans une
heure je vais te faire rencontrer un camarade, qui va te montrer quand, où et
comment tu agiras.
Georges marchait à
côté de moi, silencieux et réfléchissant. Une petite pause survint. Il alluma
une nouvelle cigarette. Il était clair qu’il luttait avec lui-même. De sa
poitrine sortit un petit soupir, il tira profondément sur la cigarette, sans
expirer la fumée, et il commença à me parler avec un ton légèrement
nerveux :
— J’aime la
clarté, je déteste les malentendus. Et, il s’avère qu’ici, il y a un
malentendu. Et toi, et le camarade, qui m’a rencontré avec toi, vous parlez de
moi comme un combattant, un nouveau combattant, qui a rejoint la lutte armée.
Je ne sais pas comment notre agent à la direction centrale vous a soumis la
décision du groupe du parti. Mais je vais t’annoncer ce qui s’est décidé
exactement : « Le camarade, c’est-à-dire moi, est désigné pour entrer
dans les rangs des groupes de combattants, mais étant donné qu’il a certaines
considérations, qu’il les présente lui-même devant les camarades, et si elles
sont acceptées, le groupe présentera un nouveau candidat ». C’est ça la
question.
J’étais obligé
d’écouter ses considérations. Le temps de janvier nous transperçait de sa
froideur humide, et le vent soulevait légèrement nos imperméables. Nous sommes
passés devant le cimetière Vaugirard, nous sommes entrés dans la bruyante rue
Lecourbe et nous avons commencé à faire le tour des rues autour du métro
Convention. Qu’ai-je appris ? Georges vivait avec son amie, elle aussi
arménienne. Longtemps ils avaient été sans emploi. Enfin ils ont trouvé une
sortie. Ils ont commencé à faire des beignets et des gâteaux. Ils les vendaient
à très bon prix dans une unité militaire à Rouen. Il voyageait deux fois par
semaine jusqu’à cette ville bretonne. Avec l’argent gagné pour l’instant, ils
remboursent les prêts et payent l’équipement artisanal et quelques meubles pour
l’appartement. J’étais intrigué par le fait qu’il s’était acheté une table pour
écrire, parce qu’il aimait écrire des choses. Sans le vouloir, je m’imaginais
Georges comme un Tommy, mais plus âgé. J’ai compris que j’avais affaire à une
nature émotionnelle. Ses considérations étaient les suivantes : pourquoi
exactement lui, et pourquoi exactement maintenant, quand il vient de créer des
conditions de vie meilleure et qu’il peut s’adonner à sa passion favorite — la
poésie ? Pourquoi exactement lui, quand il s’agit de travail pour la cause
et de victimes. Alors qu’il a consacré des années entières à l’émigration
arménienne, et que beaucoup des membres du parti réduisaient leur devoir pour
la cause principalement à des contributions d’argent.
Avec un peu de
protestation dans la voix Georges m’a révélé son âme :
— Ils sont tous
riches et … cyniques. Ils n’ont pas honte de me dire, qu’ils assureront une
pension pour ma femme, au cas où il m’arriverait un malheur. C’est ce qui me
retient. En plus dans le groupe il y a des plus jeunes et qui devraient être
aussi aptes à combattre comme partisans. Je propose que vous veniez dans le
groupe et posiez à chacun la question : « Pourquoi pas toi et non
Georges ? » On verra alors ce qu’ils répondront et s’ils pourront
opposer quelque chose de sérieux…
Je l’ai laissé
parler pendant presque une heure. Je ne l’ai pas présenté au camarade, qui nous
attendait dans un des cafés à côté du métro Convention. Avec Georges il fallait
travailler encore, il fallait attendre qu’il mûrisse, avant qu’il entre dans
nos rangs.
S’ensuivirent
beaucoup de lundis et de vendredis. Les rencontres continuaient pendant des
heures. Nous avons appris à nous connaître comme des frères, sans qu’il me
révèle son nom et moi, sans lui dévoiler ma nationalité. Une compréhension
spéciale s’est installée entre nous, sur les thèmes de l’art et de la
littérature. Je lui ai dévoilé ma passion pour le théâtre, et lui son ardeur pour
la poésie. Il a publié des poèmes dans leur journal avant la guerre. Il avait
assez de poèmes pour un recueil.
Qu’est-ce que j’ai
encore appris de la biographie de cet homme extrêmement intéressant, très
cultivé et avec un grand élan d’énergie ?
À huit ans, il a été
chassé de sa ville natale Adıyaman, près de la frontière syrienne. Les
gendarmes turcs ont pris avec lui sa mère, ses deux frères et sa tante. Son
père, qui devint partisan dans les environs d’Urfa, succomba dans la lutte
contre les armées turques. Sa mère attrapa le paludisme et mourut bientôt. Les
trois orphelins se blottirent sous la faible protection de la tante. Tous les
quatre furent exilés à Deir ez-Zor, où des dizaines de milliers de compatriotes
moururent sous les coups des séides du sultan, de la misère, de la faim et des
maladies. Une mission catholique à Istanbul réussit à sauver une très petite
partie des enfants. Dans cette partie il y eut le petit enfant avec le regard
éveillé, aux yeux noirs, aux cheveux bouclés et au petit nez pointu. Le sort de
ses proches fut tragique — tous laissèrent leurs os dans le camp de
concentration turc. Parmi les enfants protégés dans le monastère catholique
l’orphelin Georges se détachait par son intelligence, sa grande mémoire et sa
belle voix. Les chefs de la mission voyaient déjà en lui un futur confrère. À
17 ans ils lui proposèrent ouvertement de choisir la robe noire. Le jeune homme
refusa catégoriquement. Il s’était déjà consacré en son for intérieur à la
mission de travailler pour améliorer le destin de l’émigration arménienne,
éparpillée aux quatre coins du monde.
Venu bientôt à
Paris, Georges chercha en vain parmi ses compatriotes un parent proche. Dans la
ville bruyante et très peuplée, il se sentait seul et étranger. Il chercha une
aide à la solitude dans la poésie, les livres et les syndicats progressistes.
Les classiques du Marxisme-Léninisme lui ouvrirent un nouveau monde. Il devint
un membre actif de la jeunesse communiste française. Dans le milieu des années
30 il était déjà secrétaire du comité central de secours pour l’Arménie[81]
et éditeur de leur journal Zangou. Il publiait des ouvrages, bien connus de ses
compatriotes à l’étranger. Il avait les pensées suivantes : « Amuser
quelqu’un c’est bien, mais l’éduquer c’est mieux ; le rôle de l’écrivain
est d’éduquer et d’enseigner les masses ; le but du créateur est de durcir
le caractère des gens et de les sortir du chaos présent vers une meilleure
vie »
Je ne suis pas allé
dans le groupe de Georges. Georges est venu vers nous. Pourquoi en fin de
compte a-t-il donné son accord pour entrer dans nos rangs ? Sûrement pas à
cause de la force de mes arguments. Pendant ce temps se déroulait la terrible
bataille de Stalingrad. Dans ses flammes se sont réduites en cendres les
hésitations du futur commissaire militaire des FTP-MOI parisiens. La victoire
de Stalingrad lui a donné un élan décisif.
La première action
de Georges représentait la forme la plus haute d’opération militaire des
partisans dans les conditions de l’époque à Paris. Il devait attaquer tout seul
une compagnie hitlérienne entière. À sept heures la compagnie venait de la
banlieue Levallois-Perret, se montrait sur l’avenue Bineau et entrait sur
l’avenue Porte de Champerret, pour s’engouffrer dans la station de métro du
même nom. L’avenue dans cette partie de Paris était large, avec des bâtiments
élevés et avec un trottoir large du côté gauche. Sur le trottoir s’élevaient
des arbres relativement gros et hauts.
La préparation de
l’action dura à peu près deux semaines. Pendant ce temps nous deux, et ensuite
Rajman, désigné comme protection, plusieurs fois, le matin et l’après-midi nous
regardions tout autour l’endroit de l’action et les chemins de repli des
combattants. Le plan était défini et finalisé par nous trois à l’unanimité. Il
comprenait les points suivants : Georges s’adosse à un arbre près de la
rue Chaptal et avenue Porte de Champerret. Rajman est derrière lui à 5-6
mètres. Quand la compagnie dépasse l’arbre, Georges lance la bombe au milieu de
la compagnie, se lance rapidement dans la rue Chaptal et à l’angle de la rue
Louise Michel il donne son pistolet à une camarade. Rajman le suit à une
distance d’une dizaine de mètres.
La veille de
l’action Georges a fait devant moi la confession suivante :
— Tu sais dans
quel état d’esprit j’étais au début. Depuis j’ai grandi à mes propres yeux.
Quand, il y a deux semaines nous avons discuté concrètement de ma première
action, j’étais prêt, résolu à me lancer, mais je ressentais une petite peur,
j’étais troublé, je pensais à des choses non essentielles. Depuis trois jours
je me suis débarrassé de tout ; j’ai l’impression d’avoir pénétré le
secret de l’être humain et je suis au-dessus de tout ça. Jamais, même quand je
créais mes meilleurs poèmes, je n’ai ressenti un tel bonheur, une telle joie,
une telle puissance. Je me sens bien et léger… Jusqu’à ce jour je n’ai pas tué
une poule, mais maintenant je suis prêt à me battre contre une armée
hitlérienne entière.
Je comprenais le
combattant, qui le lendemain recevra son baptême du feu, et je me suis contenté
de lui paraphraser notre Christo Botev[82] :
« Il n’y a pas de pouvoir sur la tête qui a décidé de tomber ! »
À neuf heures le
lendemain matin pendant la rencontre au parc Monceau avec ses arbres dénudés et
ses bancs vides Georges et Rajman me racontèrent leur exploit. Juste à sept
heures, la compagnie entre dans l’avenue Porte de Champerret et dépasse
l’arbre. Georges lança la bombe au milieu de la compagnie. Après 5-6 secondes
les hitlériens survivants commencent à tirer sans discernement avec des pistolets,
des fusils et des mitraillettes. La bombe tombée brusquement, comme d’en haut,
les a fait tirer sur les fenêtres des bâtiments voisins. Selon le plan, Georges
entre dans la rue Chaptal, suivi de Rajman à une dizaine de mètres. Soudain les
deux entendirent quelqu’un courir et crier : « Halt, halt ! » Georges tient solidement son pistolet et
accélère ses pas. C’était un sous-officier allemand, qui tout en courant
dégrafait son étui et continuait à crier : « Halt, halt ! » À ce moment Rajman se retourne et avec une
seule cartouche abat le poursuivant téméraire. Rajman rattrape son camarade, le
prend sous le bras et les deux transmettent leurs pistolets à l’agent qui les
attend. Inquiétés par personne, sains et saufs et satisfaits, ils quittent les
environs de la Porte de Champerret.
La bombe avait
envoyé dans l’autre monde une vingtaine d’hitlériens. C’était la première
bombe, lancée par Missak Manouchian — Georges, qui sera le chef légendaire des
groupes de partisans — Main-d’œuvre immigrée de Paris. Plus tard Manouchian
avouera une faiblesse humaine :
— À ma première
action j’avais fait venir mon meilleur ami, pas tellement pour être témoin de
mon exploit, mais plutôt pour raconter aux générations ma mort éventuelle.
SALUTATION
ET CADEAU POUR L’ARMÉE SOVIÉTIQUE
En janvier 1943,
Lapierre, alors responsable de notre troïka pour le compte de l’état-major des
francs-tireurs et partisans français (FTPF), m’a demandé de réunir les
camarades de notre état-major dans un logement sûr. Il devait être à notre disposition
toute la journée. Il n’a pas oublié d’ajouter :
— Ce logement
doit être bon à tous points de vue. En cas de malheur, nous agirons. Nous ne
devons en aucun cas tomber entre leurs mains.
J’ai pris la demande
comme un ordre.
Lapierre était un
homme grand et robuste au visage basané. Il portait une casquette et très
souvent une écharpe blanche. Il était toujours pressé et trouvait toujours le
temps de donner les explications demandées. Pour cela, il était étonnamment
bref. En deux ou trois mots, il vous clarifiait une question qui vous tournait
dans ta tête comme une boule brumeuse depuis des semaines. Ce métallurgiste
français raisonnait comme un vrai général : simple, clair, percutant.
C’était un plaisir pour moi de rencontrer un tel dirigeant.
Cette fois, je
m’élançais pour exécuter la commande rapidement et comme il faut. C’était
l’hiver. Un hiver typiquement parisien : doux, humide, pluvieux. Mes amis
et connaissances françaises ne me refusaient jamais leur logement. Ils ne
savaient pas exactement ce que je faisais. Mais ils me considéraient comme un
des leurs ; ils sentaient qu’eux et moi détestions les hitlériens ;
que ni eux ni moi n’allions travailler en Allemagne.
J’ai décidé de tenir
la réunion dans la chambre de l’infirmière Andrée Koké. C’était l’amie d’un de
mes compatriotes qui était retourné dans son pays natal. Elle vivait seule.
Elle haïssait les hitlériens à mort. Elle ne comprenait pas grand-chose à la
politique. Les rares fois où nous nous voyions dans une de nos familles, je lui
expliquais le sens de la lutte des classes, qui se livrait sous la forme d’une
guerre entre l’axe fasciste et les forces alliées. Peu à peu, le pansement qui
lui bandait les yeux lui était enlevé, à elle l’ouvrière salariée. Koké
s’annonçait comme une bonne sympathisante à nous.
Elle vivait à
100-150 mètres de la station de métro Corvisart sur la rue du champ de
l’Alouette. J’ai galopé dans les escaliers jusqu’au troisième étage. J’ai
sonné. Koké était là. Elle dînait. Elle m’a invité aussi. Alors qu’elle me versait
un ersatz de café, elle m’a demandé directement :
— À quoi
dois-je cette étrange visite du soir ?
J’ai expliqué que
j’avais besoin de son logement. Sans hésiter, elle accepta volontiers. Elle
ressentait un sentiment caché de fierté, parce qu’elle aussi rendait service à
des gens qui luttaient pour la liberté de sa patrie. Elle a accepté de
s’occuper de la nourriture de cinq personnes pendant une journée. Nous avons
pris toutes les précautions. Je lui ai fait allusion à la gêne du troisième
étage. Elle m’a montré deux tuyaux d’évacuation qui passaient juste devant la
cuisine et la chambre.
— Vous les
utiliserez en dernier recours. Ne vous inquiétez pas pour moi. S’il y a un
pam-pam, je l’entendrai. Je travaille à proximité. Je trouverai un moyen pour
être plus tard l’un des soldats que vous gérez.
Après deux jours,
nous sommes entrés dans le logement de Koké selon le plan prévu. Les trois
camarades Hervé, Roger et Louis sont entrés la veille au soir. Koké leur a
donné son seul lit et elle-même a dormi dans la cuisine. Tôt le matin à 7
heures j’ai amené Lapierre.
Le dirigeant
français a commencé par évaluer la situation — au niveau national,
international et sur les différents fronts militaires. La bataille de
Stalingrad était entrée dans une phase décisive. Le dénouement n’était pas
encore arrivé. Mais par la bouche de Lapierre, le Comité central du Parti
communiste français jugeait déjà les combats de Stalingrad comme le début de la
fin de la marche hitlérienne. Avec son ton calme et sa logique de fer il nous
disait :
— Il y a un
tournant dans les hostilités. L’ordre de ne pas reculer d’un pas de plus n’est
pas un hasard. Le commandement soviétique a calculé le rapport des forces, les
siennes et celles de l’ennemi. Il a décidé de ne pas permettre aux hitlériens
de mettre un pied de l’autre côté de la Volga. L’Armée rouge accomplit des
exploits incroyables. Les patriotes sincères de tous les pays doivent lui venir
en aide. Nous avons une excellente occasion pour cela. Le 25e anniversaire de
la création de l’Armée rouge approche. Nous devons exprimer notre gratitude à
cette grande armée. Nous sommes désormais privés de la possibilité d’envoyer
des télégrammes de félicitations et des cadeaux par la poste. Mais nous avons
les conditions pour faire un cadeau et envoyer un télégramme dont l’armée et
l’Union soviétiques garderont le meilleur souvenir.
Le camarade Lapierre
nous a informés que le Comité central du Parti communiste français et
l’état-major des francs-tireurs et partisans français nous ont désignés, les
étrangers des groupes de combat de Paris, d’envoyer le télégramme et faire le
cadeau. Pour cela, il était nécessaire que nos groupes d’élite mènent des
actions qui, par leur effet et leurs conséquences, trouveraient un écho auprès
des soldats soviétiques eux-mêmes. Les actions étaient les suivantes. Les
batteries anti-aériennes du pont de Passy[83] à
Paris et du pont de Saint-Cloud près de la banlieue de Suresnes devaient être
attaquées et détruites. La détonation de nos bombes serait le télégramme, et
les batteries détruites le cadeau.
Il n’y avait rien
dans son ton qui trahissait le moindre doute sur notre bonne volonté. Au bout
d’un moment, sans ajouter un mot de plus, il a demandé simplement, d’un ton
neutre, ce que nous pensions de la proposition.
Hervé a essayé de
nous convaincre de l’importance des actions et du grand honneur que nous
faisaient nos camarades français. Ce n’était pas nécessaire, car Lapierre
s’était exprimé de façon suffisamment claire et persuasive.
Une réponse à la
question était attendue. Roger, Louis et moi nous sommes regardés. Il y eut une
courte pause. Le silence était tendu, mais pas oppressant. Chacun de nous
imaginait l’importance de la responsabilité qui nous était confiée. Il
s’agissait de sauver l’honneur du prolétariat parisien, du parti, de la nation.
Nous avons demandé à
Lapierre de transmettre au parti que nous nous engagions à accomplir la tâche.
Nous avons demandé deux semaines pour étudier les objectifs en détail.
— Je n’avais
aucun doute que vous accepteriez.
— Pour nous,
c’est un ordre de l’armée soviétique elle-même, a déclaré Louis, presque
rapidement, brisant son discours lent.
Dans l’après-midi,
nous avons discuté d’un certain nombre de problèmes actuels de notre
organisation de combat. Finalement nous nous sommes décidés : nous irions
tous les trois — Charles, Roger et Louis — immédiatement après le rendez-vous
au pont de Passy. Nous voulions voir de nos propres yeux non seulement le lieu
de l’action, mais aussi étudier les principales conditions dans lesquelles elle
devait se réaliser. Nous avions l’habitude de faire une inspection personnelle
des lieux d’action, mais jamais auparavant nous n’étions sortis pour repérer un
site ensemble, tous les trois.
Une voie ferrée
souterraine passe sur le pont de Passy, qui perce et encercle
Paris, tantôt elle apparaît en surface, tantôt elle se cache. Des colonnes de
fer donnent à ce pont long et large un aspect imposant. Au-dessous de la ligne
aérienne, dans l’un des renfoncements latéraux du tablier du pont, les
hitlériens s’étaient construit des baraques. La batterie elle-même était
installée sur le trottoir du quai Passy au bord de la Seine. Dans la pénombre
du soir de janvier, debout comme de simples badauds sur le trottoir d’en face,
nous vîmes deux canons et plusieurs appareils spéciaux, gardés par deux
sentinelles. Les canons, les appareils et les hitlériens se tenaient sur une
sorte de plate-forme triangulaire qui aboutissait aux parapets de pierre de la
Seine. Trois larges marches de pierre menaient à la plate-forme elle-même. Un
peu à droite, la rue escarpée du Dr Germse atteignait le quai d’un côté, et
l’avenue du Général Mangin de l’autre. Pour la méthode d’attaque, nous avons
décidé de repousser à une autre visite de notre part. Nous avons tout de suite
étudié l’élément essentiel de la tactique de combat : le lieu de retrait
des combattants. Nous avons mesuré à l’œil nu la distance entre l’objectif et
la ruelle : 10 à 12 mètres. Nous l’avons remonté, pas plus de 50 mètres de
long. C’était la seule issue pour les camarades après l’action.
Nous avons parlé de
cet objectif longtemps. Pris dans la conversation, nous n’avons pas remarqué
notre arrivée à l’église Notre-Dame. C’était l’heure du dîner. En raison de
notre excellent moral, j’ai invité mes amis dans l’un des restaurants grecs à
proximité. Il y avait danger qu’un des compatriotes me voie et se hasarde à
prononcer mon nom. Mais je comptais sur l’heureuse coïncidence, sans laquelle,
soit dit en passant, aucun révolutionnaire ne pourrait survivre longtemps...
Mes camarades ont goûté une telle cuisine pour la première fois. Nous avons
mangé avec appétit. Ils ont souhaité boire du café turc.
Nous nous sommes
répartis les tâches des jours suivants et nous nous sommes séparés. Plus tard,
nous avons décidé : l’action du pont de Passy sera confiée au détachement
juif, et l’attaque du pont de Saint-Cloud aux combattants italiens. La
direction jusqu’au moment de l’action devait être la nôtre
personnellement : Charles pour l’assaut de Saint-Cloud, Roger au pont de
Passy.
Le chef des
combattants italiens à cette époque était Pierrot. Il avait laissé une partie
de son bras gauche dans la lutte pour la liberté espagnole. Commis-comptable de
profession, il s’était auparavant senti coupable envers ses frères ouvriers
manuels. « J’ai dû payer cet impôt sanglant pour mériter de devenir un
digne fils de la classe ouvrière en lutte », m’a un jour confié mon
collègue. Avant que Pierrot ne devienne commissaire politique, le détachement
italien était malade. Fort de son expérience organisationnelle, de sa
persévérance et de sa grande autorité auprès des combattants, Pierrot a su
remettre rapidement l’unité sur pied. Chaque semaine, les camarades italiens
rapportaient 10 à 15 actions significatives.
Quand je lui ai fait
part de la décision du parti et de notre état-major, Pierrot a gesticulé de
joie comme un enfant. Il m’a assuré que ce serait une fête pour tous les
combattants. Pour lui personnellement, cela lui rappelerait les combats en
Espagne.
— Nous
laisserons une trace aux hitlériens pour qu’ils se souviennent de nous, a
déclaré Pierrot avec passion.
Nous sommes allés
tous les deux au pont de Saint Cloud. L’emplacement de l’objectif était gravé
dans notre mémoire : au milieu, un canon anti-aérien à longue portée. Aux
deux extrémités du pont, des baraques pour la compagnie de la batterie ; à
une extrémité vers Paris deux autres canons et plusieurs appareils de mesure.
Sur les embouchoirs des trois canons étaient peints des cercles blancs, rouges,
verts, jaunes, indiquant le nombre d’avions abattus par chaque canon.
Pierrot a commencé à
parler de la facilité avec laquelle ils accompliraient la tâche. Il était de
mon devoir de verser de l’eau froide sur sa fantaisie échauffée. Sans heurter
ses beaux élans, je fixai son attention sur les difficultés de l’action.
Avant de nous
séparer, nous avons convenu qu’il me donnerait dans trois jours un plan
détaillé de la marche à suivre, les noms et le nombre d’exécuteurs, et les
moyens militaires dont il aurait besoin.
Les trois jours
passèrent inaperçus. Nous étions tellement pris dans le temps lui-même que nous
ne sentions pas son cours. Pierrot est apparu à l’heure avec le plan d’action
demandé, travail de leur état-major.
De son côté, Roger a
reçu un plan détaillé de Richard. Avec Olivier, ils sont allés plusieurs fois
inspecter les lieux pendant la journée et le soir. Ils voulaient avoir une idée
précise du mouvement des piétons et des voitures à différents moments de la
journée.
Les trois premiers
se sont rencontrés dans la forêt de Meudon. Nous y avions découvert quelque
chose comme un abri. Les enfants y jouaient aux brigands pendant l’été. Les
jours pluvieux de janvier le rendaient inutilisable par les gosses aux cris
aigus. Nous nous y sommes tranquillement installés et avons discuté pendant des
heures les actions passées et à venir des partisans étrangers en région
parisienne.
Les commandants
politiques nous ont présenté des plans généralement bons. Pour l’exécution des
tâches, des combattants sélectionnés aux qualités éprouvées plus d’une fois ont
été recrutés. Après de longues délibérations, nous avons décidé :
1. Le Service
« Renseignement » continue à étudier les objectifs — le nombre et
l’équipement des soldats, les heures de leurs quarts de garde, les visites non
essentielles aux baraques, le mouvement de la population civile et de la police
française de 6 h du matin à minuit ;
2. De donner un avis
sur quel est le moment le plus favorable pour attaquer.
L’étude de
l’objectif a duré trois semaines. Vers le 15 février, nous, l’état-major des
combattants MOI, étions prêts. Nous avons proposé notre plan pour les deux
actions au camarade Lapierre. Après consultation du CC du Parti communiste
français et de l’état-major des francs-tireurs et partisans français, il a
approuvé pleinement le plan proposé. Il restait 5-6 jours pour se préparer
techniquement. La préparation politico-psychologique des combattants était
terminée. Il restait à parler une dernière fois avec les chefs directs des
actions, Secondo et Jean.
Secondo était
originaire du nord de la France. Il y avait travaillé comme ouvrier du
bâtiment. Il s’était bien illustré dans le mouvement de résistance. À Paris, il
avait enregistré des pages lumineuses. L’incendie d’une des grandes usines
d’Argenteuil était de son fait. Le parti comptait beaucoup sur lui. De petite
taille, aux cheveux blonds et au teint clair, Secondo avait des mains rugueuses
et durcies à cause de la chaux. Son cou était rose-rouge, avec des plis
profondément incisés. Son front, ouvert au-dessus d’yeux blonds et de sourcils fins,
était percé d’une seule ride qui témoignait d’une profonde réflexion. Ce petit
ouvrier italien sans prétention attirait dans le combat des groupes entiers de
combattants plus âgés et plus endurcis.
Ma rencontre avec le
chef militaire du détachement italien avait, pour ainsi dire, un caractère de
prospection. Il y avait des rumeurs de changement chez Secondo : son
enthousiasme s’est refroidi, il est devenu nerveux, il a reporté certaines
actions pendant longtemps. Tout d’abord, je me suis informé pour savoir comment
les combattants sélectionnés voyaient l’action à venir. Secondo a résumé l’état
de leurs esprits en une phrase :
— Ils brûlent
du désir d’agir au plus tôt !
Quand je lui ai
demandé comment il évaluait lui-même la préparation, il m’a surpris par sa
réponse :
— Tout se passe
très bien jusqu’à présent. La question est de savoir si nous serons capables
d’accomplir ce que nous avons décidé de faire.
J’ai ressenti un
faible doute, et je me suis empressé d’en connaître la raison, afin de la
dissiper. Secondo m’a honnêtement avoué son angoisse — toute l’action a été
calculée en minutes et en secondes. Si l’un des combattants troublait le plan,
le succès pourrait être compromis. Nous avons discuté de la possibilité
d’écarts et avons conclu qu’ils ne pouvaient pas être décisifs pour le bon
déroulement de l’action.
À la fin de la
réunion, Secondo a voulu qu’on s’embrasse. Son étreinte était chaleureuse et
exprimait une foi totale dans la juste cause de notre lutte.
Jean était un homme
vraiment jeune. Il venait d’avoir 16 ans. Dans l’équipe, il est monté en un
éclair. Jusqu’à hier, personne ne soupçonnait son existence, et aujourd’hui il
était déjà à la tête d’un groupe, voire assistant du commandant militaire. La
famille de Jean a été enlevée par les chiens hitlériens et déchiquetée quelque
part en Allemagne. Par coïncidence, il n’a pas été attrapé lorsque ses parents
ont été arrêtés. Le jeune abandonné a erré pendant plusieurs mois de porte en
porte chez des amis français. Il a écouté et lu pendant ce temps à quel genre
de torture Hitler soumettait ses compatriotes. Il a profondément souffert que
la fille, devant laquelle il ne pouvait pas se tenir debout et parler
calmement, ait également sombré dans l’océan de sang — l’Allemagne hitlérienne.
Un jour, par l’intermédiaire d’amis, il a rejoint Richard et lui a dit :
« Vous êtes des partisans. Vous vous battez, votre vie a un sens.
Emmenez-moi avec vous. Je veux vivre, me battre, venger mes proches. »
Avec notre
consentement, Richard a confié à Jean un certain nombre d’actes mineurs de
sabotage. Le jeune homme exubérant a fait preuve de maîtrise de soi, de
courage, d’ingéniosité et d’initiative. Bientôt, son propre groupe a commencé à
l’appeler chef. Jean a reçu son baptême du sang rue du Sergent Bauchat près de la
Place de la Nation. Là, un officier hitlérien ivre but son dernier verre, brisé
par la balle de Jean, qui s’était entraîné à tirer une fois dans la forêt de
Rambouillet.
En me rencontrant,
il montra une joie enfantine. Il ne pouvait s’empêcher d’être fier que lui, le
jeune homme, se voie confier un travail aussi responsable. Ce n’était pas la
peine de prendre son pouls politique et moral. La conscience tranquille,
j’acceptai qu’il mène l’assaut sur le pont de Passy.
Le jour de l’armée
soviétique approchait. Jusqu’à sa veille, nous n’avons pas informé les groupes
de combat de l’heure et des minutes de l’action. Ce n’est que le dernier jour
que nous leur avons transmis l’ordre de l’état-major : « Attaquez à 6
h 45 précises ! » Naturellement, chaque groupe ne savait rien de
l’autre. Et nous, les dirigeants, comptions beaucoup sur la simultanéité des
attaques — laissant les occupants ressentir la force de notre organisation de
combat, sa capacité à porter des coups violents simultanément à des kilomètres
l’un de l’autre.
Le soir du 22
février, Roger et moi avons vu tour à tour Pierrot, Richard, Secondo et Jean.
Les rencontres étaient comme un test avant le combat. Les camarades le
sentaient et ne nous en voulaient pas pour les explications que nous voulions
et les clarifications que nous apportions. Nous avons eu une conversation plus
longue avec Secondo, car l’attaque qu’il devait mener était assez
compliquée : sur le pont de Saint-Cloud, l’attaque se déroulait en trois
points presque simultanément.
Le premier point —
la baraque à une extrémité du pont, en direction de Suresnes, le deuxième point
— le canon au milieu du pont, et le troisième — les canons, l’équipement et la
baraque à l’autre extrémité, côté parisien. Ici, la précision était l’une des
conditions décisives du succès. La première baraque devait être soulevée par
une machine infernale qui fonctionne cinq minutes après sa mise en place.
Pendant ces cinq minutes, celui qui la place derrière un mur, sous les fenêtres
de la baraque, doit sauter par-dessus le mur et, avec un autre combattant,
marcher le long de la voie du pont lui-même. Ils doivent...
Sur cette feuille de
mes notes commence l’histoire de Pierrot. Nous avons rencontré le commandant
politique du détachement italien au Bois de Boulogne une heure après la
bataille. Il était exactement 8 heures. Pierrot a volé vers moi comme s’il
flottait sur des ailes.
— C’est
fait ! C’est fait ! — répétait-il de loin, courant presque dans
l’allée. J’avais choisi exprès la forêt, pour que Pierrot puisse donner libre
cours à ses gestes, dont je savais qu’il lui serait impossible de s’abstenir à
un tel moment.
Et donc Pierrot m’a
librement raconté ce qui suit :
Il n’avait jamais vu
un combat aussi brillant, aussi précis. En Espagne, c’était différent. En tant
que teniente (lieutenant), il n’avait pas participé à l’élaboration des
plans. Ici, il savait tout à l’avance, car il avait créé le projet lui-même. Et
comme sur des roulettes, comme une vraie montre suisse, le travail a commencé,
a eu lieu et s’est terminé. Comme prévu, les combattants se sont tous présentés
à leur place à l’heure. Un groupe a traversé le pont à 6 h 30 précises.
L’autre, le plus grand, se divisa en deux, et dans des rues différentes,
prenait position contre la première baraque et les canons au début du pont. On
ne voyait encore rien. Il y avait un brouillard assez épais.
Il marchait donc le
long de l’avenue de la Reine. Et parce qu’il n’avait pas dormi, à cause de
l’excitation, il a eu froid. Cet état a duré deux ou trois minutes. Puis il
sembla que le feu se déversait sur lui. Et si l’un des combattants
s’embrouillait quelque part ? Cela lui a traversé l’esprit. – Alors ?
Puis il s’approcha de la première baraque. Il voulait voir ses camarades. Il
est passé, a vu les siens et s’est calmé. Il a regardé sa montre : 6
heures et 40 minutes. Secondo et un autre camarade étaient déjà de l’autre
côté. Et soudain, il a entendu des coups de feu. Secondo et son camarade ont
tiré sur la sentinelle du milieu. C’était le signal pour passer à
l’action. Une véritable canonnade a commencé. Des balles et des bombes volaient
contre les canons, la sentinelle et la baraque du côté De la Reine, à 40-50 pas
de lui. L’attaque a duré une minute ou deux. Un grondement sourd est venu de
l’autre bout du pont. La machine infernale a explosé avec un peu de retard. Le
tonnerre a résonné dans toute la région environnante. Il a couvert de son
fracas le feu des bombes et de nos Schmeisser, qui opéraient à l’autre bout du
pont. Les fenêtres des maisons voisines s’éclairaient et s’ouvraient. Après
environ trois ou quatre minutes, les tirs ont cessé. Il n’y avait pas de temps
à perdre. Les camarades se sont rendus à l’endroit désigné pour vérification un
par un. Tous avaient survécu. Il a parlé à Secondo. Il voulait l’embrasser. Secondo
s’est révélé être un vrai courageux. Après avoir traversé le pont avec un
jeune, ils ont attendu la minute convenue. Le jeune s’est approché du mur.
Soutenu par Secondo, il l’a franchi, avec légèreté, comme un chat. Il ne s’est
pas attardé plus de deux minutes. Le tour de Secondo est venu. Son tir devait
donner le signal de l’action aux autres combattants. Au milieu du pont, le
boche se tenait appuyé sur le canon. Ils se sont approchés de lui à 4-5 mètres.
Secondo était prêt, mais lorsqu’il a vu que la sentinelle ne leur prêtait
aucune attention, il s’est approché encore plus et a tiré presque à bout
portant. Il a détruit le canon avec une bombe. Ils couraient et criaient :
« Vive l’Armée rouge ! » Ils ont rejoint les camarades qui
bombardaient les baraques et les appareils de surveillance aérienne. Ils ont
également largué leurs bombes. Comment ils ne se sont pas tués dans le
noir ? C’était vraiment un coup de chance.
Après son histoire,
Pierrot m’a regardé. Il s’attendait à ce que je lui demande quelque chose.
— Les boches
n’ont-ils pas au moins essayé de tirer ?
— Non !
Pas un, même pas une fois ! Et c’est compréhensible. L’attaque était si
concentrée, si soudaine et impétueuse, qu’ils ne pouvaient pas comprendre ce
qui se passait. Et même si certains d’entre eux ont compris, il était déjà trop
tard — ils étaient en route vers mon saint homonyme.
Notre joie mutuelle
était sans fin. Et nous aurions pu discuter à l’infini avec Pierrot, vif comme
du mercure et doux comme un garçon angélique, de l’attaque, des combattants, de
l’effet sur la population, de la satisfaction sincère des frères soviétiques
lorsqu’ils apprendront l’exploit des combattants parisiens. J’ai mis fin avec
tristesse à cette mémorable rencontre au Bois de Boulogne. À 9 heures, Richard m’attendait
dans un des coins reculés de la même forêt. Il me tiendrait au courant de
l’action sur le pont de Passy. J’ai consacré les dernières minutes avec Pierrot
aux conclusions de l’action. Je lui ai conseillé de réunir les combattants
l’après-midi même et de les féliciter au nom de notre état-major. De leur
promettre qu’ils recevront des présents convenables, eux qui ont fait un si
brillant cadeau à l’armée soviétique. Finalement, j’ai décidé de le rendre
particulièrement heureux. Je lui ai révélé qu’à la minute-même de leur attaque
d’autres combattants avaient attaqué le pont de Passy. Pierrot s’est exclamé
peut-être dix fois : « Eh bien, c’est magnifique, magnifique,
magnifique ! »
En me dépêchant pour
la rencontre avec Richard, une question m’a traversé l’esprit : « Et
si là-bas ils n’y étaient pas arrivés ? »
La forêt était
fraîche de sa rosée matinale. J’ai inhalé l’air frais à pleine poitrine. Ma
démarche était plus légère. Je vivais l’un des moments les plus heureux de ma
vie. Des passants promenant leurs chiens me croisaient. Montés sur de beaux
chevaux étoffés, des femmes et des hommes satisfaits effectuaient leur
traditionnelle promenade matinale le long des avenues du bois de Boulogne. Je
regardais maintenant tout ce monde, non avec mépris, mais avec pitié. Il
pouvait voler à la vie autant de biens matériels et de plaisirs qu’il le
voulait. Il ne pouvait pas se mesurer à la richesse de l’expérience, même avec
le plus miteux des partisans. Nous vivions notre vie si pleinement à cette
époque que nous ne l’aurions même pas échangée contre des titres, de l’argent
et des ornements en or !
Richard m’accueillit
calmement. Il savait se contrôler.
D’un ton chaleureux
et immédiat, il m’a fait un bref récit de Jean, le commandant immédiat et
participant à l’attaque.
L’essentiel était
fait. Les garçons ont attaqué la batterie du boulevard Passy et ses gardes.
Mais dans cette action, le groupe, qui était censé lancer des bombes dans la
baraque située sur le pont lui-même, a commis une grave erreur. Les deux se sont
approchés de la baraque et ont attendu le signal de ceux qui attaquaient la
batterie. À ce moment, la porte de la baraque des sentinelles s’est ouverte.
Une femme est sortie. Un soldat allemand lui envoyait des baisers. Les coups de
feu du boulevard en face de la batterie ont effrayé la femme, qui s’est
accrochée à l’homme. Nos deux combattants se sont également figés sur place.
Leurs mains ne se sont pas levées pour tirer sur une femme...
— Quelle
femme... une salope ! cria Richard avec indignation. — Elle a satisfait
les salauds toute la nuit.
En conclusion, il
m’a dit qu’il avait vivement critiqué la sentimentalité injustifiée de Gilbert
et André, et qu’il leur assignerait bientôt une autre action similaire de
punition et d’éducation.
J’ai approuvé la
conduite de Richard et lui ai fait plaisir avec la nouvelle de l’exploit très
réussi du détachement italien. Comme Pierrot, il s’est exclamé :
« C’est merveilleux, extraordinaire ! »
À 11 heures, je
devais faire mon rapport à Lapierre. Après m’avoir écouté, il salua
chaleureusement les combattants et promit des cadeaux en signe de distinction[84].
Ma secrétaire
Solange et moi sommes partis l’après-midi, à 14 heures précises, pour le Pont
Saint-Cloud. Solange était une Polonaise venue en France depuis longtemps.
Diplômée en pharmacie, elle a épousé un Français moyen typique.
— On s’aimait
et on s’aime peut-être encore, me dit Solange. — Mais nous ne pouvons pas vivre
ensemble. Il est si bon et satisfait de moi, de lui-même et du monde tel qu’il
est, qu’il m’étouffe de sa satisfaction. Nous ne sommes pas officiellement
séparés, mais nous vivons loin l’un de l’autre. Il ne comprend pas mon ambition
de me battre, je ne supporte pas son indifférence béate pour le sort de son
propre pays. La pharmacie est tout son univers. Pour moi, sa pharmacie, avec
tous ses revenus, était une prison. Je me suis évadée de la prison plutôt que
du serrurier.
Solange parlait un
français excellent. Chaque fois et partout où je voulais passer pour un
français, je la laissais parler. Les gens nous considéraient souvent comme un
couple marié. Munis de fausses cartes d’identité solides et de documents
supplémentaires, nous avons décidé de constater par nous-mêmes les résultats et
l’effet de l’action sur le pont de Saint-Cloud.
Deux heures de
l’après-midi. Un soleil radieux brillait, dont les rayons pâles apportaient à
la fois lumière et joie à cette journée de février qui avait commencé par le
brouillard. Les gens à l’arrêt de bus pour Saint Cloud parlaient avec
animation. Il y avait quelque chose de spécial dans l’air. Des questions et des
réponses étaient entendues que personne ne comprenait ou n’appréciait mieux que
nous.
— Comment, tu
ne sais pas ?
— Mais que
s’est-il passé ?
— Vous
n’habitez pas près du pont ?
— C’est
extraordinaire !
— Mais qu’y
a-t-il donc, tout le monde parle comme si on était au marché ? — la dame
avec un enfant à la main éleva la voix en se tournant vers son voisin, un vieil
homme voûté.
— Il paraît que
les partisans sont descendus de la montagne et ont fait sauter le pont.
— Quoi, donc
nous ne pourrons pas passer de l’autre côté ? — la vieille femme, grande
et nerveuse s’indigna.
Dans le bus
lui-même, l’ambiance était animée. Tout le monde parlait de l’événement du
matin. Ceux qui l’apprenaient pour la première fois étaient très aimablement
informés par le conducteur. Il engageait une vraie conversation amicale,
expliquant pourquoi le bus s’arrêterait devant le pont, comment ils devraient
le traverser à pied, et comment un autre bus viendrait les chercher sur l’autre
rive de la Seine. Il le faisait avec un tel sourire, de telles allusions à la
rossée que les boches avaient reçue, qu’on pouvait avoir l’impression qu’il
était initié à l’événement. Solange et moi avons juste échangé des regards et
nous nous sommes tus. Mais elle et moi étions satisfaits de l’esprit inventif
du brave conducteur qui, bien que de manière un peu voilée, louait l’exploit
des partisans.
— Et combien
sont-ils à être descendus de la montagne ? (Qu’ils soient descendus de la
montagne, personne n’en doutait !).
— Personne ne
peut le dire, a déclaré le conducteur très gentiment. — Mais pour autant que
j’aie compris d’un boche et pour autant que je puisse estimer, il y en avait au
moins 200-250. Sinon, ils n’auraient pas pu détruire tous les canons sur le
pont.
La rumeur s’était
déjà répandue. Ce fut l’un des meilleurs résultats de l’action.
Devant le pont, nous
sommes tous descendus du bus. Contrairement aux explications du conducteur, les
piétons ne passaient pas librement sur le pont. La police hitlérienne, qui
formait une véritable clôture sur le côté gauche du pont, ne nous a pas permis
de nous arrêter et de regarder. Elle appelait constamment :
« Schnell, schnell » (vite, vite). Non pas que le conducteur nous ait
menti. Une situation nouvelle s’était présentée. Pour voir le champ de
bataille, de nombreux dignitaires hitlériens étaient venus de Paris, conduits
par le commandant des troupes d’occupation en France, le général Stülpnagel. Il
était accompagné de dizaines d’officiers, la plupart avec des appareils photo,
et d’un grand nombre de policiers civils allemands et français. Le plus
intéressant : sur le côté droit, à côté du parapet, une grande carte était
étalée sur le trottoir, sur laquelle se penchait un groupe d’officiers. L’un
d’eux promenait la carte avec une longue baguette en bois. Solange, me
regardant avec une joie cachée, demanda :
— Est-ce qu’on
passe ?
— Nous passons.
Avec la multitude de
piétons, nous avons également traversé le pont à pas rapides. Nous avons jeté
un coup d’œil furtif sur le côté. Il y avait des canons et des appareils
détruits. Sur l’une des baraques, au lieu d’une porte, il y avait un grand trou
béant. Les vitres étaient brisées.
Nous nous sommes
arrêtés dans un café sur la place au pied des hauteurs de Suresnes. L’ambiance
au café était différente de celle à l’arrêt de bus. Le propriétaire et le
serveur ne savaient pas qui entrait dans le café et étaient réservés. Aux
questions de Solange ils répondirent par les excuses les plus ordinaires qu’ils
ne savaient rien, n’avaient rien vu, mais les gens disaient que 1 200 partisans
étaient descendus de la montagne, qu’ils se seraient cachés ensuite dans la
forêt de Rambouillet, qui était maintenant assiégée par les troupes allemandes,
que des généraux ont fait tout le trajet depuis Berlin pour enquêter sur
l’affaire, qu’ils n’avaient plus rien entendu, etc.
Le même jour, Radio
Londres et Radio Moscou ont diffusé un récit enthousiaste des exploits des
partisans parisiens le jour du 25e anniversaire de l’Armée rouge.
En ce matin brumeux
de février 1943, les unités des partisans émigrés sauvèrent véritablement
l’honneur de la France, disgraciée par la trahison de Pétain et de Laval.
Par-delà des frontières de l’Europe conquise, ils serrèrent la main des
vainqueurs de Stalingrad. Avec la détonation de leurs bombes et de leurs
Schmeissers, ils envoyèrent aux invincibles guerriers soviétiques leur
« Nous sommes avec vous ! »
LES
DÉRAILLEMENTS ET LE COMBATTANT JOSEPH BOCZOV
France
occupée ! Ce n’étaient pas seulement des milliers d’hitlériens dans les
rues parisiennes, les cafés, les magasins, les cinémas, les lieux de
divertissement. Ce n’étaient pas seulement les centaines de casernes, postes
militaires et bâtiments où séjournaient les occupants. Les milliers de
prisonniers n’étaient pas non plus attelés à la construction du mur de
l’Atlantique le long de la côte ouest de la France. La France occupée était
pillée, affamée, aspirée. Les trains de l’occupant circulaient 24 heures sur 24
entre la France et l’Allemagne. Ils partaient de différentes gares françaises
et empruntaient des dizaines de voies ferrées en traversant des dizaines de
postes frontières en direction du Reich, débordant des produits les plus
divers. Plus de 50 trains multi-voitures transportant du charbon, de la bauxite,
du minerai de fer, des pièces préfabriquées en métal, des céréales, de la
nourriture, des produits laitiers, des vêtements d’extérieur et des
sous-vêtements, des chaussures, des briques, des tuiles, des tuiles de faïence
et des centaines d’autres traversaient un seul passage frontalier dans le nord
de la France en une seule journée. Une grande partie de ces trains transportait
des milliers de cochons, moutons, vaches, ânes, chevaux. Parallèlement aux
trains, des milliers de camions de plusieurs tonnes formaient un véritable flot
qui versait du sang dans l’organisme épuisé de l’économie hitlérienne.
La Résistance a pris
des mesures contre l’utilisation massive des lignes et du parc ferroviaire
français. Elle a porté de sérieux coups au trafic de transport, ce moteur de la
machine de guerre hitlérienne. Nous, les combattants étrangers, avons reçu
l’ordre d’organiser un groupe pour faire sauter les voies ferrées et provoquer
des déraillements de trains. L’état-major a confié cette tâche à l’un des
premiers combattants de la région parisienne, André[85].
Le choix n’était pas accidentel. André était ingénieur chimiste de profession
et un combattant extrêmement dévoué et courageux. Inter-brigadiste et interné
des camps de concentration, il n’avait pas accepté d’être emmené pour
travailler en Allemagne. Au péril de sa vie, il avait sauté d’un train en
marche, était resté en France et avait rejoint aussitôt les rangs de la
Résistance. À la tête d’un groupe de combat, il avait organisé le premier
attentat à la grenade sur la gare de Belleville.
Lors d’une
conversation avec moi, André accepta volontiers la tâche. Il demanda des
instructions concernant avec qui, comment et quand il devait agir. Je lui ai
promis de lui donner des combattants éprouvés, principalement des Hongrois et
des Roumains, et une somme d’argent pour se procurer les clés, les leviers et
autres outils nécessaires. Il s’agissait de dévisser les boulons qui reliaient
deux rails, puis de déplacer l’un des rails d’environ un mètre. À ce moment-là,
on imaginait les déraillements aussi simplement. En réalité, les choses se sont
avérées beaucoup plus compliquées. Les hitlériens mobilisèrent des Français
plus âgés et leur firent surveiller les chemins de fer. Ils les répartissaient
de manière à ce que chacun soit responsable d’une section donnée de 100 à 500
mètres. Si un sabotage était commis dans la zone désignée, le garde concerné
était puni de mort. Afin d’assurer une plus grande visibilité, les occupants
ont ordonné de couper la forêt à 10-15 mètres de part et d’autre des voies. Ces
mesures et d’autres ont rendu les travaux de déraillement extrêmement
difficiles.
En peu de temps,
André a pu organiser le groupe souhaité. Les Hongrois étaient Tommy et Joseph.
Je ne me souviens pas des noms des camarades roumains. Aidé par le service de
renseignement, André a commencé à opérer dans les environs de la ville de
Château-Thierry, à 100 km au nord-est de Paris. Une dizaine de trains de
troupes et de marchandises passait la nuit sur cette ligne. Les intervalles
entre eux étaient de 20 à 40 minutes.
À plusieurs
reprises, le groupe a tenté d’agir. Les combattants débarquaient en gare de
Charly avant Château-Thierry, traversaient le pont sur la Marne et se
dispersaient dans la sombre forêt traversée par les trains. Ils ont trouvé un
virage commode sur la ligne et ont commencé à agir. En vain. Malgré leurs
efforts, ils n’ont pas réussi à dévisser un seul écrou. La clé qu’ils avaient
s’est avérée inadaptée. La deuxième expédition de nuit s’est à nouveau soldée
par un échec. Cette fois, la clé était bonne, mais aucun des six combattants
n’avait eu la force nécessaire pour dévisser au moins un écrou profondément
rouillé. Le manche de la clé était court et une seule personne ne pouvait le
manipuler. Pour la troisième sortie, un morceau de fer assez long a été soudé à
cette poignée. Trois personnes pourraient travailler avec une telle clé
étendue. Grande fut leur colère, lorsqu’au tout premier écrou qui commença à se
dévisser, la partie attachée de la poignée se cassa et resta entre leurs
mains !
J’ai eu une
conversation sérieuse avec André. Je le réprimandai sévèrement : il
n’avait pas manqué d’argent pour se procurer des outils convenables, il avait
pris la tâche à la légère. Le combattant plein d’abnégation a supporté la
critique avec douleur. Il a souffert de l’échec plus que quiconque. Je l’ai
averti de cesser les sorties jusqu’à ce que je rapporte au quartier général le
résultat de leurs tentatives...
Nous décidâmes que
le groupe d’André remettrait les outils au détachement italien et serait chargé
d’actions à Paris même. Roger nous a influencés pour prendre une telle
décision. Selon ses informations, les camarades roumains trouvaient les
expéditions nocturnes trop risquées, une fois ils ont failli tomber entre les
mains d’une sentinelle allemande, les 20 ou 40 minutes ne suffiraient jamais
pour dévisser huit boulons et déplacer un rail.
André s’est opposé à
notre décision, mais son objection semblait plus suppliante que défiante. Il a
proposé qu’on lui accorde des moyens financiers supplémentaires pour travailler
comme ingénieur chimiste afin de développer une telle charge qui, au passage du
train, exploserait et provoquerait une catastrophe.
J’ai consulté les
camarades de l’état-major. Louis, qui avait déjà fait appel à André comme
spécialiste, nous a assurés de ses capacités à préparer des matières
explosives. Roger nous a informés que le chef du groupe collectait déjà de
l’argent auprès de ses amis avec l’intention de réaliser la charge avec ses
propres fonds et était même prêt à aller tout seul la mettre sous la voie
ferrée. Dans cette situation, j’ai donné à André l’accord de la direction pour
réaliser l’engin explosif à une condition : il avait droit à trois
tentatives avec un groupe réduit : lui, Tommy et les deux combattants
roumains. Ravi, André m’a dit :
— Pour moi,
c’est non seulement une question de combat, mais aussi d’honneur professionnel.
En voyant cet homme
de presque 40 ans aux yeux bleus et enfoncés, au visage pâle et émacié, aux
longs cheveux blonds lissés, au nez en bec d’aigle, aux lèvres fines, à la
démarche lourde et au dos voûté, j’ai compris, j’ai senti : un des
combattants d’élite de la Résistance française marche à mes côtés, dévoué sans
limites au service de son idéal. Aucune ombre de doute ne pouvait être jetée
sur sa pure image de révolutionnaire professionnel.
Les trois tentatives
avec la charge explosive ont lamentablement échoué. Une véritable tragédie
personnelle pour l’idéaliste André. Il se sentait coupable, professionnellement
humilié. Il a attribué cet échec à la mauvaise qualité des matériaux achetés.
Sinon, il ne pouvait pas expliquer pourquoi les charges n’explosaient pas.
J’étais lié par la décision de l’état-major et je lui ai donc dit : le
front de la résistance est très large et il y a une place pour chaque
combattant honnête. Je lui ai ordonné d’arrêter de besogner comme ingénieur
chimiste et de se mettre à la disposition de Roger, dont il recevra une
nouvelle mission... Si je l’avais poignardé avec un couteau, il ne serait pas
devenu aussi pâle ! Heureusement, nous étions assis dans un vaste café de
la place Clichy. Et pourtant, l’homme solide, le combattant aguerri près de
Madrid, s’est effondré sur sa chaise. J’ai parlé des chemins compliqués de la
lutte, de notre responsabilité, du fait que la lutte est partout, que chacun à
sa place pourrait donner le maximum... André n’écoutait pas. Il serrait ses
larges mâchoires, fixait intensément la table, sirotait silencieusement son
café. Il fumait nerveusement. Après cinq ou six minutes de silence, il commença
lentement, péniblement :
— Nous n’avons
pas réussi... plus précisément, j’ai échoué. Vous me jugez sévèrement.
J’ai essayé de
protester en vain... Il m’a ignoré et a continué :
— C’est votre
droit. Si j’étais vous, je prononcerais le même jugement... Maintenant, je me
tourne vers toi. Pas en tant que dirigeant, mais en tant que camarade de lutte,
en tant qu’ami, en tant qu’humain. J’espère que tu me comprendras... Je crois,
tu comprends, je crois à l’action. Je suis convaincu, je suis absolument
convaincu que je réussirai !... Est-ce que tu me crois ?
Que pouvais-je
répondre à une question aussi pointue, et de la part d’un camarade déchiré en
ce moment par une véritable tragédie ? Je me suis contenté de lui
dire :
— Si je ne te
faisais pas confiance, et cela infiniment, je ne serais pas assis à la même
table que toi et je n’aurais pas une conversation fraternelle avec toi !
Enhardi, André
poursuivit :
— Je n’avais
aucun doute... Merci... Maintenant écoute, je veux que tu prennes un
risque : me laisser essayer une fois de plus... Je jure que je prendrai
toutes les précautions pour Tommy et les autres. Je vais améliorer la
composition de la charge... Quelque chose me dit que cette fois je vais
réussir... Comprends-moi, je ne peux pas vivre sans avoir tout fait pour la
réussite de l’action...
Un deuxième Richard
était devant moi ! Pour la seconde fois j’étais confronté au même
dilemme : soit observer la discipline soit blesser gravement un homme,
sincère, un combattant dévoué jusqu’à la mort à la cause ?
J’ai répondu à
l’appel direct après quelques hésitations et arrangements. J’ai mis une
condition :
— Vous y allez
juste toi et Tommy. Pas un mot à personne !
André resta sérieux.
En se séparant, il a pris ma main dans les siennes et l’a tenue plus longtemps
que d’habitude. Il m’a donné rendez-vous le sixième jour à partir d’aujourd’hui
au même endroit et à la même heure !
Après six jours à 10
heures du matin dans un vaste café entouré de grands miroirs, André prononça
les premiers mots avec sa simplicité caractéristique :
— Réussite
totale !
Cette fois, nous
avons fumé des cigarettes de guerre avec plaisir et nous avons parlé du fond du
cœur. André m’a remercié pour la confiance et m’a expliqué l’action dans les
moindres détails. La chose la plus importante était qu’ils avaient eu la chance
d’approcher un endroit caché sur la ligne sans se faire remarquer, de creuser
rapidement un trou sous le rail, d’y cacher la charge et de se retirer sans
être détectés à environ 300 mètres dans les bois. Ils ont attendu et ont
entendu l’explosion du matériel et le fracas des wagons qui se renversaient.
Dans le silence de la nuit, des cris humains volaient jusqu’à leurs oreilles...
Tommy était magnifique. Tout au long de l’action, il s’est comporté calmement,
sans l’ombre d’une peur. Et maintenant il était heureux comme un enfant...
Ainsi commença la
lutte subversive et très efficace du groupe d’André, dont le chef devint l’un
des principaux dirigeants de la Résistance française en région parisienne.
Voici quelques-uns des exploits les plus importants de ce groupe
légendaire :
Dans la nuit du 10
au 11 juillet 1943, attentat sur la ligne de chemin de fer Paris-Cherbourg.
Résultat : la locomotive et les quatre wagons entièrement détruits.
Beaucoup d’officiers et de soldats tués et grièvement blessés. Circulation
interrompue pendant 24 heures.
Dans la nuit du 28
au 29 juillet de la même année, attentat sur le train Paris-Château-Thierry. La
locomotive et trois wagons complètement détruits. Circulation interrompue
pendant 48 heures.
Dans la nuit du 3 au
4 août, un train de permissionnaires allemands sur la ligne Paris-Reims, près
de La Ferté-Milon, explose. Des dizaines d’officiers et de soldats tués.
Dans la nuit du 20
au 21 août, déraillement d’un train transportant du matériel militaire sur la
ligne Paris-Rethel. La locomotive, 19 wagons et du matériel militaire
complètement détruits.
Ces attaques
persistantes, efficaces et similaires, exécutées par les combattants émigrés
sous la direction d’André n’étaient qu’une partie des coups massifs que les
combattants et partisans français infligeaient au transport hitlérien. En un
seul semestre, et uniquement en zone Nord de la France, du 1er avril au 30
septembre 1943, 270 actions ont été menées contre les chemins de fer, les trains
de militaires et de marchandises. Parmi eux, 183 ont causé des dommages
importants, 42 — des dommages mineurs et 45 — des perturbations prolongées de
la circulation. Résultat final — 357 locomotives et 1688 wagons mis hors
service.
Notre objectif
n’était pas de détruire uniquement les locomotives et les wagons. Nous avons
particulièrement poursuivi les ressources humaines de l’ennemi. Chaque fois et
partout où nous les avons trouvés, nous avons imaginé mille façons de les
attaquer et de les détruire.
« TU
AS LE BONJOUR DU COMMANDANT DE GROSS
PARIS »
Les combattants
anonymes de la Résistance suivaient inlassablement et avec vigilance chaque pas
de l’ennemi. Chaque fois et partout où ils voyaient des uniformes verts, ils
pensaient immédiatement à des moyens et à des formes pour leur donner la
rétribution qu’ils méritaient.
En mai 1943, le
service de renseignement nous a apporté un objectif de valeur : le
commandant militaire de Paris, le général Schaumburg, fait sa promenade
matinale à cheval dans les allées autour du lac intérieur du bois de Boulogne.
Il n’est accompagné que de son adjudant avec le grade de commandant. Ils
chevauchent lentement, parlent souvent et passent régulièrement devant le
pavillon du Tyrol sur l’allée des dames. Leur promenade commence à 8 heures
précises et se termine à 8 h 30. Les trois camarades du renseignement Bianca,
Odette et Martin nous ont avertis que toute la zone est fortement gardée par
des policiers en uniforme et en civil. Après deux ou trois visites du coin de
la forêt en question, Martin a été arrêté par des agents comme personne
suspecte.
À l’état-major, nous
avons évalué le grand effet politique de la suppression de cet important
dignitaire fasciste et avons décidé d’examiner nous-mêmes l’objectif avant
d’agir. Roger et moi avons vérifié les informations de nos services sur place.
Ce que nous avons vu nous a fait réfléchir à la mise en œuvre de l’action.
Aucune illusion sur sa complexité, sa difficulté et son danger. Nous sommes
arrivés à la conclusion qu’elle ne pouvait être que l’œuvre des combattants les
mieux préparés, et qu’elle ne devait être entreprise qu’après l’étude la plus
attentive des conditions d’attaque et de retraite. Il fallait du temps et on
s’en est donné. Les trois agents du renseignement commencèrent à se relayer un
jour sur deux, et dûment déguisés, pour surveiller les cavaliers.
Nous sommes aussi
allés sur place : Charles avec Gaston et Roger avec Boczov. Les deux
combattants d’élite s’y sont directement opposés. Ils ont décrit l’attaque
possible comme une aventure qui sacrifierait presque toutes les personnes
impliquées dans l’attaque. Leur principale objection était l’impossibilité pour
les combattants de se retirer et de se cacher en toute sécurité. Nous avons dû
reconnaître le grand danger que les attaquants soient encerclés, capturés ou
massacrés sur place. Nous avons péniblement abandonné la forêt, mais pas le...
général.
Martin a été chargé
de tracer l’itinéraire du véhicule dans lequel le commandant de Paris allait
travailler... Deux ou trois semaines ont passé. Le rapport sur le voyage de la
voiture du général disait : le général habite une villa avec un grand
jardin. Il y a deux sentinelles devant la villa. À neuf heures précises, la
voiture de marque Horch quitte la villa et traverse à une vitesse relativement
grande les rues parisiennes jusqu’à la place de l’Opéra, où se trouve la
principale commandature allemande. Le seul endroit où la voiture
ralentit obligatoirement est le coin des rues Paul Doumer et Nicolo. À cette
heure de la matinée, la circulation des piétons et des véhicules à moteur y est
assez faible. Le lieu et le moment sont propices à l’action.
L’état-major
n’hésita pas longtemps. La volonté et l’ambition de porter un coup qui
résonnerait fort dans l’âme des patriotes de Paris nous poussèrent à une
décision rapide. Nous avons élaboré un plan opérationnel de l’action. La grande
question à laquelle nous étions confrontés était : qui devraient être les
participants à l’attaque ? Pour ce genre d’action — une attaque ouverte
avec une bombe et un pistolet — Gaston et Boczov, tous deux âgés d’environ 40
ans, semblaient quelque peu inadaptés. Dans ce cas, nous avons recherché de
jeunes combattants rapides. Nous nous sommes arrêtés sur Marcel Rajman, aguerri
en tir précis, sur le jeune italien, le mineur Spartaco, dont les deux frères
étaient déjà morts héroïquement dans la lutte contre les occupants, et le
charpentier espagnol Alfonso, lieutenant des inter-brigades de la République
espagnole.
Il était nécessaire
et normal pour moi, en tant que commissaire politique, d’avoir une conversation
avec les camarades visés. Tout d’abord, j’ai parlé avec ma connaissance de
longue date Rajman, nommé à la tête du groupe de combat. Il s’est révélé à moi
sous sa véritable identité. L’envergure politique de la tâche le remplissait
d’un sentiment de pleine valeur. À peine par envie de se vanter, il s’empressa
de m’avouer :
— Tu vois, plus
d’actions comme celle-ci et je ne serai pas désolé même si je tombe trop tôt.
Un coup pareil équivaudrait par son effet à dix attaques comme celle de la rue
Monsieur le Prince. Il est bon de viser plus haut et plus souvent.
Mon jeune ami
brûlait d’enthousiasme, et il était inutile de le préparer politiquement et
mentalement. Je l’ai seulement averti de ne pas sous-estimer les difficultés de
l’attaque et surtout de la retraite. Il m’a assuré qu’avec Roger et les deux
autres participants, ils avaient pensé à tout jusque dans les moindres détails.
Je n’avais aucune raison de douter.
La rencontre avec
Spartaco et Alfonso s’est déroulée dans une autre ambiance. Ils m’ont laissé
errer sur l’horizon de la situation internationale, leur annonçant
l’écroulement inévitable de l’hitlérisme et la victoire inexorable de l’Armée
rouge, leur soulignant l’extrême importance de l’action à venir et combien le
Parti comptait sur le courage de leur jeune âge, leur mobilité et leur
conscience communiste. Au cours de la promenade de près d’une heure le long des
boulevards extérieurs, j’ai découvert chez les deux interlocuteurs non
seulement une volonté de sacrifice et d’exploit, mais aussi une vision
politique mûre.
J’ai signalé à notre
instance dirigeante le moral extrêmement élevé des combattants. Roger nous
assura de la bonne organisation militaire des préparatifs. Louis a donné une
garantie pour la qualité des grenades et des pistolets. Nous avons fixé la date
à l’unanimité — 28 juillet 1943...
Et voilà que je vois
le même jour comment le chef militaire Roger est entré dans le petit jardin
disgracieux devant l’église de la Sainte-Trinité sur la place du même nom,
souriant exactement à dix heures et dix minutes. Il portait un chapeau gris
doux, un costume verdâtre et ses éternels gants à la main gauche. J’ai senti le
succès et j’ai souri. L’ami commença sur un ton inhabituel pour lui :
— C’est fait !
On peut se saluer ! Monsieur le général n’est plus de ce monde.
Avec une impatience
compréhensible, je demandai :
— Et nos
garçons ?
— Sains et
saufs. Ils se sont retirés en ordre complet.
— Raconte
comment tout s’est passé !
Roger possédait de
nombreuses qualités : un esprit clair, une énergie bouillonnante, une
mémoire magnifique et d’autres qualités enviables, mais l’une des plus
positives d’entre elles était sa capacité à décrire de manière claire, précise
et concise l’essentiel d’un événement. En une minute ou deux, il m’a décrit
l’exploit des combattants.
À neuf heures cinq
précises, la voiture a viré de l’avenue Paul Doumer à la rue Nicolo et a
ralenti. Rajman au même moment a lancé la bombe directement contre le
pare-brise. La voiture a perdu l’équilibre et a percuté le poteau électrique
sur le trottoir d’en face. Alfonso et Spartaco ont couru et ont tiré sur le
général Schaumburg, les deux officiers et le chauffeur. Les nôtres se sont
retirés en ordre. La voiture était en feu et personne n’en est sorti... Dans la
rue Massenet voisine, Daniela et Katerine ont pris leurs armes. Rajman a
plaisanté et a embrassé Daniela en disant : « Tu as le bonjour du
commandant de Gross Paris[86] !
Nous méritons des félicitations ! »
Nous les avons
reçues. Lapierre nous a transmis les chaleureuses salutations de combat du CC
du Parti français et de l’état-major des francs-tireurs et partisans français.
Des louanges
extraordinaires, accompagnées de récompenses matérielles et morales, nous
furent témoignées après une autre action non moins brillante. La machine de
guerre hitlérienne avait besoin non seulement de soldats fanatiques. Elle
absorbait aussi un grand nombre de travailleurs. La propagande de Goebbels avec
de l’écume à la bouche appelait les travailleurs des pays occupés d’Europe à
affluer vers l’Allemagne, où ils recevraient des salaires fabuleux. La campagne
verbale alléchante n’attirait pas beaucoup de travailleurs étrangers. Par
conséquent, les occupants ont souvent eu recours à la force brutale. Ils ont
organisé de véritables rafles humaines, bloquant des rues entières en plein
jour, arrêtant tous les passants, sélectionnant des citoyens valides et les
kidnappant en Allemagne. À d’autres moments, ils faisaient irruption dans les
églises, surprenant les fidèles par le claquement de leurs Schmeissers et les
cris grossiers de « Dehors ! Vite ! Vite ! », ils
chargeaient les hommes apeurés dans les camions et les emmenaient dans une
direction inconnue, ou plutôt vers l’Allemagne nazie parfaitement connue. Les
mêmes rafles ont été menées dans les fabriques, ateliers, usines françaises,
d’où ils volaient des centaines d’ouvriers et de spécialistes pour leur
industrie militaire. Malgré cette chasse à l’homme inhumaine, l’économie de
guerre allemande souffrait d’un manque de main-d’œuvre.
En juillet 1943, le
Dr Julius Ritter est arrivé dans la capitale française. Il est devenu le chef
du service de recrutement des ouvriers français. Le sinistre Hitler l’avait
chargé de recruter en peu de temps 600 000 travailleurs des deux sexes pour
injecter du sang neuf dans l’économie allemande épuisée. Le Dr Ritter a
commencé sa mission par une propagande bruyante dans les journaux. Avant tout,
il s’est présenté au public français comme un scientifique — docteur en
sciences chimiques — et comme un adepte de l’amitié franco-allemande, qui
serait à la base de la future Europe forte et florissante. Le monsieur a même
donné plusieurs conférences à l’Institut de chimie, bruyamment annoncées par la
presse soumise à Hitler. Parallèlement à la propagande dans toute la France et
surtout à Paris, des centaines de bureaux travaillaient d’arrache-pied pour
recruter des ouvriers pour l’Allemagne.
Le Parti communiste
français était clairement conscient du danger que la France soit privée de
centaines de milliers de travailleurs et la Résistance française de milliers de
ses combattants actuels et futurs. Il a mobilisé ses forces et a décidé de
déjouer la mission du Herr Obersturmführer Dr Ritter. Les groupes de combat ont
intensifié leurs attaques contre les bureaux de recrutement, et notre
état-major a reçu l’ordre de... s’occuper personnellement du Dr Ritter...
Bientôt, le service
de renseignement nous rapporta leurs informations : le docteur Ritter
habite rue Pétrarque dans le 16ème arrondissement ; il quitte sa maison à
8 h 30, une voiture l’attend sur le trottoir ; le chauffeur ouvre la porte
de la voiture, attend qu’il s’installe et va prendre le volant ; aucun
adjudant ne l’accompagne ; il n’y a pas de garde en service devant la
maison ; à cette heure la rue aristocratique est presque déserte et les
passants sont rares.
L’action nous
paraissait facile, surtout après la frappe réussie contre le général
Schaumburg. Pour une certitude absolue dans sa réalisation, nous l’avons confiée
aux expérimentés Rajman et Alfonso. Après avoir inspecté la situation eux-mêmes
à deux reprises, les jeunes se sont déclarés prêts à agir...
Un matin, par une
très agréable journée de septembre, Rajman et Alfonso étaient en conversation
près de la maison de M. Ritter. Ils ne regardaient pas leurs montres. Ils
savaient qu’à 8 h 30 précises, le messager personnel d’Hitler apparaîtrait pour
monter dans sa voiture. Ils ne se sont pas trompés. À la minute près, le
recruteur en chef apparut, fit deux ou trois pas et entra par la porte ouverte
par son chauffeur. À ce moment, Alfonso, qui s’est approché de deux mètres, lui
a tiré trois balles. Selon Rajman, Ritter n’a été que blessé. Avec deux autres
balles, il l’a achevé. Ils ont envoyé l’Obersturmführer en enfer chez Saint
Pierre — là il pourrait recruter des âmes mortes. Rajman a terminé. « La
récolte est bonne. Tu peux nous féliciter »...
Non seulement je
l’ai félicité en notre nom pour cette moisson vraiment riche, mais je leur ai
fait savoir que justement en raison des récentes actions réussies menées par
nos détachements, le Comité central du Parti communiste français et
l’état-major des francs-tireurs et partisans français leur envoyaient des
salutations de combat et ordonnaient que tous les combattants soient
matériellement récompensés. Par ailleurs, l’état-major des francs-tireurs et
partisans — main-d’œuvre immigrée de la région parisienne devait attribuer des
grades militaires aux combattants émigrés.
Matériellement
récompensé ?! Je m’empresse de préciser qu’il ne s’agissait pas d’argent,
mais de… cadeaux. Chaque combattant pouvait faire le souhait d’un objet, selon
ses goûts et ses besoins. Les commissaires politiques devaient dresser une
liste et acheter les articles. C’était touchant de lire une telle fiche !
Elle était dominée par les demandes de chemises et de maillots de corps ou ne
serait-ce que de chaussettes et de mouchoirs, de stylos automatiques, de
crayons multicolores, de peintures aquarelles, de briquets à essence, de gants.
Le camarade Yves (Henri Rol-Tanguy), qui a vu les listes, s’est exclamé :
— Avec des
combattants aussi modestes, la victoire ne peut qu’être de notre côté. — Se
tournant vers moi, il ajouta avec un sourire amical : — Vous, du quartier
général, soyez plus audacieux dans vos souhaits. Vous savez, nous ne sommes pas
à court d’argent. La dernière attaque de la poste de la ville de Saint-Étienne
nous a rapporté des sommes que nous nous demandions comment dépenser[87].
Roger, Louis et
moi-même avons fait preuve d’immodestie vis-à-vis de la base : de la
boutique Belle Jardinière, nous nous sommes habillés de pardessus couteux,
qu’avec notre salaire de 2 500 francs, comme tous les soldats réguliers, nous
n’aurions jamais pu acheter.
L’honneur d’offrir les
grades militaires retomba sur ma conscience comme une lourde tâche. J’ai
ordonné aux commissaires politiques de tous les détachements de présenter des
propositions écrites, en commençant par caporal, sergent, sergent-chef,
adjudant et atteignant le grade de sous-lieutenant. La nouvelle a provoqué
l’émoi parmi les combattants. Ils se sentaient fiers d’être hiérarchiquement
associés à l’armée secrète, courageuse et insaisissable de la Résistance
française. Avec une anxiété compréhensible, ils attendirent le jour de la
remise des grades. C’était de ma faute si ce jour tardait à venir. De bons
patriotes et d’honnêtes gens vivaient dans les logements illégaux dont je
disposais. Cependant, je n’ai pas osé leur confier des documents avec le nombre
et la structure de nos groupes de combat. À cette fin, j’ai cherché et loué
temporairement une chambre privée au rez-de-chaussée de l’hôtel de Mme Artik,
rue de la Mare. La chambre donnait sur la rue, ce qui me laissait la
possibilité en cas de danger, de sauter par la fenêtre. J’ai déplacé le lit de
fer, détaché une des planches en dessous, creusé un plus grand trou sous les
autres planches, et là je cachais les papiers dangereux pendant la journée.
Plusieurs soirs, j’ai écrit de brèves caractéristiques pour chaque combattant,
en me basant sur les écrits plus longs et pas toujours suffisamment lettrés des
commissaires politiques des détachements. J’avais plus de 600 dossiers à
traiter. J’essayais de revenir avant 22h pour passer pour un locataire
régulier. Je ne travaillais que le soir et tard jusqu’à minuit.
Un soir, Vlado
m’attendait au café, où se trouvait le tableau avec les clés des chambres. À
mon salut habituel, il a répondu d’un ton maussade, et à ma grande surprise, le
propriétaire m’a également accueilli avec une froideur morose. Après avoir bu
ma boisson « diabolo » habituelle, mon ami m’a invité à faire une
promenade. Nous sommes sortis dans la rue sombre et alors déserte. Vlado a
entamé la conversation sur le ton d’un père en colère contre un fils qui a
commis un péché :
— Qu’est-ce que
tu as fait ? Toute l’organisation se serait enflammée à cause de
toi ! C’est comme ça qu’on travaille ?... Non, voici tes listes de
pseudonymes, de caractéristiques et tes propositions pour les grades
d’officiers. Remercie Dieu que c’est Madame Artik qui les a trouvées et non la
femme de ménage. Elle me les a remises toute secouée. « Je vois, M. Boris
travaille contre les boches. Je suis Française. Je ne peux pas le trahir. Mais
il ne doit plus rester dans le logement. S’ils le trouvent ici, les autorités
allemandes fermeront l’hôtel et mon mari et moi serons traînés en
Allemagne... »
Enfin, Vlado a
tranché d’un ton catégorique :
— C’est bon
maintenant, tu vas devoir déguerpir de l’hôtel...
Il était plus de 10
heures du soir. Il était trop tard pour chercher un autre refuge. Notre
conversation s’est terminée par une décision fataliste : je passerai aussi
cette nuit à l’hôtel ; si je suis surpris, je brûlerai tout au risque de
mettre le feu à l’hôtel et de périr moi-même dans ses flammes…
Il était hors de
question de dormir. J’ai réfléchi au hasard et à sa puissance aveugle, dont
nous, humains, sommes ou pouvons être les victimes... La femme de ménage est
tombée malade. La propriétaire a dû nettoyer les chambres. Elle a déplacé le lit
pour nettoyer la poussière qui s’était accumulée dans un des coins. Une
brindille du balai s’est coincée dans la fente entre deux planches. Elle a
commencé à le retirer, et à ce moment l’une des planches s’est déplacée. En
bonne logeuse, la propriétaire s’est accroupie pour fixer la planche et... a
découvert la cachette... J’ai aussi réfléchi sur le patriotisme du peuple
français. Madame Artik, dont le but principal dans la vie était de gagner plus
d’argent et d’avoir un enfant, ne faisait rien pour aider la résistance. Si on
lui proposait d’y participer, elle refuserait catégoriquement. Mais lorsqu’elle
s’est retrouvée face à face avec l’une des manifestations du mouvement de
résistance, elle s’est sentie partie intégrante de son peuple en lutte. Son devoir
patriotique s’est réveillé et a sauvé de l’échec tout un réseau de groupes de
combat.
Une nuit passée avec
de telles pensées m’a conduit à la décision de prendre trois jours de congé de
mes fonctions actuelles pour compléter mes propositions. J’ai été hébergé par
la famille Kazakov, dont le cottage était niché dans la jolie et tranquille
banlieue parisienne de Vélizy, 129 rue Lavoisier. J’ai eu recours à nos
compatriotes, étant sûr que je trouverais chez eux la tranquillité d’esprit
nécessaire pour travailler et un bon accueil par les hôtes.
Boris et Dora
n’avaient pas d’enfant, mais ils n’étaient pas malheureux. Dans leurs années de
maturité, entre 40 et 50 ans, ils rayonnaient de santé et de vitalité. Le
sourire et la voix retentissante de la blonde Dora de Roussé décoraient et
retentissaient dans les jardins des nombreux voisins fascinés par la joyeuse et
agréable Madame Kazakova. Le charpentier Boris avait gagné le cœur de tous les
voisins avec son travail acharné, son honnêteté et sa serviabilité proverbiale.
La bonne réputation du couple complice bulgare me servait de couverture sûre.
On m’annonçait comme un cousin, vendeur de dentifrice, venu faire une pause du
bruit de la capitale et des trajets fréquents et fastidieux à la campagne.
Mon homonyme et sa
femme avaient non seulement ouvert les portes de leur maisonnette, mais aussi
leur cœur aux acteurs de la Résistance. Quand se posait la question d’un
endroit extrêmement sûr pour que notre état-major des combattants émigrés
puisse passer du temps avec le colonel Rol-Tanguy et Robert Ballanger, je me
souvenais toujours du refuge de la famille Kazakov. Je ne connais pas de cas où
ils nous ont refusé leur hospitalité. Et pas n’importe comment, mais
spontanément, sincèrement et généreusement malgré la pénurie générale causée
par la guerre.
En ma qualité de
commissaire politique, qui doit se tenir au courant des événements et de
l’actualité en France et dans le monde, le Comité central du Parti communiste
français m’a fourni deux appareils radios (c’est parce que je ne dors pas à la
même place). J’ai confié l’un des appareils à mes amis les Kazakov, car leur
demeure était l’une de celles où je me sentais le plus en sécurité et que
j’utilisais le plus souvent.
Si l’on ne peut dire
de Dora que c’est une personne qui cache les combattants, et qui de plus le
fait de manière intelligente, courageuse, discrète et extrêmement dévouée, on
peut aussi dire de Boris, que non seulement il cache des illégaux, mais il est
aussi un combattant dévoué et courageux. Quelle que soit la tâche que je lui
confiais, il l’accomplissait toujours consciencieusement, quels que soient les
risques qu’il prenait. Il me servait de liaison avec mes associés, distribuait
de la littérature illégale, participait au sabotage des machines dans les
ateliers aéronautiques de la banlieue de Villacoublay, où il travaillait.
Le dévouement et
l’abnégation de ces merveilleux patriotes et internationalistes, Dora et Boris,
se sont manifestés d’une manière particulièrement forte, je dirais touchante,
lorsque je leur ai proposé de cacher chez eux deux officiers soviétiques qui
s’étaient échappés des camps de prisonniers de guerre en Allemagne et avaient
atteint difficilement Paris. Ils ont accepté la proposition avec des
acclamations :
— Mais bien
sûr ! Tu n’as même pas besoin de demander ! Emmène-les
maintenant ! Peut-on refuser à nos frangins ?
Et les deux
combattants soviétiques ont commencé à vivre dans cette famille aimante. Je
donnerai la parole à l’un d’eux, le capitaine Mikhail Antonov, pour voir avec
quel soin les officiers de Sébastopol ont été entourés, dont l’autre avait le
grade de major.
CARACTÉRISTIQUE
— TÉMOIGNAGE
Je connais le
camarade Boris Kazakov et sa femme Dora depuis août 1944, lorsqu’avec un de mes
camarades nous nous sommes échappés d’un camp allemand. Boris Kazakov et sa
femme m’ont beaucoup aidé, moi et mon ami, avec des vêtements, de l’argent, de
la nourriture et un logement. Je sais qu’ils ont vraiment partagé leur dernier
morceau de pain avec nous et ont aidé beaucoup d’autres camarades que nous. Je
sais que ce sont des gens dévoués au pouvoir soviétique, qui comprennent très
bien qui sont les ennemis des travailleurs.
Responsable
du point de rassemblement à Argenteuil :
Capitaine M. Antonov
20. V. 1945
Dans une série de réunions
avant et après l’Insurrection de Paris fin août 1944, une véritable amitié de
lutte s’est créée entre les camarades soviétiques et moi. Après l’insurrection,
ils ont appris mon nom et les postes à responsabilité que j’occupais dans la
Résistance. Je leur racontai fièrement comment nous, combattants émigrés
parisiens, avions félicité l’Armée rouge à l’occasion de son 25e anniversaire
et comment nous nous étions tous sentis comme des soldats de cette glorieuse et
invincible armée soviétique. Misha et son camarade, plus âgé que lui, ont
reconnu que l’un des facteurs de la victoire finale sur l’hitlérisme résidait
dans les mouvements de résistance des peuples européens.
Il se trouve que je
devais rendre un service important à Misha. Se sentant libre, il avait
rencontré et était tombé amoureux d’une jeune française d’origine hongroise. Il
voulait, et elle voulait beaucoup, l’emmener en Union soviétique en tant
qu’épouse. Mais le général, qui autorisait le rapatriement des prisonniers
soviétiques, lui a demandé de nommer une personne qui pourrait garantir que les
intentions des deux candidats au mariage étaient sérieuses. Sollicité par les
amants, je me suis présenté devant le camarade général, et en ma qualité alors
de secrétaire du Centre d’Action et de Défense des Immigrés (C.A.D.I.) je l’ai
assuré du sérieux des sentiments réciproques des jeunes, précisant que je
connaissais le père de la fille — combattant de la commune hongroise. Le
général a tenu compte de ma requête, le mariage a eu lieu.
Cher Misha, depuis
lors, nous ne nous sommes ni vus ni entendus. Mais récemment j’étais à Paris et
j’ai trouvé ton portrait. J’espère à travers lui obtenir des informations sur
le chemin de ta vie. J’espère...
Permettez-moi
maintenant de m’excuser auprès des lecteurs pour cet écart et de continuer mon
histoire. Dans la demeure des Kazakov, j’ai accompli trois tâches principales
en trois jours : j’ai terminé les caractéristiques, déterminé les grades
militaires et nommé les détachements nationaux et certains groupes de combat
individuels avec des noms spéciaux. En vertu de l’instruction de l’état-major
des francs-tireurs et partisans français, nous, chefs parisiens des combattants
étrangers, avions le droit de nommer jusqu’au grade de lieutenant. J’ai adopté
et proposé le principe : que tous les membres de la direction des
détachements soient promus au grade de lieutenant, tous les chefs de groupes de
combat — sous-lieutenants, les chefs des services centraux
« Renseignement », « Technologie et armement »,
« Médecine et protection sociale », « Problèmes de
logement », ont reçu le grade de lieutenant ; les secrétaires et
agents de liaison devinrent sous-lieutenants. À nous trois — Charles, Roger,
Louis — le camarade Rol-Tanguy nous annonça que nous avions obtenu le grade de
capitaine.
Les noms des équipes
et des groupes m’ont donné du fil à retordre. Je devais les trouver avec de
nombreuses qualités : politiquement corrects, colorés, sonores. J’ai
commencé par les indiscutables : la Marseillaise, la Commune de Paris,
Robespierre, Saint-Just, Bara et Viala, Valmy, le 14 juillet, le Grand Octobre,
Stalingrad, l’Armée rouge et j’ai arrêté. Leur nombre était loin du nombre de
groupes de combattants. J’ai laissé le chemin des noms et des événements
historiques et j’ai laissé libre cours à ma fantaisie poétique : des noms
comme Éclair, Tonnerre, Revanchards, Déluge de feu, Justice, Vérité, Revanche,
Futur, Tornade, Tempête et autres.
Avec des
modifications mineures, Roger et Louis ont accepté le projet de
caractéristiques, de grades et de noms. Puis dans une joie non dissimulée, les
combattants ont accueilli... « leur promotion ». Leur confiance au
combat a encore augmenté. À cette occasion, nous avons constaté une violation
de la conspiration : certains combattants s’étaient vantés auprès d’amis,
de fiancées et de voisins. J’ai rencontré exprès un jeune camarade du
détachement juif qui s’était vanté d’être porteur d’épaulettes invisibles de
sous-lieutenant. Le bon garçon Jean réalisa sa culpabilité et, les larmes aux
yeux, promit que toute information clandestine s’enfoncerait en lui comme une
tombe.
Peu importe à quel
point nous avons suivi les règles de la conspiration, la police a réussi à nous
tomber dessus. Des combattants individuels, principalement des Espagnols, ont
signalé des limiers sur leurs traces. Les signaux sont devenus plus fréquents.
Des rapports de pistage arrivaient de toutes les équipes. Roger n’y croyait
pas. Il soupçonnait chez les uns une imagination débridée, chez d’autres la peur,
chez des troisièmes une tentative d’échapper à la lutte. Dans notre quartier
général, il a catégoriquement défendu sa thèse et réfuté avec passion la
possibilité de la crédibilité de l’information. Le responsable militaire
affirmait :
— Il est
impossible qu’un traître se soit glissé dans nos rangs. Nous sommes tous passés
au tamis le plus épais et avons été scrutés à la plus grande loupe. Depuis plus
d’un an, la police n’a pas été en mesure de provoquer ne serait-ce qu’un échec
individuel. De quoi a-t-on besoin en ce moment ? Que chacun de nous
redouble de vigilance en observant strictement les mesures de nettoyage ;
d’être prudent avant d’aller à une réunion, et ensuite de regarder autour de
soi avant de rentrer chez soi et en sortant le matin.
L’assurance de Roger
n’a pas changé le cours des événements. La vie l’a bientôt éclaté comme une
bulle de savon.
Un après-midi de
septembre, j’avais pris rendez-vous avec le commissaire politique Pierrot dans
l’étroite rue de Trévise près du théâtre des Folies Bergère. J’avais hâte de
voir le jeune et énergique dirigeant italien qui me rapporterait les actions de
l’équipe au cours de la semaine écoulée. Échauffé par l’embuscade sur la
chaussée Dragalevsko, j’ai scruté la rue avant l’heure du rendez-vous. L’examen
s’avéra positif : il n’y avait rien qui me paraissait suspect ; je
n’ai remarqué aucun signe d’embuscade. Ma vigilance récente me tenait sur mes
gardes. J’entrai dans un café à l’intersection de la rue Bleue, d’où je pouvais
observer la circulation sur la rue de Trévise. Je buvais mon café lentement
jusqu’à ce que le commissaire politique italien apparaisse. J’ai regardé
derrière lui — encore rien ! J’ai payé en vitesse et j’ai accéléré le pas
pour le rattraper. Je plaisantai, en lui tapant sur l’épaule. Pierrot fut
surpris de me voir venir par derrière et non vers lui comme cela avait été
convenu. Il s’est amusé de la plaisanterie et nous sommes partis ensemble.
Le rapport
hebdomadaire de combat du détachement italien était plus que louable :
élimination d’un général hitlérien qui voyageait très souvent entre Paris et le
front de l’Est ; déraillement d’un train avec des troupes
hitlériennes ; rupture à jamais de l’activité de trahison de deux
fascistes italiens — collaborateurs de l’occupant ; attaque à la grenade
contre un bureau de recrutement pour l’Allemagne ; moteurs endommagés
d’une dizaine de camions dans un grand garage de la banlieue de
Levallois-Perret. Avec un tel rapport, je ne pouvais que féliciter la direction
et toute l’équipe italienne, qui était en concurrence silencieuse avec l’équipe
juive. Le championnat, qui était d’abord détenu par les Bulgares, a récemment
commencé à être remporté par les équipes juives et italiennes.
L’histoire des
actions brillantes m’a captivé. En même temps, j’étais dérangé par le ton élevé
et surtout les gestes exagérés de Pierrot. Nous avions déjà dépassé le Théâtre
des Folies Bergère et avancions rue Geoffroy-Marie. Vu l’activité des gens dans
ce centre commercial de Paris, et sans oublier la main gauche artificielle de
l’Inter-brigadiste d’Espagne, la gesticulation de mon interlocuteur
impressionnait les passants, dont certains se tournaient vers nous. Ma remarque
de ne pas raconter avec des gestes aussi expressifs a été acceptée… en
principe. Au bout d’une minute ou deux, mon ami oubliait et gesticulait de
nouveau sans limite. J’ai été obligé de répéter de nouveau et de lui faire
comprendre qu’il devrait nous considérer comme des personnes qui ne devraient
pas être remarquées par les autres. Pierrot a ensuite dévoilé une petite page
de son parcours :
— Je ne
briserai pas la conspiration si je te dis que je suis des environs de la ville
de Toscane. En fait, nous, les Toscans, utilisons beaucoup nos mains lorsque
nous parlons. Nous avons un dicton : « Eh bien, tête stupide — j’en
ai marre de lui parler en lui expliquant avec mes mains ! » Mais nous
sommes tolérables, il y a pire. Tu n’as jamais eu affaire à une personne de
Calabre ? Si tu interdis à un Calabrais de gesticuler, il deviendra
aussitôt muet, sa bouche se fermera comme les portes d’un couvent de femmes...
Nous avons traversé
le bruyant boulevard Montmartre et nous nous sommes engagés sur le trottoir de
droite de la rue Montmartre, qui était très fréquentée en ce moment. Nous
marchions vers la place du Palais Royal, où je retrouverais Georges l’Arménien
à la station de métro.
Je ne crois pas à la
télépathie, mais je compte sur mon œil vif. Et là, pour des raisons qui
m’étaient jusqu’alors inexplicables, je jetai un coup d’œil en biais sur le
trottoir d’en face. Mes yeux tombèrent sur un homme de taille moyenne, avec un
costume bleu et une casquette bleu foncé. Involontairement, je le fixai plus
longtemps. Je fus surpris de constater qu’il me regardait aussi, mais il n’a
pas soutenu mon regard et a essayé de se cacher derrière un passant qui
marchait à côté de lui. Je continuai à le tenir à l’œil pendant quelques
secondes. Il se cachait obstinément et évitait clairement nos regards. Ce petit
jeu m’a piqué comme une aiguille chauffée à blanc. Mon esprit travaillait fiévreusement.
J’ai eu un pressentiment : nous sommes suivis, celui d’en face n’est
probablement pas seul. Je tournai brusquement à 180 degrés et m’arrêtai sur
place à la grande surprise de Pierrot. J’ai dévisagé les piétons derrière nous.
Un homme plus grand que la moyenne dans la quarantaine, la tête chauve et les
cheveux châtain clair a également refusé de croiser mon regard. Les yeux
baissés, il nous dépassa maladroitement.
C’est devenu clair
pour moi — les limiers sont sur nos talons. Il fallait prendre une décision
très rapide. Sur le ton d’un patron qui ne tolère pas les objections,
j’ordonnai à mon ami :
— Nous sommes
suivis, tu vas faire ce que je fais, parler d’un mariage ou d’un film.
Nous avons ralenti.
L’intelligent Toscan a commencé à raconter comment une femme trompait son mari
et comment il l’avait abattue, elle et son amant. D’un pas vif, je descendis du
trottoir et traversai la rue sans passer par le passage carrelé de jaune.
Pierrot me suivait. Empruntant le trottoir d’en face, nous sommes retournés sur
les Grands Boulevards et sommes entrés dans le café à l’angle de la rue
Montmartre et de la rue d’Uzès.
J’avais besoin de
temps et d’un endroit tranquille pour expliquer au jeune commissaire politique
quelles mesures nous devions prendre dans ces circonstances. Par habitude, j’ai
pris un coin du café d’où je pouvais tout voir et où mon dos était protégé. Le
mur du café de la rue d’Uzès était tout de verre, à travers lequel j’aurais vu
nos poursuivants. Pendant cinq ou dix minutes, aucun d’entre eux n’est apparu
dans la rue, ni personne n’est venu manger au comptoir. J’en ai profité pour
dire à Pierrot comment je voyais la situation.
— Mon œil ne me
trompe pas. J’ai accumulé assez d’expérience conspirationniste dans mon pays
natal. Des agents sont sur notre piste. J’en ai vu deux. Il peut y en avoir
plus. S’ils ont un ordre, ils nous arrêteront ici au café. Dans ce cas, notre
destin est scellé. Nous ne devrons pas nous laisser faire. Nous proclamerons
haut et fort que nous sommes des patriotes français pour gagner les visiteurs
et les passants de notre côté. Si l’on crée un attroupement de Français, dans
le tumulte il faut échapper aux pattes des chiens. C’est ce qu’ont fait les
bolcheviks à l’époque tsariste, et beaucoup ont été sauvés grâce à l’intervention
du peuple. S’ils ne nous attaquent pas maintenant, ils continueront à nous
marcher sur les talons... Il va falloir se dépêcher de sortir. La chose la plus
sensée à faire est d’entrer dans le métro. Là, nous essaierons de leur
échapper. Maintenant réponds-moi : as-tu assez d’argent sur toi pour
passer une semaine hors de Paris, et peux-tu y trouver des amis pour
t’abriter ?
Pierrot m’a fait un
signe de tête affirmatif.
J’ai continué :
— Dès ce
moment, sans avertir personne, tu mets fin à toutes les rencontres et tu
disparais de la circulation de Paris. J’informerai personnellement et
rassurerai tes compatriotes. Je vais aussi m’éloigner de la capitale. Nous nous
reverrons dans dix jours exactement dans la ville de Meaux à la gare à 4 heures
de l’après-midi... Rencontre de contrôle le lendemain, mais à 14 heures.
L’addition, s’il vous plaît !...
Dans la rue, la vie
continuait comme d’habitude. Les gens se pressaient ou flânaient, chacun occupé
par lui-même. Il n’était jamais venu à l’esprit de personne qu’à ce moment deux
chefs de la Résistance parisienne étaient sur le point de mourir. Nous sommes
descendus à la station Montmartre toute proche. Nous nous sommes regardés et
nous nous sommes serré la main comme si nous nous disions un dernier « adieu ».
Afin de séparer les poursuivants nous sommes allés dans des directions opposées
— Pierrot la ligne Balard, et moi Montreux. Pierrot est monté dans le métro le
premier. Je ne pouvais pas distinguer si l’un des agents était monté dans le
wagon après lui. Resté seul, je longeai le quai et m’approchai de la sortie du
métro vers la rue Saint-Fiacre. De là, j’ai discrètement observé qui étaient
les nouveaux passagers : une femme âgée vêtue de noir, une mère avec un
petit garçon, et… après elle, l’agent du trottoir d’en face. Il n’a pas remis
de billet au poinçonneur, mais a présenté une carte (une carte de police pour
moi !). Le monsieur s’était « transformé » — il portait la
casquette à la main, avait enlevé sa cravate et avait déboutonné sa chemise. Au
début, il attendait loin de moi, mais quand le train est arrivé, il a couru et
est monté dans la voiture à côté de la mienne. Il s’est assis à un endroit d’où
il pouvait me regarder à travers les vitres des voitures. Je me suis assis
aussi. J’ai ouvert un journal ostensiblement pour le lire, mais en fait j’étais
sur des charbons ardents et je calculais fiévreusement comment
« éliminer » l’invité non désiré. Je raisonnais de la manière
suivante : les prochaines stations sont bondées, il faut que je descende
là-bas et que je me glisse dans la foule, alors j’espère m’échapper de l’œil
aiguisé du limier. Mais l’expérience que je venais de mener, où, malgré les
précautions que j’avais prises, je n’avais pas remarqué le danger qui rôdait,
m’incitait à ne pas compter m’éloigner si facilement de l’habile policier. J’ai
pensé sortir et me réfugier dans un taxi. Mais ne va-t-il pas m’arrêter avant
que je ne monte dans le taxi ?... Et soudain, un autre salut incroyable
s’est présenté devant moi. Les portes des wagons se ferment automatiquement. Et
si j’arrive à les ouvrir et à sauter en mouvement ? Ça vaut le risque. À
la station République, je me suis levé, je me suis tenu près d’une des portes
de la voiture et j’ai continué à « lire ». Nous avons passé la station
Saint-Ambroise et sommes arrivés à la station Voltaire. Certains passagers sont
descendus, d’autres sont montés. Les portes ont commencé à se fermer. Décidant
d’agir, j’étendis ma jambe droite et la coinçai entre les portes coulissantes
au risque d’être sévèrement pressé. J’ai ressenti une douleur sourde pendant un
moment, mais l’essentiel de mon objectif était accompli : la porte ne
s’est pas bien fermée et le train a démarré. De toute la force d’un fugitif
poursuivi, et de mes quarante ans, j’ouvris la porte des deux mains, et sautai
dehors à l’étonnement de mes compagnons de voyage. En mettant le pied sur le
quai, je vis passer devant moi la voiture dans laquelle l’agent lisait
calmement un journal. Je l’aurais salué s’il m’avait regardé, mais il lisait,
convaincu que j’étais toujours dans la voiture de devant. Je soupirai avec un
grand soulagement — j’avais « éliminé » le détestable monsieur et
maintenant je pouvais respirer librement. Dès que je suis sorti de la station
de métro, j’ai appelé un taxi et demandé à être déposé devant le Théâtre du
Châtelet. De là, j’ai marché jusqu’à la station Palais Royal. J’ai utilisé la
même stratégie que pour la rue de Trévise — quinze minutes avant la rencontre,
j’ai regardé autour de moi, mais cette fois aussi je n’ai rien trouvé de
suspect.
Georges Manouchian
et moi nous nous sommes rencontrés sur le quai de la ligne Vincennes-Neuilly.
Georges était déjà à la tête d’un groupe de combat. Il est apparu de bonne
humeur. Je l’ai trouvé rénové. Une confiance en soi particulière, une gaieté
fraîche rayonnaient de toute sa silhouette mince. Quand je lui ai demandé s’il
était propre et s’il n’avait pas remarqué qu’il était suivi, il m’a répondu
nonchalamment et avec étonnement : « Je n’ai rien vu. Pourquoi,
qu’est-ce qu’il y a, y-a-t-il un combattant atteint ? » J’expliquai
prudemment qu’une extrême vigilance s’imposait maintenant, et je lui ordonnai
de quitter dès le soir-même toutes ses cachettes à Paris et de passer la nuit à
la campagne ; de réduire les rencontres et de ne les tenir qu’en
banlieue ; d’attendre d’autres instructions dans une semaine. Il est juste
d’avouer, je n’ai pas réussi à convaincre le poète enthousiaste de la gravité
du danger imminent. Il m’a dit d’un air suffisant :
— J’obéirai,
mais personnellement je me considère comme un démon assez grand pour voir si
j’ai une queue ou non.
Contrairement à ma
promesse faite à Pierrot, je n’ai pas quitté Paris et je n’ai pas arrêté mon
travail. Le lendemain, je devais rencontrer un camarade français, commissaire
politique des combattants français en région parisienne. Je devais lui rendre
compte de l’état, des méthodes, de la composition numérique et de l’activité
générale de l’organisation des étrangers participant à la Résistance. La
réunion était prévue à 10 heures du matin rue du Dragon dans le sixième
arrondissement. Bernadette, secrétaire de l’Italien Fernand, me mettrait en
relation avec mon collègue en question.
Je suis entré dans
la rue du Dragon depuis le boulevard Saint Germain. Relativement calme, je
marchais sur le trottoir de droite. Devant moi, sur le même trottoir,
l’Italienne Bernadette parlait avec la Polonaise Lily, la secrétaire d’Hervé.
J’allais m’approcher d’eux et leur demander pourquoi Lily était venue, sans en
avoir été prévenu, lorsque j’aperçus à gauche l’agent à la casquette de la rue
Montmartre, caché derrière un lampadaire dans la vieille et étroite rue pavée
Bernard Palissy. Il suivait les camarades. J’ai frissonné, mais j’ai continué.
Démonstrativement, comme un inconnu, je suis passé devant les deux filles
surprises. Lily se hasarda à m’arrêter avec un timide : « Monsieur
Charles ! » Gênées par mon comportement, elles ne me suivirent pas,
mais restèrent clouées au trottoir. Je devais les prévenir à tout prix. Je
serais une crapule à mes propres yeux si je ne faisais pas de mon mieux pour
leur signaler le danger. À une quinzaine de pas d’eux, je me penchais pour
faire semblant de lacer mes souliers. Heureusement, elles me suivaient des
yeux. Avec la main et la tête je leur ai fait savoir qu’elles étaient suivies,
je me suis levé et j’ai traversé le carrefour de la Croix-Rouge. Rue de Rennes
j’ai sauté dans le premier taxi. Le salut d’aujourd’hui m’a semblé bien plus
incroyable que celui d’hier. Le cercle se resserrait. Et ce qui était le plus
terrible : il s’élevait et atteignait le sommet, la Commission du CC du
PCF et l’état-major des partisans étrangers. J’avais peur pour moi et de moi —
n’étais-je pas en train de promener les agents ici et là à cause d’une
vigilance émoussée ? Dans tous les cas, une chose est devenue claire pour
moi — la police a réussi à ratisser large et n’attend positivement que le
moment opportun pour récolter une riche prise.
J’ai convoqué deux
réunions : l’une du trio Roger, Louis et Charles, l’autre avec la
participation du camarade Hervé. Que s’est-il avéré ? Roger continuait
d’insister sur le fait qu’aucun limier n’est tombé sur nos traces, que j’avais
aussi souffert d’illusions d’optique, d’erreurs de calcul, etc… en raison de la
forte pression de l’activité illégale… Louis et Hervé adoptèrent une position
hésitante. Ils ont prêté une certaine crédibilité à mes affirmations. En
confirmation de ce qui s’est passé rue du Dragon, Hervé nous a raconté comment
Bernadette et Lily ont été abordées par un monsieur dans le métro, qui leur a
chuchoté « Mesdemoiselles, vous êtes suivies », et est rapidement
descendu à la gare Montparnasse.
Aux faits déjà
connus j’ai ajouté le témoignage de ma secrétaire Solange. Avec sa myopie assez
forte, elle témoignait aussi de la présence d’agents insolents autour d’elle et
de son logement, et que peu de temps auparavant la police avait demandé à sa
logeuse pourquoi, sans être divorcée, elle avait vécu des années séparée de son
mari, qui était apothicaire à Toulouse.
Angoissé et
responsable, je développai à mes camarades ma thèse pour une sortie sans
douleur des pièges de la Gestapo.
— Connaissant
l’esprit combatif élevé de nos gens, basé sur la pénétration policière sérieuse
de toute l’organisation, je pense que nous devons prendre des mesures radicales.
Je propose que tous nos combattants de la région parisienne soient transférés
en zone libre et inversement, que leurs remplaçants viennent de là. L’opération
d’échange durera 3-4 semaines dans le pire des cas, même un mois. Nous avons
les fonds, nous pouvons agir immédiatement. Il n’est pas nécessaire pour moi
d’argumenter de manière exhaustive la nécessité impérieuse d’une telle action.
Cette dernière est non seulement nécessaire, mais elle seule peut être
efficace. Ce n’est qu’ainsi que nous échapperons aux tentacules de la police,
que nous couvrirons nos traces.
Roger m’a accusé de
paniquer, Hervé et Louis ont demandé du temps pour réfléchir. J’étais consterné
par l’aveuglement de l’un et par la douce prudence des deux autres.
Nous avons terminé
la rencontre par des décisions concrètement utiles, mais timides et indignes
d’une épreuve suprême : il est obligatoire pour tous les combattants de
changer de domicile ; de n’organiser leurs réunions qu’en banlieue ;
de ne pas utiliser le métro ; d’acheter des bicyclettes pour tous ceux qui
savent rouler, et pour ceux qui ne savent pas d’apprendre ; de changer les
noms de combat ; Solange, qui met en danger le Comité Central et
l’état-major, de couper immédiatement tout lien et de se cacher pendant trois
mois à la campagne.
Avant de nous
séparer, chacun de nous quatre a choisi un nouveau surnom. Hervé s’appelait
Irène, Roger devint Olivier, Louis changea son nom en Jérôme, au lieu de
Charles je m’appelais Gaby en mémoire du grand journaliste Gabriel Péri, membre
du CC du PCF, fusillé par les hitlériens.
Pas même une semaine
ne s’est écoulée et les décisions ont été mises en œuvre. Enfourchant leurs
bicyclettes, les combattants se sont installés en banlieue, où ils se
réunissaient et préparaient les actions à venir. À quarante ans, j’ai eu du
mal, mais j’ai appris à utiliser la machine instable du diable sur deux roues.
Avec le remaniement en demi-teinte, nous avons probablement quelque peu
bouleversé les plans de la police. Mais nous n’avons certainement pas réussi à
« blanchir » ceux qui sont tombés une fois dans les traces de la
Gestapo.
Avant de pouvoir
partir à la campagne, Solange a été arrêtée. L’ayant reconnue à cause de sa
photo, trois agents se sont jetés sur elle alors qu’elle sortait du bus à la
station Place d’Italie. Conduite à la préfecture de police, un certain grand
patron a grondé ses subordonnés :
— Vous êtes
pressés comme des gosses. Qu’est-ce que j’en fais d’elle seule ? Par son
intermédiaire, nous devions atteindre leur direction et leur chef. Maintenant
vous vous occupez d’elle. Crachez sur vos mains et faites sortir de la bouche
de cette communiste et paria où se trouve son chef.
Solange a été à la
hauteur de notre confiance absolue en elle. Elle n’a pas parlé. Désespérés par
la vaine torture d’un mois, les bourreaux l’ont envoyée à une mort certaine
dans le camp d’Auschwitz. Au mépris de ses ennemis, à la gloire de la tribu
communiste et à l’étonnement de ses amis, Solange est revenue du camp de la
mort malade, fragile comme une primevère, mais vivante.
EXPÉRIENCE
PARISIENNE EN ZONE OCCUPÉE
Au début d’octobre
1943, Bruno, secrétaire de la Commission des étrangers au CC du PCF, m’a
convoqué à une rencontre dans la ville française typiquement calme de
Marly-le-Roi près de Paris. L’après-midi était ensoleillé. Nous traversions des
rues presque désertes. Bruno marchait avec un chapeau dans les mains et
s’essuyait de temps en temps le front avec un mouchoir. J’ai remarqué qu’il
marchait assez lentement et se retournait très souvent pour voir si nous étions
suivis. À mon avis, avec le deuxième mouvement, il en faisait trop.
Le secrétaire a
abordé le but de la rencontre d’une manière très terre-à-terre :
— Par décision
du CC du PCF, tu changes d’emploi — chef du parti des groupes de francs-tireurs
et partisans de la main-d’œuvre immigrée dans la zone occupée de France,
divisée en neuf régions du parti. Tu assureras la liaison avec les secrétaires
français de chaque région. Ils sont les principaux dirigeants politiques de
leurs régions. Tu coordonneras toutes les tâches les plus importantes avec eux.
Eux, les français, te mettront en relation avec des émigrants responsables du
travail parmi les étrangers. Tu dirigeras précisément ces responsables
régionaux qui sont les nôtres, je le répète, en accord avec les secrétaires
français... Maintenant, deux mots pour toi. Le sens de ta nouvelle mission et
la tâche principale qui t’est confiée est de transférer l’expérience des
groupes de combat parisiens en zone occupée. Tu agiras en fonction de la
situation... Tu voyageras et séjourneras souvent à la campagne. Cela te causera
certaines difficultés, mais aussi une aubaine pour toi - pour effacer tes
traces parisiennes.
Avant que je ne
commence mes voyages à la campagne, une Française de dix-sept ans m’a été
assignée comme secrétaire et dactylographe. Avec de grands yeux bleu clair, des
cheveux presque blonds, modestement vêtue d’un chemisier blanc et d’une jupe
bleue, la jeune fille voulait que je lui explique en quoi consisterait son
travail et comment elle devrait se comporter en tant que conspiratrice devant
ses proches et amis. Je lui ai dit qu’elle devrait d’abord trouver un faux nom.
Elle l’avait déjà trouvé — je pouvais l’appeler Daniela. Nous avons arpenté les
rues de Paris pendant près de deux heures. Je l’ai instruite dans les moindres
détails. En fait, je lui transmettais mes années d’expérience. Finalement, je
me suis arrêté sur la volonté d’être prêt au sacrifice. Daniela, qui jusqu’à
présent n’approuvait que par « oui », « je comprends »,
m’interrompit :
— Et c’est
aussi ce sur quoi j’ai réfléchi. En acceptant d’être une combattante de la
Résistance, je me suis dit en même temps que je faisais partie de l’Armée
rouge, et tout comme le peuple soviétique qui se bat et déplore des victimes,
je peux aussi tomber dans le combat ici. La liberté ne peut être gagnée sans
sacrifice. Je suis bien au courant de cela.
La jeune fille m’a
conquis par sa pureté de pensée et sa conscience de lutte. J’ai organisé une
deuxième réunion où je lui donnerais du matériel à copier, et je m’apprêtais à
me séparer d’elle. Alors Daniela m’a très timidement demandé si elle pouvait me
poser une question privée. Je lui ai dit que cela dépendait de la question.
— Je
me trompe peut-être, mais j’aimerais savoir, tu n’es pas bulgare ?
Le coup est venu
sans prévenir, mais je me suis vite maîtrisé.
— Grosse
erreur. Désormais, tu travailleras avec des étrangers, mais tu ne dois jamais
t’intéresser à leur nationalité... En ce qui me concerne, tu es loin de la
vérité. Je ne suis même pas européen. Prie pour que nous vivions jusqu’à la
victoire, alors tu connaîtras aussi ma patrie.
(Après la libération
de Paris en août 1944, Daniela et moi avons beaucoup ri sur le fait que je
n’étais pas européen, ce qu’elle ne croyait pas. Elle m’a révélé exactement ce
qui l’avait poussée à poser sa question : avant la guerre,
l’inter-brigadiste bulgare Doncho Diankov, mon ami, a rendu visite à sa
famille ; elle a constaté que j’avais le même accent que lui et a tiré une
conclusion sur ma nationalité. Cet accent malheureux qui est le nôtre, dont peu
de Bulgares parviennent à se débarrasser !)
Le premier
secrétaire régional français m’a été présenté dans la banlieue de Corbeil. Il
s’appelait Maxime. Le nom m’intriguait, me faisait soupçonner un étranger comme
un de nos frères. Mais, d’un autre côté, j’ai été surpris par son français. Pas
tant à cause de l’accent parisien mais plutôt à cause des mots et des formes
littéraires[88].
Maxime était de taille moyenne, mince, avec une poitrine étroite et un visage
oblong pâle. Il était extrêmement propre. Ses longs ongles brillaient comme des
boutons de mica, son costume noir — repassé de façon festive, un nœud papillon
bleu foncé sur son col amidonné blanc. Au tout début de la conversation, il me
dit qu’il était affecté en Bretagne, mais qu’il n’était pas encore entré en
fonction. Puis il a exprimé son regret, car il ne pouvait rien me dire de
nouveau sur la disposition de nos forces et celles de l’ennemi là-bas, ni sur
nous, les étrangers. L’italien Nino, que je connaissais déjà, devait le
retrouver dans quelques jours dans Rennes, la capitale bretonne. Après un
échange d’idées, nous avons convenu de concentrer nos efforts dans deux
directions — la création de sections du parti et la formation de groupes de
combat.
— Notre
ambition doit être de faire de la Bretagne un Paris au plus vite. — C’est de ça
que parlait Maxime et c’était comme s’il m’enlevait les mots de la bouche. —
Que les hitlériens sentent le feu sous leurs pieds, comme sur le front de
l’Est. À cette fin, il m’a été suggéré d’utiliser ton expérience dans la lutte
des groupes de combat.
Les conditions m’ont
obligé à rendre visite à Maxime et Nino plusieurs fois au cours des trois ou
quatre mois suivants. Au début, tous deux rencontrèrent de sérieuses
difficultés. L’animation des rues parisiennes, qui servait souvent de
couverture commode, était absente ici dans les villes bretonnes de province. En
plus, la police française et les agents de la Gestapo avaient largement étendu
leurs réseaux et surveillaient chaque mouvement des antihitlériens les plus
connus. Le peuple, dans sa masse, éprouvait une forte haine pour les occupants
et exprimait de mille manières ses sentiments patriotiques. Sur cette base,
bien que dans un laps de temps pas très court, Maxime et Nino ont réussi à
créer le squelette d’une organisation efficace de la Résistance. À la fin du
troisième mois, les sabotages dans les entreprises et les institutions
devinrent plus fréquents ; un train de la ligne Brest-Quimper a
déraillé ; des bombes ont explosé dans un cinéma allemand de la ville de
Rennes et dans un local hitlérien de la ville de Vannes. Nous étions loin de
faire de la Bretagne un Paris, encore moins une partie du front de l’Est, mais
les combattants étaient déjà résolument sur la voie de la résistance offensive.
C’était une garantie pour le déploiement actif de la lutte dans cette partie
patriotique du sol français. Et en effet, le nombre de groupes de combat a
augmenté, leurs frappes sont devenues plus fréquentes et élargies. En février
et mars 1944, l’évaluation donnée par le CC du PCF pour la lutte dans ce
domaine était louable. Le mérite revenait sans aucun doute à Maxime et Nino.
Malgré la différence des professions — un enseignant et un électricien — ils
avaient remarquablement bien travaillé de concert et étaient même devenus amis.
Portés par les premiers succès — comme nous l’avons appris plus tard — ils ont
sous-estimé la vigilance policière et ont élu domicile dans un logement. Ils
ont payé cher la violation des règles élémentaires du travail illégal. Un
matin, ils ont été surpris par des coups forts frappés à la porte, mêlés à des
cris sinistres. Maxime, saisissant des vêtements et des chaussures, a sauté du
troisième étage sur une terrasse et de là sur un trottoir de la rue. Nino
n’était pas si agile et s’est laissé attraper par les agents qui ont fait
irruption par la porte cassée.
C’est ainsi que
Maxime et Nino ont échoué, mais ils ne sont pas morts. Le premier est resté à
son poste, a vécu jusqu’au jour de la libération et a travaillé sous son vrai
nom, Marcel Dufriche, d’abord comme secrétaire de la CGT. Nino a été interné en
Allemagne, y a vécu les horreurs des camps de la mort et en est revenu sec
comme un bâton, mais vivant. Le grand blond jovial Nino avait perdu la beauté
de son visage rose, mais avait conservé sa gaieté bouillonnante. Après la
guerre, il est allé dans son pays natal et s’est consacré au travail du parti.
Des dizaines de
camps de prisonniers de guerre soviétiques étaient dispersés dans toute la
France occupée. Le Parti communiste français en a fait la cible de son activité
de propagande. Il avait sélectionné des camarades connaissant le russe,
l’allemand, l’arménien et les avait chargés de communiquer par tous les moyens
avec les détenus et, si possible, avec les soldats et gardes allemands. Lorsque
je travaillais en région parisienne, j’étais en contact avec le camarade
allemand inter-brigadiste Max. Il gérait l’activité AMI parmi les troupes
d’Hitler.
Pour travailler
parmi les militaires allemands et les prisonniers de guerre à la campagne, Max
m’a présenté au Français Robert. Au préalable, Hervé m’a conseillé d’assister
Robert au maximum dans sa délicate mission et de ne le mettre en relation
qu’avec les camarades les plus solides, et seulement en cas de nécessité absolue.
Le nouveau combattant était grand, pâle et avec des doigts extrêmement secs. Il
toussait souvent. Dès la première rencontre, il souleva un problème très
délicat : près de la ville de Rouen, plus de cinq mille prisonniers
soviétiques étaient prêts à désarmer une centaine de gardes, soldats et
officiers hitlériens et à rejoindre les partisans français. J’avais l’habitude
d’être un optimiste incorrigible, et donc au premier moment j’ai presque
étreint mon camarade et j’ai presque crié : « Super ! Extraordinaire ! »
Un instant après la première impulsion, une pensée froide comme un couteau
aiguisé me traversa l’esprit : où iraient-ils, qui les abriterait, qui les
armerait-il et avec quoi ? Je me suis posé ces questions et j’ai répondu en
même temps en pensant à voix haute : « Impossible ! Nous ne
sommes pas l’Union soviétique, où il y a de vastes territoires libres capables
d’accueillir une masse aussi énorme. » Robert avait déjà exprimé la même
opinion aux prisonniers, mais avait promis de leur faire connaître l’opinion
officielle de la direction. Avec Bruno, Hervé, Fernand et Gaby[89],
en accord avec le CC du Parti communiste et l’état-major de la Résistance
(FTPF), nous avons décidé : que les internés soient félicités pour leur
volonté de continuer la lutte sur le sol français ; qu’ils attendent le
deuxième front imminent et qu’ils agissent ensuite ; les évasions
partielles sont autorisées...
Robert leur a
communiqué notre avis. Ils l’ont accepté à contrecœur, avec un sens de la
discipline. Dans ce cas, la direction a pris la bonne décision. Cela s’est vu
pendant le deuxième front, lorsque les mêmes détenus ont capturé le personnel
hitlérien et ont rejoint le peuple français insurgé pour libérer Rouen et ses
environs.
Robert et moi, nous
nous sommes rencontrés et avons discuté de la manière d’augmenter l’information
en allemand et par quels moyens afin d’ébranler le moral des occupants. La
dizaine de collaborateurs, majoritairement allemands, tchèques et polonais,
menés par Robert rédigeaient, imprimaient et distribuaient appels et slogans,
travaillant 24 heures sur 24 en zone occupée. Leur travail subversif était
primordial, mais une fois, Robert m’a surpris avec une objection
personnelle :
— Je suis un
travailleur intellectuel. Je pourrais être utile parmi les intellectuels
français. Je ne comprends pas pourquoi le parti m’a envoyé, moi un Français,
travailler parmi les étrangers. Et puisque je n’ai pas d’autre lien avec le
parti que toi, merci de communiquer mon désir d’être transféré dans un
environnement français.
Après le deuxième
front, la direction a satisfait la demande de Robert[90],
un homme intelligent, bon, mais avec un caractère un peu particulier.
La deuxième région
que j’ai visitée le plus souvent et le plus était le Nord de la France,
principalement les départements du Nord et du Pas de Calais, connus pour leurs
industries minières et textiles. Plus de 800 000 Polonais et plus de 200 000
Italiens travaillaient dans les mines.
Dans son
impressionnante majorité, cette masse d’un million d’hommes est restée fidèle à
son antifascisme d’avant-guerre. À la demande et à l’exemple des communistes et
du Komsomol, de nombreux mineurs des deux nationalités ont commis toutes sortes
de sabotages, la plupart causant de graves dommages à la production de charbon.
La tâche était d’élever l’action de sabotage à un nouveau niveau et surtout de
trouver des combattants pour des actions armées afin de détruire le personnel
de l’oppresseur national.
Dans la ville de
Lille, j’ai eu l’agréable surprise de rencontrer l’agitée Odette du Bureau du
Renseignement. Elle avait une nouvelle position — membre du trio dirigeant des
étrangers pour le nord de la France. Elle s’appelait maintenant Mariana et ne
portait pas de chapeau. Vêtue pauvrement, avec un foulard de couleur bon
marché, elle ressemblait à l’une des milliers de filles de mineurs. Elle avait
élu domicile dans un immeuble où ne vivaient que des familles ouvrières. Grâce
à sa nature sociable, elle avait réussi à se rapprocher de ses voisins de
l’étage. Elle m’assurait de leur haine des hitlériens et de leur loyauté envers
ceux qui se battent. Elle devait tenir une telle position, car je la
réprimandai vivement pour l’imprudence de faire fonctionner dans sa propre
chambre une ronéo, qui faisait un bruit révélateur. Selon tous les principes du
travail illégal, elle n’avait pas le droit de le faire. Mais c’était la
particularité de cette Mariana joufflue, aux yeux noirs et incroyablement
courageuse. Aucune règle ordinaire ne la touchait, ou plutôt elle ne
s’inscrivait dans aucun cadre habituel. Elle agissait en obéissant à son
intuition intérieure particulière. Elle s’y tenait et faisait des choses qui
dépassaient les limites de la logique humaine harmonieuse. Et ce qui était
étrange — elle avait toujours réussi à rester indemne.
J’ai cru nécessaire
d’ordonner : que les travaux sur la ronéo soient arrêtés
immédiatement ; l’appareil lui-même devant être transféré ailleurs ;
que Mariana loue un nouveau logement.
La réalité, la
réalité cauchemardesque hitlérienne se dressait devant nous comme un mur de
pierre avec toute son inexorabilité. Les efforts conjoints de Mariana, d’autres
camarades polonais et italiens et de moi-même s’étaient heurtés pour le moment
à des difficultés insurmontables. Et ce moment durait déjà depuis trois semaines.
Sans révoquer mon ordre, j’ai été obligé de permettre à l’ambitieuse Mariana
temporairement, et uniquement temporairement, de remettre en marche la ronéo.
De plus, un soir, j’ai personnellement dû aider la camarade à imprimer une
convocation pour l’anniversaire de l’Armée rouge !
C’était un dur
labeur chez les mineurs du nord de la France à cette époque. Dans leur
majorité, ils étaient un terreau fertile pour l’activité antihitlérienne.
Individuellement, chaque mineur se présentait à nous comme une forteresse
imprenable. La méfiance, la peur, la suspicion durcissaient les contacts entre
les antifascistes. La propagande radiophonique schismatique du gouvernement
polonais provisoire de Mikolajczyk à Londres avait enfoncé un clou dans les
rangs unis de la masse des mineurs polonais. Des camarades polonais connus et
faisant autorité avaient été pour la plupart tués, arrêtés ou portés disparus
dans les camps de concentration allemands. Les nouveaux militants
n’insufflaient pas encore la confiance nécessaire aux mineurs. L’un d’eux
s’appelait Claude. Il avait dirigé plusieurs noyaux du Komsomol dans les villes
minières de Lens, Vimy, Aneven, Hénin-Liétard, Méricourt, Avion, Sallaumines,
etc. Jeune beau blond à la carrure athlétique, ce mineur polonais impressionnait
par son érudition qui dépassait le niveau de son milieu. En plus du français,
il parlait couramment l’allemand comme langue maternelle. Originaire de
Katowice, il était venu vivre chez ses parents mineurs à l’âge de 16 ans, était
entré dans les mines et avait suivi des cours du soir de technicien minier.
Après des rencontres
répétées entre nous trois — Mariana, Claude et Gaby — nous nous sommes mis
d’accord sur le maillon qui devait nous permettre de tirer la chaîne. Il
s’agissait de l’artisan verrier Pientka, qui avait été président avant la
guerre de la Société des Polonais et qui depuis s’était isolé et coupé de toute
activité publique. Son autorité parmi ses compatriotes continuait d’être
extrêmement intense. Beaucoup, des centaines de personnes, dépendaient de lui
pour rejoindre le combat. En ce moment il conseillait à ses amis de ne pas
s’immiscer dans les affaires de la France, qui se débarrasserait elle-même des
occupants, les étrangers devaient attendre la fin de la guerre. Les Polonais en
particulier ne devraient pas se manifester, car ils écoutaient deux voix —
l’une de Londres, l’autre de Moscou — et ces voix étaient différentes. On ne
savait pas qui l’emporterait après la victoire, et il valait donc mieux adopter
une position d’attente.
Deux fois Mariana et
Claude sont allés lui demander de me rencontrer. J’ai été présenté comme un
« camarade d’en haut ». Les deux fois, il a refusé.
— Accepter une
rencontre, c’est s’engager, leur a-t-il dit, et je veux vivre en paix et s’il
vous plaît, laissez-moi tranquille.
Il ne savait pas à
qui il avait affaire. Alors Mariana pouvait-elle le laisser tranquille, ne pas
terminer le travail qu’elle avait commencé, ne pas remplir l’ordre du
parti ? Comme une mouche agaçante, elle se mit à tourner autour de lui presque
tous les deux jours. Enfin, elle réussit à le persuader que je lui rende visite
dans son atelier en tant que client ordinaire, seul, avec un mot de passe tout
aussi innocent : « J’ai deux carreaux cassés à la maison, l’un plus
grand, l’autre plus petit. »
Le lendemain matin,
le propriétaire m’accueillit froidement avec ces mots :
— Quelle
nouvelle chose vous allez me dire, car j’ai réfléchi à tous les
arguments ?
— Je n’ai
aucune prétention à vous faire découvrir l’Amérique, ai-je dit — Je voudrais seulement
converser comme des communistes.
— Je vous
écoute. Parlez plus doucement et soyez bref.
Au lieu de
développer la moindre réflexion, je lui ai dit que nous étions adultes (il
gravitait autour de la cinquantaine), qu’il était hors de question pour nous
d’avoir une conversation sérieuse dans ces conditions, alors qu’à tout moment
nous pouvions être dérangés par Dieu sait quel client. Après quelques
hésitations et des questions pour savoir si j’étais propre, si mes documents
étaient en règle et quelle profession j’exerçais selon les papiers, Pientka, à
ma grande surprise, m’invita chez lui. Ma profession de médecin « dans les
règles de l’art » eut sur lui un effet très bénéfique.
— S’il y a des
complications, vous venez m’examiner et c’est tout. N’importe comment j’ai un
problème de foie.
Le verrier Pientka
venait d’un village. Il y avait quelque chose de maladroit dans ses mouvements.
Ses gestes étaient grossiers, ses pas larges et lourds. Sur ses larges épaules
et son dos voûté se dressaient une grosse tête au front ouvert, des yeux noirs
enfoncés sous des sourcils épais, des pommettes saillantes et des mâchoires
puissantes. Le salon de son appartement attirait le regard par la propreté et
la splendeur du buffet antique en acacia avec un miroir au milieu de la table
ronde massive recouverte d’une épaisse nappe de dentelle, de la bibliothèque
assez grande à côté d’une fenêtre double ornée de fleurs dans des vases en
verre. L’épouse endimanchée, dodue et de taille moyenne, nous a servi un dîner
sec accompagné de vin rouge du Beaujolais. Quelques mots en polonais, prononcés
par moi-même, ont permis à l’hôtesse de se détendre et de se sentir parmi les
siens. Dans sa manière de recevoir, je voulais voir notamment l’expression de
l’hospitalité slave. J’ai regardé de travers mon interlocuteur. Son aspect
sérieux et pensif contrastait clairement avec l’atmosphère accueillante. Son
humeur n’était pas prometteuse.
La conversation a
duré près de trois heures. Nous nous sommes écoutés et notre ton était modéré
et calme. J’ai concentré mes arguments et mes raisonnements sur un point — la
nécessité de participer à la lutte. Pientka s’est détendu et a peut-être
imperceptiblement exprimé sa principale douleur :
— Mon isolement
me pèse lourdement. Les camarades ne le savent pas. Mais que puis-je
faire ?
Devant moi se tenait
un communiste honnête, confus dans sa foi et sa pensée.
— Cher Pientka,
tu es communiste et tu te sens comme tel, n’est-ce pas ?
— Sinon
comment ? Je ne suis qu’un communiste et je ne peux pas être autre chose.
— Alors tu ne
peux pas t’empêcher de sortir des eaux troubles dans lesquelles tu te balances
actuellement.
La clarification ou
plutôt la guérison n’est pas venue d’un coup. Nous avons tenu des causeries
similaires pendant deux semaines. Lors de certaines d’entre elles, Pientka
accepta la présence du « jeune homme » Claude. Enfin le vitrier,
l’ardent patriote polonais, rompit le cerceau de son isolement, cessa d’être un
jouet d’enfant dans le flot des événements et devint un facteur. Le réveil du
vieux communiste eut un effet revigorant sur un grand nombre de mineurs. Une
salle fut bientôt trouvée pour la ronéo de Mariana. Les sabotages se sont
intensifiés, plusieurs locomotives minières souterraines ont été incendiées, un
groupe mixte de Polonais et d’Italiens a provoqué le déraillement du train sur
la ligne Lens-Béthune, les appels et les pamphlets de propagande se sont
intensifiés et se sont étendus.
La participation de
Pientka dans la vie de l’organisation était gardée secrète. Le seul contact
avec lui était Claude. Devant ses amis français, pour la plupart des
Gaullistes, et devant des Polonais inconnus, Pientka lui-même continuait à
adopter une position passive et neutre. Un tel comportement s’est avéré très
fructueux, non seulement du point de vue de la conspiration, mais aussi en vue
de certains résultats pratiques substantiels.
Une fois, Pientka a
été invité par ses amis Gaullistes à assister à une réunion secrète où un major
de l’armée de l’air britannique allait prendre la parole. Il n’a pas souhaité
donner une réponse définitive avant d’avoir entendu nos conseils. Nous lui
avons conseillé de profiter de l’occasion pour apprendre d’une source de
première main l’opinion de l’Angleterre alliée sur le déroulement de la guerre,
que lui ou un Français préparé par lui devrait poser la question : quand
les Américains et les Anglais ont-ils l’intention d’ouvrir le deuxième front en
Europe occidentale ? De retenir le plus de détails possibles du discours
du Major et des interventions des personnes présentes ?
Le vieux communiste
revint de la réunion aussi révolté que décidé à prendre une part toujours plus
active à la lutte. Ce qu’il avait vu et entendu était une découverte complète.
Une vingtaine de personnes y avaient participé. La plupart des artisans, rien
que des connaissances. Pas un seul mineur. Un policier civil. Deux
fonctionnaires de la commune de Lens. Le major était grand, blanc, avec un
visage rose, pas du tout comme nos clandestins pâles et maigres. Il leur a
distribué des cigarettes et du chocolat. L’hôtesse, propriétaire d’un grand
magasin colonial, leur a offert du café et des biscuits. Il semble que le major
se cachait dans son domicile. La chose principale, la chose la plus importante,
a dit l’orateur quelque part au milieu de son discours. Il s’interrompit et
demanda : « Ici, nous sommes des nôtres, des Gaullistes, il n’y a pas
de communistes, n’est-ce pas ? » Deux ou trois voix
s’élevèrent : « Nous nous connaissons tous... Parlez
librement. » Rassuré, le major changea de sujet. Il s’en est pris à
l’Union soviétique, qui, selon lui, voulait conquérir toute l’Europe. Et
qu’est-ce que cela voulait dire ? Et enfin il les prévint que dans
quelques jours on leur remettrait des armes. Il était interdit de les utiliser
sans leur permission. Ou plutôt, à l’insu de la gentille hôtesse, Madame
Durand. Elle savait, et ils auraient pu savoir, que les armes devaient être
utilisées principalement contre les communistes, qui s’apprêtaient à faire
passer un joug rouge sur la France. Ils avaient déjà élaboré des plans sur la
façon de prendre le pouvoir et avaient des listes de personnes à tuer. Certains
des noms des personnes présentes ont dû y figurer.
Ils sont tous partis
en silence. Même l’agent n’était pas joyeux. Seul un gentil sourire fleurit sur
le visage de l’hôtesse...
— Tu ne lui as
pas posé de questions sur le deuxième front ?
— C’était
inutile...
Le patriote Pientka,
dégoûté par le cynisme du major, a émis à juste titre tous les jurons polonais
salés possibles dans sa langue maternelle. La rage anticommuniste du major
anglais sans nom a vraiment dépassé les limites de la tolérance. Ses paroles
précèdent ce que le premier ministre britannique Winston Churchill lui-même
témoignera en mars 1945, à savoir : « La Russie soviétique est
devenue un danger mortel pour le monde libre. » Un peu plus tard, mais
toujours avant la fin de la guerre, au moment où des centaines de milliers
d’hitlériens se rendaient et lorsque les rues de Londres et d’autres villes
étaient inondées de gens en liesse, à ce moment-là, Churchill lui-même
admit : « J’ai envoyé un télégramme à Montgomery (commandant en chef
des forces britanniques en Europe occidentale), dans lequel je lui ai demandé
de collecter et de stocker soigneusement les armes allemandes afin que nous
puissions ensuite les redistribuer facilement aux soldats allemands avec
lesquels nous aurions à coopérer si l’avance soviétique se poursuivait. »
La rencontre avec le
major nous a convaincus de la perfidie, de la trahison et des plans infernaux
des dirigeants anglais. Mais nous n’avons pas refusé les armes. Pientka les
accepta, les cacha soigneusement à deux ou trois endroits et les mit à notre
disposition. Elles furent bientôt utilisées contre ceux qui le méritaient — les
occupants.
« NON KAPUTT ! VOLGA, VOLGA, MAT RADNAIA ![91] »
Dans le nord de la
France, il y avait de nombreux camps de prisonniers soviétiques. Dans la
plupart des cas, les prisonniers étaient contraints de languir dans de vieilles
baraques basses, dans des locaux d’usine abandonnés, dans des écoles et des
casernes délibérément vidées. Nous considérions la masse des prisonniers comme
une force antihitlérienne temporairement enchaînée et potentielle. La jeune et
mince femme polonaise Irena-Wanda, chargée d’établir une connexion avec l’un
des camps, s’est rendue en vain dans plus d’une douzaine de localités. Elle
parlait assez correctement l’allemand et le français, mais malheureusement elle
ne connaissait presque pas un seul mot de russe. Sous divers prétextes, elle
avait pris un risque et s’était infiltrée dans deux ou trois camps. Dès qu’elle
parlait, les internés lui répondaient avec une suspicion hostile ou avec des
plaisanteries masculines. À son avis, seuls ceux qui connaissent le russe
pouvaient compter sur un succès. Ses impressions étaient bonnes, aucun doute
que nous croiserions des hommes prêts à se battre à nouveau. Lorsqu’on lui a
demandé sur lequel des camps nous devrions concentrer nos efforts, elle a
recommandé le camp de la ville de Lens.
Pientka, Claude,
Mariana et moi étions confrontés à la question de savoir comment trouver une
personne connaissant le russe et apte à la mission. L’impuissance était
inscrite sur le visage de mes principaux associés. J’étais silencieux. La tâche
était dangereuse, mais tellement importante. Il fallait à tout prix atteindre
les hommes soviétiques, leur prêter main-forte, les arracher aux griffes de
l’ennemi. Changer leur destin valait le sacrifice. Face à une épreuve, ma
conscience a fait son choix. J’ai rompu le silence.
- Je connais le
russe, ou plutôt je peux me comprendre avec les Russes.
Curiosité :
Pientka, Mariana et Claude ont été surpris que je connaisse la langue de
Tolstoï, mais ont accepté sans surprise ma volonté d’accomplir la tâche
moi-même. Ils ont probablement raisonné comme mon ami Vlado, qui voulait que
les cadres participent également aux actions.
Irena-Wanda et moi
avons élaboré un certain plan : examiner le camp de l’extérieur, suivre
les sorties et les entrées, savoir à quelle heure de la journée il y a le plus
de prisonniers dans la cour et quand leur garde est la plus faible. Pendant une
semaine, tantôt en binôme, tantôt individuellement, nous sommes passés devant
l’entrée principale et nous avons contourné le camp. C’était une caserne avec
une large cour, un long bâtiment à plusieurs étages à droite et un certain
nombre de bâtiments bas à un étage à gauche et au fond de la cour. De hauts
murs de briques surmontés d’un treillis métallique d’un mètre entouraient les
bâtiments et la cour. L’entrée était la plus fréquentée le matin et à midi, lorsque
des camions de vivres et de soldats, des bus et des voitures pour le personnel
militaire et civil entraient et sortaient. Un matin sur deux à 7 heures, un
groupe d’environ 10 prisonniers partait avec trois chariots d’ambulance. Ils
étaient accompagnés de trois soldats allemands. Ils se dirigeaient tous vers
l’abattoir local, qui se trouvait à une douzaine de rues de la caserne. Là, ils
attendaient environ une heure pour que la viande soit pesée et chargée. Ils
revenaient exactement par les mêmes rues. Les gardes ne permettaient à personne
de parler aux prisonniers, mais ils toléraient que des femmes leur donnent des
cigarettes, des saucisses, des œufs, des fruits. Irena-Wanda et moi avons
longuement discuté de la manière d’établir un contact avec ce groupe. Nous
avons été attristés de constater qu’il était presque impossible de leur parler
pendant au moins 5 à 10 minutes. Alors, au vu de nos observations, nous avons
décidé d’entrer dans le camp à 4 heures de l’après-midi, alors que presque
aucun uniforme hitlérien n’était visible et qu’au même moment, la plupart des
prisonniers se promenaient dans la cour du camp.
Il y a quelques
jours, notre brave camarade s’était présentée devant le garde de l’entrée
principale pour chercher le lieutenant Leissner, qu’elle avait inventé. Le
soldat lui expliqua qu’il ne connaissait pas un tel lieutenant, mais qu’il y
avait ici un lieutenant Arnold, qui aimait les jolies demoiselles, et qui la
recevrait avec plaisir. Ayant appris l’essentiel pour elle, Irena-Wanda remercia
le soldat bavard et continua son chemin.
Par un après-midi
ensoleillé, avec une bonne humeur volontairement rehaussée, nous nous sommes
présentés tous les deux à l’entrée principale. Vêtue d’un chemisier rose et
d’une jupe plissée grise, Irena-Wanda a annoncé dans un bel allemand que nous
allions voir le lieutenant Arnold. La sentinelle nous a poliment indiqué un des
locaux allemands où se trouvait le bureau de l’officier que nous recherchions.
En entrant dans la cour, ma première tâche fut de cacher le journal allemand
que j’avais volontairement placé dans la poche de ma veste bleu marine. J’ai
laissé entrer ma camarade dans le bureau, où elle devait tout faire pour rester
le plus longtemps possible. J’ai fait quelques pas devant les fenêtres de
l’immeuble à un étage et j’ai allumé une cigarette. Je quittai ma place et
m’approchai d’un groupe d’hommes soviétiques, tous vêtus de vieux pardessus
verts froissés. Je me suis dirigé vers ce groupe particulier parce qu’ils
étaient en quelque sorte séparés de la foule, parce qu’ils étaient jeunes et
parce que l’intuition m’a poussé vers eux. Décidant de risquer le tout pour le
tout, je leur ai tendu la boîte de cigarettes avec les mots :
« Allumez-en une… tavarishchi[92] ! »
Deux d’entre eux tendirent la main timidement, et les yeux de chacun
s’illuminèrent au mot « tavarishchi ».
Sans perdre une seconde, je poursuivis : « Je suis Bulgare. Avec les
partisans français, nous luttons contre l’occupant. Celui qui veut s’échapper,
nous l’aiderons. Si vous êtes d’accord, que l’un de vous soit dans le groupe de
la viande demain. Pendant que vous attendez, qu’il me passe un bout de
papier... Je suis communiste. »
Tout le monde a
tourné les yeux vers le gars le plus proche de moi avec un front ouvert, de
grands yeux bleus et des cheveux châtain clair. C’était comme s’ils lui
demandaient : « Qu’est-ce que tu en dis ? » Il tira une
longue bouffée ou deux de sa cigarette et, comme en réponse à ma question
tacite, marmonna : « Eh bien, quoi ? Il faut qu’on parle... On
ne peut pas décider... Il y a des anciens... On verra. Si quelque chose est
décidé, rencontre à l’urinoir de l’abattoir demain. Là on peut parler. »
Intérieurement
jubilatoire, j’ai dit « Harasho !
Dasvidania[93] »,
je leur ai donné le paquet de cigarettes et j’étais sur le point de m’éloigner,
quand j’ai entendu le jeune homme, soudainement presque transformé, avec de la
détermination et de la haine dans la voix, m’avertir :
— Tavarishch
ou provocateur, tu sais, nous sommes déterminés à tout. Nous ne voulons pas
vivre quand nos frères se battent et meurent.
Les mots tranchants
du jeune homme m’ont profondément secoué, je me suis contenté de ne prononcer
que la phrase russe :
— « Pajiviom – ouvidiem[94]! »
Étrange. J’ai rempli
ma mission en très peu de temps. Je ne savais pas quoi faire des minutes
restantes. Elles étaient peut-être cinq ou six, mais elles me semblaient une
éternité. J’ai fait les cent pas, regardant la cour et les gens. En groupes çà
et là, par paires ou par trois, assis ou marchant, la masse dense des captifs m’apparaissait
comme une vaste tache vert-gris mouvante. Et dans le tableau général – des
détails séparés : joueurs de dames, un autre dessine quelque chose sur le
sable avec un bâton et l’efface constamment, un troisième reprise, un quatrième
joue de l’ocarina et surtout – un silence un peu troublant... Les minutes
n’avançaient pas. L’un des membres du groupe à qui j’ai remis les cigarettes
s’est approché de moi en silence, s’est arrêté, m’a regardé d’un air
interrogateur, un sourire complice traversa mon visage qui le laissa
apparemment impassible, il alluma une cigarette et s’éloigna... Finalement, le
chemisier rose illumina le seuil. Nous avons immédiatement traversé la cour.
Irena-Wanda s’est excusée en polonais. « Je n’aurais pas pu m’attarder plus
longtemps. As-tu eu assez de temps ? » Je lui ai répondu dans sa
langue : « Tout va bien ! »
— Monsieur
Arnold est un homme merveilleux ! elle a parlé fort lorsque nous sommes
passés devant la sentinelle qui nous a fait le salut militaire.
Satisfaits, nous nous
sommes arrêtés au premier bistrot croisé en chemin, où nous avons eu notre
conversation. Elle s’est fait passer pour une dactylographe au chômage en
français et en allemand. Monsieur Arnold eut pitié d’elle et promit d’aider une
citoyenne de la ville « allemande » de Poznań, qu’il connaissait
et dont il aimait beaucoup l’opéra ; il demanderait à certains de ses
collègues et lui ferait savoir ses chances dans quelques jours.
— Vous
déciderez si je dois comparaître ou non.
— Nous
attendrons... Maintenant, il est plus important de mener à bien la mission
d’aujourd’hui.
Après avoir écouté
le récit du déroulement de ma rencontre, ravie, elle m’a fait part de son
optimisme, un peu en contradiction avec mon scepticisme. Je n’étais pas encore
tout à fait sûr de la réussite finale. La question s’est imposée à moi :
même s’ils sont d’accord, comment vont-ils s’évader ? C’était une question
à laquelle nous n’avions pas pensé.
Pientka et Claude ne
voyaient pas comment l’évasion s’accomplirait avec cette haute clôture surmontée
d’un treillis métallique et sous surveillance accrue la nuit. Quoi qu’il en
soit, ils se sont engagés à trouver un abri pour 20 fugitifs ; ils leur
fourniront des vêtements, des chaussures, de la nourriture, des armes, de
fausses cartes d’identité.
— Et
pourrons-nous trouver des gens pour les prendre en charge une fois qu’ils
auront franchi le mur ?
— C’est aussi
en notre pouvoir, m’encouragea Claude.
— On doit leur
poser comme condition que les candidats à l’évasion sachent faire du vélo. Ils
doivent immédiatement quitter Lens et nous les installerons dans les villages
miniers environnants de Sallaumines, Méricourt, Avion et autres — m’a conseillé
Pientka.
Je n’ai pas eu
d’objections ni exprimé de points de vue différents.
Le lendemain matin,
le gars avec le front ouvert était dans le groupe de la viande. Après avoir
échangé des regards, j’entrai dans l’urinoir de l’abattoir, qui se trouvait à
quelques pas de l’endroit où attendaient les prisonniers. Les urinoirs français
sont des cabines rondes en fer avec quatre compartiments à l’intérieur. Sans se
voir, les clients peuvent se parler. Le jeune homme me suivit et prit place à
côté de moi.
— Nous avons
décidé de prendre le risque. Nous sommes d’accord. Mais comment s’évader ?
Avez-vous un moyen ?
— Nous n’en
avons pas, mais nous vous soutiendrons. Vous devez essayer vous-même.
— Bien. Nous
avons réfléchi. Ce n’est pas difficile. La sentinelle de nuit dort souvent.
L’important est que vous nous accueilliez au-delà du mur, que vous nous
fournissiez des logements et des armes.
— Nous pouvons
accueillir 20 personnes. Il faut savoir faire du vélo. Ils seront cachés en
dehors de Lens.
— Quand
pensez-vous que nous devrions nous évader ?
— Cela dépend
de vous. Donnez-nous juste un préavis de deux jours.
— D’accord...
Nous voulons un revolver ou deux avant l’évasion. Au cas où.
— On verra...
Dans deux jours, de nouveau ici... Salutations à tous de la part des
francs-tireurs et partisans français...
Grande joie !
Mais encore plus de soucis et de responsabilités ! Et à ce moment-là — un
message de Paris pour faire rapport à la Commission des émigrés du CC du PCF.
Il me semblait indigne et contraire à l’éthique de m’écarter au milieu d’une
telle action. J’ai reporté mon départ.
Notre activité
fébrile ne tarda pas à produire ses résultats : en deux jours on trouva 15
bicyclettes, dix logements et cinq mineurs armés qui allaient soutenir,
conduire et loger les évadés.
Lors de la deuxième
rencontre dans l’urinoir, le garçon soviétique a souri pour la première fois.
C’était au moment où il prenait les pistolets, qu’il glissait sur sa poitrine
sous sa capote. Il a dit son nom — Volodia. J’ai donné le mien — Gaby.
— Nous
essaierons dans trois jours, vendredi soir. À une heure ! Êtes-vous
prêts ?
— Formidable !
— Nous avons une
demande : ne peut-on pas être plus de 20 personnes ?
— Malheureusement
non. Nous avons tout préparé pour 20 seulement. Je rappelle, ils doivent savoir
faire du vélo.
— Vous devez
nous attendre derrière le grand bâtiment. C’est l’endroit le plus pratique.
— Vous devez
jeter les manteaux et les casquettes.
— Entendu...
— Courage !
— Je répète,
vendredi soir à une heure.
L’événement
fatidique, attendu avec une émotion suprême, eut lieu le soir dit et à l’heure
dite. Volodia a été le premier à sauter par-dessus. Avec Claude, ils ont
commencé à attraper les « morceaux » suivants. Ceux qui descendaient
étaient immédiatement mis deux par deux sur des bicyclettes et dirigés en
dehors de la ville dans le noir. Mais peut-être que le dixième gars a chuchoté
à Volodia : « D’autres sont venus. » Volodia les a injuriés et
nous a demandé de retenir les camarades jusqu’à ce que nous soyons comptés. Les
« morceaux » se sont avérés être... 24. Après avoir insulté et menacé
les intrus, Volodia nous a demandé de les prendre également. Montés à deux, les
fugitifs s’enfoncèrent rapidement dans les rues sombres de Lens en direction
des villages miniers environnants de Liévin, Avion, Sallaumines, etc.
Je pouvais aller à
Paris ! Mon humeur était plus que bonne. La voix de mon sang slave se
mêlait au sentiment d’un devoir communiste accompli.
J’ai d’abord été
entendu par le secrétaire de la Commission, Bruno, avec lequel nous nous sommes
rencontrés pour la deuxième fois dans la ville de Marly-le-Roi, près de Paris.
Il m’a félicité pour la première action de libération de prisonniers
soviétiques en France. J’ai été surpris par sa générosité. Extrêmement modeste
dans la vie, il s’opposait chaque fois qu’il devait autoriser une somme plus
importante. Maintenant, il avait lui-même proposé :
— Nous
donnerons sans compter autant d’argent que nécessaire. Vous devez acheter à
tous des costumes, des chaussures, des pardessus, des sous-vêtements. Bien sûr,
différents. En un mot, tout ce dont vous avez besoin. Je ne parle pas de la
nourriture. Les mineurs polonais seront généreux pour les héberger au mieux.
Lorsque tu reviendras vers eux, tu dois les familiariser obligatoirement avec
la situation politique et avec la Résistance française...
Le même jour, une
réunion de la Commission pour le travail parmi les émigrés du CC du PCF a eu
lieu dans la maison du couple hospitalier Dora et Boris Kazakov. Yves — Henri
Rol-Tanguy, Bruno, Irène, Fernand, Olivier et Gaby étaient présents. (Le
camarade tchèque Louis, responsable de la technique, a été capturé dans l’une
des banlieues lors d’une rencontre avec son homologue français.) Le point
central de mon rapport était évidemment l’évasion des prisonniers soviétiques.
Yves a souligné la grande portée politique de cette action inédite. Ravis de
cette réussite, les camarades de la commission n’ont cependant pas oublié de
critiquer ma participation personnelle. Olivier était le plus assidu. Il m’a
accusé d’une « tendance nationale à mettre les membres de la direction en
danger ». Il a suggéré que je sois puni par un blâme, mais personne ne l’a
soutenu. Dans une brève analyse de l’action d’évasion, Bruno a noté la grande
responsabilité de maintenir le peuple soviétique en vie à tout prix. Nous
décidâmes d’un commun accord : que les fugitifs soient transférés du Nord
vers l’Est de la France au plus tôt ; que le Bessarabien russophone
Gilbert se rende à Lens et organise le transfert ; que Mariana soit nommée
responsable politique des émigrés dans l’Est de la France, sa place étant prise
par Margarita, la Polonaise ; que Gaby se voie accorder une somme
suffisante pour acheter tout le nécessaire et subvenir aux frais du départ des
captifs.
Jusqu’ici tout
allait bien, même très bien — malgré les remarques que les amis ont faites à
mon sujet.
La secrétaire
Danielle habitait dans les logements ouvriers de la rue Alphonse Karr dans le
19e arrondissement. Avec sa mère Teresa, ils occupaient un petit appartement de
deux pièces. Madame Tibble travaillait comme serveuse et participait à la
Résistance. J’ai passé des jours et des nuits dans leur logement à lire les
notes et rapports accumulés des 9 régions du territoire occupé, à rédiger des
instructions et à répondre aux questions, à dicter mon propre rapport sur
l’activité trimestrielle des groupes de combat étrangers. Danielle, 17 ans, ne
s’est jamais plainte de travailler 10 à 12 heures par jour. Elle a
consciencieusement copié et corrigé les manuscrits. Dès qu’il le fallait, elle
sortait chercher du matériel auprès des secrétaires d’Yves, Bruno, Irène et
Fernand.
Un jour, la petite
Tibble est revenue en retard et visiblement inquiète. Au début, elle a refusé
d’admettre son embarras, mais après quelques hésitations, elle m’a répété ce
que Lily, l’agent de contact d’Irène, lui avait dit : il y avait eu de
nombreuses arrestations de nos combattants ; elle, Danielle, surveillait
chaque fois qu’elle sortait et rentrait à la maison; il était souhaitable
qu’elle change de logement actuel et qu’elle change souvent de tenue.
— En plus, Lily
m’a dit de te donner l’ordre d’Irène de retourner à la campagne au plus tôt.
Là-bas d’attendre les ordres de la direction... Tu es mon chef. Avant de
partir, j’attends que tu me dises ce qui va m’arriver...
La réussite dans la
vie rend une personne meilleure, plus heureuse. C’est normal. L’inverse m’est
arrivé. Le cœur tremblant, j’ai prévu que peut-être un jour, quelque part, il y
aurait un échec dans l’organisation, mais quand j’ai appris cet échec, j’ai été
choqué. Eh bien, je connaissais de nombreux combattants, nous étions liés par
des sentiments et des pensées communes, certains d’entre eux étaient proches de
moi comme des frères et des fils. La peine envers eux ne m’a pas brisé. À cette
heure-là, le sens des responsabilités prévalait. Les victimes criaient que l’on
sauve les vivants, que l’on continue la lutte, et non seulement pour les
venger, mais aussi pour que notre idéal commun triomphe.
J’ai pris des
précautions rapides. Des rencontres étaient prévues à Paris avec les chefs de
régions, je ai reporté et transféré à la campagne, principalement dans la ville
de Lyon. J’ai écourté mon séjour dans la capitale. J’ai changé de vêtements.
J’ai dit à Danielle, qui m’a assuré qu’elle n’avait rien remarqué de suspect
autour de son logement, de minimiser ses rendez-vous, d’inventer une autre
coupe de cheveux, de changer d’apparence et de surveiller son appartement. Le
cinéma que je lui avais promis est tombé à l’eau.
Dans Lens j’ai
trouvé Gilbert. De petite taille, mince, vêtu d’un costume de drap gris
ordinaire, il n’aurait pas fait forte impression autour de lui si ce n’était
son visage. Environ deux mois plus tôt, ce camarade dévoué avait été blessé
dans l’incendie du laboratoire d’explosifs. Son visage et un bras portaient des
marques de brûlures graves. Il a rendu visite aux gars soviétiques, leur a parlé,
leur a demandé qui avait besoin de quoi et a déjà fait quelques achats. Mariana
partit prendre ses fonctions dans l’Est de la France et pour y organiser
l’hébergement des futurs combattants soviétiques.
Claude, Pientka,
Margarita et Gaby, nous avons été confrontés à un sérieux problème :
approvisionner ou non en armes les camarades soviétiques ? Ils ont voulu
avec insistance et à plusieurs reprises être armés, brûlant du désir de
rejoindre immédiatement les rangs de la Résistance. Ils avaient également
besoin d’armes pour se défendre, car ils étaient déterminés à ne pas tomber
vivants entre les mains des hitlériens.
Après réflexion,
nous avons décidé de distribuer des armes à tous les fugitifs et leurs
compagnons en route vers les nouveaux abris. Il nous a semblé que nous avions
pris la bonne décision. Fondamentalement, la décision était correcte. Mais en
pratique, cela a conduit à certaines conséquences fatales.
Nous attendions des
courriers de l’Est de la France. Ils ont été retardés plus longtemps que la
période spécifiée — une semaine. Pendant ce temps, j’ai visité presque toutes
les villes minières où se cachaient les prisonniers évadés. Grâce au contact
avec les soldats de l’armée soviétique, j’ai vivement ressenti la grandeur
incommensurable du patriotisme soviétique. Les fugitifs jusqu’au dernier
frémissaient de prouver leur amour pour la patrie, leur volonté de se battre et
de mourir pour leur patrie soviétique loin d’elle. Mes entretiens sur la
situation du front de l’Est, la marche rapide et victorieuse de l’armée
soviétique sur tous les fronts, les luttes des combattants et partisans
français, yougoslaves et autres européens ont suscité un intérêt fébrile. Ils
m’ont bombardé de dizaines de questions. La plupart d’entre elles concernaient
le deuxième front : quand l’ouvriraient-ils ? Si les USA et la
Grande-Bretagne étaient des alliés sincères, n’arriveraient-ils pas à un moment
donné à s’entendre avec Hitler et à tourner les armes contre l’Union
soviétique ? Parfois, les conversations duraient jusqu’à minuit.
Tard dans la nuit,
dans la ville d’Hénin-Liétard, un groupe de quatre fugitifs
soviétiques et un mineur polonais ont dû déménager d’un appartement à un autre.
Ils se sont heurtés à deux sentinelles allemandes qui ont demandé leurs cartes
d’identité. Le Polonais présenta ses papiers et expliqua que ses collègues
venaient d’arriver à la mine, que leurs papiers étaient au commissariat.
L’une des
sentinelles a tenté de fouiller le « mineur » qui se tenait à côté de
lui. Avec un cri de « Attention », l’homme soviétique menacé a tiré à
bout portant et a tué l’une des sentinelles. Certains des camarades ont
renversé l’autre. Ils ont saisi les armes des hitlériens et se sont cachés dans
la famille des mineurs polonais. Peu de temps après, la police française et les
soldats allemands ont barricadé les routes de sortie et fouillé les habitations
des mineurs. Les combattants soviétiques ont conseillé à la famille polonaise
de quitter la maison et se sont réfugiés dans le grenier.
Le blocus a duré
toute la nuit. À 2 heures, les policiers ont frappé et ont crié d’ouvrir la
porte, mais n’ayant reçu aucune réponse, ils sont partis. Apparemment, le
danger était écarté. À l’aube, les policiers constatèrent que les efforts des
perquisitions n’avaient donné aucun résultat. Ils se souvinrent de la maison
fermée à clé et y retournèrent : un bâtiment gris enfumé d’un étage et
demi, avec des portes et des fenêtres sur deux côtés — l’un face à la rue,
l’autre face au jardin avec de grands arbres sans feuilles. Les policiers ont
de nouveau frappé à la porte d’entrée et ont attendu. Aucun son. Puis le
sous-lieutenant aux commandes a donné l’ordre d’entrer par effraction par la
porte et les fenêtres. À coups de crosse, ils ont brisé la porte en bois et les
vitres. Furtivement ils ont parcouru les pièces du rez-de-chaussée en fouillant
dans les meubles. Ils sont montés par l’escalier en colimaçon intérieur et ont
commencé à briser la porte du grenier. Il y eut des coups de feu à l’intérieur
et deux soldats dégringolèrent l’escalier. Découverts, les combattants
soviétiques n’avaient pas d’autre issue ni d’autre choix. Les Allemands se sont
répartis dans les pièces du rez-de-chaussée, à côté de la maison et derrière
les arbres. Après un certain temps, les assiégeants ont reçu des renforts. Ils
ont planté trois mitrailleuses dans les maisons voisines. Toute la ville
frissonnait. Les mineurs ne descendirent pas dans les mines de toute la
journée. Un officier hitlérien, agitant un drapeau blanc, s’approcha du jardin
et exhorta en russe les assiégés à se rendre. Par une fenêtre grande ouverte,
un chœur de réponses tonna :
— Vive
l’armée soviétique : Non
kaputt !
Les mitrailleuses
crépitaient, les balles sifflaient de toutes parts. Les encerclés épargnaient
les balles. Pour le plus grand plaisir des mineurs qui les observaient, leurs
tirs étaient souvent réussis.
Par intervalles, les
tirs des deux côtés s’intensifiaient parfois, puis s’atténuaient. Il commençait
à faire noir. Un espoir vacillant s’est allumé dans le cœur des mineurs :
sous le couvert de l’obscurité, et si les captifs réussissaient à franchir
l’encerclement hitlérien. Mais la soirée a réveillé la peur chez les
assaillants qu’ils pourraient laisser échapper leurs victimes. Vers 17 heures,
ils ont apporté un lance-flamme qui a craché du feu sur la maison. Les flammes
se sont rapidement et violemment propagées à tout le bâtiment. Les gens de la
mine se taisaient d’horreur. Et puis les sons de la chanson de liberté
« Volga, Volta, mat radnaia » ont retenti. Les condamnés ont chanté.
Les femmes, hommes et enfants rassemblés en groupes dans les rues avoisinantes
et aux fenêtres des maisons s’animèrent. La joie et la haine brillaient de
leurs yeux. Les hitlériens ont intensifié leur feu sur la maison en flammes. Le
bruit de leurs coups de feu n’a pas étouffé l’autre, la deuxième chanson, que
les héros soviétiques ont chantée de toutes leurs dernières forces :
« L’Internationale » !
Mariana et Gilbert
ont coordonné leurs actions et les captifs restants ont été rapidement
transférés dans l’est de la France. Divisés en trois groupes, les hommes
soviétiques ont procédé immédiatement à des actions de combat sous la direction
des Polonais Mariana et Joseph. Avec habileté militaire et passion bolchevique,
ils accomplissaient de véritables exploits de partisans : ils tiraient sur
des postes allemands devant des dépôts militaires et obtenaient d’importantes
quantités d’armes, de munitions et de vivres ; ils attaquaient des
compagnies hitlériennes et leur infligeaient de lourdes pertes ; ils bloquaient
les routes et attaquaient des caravanes entières de camions chargés de troupes
et de marchandises ennemies ; ils causaient des déraillements de trains
militaires ; en véritables vengeurs du peuple, ils exercèrent leur
revanche sur nombre de traîtres et de collaborateurs des oppresseurs nationaux.
Pendant trois mois,
les groupes de combat soviétiques dans l’est de la France sont devenus un
cauchemar de jour et de nuit pour l’ennemi. Le Haut Commandement hitlérien a
envoyé des unités militaires spéciales de Paris pour vaincre les terribles
partisans qui sont apparus — dans les environs des villes de Nancy, Dijon et
Montceau-les-Mines. Renforcés par les antifascistes italiens et soutenus par
les patriotes français et françaises, les groupes de combat de Stalingrad,
d’Octobre et de la Commune de Paris restaient insaisissables. Ils sont entrés
dans de véritables batailles militaires et en sont sortis indemnes. Jusqu’au
jour de la libération de la France, ils ont participé inlassablement et
irrévocablement dans les rangs de la Résistance française. Certains des
participants des groupes de combat sont morts. D’autres étaient heureux de voir
la victoire de leur grande patrie qui souffrait depuis si longtemps !
ON
LES NOMMAIT DES ÉTRANGERS. LES PROCÈS DES 23
Dans la première
moitié de février 1944 je suis retourné à Paris pour le travail. La capitale
était encore plus déserte et triste. Les uniformes verts étaient très présents
et donnaient « à la ville des lumières » une couleur de serpent. La
pénurie, la faim, la misère étaient à chaque pas. Les officiers hitlériens en
compagnie de leurs femmes (Brunhilde)
blondes et grandes étaient de plus en plus arrogants dans les lieux publics.
Dans les rues et boulevards, dans les cafés et restaurants ils parlaient haut,
riaient bruyamment et ricanaient en se moquant de certains français.
Dans ce Paris morose
un matin les murs se sont couverts de taches rouges – des affiches rouges
énormes, collées dans les rues, places, tunnels du métro. Par petits groupes
les passants s’arrêtaient devant, lisaient silencieusement et s’en allaient
encore plus silencieux. Certains soulevaient les épaules, d’autres souriaient
légèrement, mais tous voulaient dire secrètement : « Ces éditeurs de
Goebbels nous prennent pour des idiots ». Sur les affiches dans des cadres
en forme de médaillon – les portraits de dix combattants. Au milieu l’arménien
Georges Manouchian avec l’inscription : chef de bande, 56 attentats, 150
tués, 600 blessés ; à gauche Alfonso : espagnol rouge, 7
attentats ; à droite Rajman : juif polonais, 13 attentats. Là aussi
étaient mes autres connaissances : Boczov – chef dérailleur de trains, 20
attentats ; Fontanot – communiste italien, 12 attentats ; Thomas Elek
– 8 attentats ; Witchitz – 15 attentats ; Fingercwajg – 3 attentats,
6 déraillements ; Wajsbrot – 1 attentat, 3 déraillements ; Grzywacz –
2 attentats. Au-dessus des portraits – une grande inscription en lettres
blanches : « Des libérateurs ? » Et en dessous en lettres
rouges sur fond noir : « La libération ! Par l’armée du
crime ». Dans six carrés étaient placées des photos de trois trains
détruits, deux hitlériens tués, de pistolets, de bombes, de mèches et autres.
Je me suis arrêté la
première fois devant l’affiche sur l’avenue Clichy près de la station La Fourche
et j’ai continué rapidement mon chemin. Je m’avançais sur l’asphalte, mais il
me semblait que je marchais sur des pierres incandescentes. Je me pressais,
comme si quelqu’un me poursuivait. Ma propre image sur l’affiche me
pourchassait, elle n’était pas là, mais je l’imaginais clairement, en plein
centre, si j’avais été pris par la Gestapo. J’étais bien le dirigeant de tous
ces combattants, ensemble nous avons réfléchi, et organisé des dizaines
d’actions, ensemble nous avons éprouvé les soucis, peines et joies de la
lutte ! Je les remerciai presque à haute voix, de ne pas m’avoir dénoncé
durant les 3 mois de tortures inhumaines dans l’enfer des prisons de la
Gestapo. Pour la deuxième fois quelque chose m’attirait vers l’affiche de la
place Clichy. Des sentiments de souffrance et d’admiration me clouaient devant
les images des héros et je restai longtemps sur le trottoir.
Les 17 et 18 février
le procès des 23 francs-tireurs et partisans de la région parisienne eut lieu.
Le pouvoir hitlérien, qui jusque-là tuait des centaines et des milliers de
patriotes sans tribunal et condamnation, décida de tenir un procès public. Le
but était d’humilier et de défigurer le vrai personnage de la Résistance, de
montrer le mouvement de la Résistance dirigé par des étrangers, et les
étrangers – incités par le sionisme mondial. La presse corrompue de l’époque
déploya des efforts surhumains pour tromper l’opinion publique. Les
gribouilleurs des journaux Le Matin, l’Œuvre, Paris-soir et autres, dans un
déni de la réalité, démolissaient jusqu’aux traits physiques des accusés. Les
physionomies claires et nobles du poète Manouchian, de l’ingénieur Boczov, du
jeune Rajman dans les descriptions journalistiques se transformaient en gueules
de bulldogs, en tronches de criminels endurcis, de bourreaux. Le gribouilleur
collabo Jean Lasser fit les portraits suivants : « Manouchian a un
visage basané, les pommettes sont hautes, mais à la hauteur des lèvres, la joue
est molle et basse, elle fait un pli comme en font les dogues ».
« Rajman semble échappé d’un roman russe. Échevelé, pâle jusqu’aux lèvres,
l’œil opalin, il n’est pas de notre temps, c’est le nihiliste d’autrefois, le
révolté de toujours ». « Spartaco Fontanot est abject ». Tandis
que dans la brochure « L’armée du crime » toutes ces images noires
étaient réunies, pour défigurer les emprisonnés : « Aucun n’est
d’origine française (pur mensonge, parmi les 23 il y avait des français de
souche : Roger Rouxel, Georges Cloarec — note de l’auteur). Leur tête est
hideuse. Le sadisme juif s’y étale dans l’œil torve, les oreilles en
chou-fleur, les lèvres épaisses et pendantes, la chevelure crépue et
filasse. » Dans cette même calomnie, pour Rajman, on peut lire :
« Voyez le juif Rajman, la main du crime, regardez la large mâchoire du
criminel, son regard dégénéré, d’où transpire le sadisme entier de la race
… ».
Des brochures, des
journaux, la radio, des tracts, des affiches vomissaient de la boue
diffamatoire sur les héros combattants étrangers. La grande affiche rouge, aux
dimensions de 3 mètres sur 4, était publiée aussi en petits tracts, sur le dos
desquels les auteurs essayaient en vain d’inciter les français à la haine
contre les combattants étrangers pour la liberté de la France : « Si
les français pillent, volent, sabotent et tuent, c’est parce qu’ils sont
toujours commandés par des étrangers ». Le point d’orgue de cette campagne
xénophobe haineuse était la projection du film documentaire honteux sur le
procès de 23 partisans.
Est-ce que la
propagande hitlérienne avec sa charge entière de sales attaques et
falsifications a obtenu l’effet souhaité ? Est-ce qu’ils ont réussi à
faire peur aux français, à leur suggérer une détestation des étrangers et à les
diviser dans leur élan de conquérir la libération de la France ? Pour
l’honneur du peuple français il faut le dire clairement – la propagande
hitlérienne est tombée à l’eau. Les patriotes français ont démontré leur
maturité politique et leur solidarité avec les étrangers arrêtés. Ils mettaient
des fleurs sous les affiches, épinglaient des drapeaux tricolores sur les
affiches ou avec colère déchiraient les papiers rouges détestés. Ainsi les
pouvoirs hitlériens et leurs serviteurs de Vichy récoltèrent une déception
totale pendant le procès lui-même.
Le procès se déroula
dans l’hôtel de luxe Continental rue de Castiglione, près de la place Vendôme.
La cour martiale était présidée par un colonel, aidé par deux officiers comme
jury. Des soldats allemands armés de mitraillettes restaient debout des deux
côtés de la salle près des murs. Six avocats allemands, officiellement imposés
aux accusés, se préparaient à jouer le rôle de défenseurs dans la parodie de
procès. Près de trente journalistes de Paris, de Province et d’Allemagne
aiguisaient leurs plumes, pour stigmatiser les « bêtes sauvages ».
Ils avaient la tâche ingrate de présenter les « terroristes » comme
des assassins et des ennemis de l’Allemagne, de la France et de la civilisation
et surtout de démontrer combien la justice hitlérienne était équitable.
Les aigles capturés
étaient introduits séparément avec les mains attachées dans le dos ou par deux
attachés avec des menottes métalliques. À l’avant : Manouchian – calme et
fier, Boczov — confiant et sans peur, Rajman — souriant et dur, Alfonso —
courageux et presque joyeux, Fontanot – avec un cœur brave, constant, Elek –
innocent, pur, mais si confiant… Et oui, ils étaient pâles, asséchés, amaigris,
avec des habits froissés, mais pouvait-il en être autrement après trois mois de
tortures dans les cellules de la Gestapo ? Les photographes et opérateurs
allemands instruits expressément ont placé leurs appareils dans des angles
choisis, de telle manière que les filmés apparaissent comme des « bandits
sans scrupules » avec des visages bestiaux. Efforts vains !
L’ensemble de la campagne orchestrée n’a pas réussi à tromper le français
ordinaire. Avec une colère dans le cœur un journaliste de Vichy écrivit les
résultats d’une enquête, qu’il a réalisée avec des voisins de l’un des
accusés : « Dans la banlieue de Montreuil une de nos françaises m’a
dit qu’il n’apparaissait pas comme un mauvais garçon… Et voilà la
tragédie ! Comment en est-on arrivé à cette mauvaise habitude ?
Comment ces têtes, dignes seulement pour des investigations criminelles,
n’ont-elles pas dégoûté à aucun moment nos meilleurs français ? Quand vous
leur parlez de ces terroristes, ils remuent la tête. « Terroristes ?
– ils vont remarquer. – Vous allez vite pour les qualifier ». Et un
certain Pierre Mallo du journal Matin dans son désir d’éclipser le patriotisme
ardent des héros a écrit hypocritement : « Je cherche, je cherche
l’expression de mes impressions et j’arrive à une réponse : les accusés se
comportent comme des élèves coupables ! »
Des élèves
coupables, monsieur ? Vous étiez au procès et vous n’avez pas entendu
« l’élève coupable » Alfonso décrire les détails de l’assassinat du
Dr Ritter d’un ton tout à fait calme ?
Sous les coups de
ces déclarations directes et sincères les juges militaires s’embrouillaient,
étaient déconcertés. Le président commença par poser des questions stupides :
— Pourquoi
vous, qui êtes espagnol, vous luttez pour la libération de la France ?
Le menuisier Alfonso
lui donna une leçon de morale prolétaire :
— Même si je
suis espagnol, j’estime que chaque travailleur consciencieux, où qu’il se
trouve, doit protéger sa classe.
Un des juges cria
furieusement :
— Toi, Rajman,
tu es un assassin !
L’ouvrier tricoteur
lui répondit fièrement :
— Je me
considère comme un soldat et me considère toujours mobilisé.
À la question du
président pourquoi était-il entré dans les rangs des francs-tireurs et
partisans de Paris, Rajman, dont les parents étaient déportés dans les camps de
concentration en Allemagne, lui répondit ouvertement :
— Pour moi
c’était une question de vie ou de mort. Je ne voyais pas d’autre moyen de
lutter contre l’armée d’occupation.
Ce n’est pas par
hasard que ce jeune homme de 21 ans, encore de son vivant, avait mérité comme
surnom Tchapaev.
Georges –
Manouchian, commissaire militaire des FTP-MOI de Paris, se tenait comme un
digne chef des combattants arrêtés. Dans son ardent discours devant le tribunal
il défendit le droit des peuples oppressés de lutter contre les envahisseurs.
Devant les officiers et avocats hitlériens Manouchian déclara ouvertement et
honnêtement : « Je me suis engagé dans l’armée de libération et je
suis prêt à mourir comme soldat régulier de l’armée française de
libération. »
Spartaco Fontanot,
dont les deux frères Jacques et Nerone étaient déjà tombés dans la lutte
antifasciste, administra une raclée aux épouvantails hitlériens embarrassés
devant son idéalisme :
— J’apporte ma
vie en offrande, vive la France libérée et démocratique !
Le doux étudiant
Thomas Elek, du haut de ses 18 ans épanouis, a déclaré aux bourreaux intrigués,
que pour lui « la vie n’a pas de sens sans la liberté et c’est pour cela
que j’ai apporté mes forces dans les rangs des communistes parisiens. »
Le procès se déroula
de manière expéditive. Il ne dura que deux jours. Le tribunal hitlérien voulut
raccourcir son échec. Dans le discours final le président essaya de cacher la
honte judiciaire avec des phrases pompeuses. Avant de prononcer le jugement il
s’écria :
— Messieurs,
ce procès ne concerne pas seulement le destin de l’Allemagne, il concerne la
lutte de l’Europe pour sauver son histoire deux fois millénaire.
Quand il invita les
accusés à dire leurs dernières paroles, il resta sidéré du silence d’Alfonso.
Le fier travailleur espagnol antifasciste n’a pas daigné lui répondre car il
refuse d’utiliser ce droit suprême. Ses camarades ont utilisé leurs dernières
paroles pour déclarer encore une fois leur foi, qu’ils ont lutté en pleine
conscience et volontairement contre les occupants hitlériens, qu’ils ont
combattu pour une France libre et démocratique, qu’ils font partie de l’armée
Rouge victorieuse. Les voix puissantes de Manouchian et Boczov retentirent dans
la salle, en prédisant la disparition de la « race des seigneurs ».
Le 21 février au
matin les geôliers hitlériens distribuaient aux condamnés des feuilles de
papier blanc et des crayons. Dans les lettres d’adieu les combattants
révélèrent pour la dernière fois la splendeur de leurs nobles cœurs, pensées et
idéaux.
Voici des extraits
de quelques lettres :
M a n o u c h i a n :
« Je suis sûr
que le peuple français et tous les combattants de la Liberté sauront honorer
notre mémoire dignement. Au moment de mourir, je proclame que je n’ai aucune
haine contre le peuple allemand et qui que ce soit. Chacun aura ce qu’il
méritera comme châtiment et comme récompense… Je mourrai avec mes 23 camarades
tout à l’heure avec le courage et la sérénité d’un homme qui a la conscience
bien tranquille… Aujourd’hui il y a du soleil. C’est en regardant le soleil et
la belle nature que j’ai tant aimée que je dirai adieu à la vie et à vous tous
ma bien chère femme et mes bien chers amis. »
A l f o n s o :
« Je ne suis
qu’un soldat qui meurs pour la France… Je ne regrette pas mon passé, si je
pouvais le revivre, je serais encore le premier. »
R a j m a n :
« Ma chère
petite maman… excuse-moi de ne pas t’écrire plus longuement, mais nous sommes
tous tellement joyeux que cela m’est impossible quand je pense à la peine que
tu ressens… Je t’adore et Vive la Vie ! … Je vais être fusillé aujourd’hui
à 15 heures. Je ne regrette rien de ce que j’ai fait. Je suis tout à fait
tranquille et calme… Je suis réuni en ce moment avec trois de mes camarades
subissant le même sort que moi. Nous venons de recevoir un colis de la
Croix-Rouge et nous mangeons comme des gosses toutes les choses sucrées que
j’aime tant…»
S p a r t a c o – F
o n t a n o t :
« Ma mort n’est
pas un cas extraordinaire, il faut qu’elle n’étonne personne et que personne ne
me plaigne, car il en meurt tellement sur les fronts… et qu’il n’est pas
étonnant que moi, un soldat, je tombe aussi… J’écris ces quelques lignes d’une
main ferme et la mort ne me fait pas peur… Mes chers parents, je termine cette
courte lettre en vous embrassant bien fort et en vous criant courage. »
W i l l y S c h a p i r o :
« Les
trois derniers jours après ma condamnation, j’ai été avec deux jeunes Français
et j’ai appris à aimer la France davantage. Quel bon esprit ! … Ma
bien-aimée, élève notre enfant dans le même esprit. »
C e s a r e L u c c a r i n i :
« La plus
grande preuve d’amour, c’est de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Soyez aussi
courageux que moi. »
S z l a m a G r z y w a c z :
« Du courage,
du courage et encore du courage. De meilleurs lendemains ne sont pas
loin. »
S t a n i s l a s K u b a c k i :
« Jusqu’au
dernier moment, j’ai gardé mon sang froid et je suis fidèle à toute la famille
(lire : le parti — note de l’auteur)… Je meurs pour la liberté. »
T h o m a s E l e k :
(La lettre est
adressée à des amis, car ses parents étaient déportés)
« Je meurs,
mais je vous demande de vivre… Je vous écris cette lettre d’adieu pour vous
confirmer, si cela est vraiment nécessaire, que je n’avais que de bonnes
intentions… Vous ne devez pas vous attrister, mais être gais au contraire, car
pour vous viennent des lendemains qui chantent. »
Le parti communiste
français a donné une très haute estimation au procès et au comportement devant
le tribunal hitlérien des 23 partisans. Dans un large appel au peuple français
le parti montra toute la vérité sur le procès des 23. Dans l’appel il est
écrit :
« Ils ont voulu
montrer les détenus comme des automates, des exécuteurs aveugles d’ordres
incompris, comme des mercenaires. Mais devant les juges se sont dressés des
hommes courageux, qui n’ont pas eu peur ni des officiers – leurs bourreaux – ni
des mitraillettes pointées vers eux pendant le procès. Ils ont endossé la responsabilité
des actions menées par eux avec un grand esprit patriotique. Devant la salle
remplie de nazis allemands et de français ils ont déclaré leur amour de la
France, envers leurs patries oppressées, leur attachement aux libertés humaines
et leur haine envers les tyrans nazis. Avec leur comportement héroïque ils ont
gagné le respect des juges, ont mis en échec la campagne diffamatoire, menée
depuis des semaines, et ils ont rendu un grand service à la résistance
française, en révélant devant l’opinion publique le vrai visage des patriotes
combattants avec des armes contre l’ennemi.
Comme Garibaldi, qui
est venu lutter avec les français, et qui était l’objet d’attaques des plus
nauséabondes de la part des capitulards et des traîtres, de même les traîtres de
Vichy avec leurs maîtres boches condamnent les partisans immigrés. Mais le
peuple français a salué ces hommes courageux, qui n’ont pas hésité à sacrifier
leur jeunesse, pour que la France et le monde se débarrassent pour toujours de
la barbarie hitlérienne.
Honneur et gloire
aux combattants pour la libération de la patrie ! »
Justin Godart ancien
ministre et président du Comité d’aide et de défense des immigrés, a
écrit :
« … D’énormes
affiches montraient ces gens dans des caricatures répugnantes. Pas d’importance.
Reste ce qui suit :
Qu’ils savaient tuer
au nom d’une noble cause. C’est leur gloire.
Qu’ils sont parvenus
à mourir fièrement. C’est leur grandeur. »
Charles Tillon,
comme commandant en chef des Francs-tireurs et partisans français, rendit un dernier
hommage aux héros étrangers décédés, en écrivant les lignes suivantes :
« …Le peuple
français ressent une reconnaissance impérissable envers ses frères étrangers.
Dans son cœur il unit le souvenir de Fabien avec le souvenir de l’arménien
Manouchian, le souvenir de la roumaine Olga Bancic avec le souvenir de Danielle
Casanova… »
Le 21 février est le
jour où, chaque année, les patriotes français leur rendent hommage au cimetière
d’Ivry, à côté de Paris. Avec un discours et un temps de silence ils témoignent
de l’union dans la lutte et la mort sans différence de race et nation des
personnes, combattant pour la lumière sur la terre entière !
LA
BATAILLE POUR LA LIBERTÉ PREND UN NOUVEL ÉLAN
Sur le front de
l’Est, les troupes soviétiques ont infligé des coups étourdissants aux hordes
hitlériennes. Malgré tout son cynisme, la propagande de Goebbels ne pouvait
cacher la honteuse retraite « élastique » des
« invincibles » Teutons. La terre sacrée soviétique était presque
libérée. Les troupes soviétiques se sont approchées sans relâche des frontières
de la Roumanie, de l’Autriche, de la Pologne et de la Bulgarie. Peu importe les
efforts des dirigeants et des généraux d’Hitler pour essayer d’empêcher les
héros de Moscou, Leningrad, Stalingrad et Koursk de libérer l’Europe du joug
fasciste.
Dans cette ultime
étape du duel entre l’Allemagne hitlérienne et le pays des Soviets, les USA et
l’Angleterre ont décidé d’ouvrir le deuxième front tant promis. Le 6 juin 1944,
leurs troupes ont débarqué dans le Nord de la France, en Normandie. Aidés par
des unités militaires de la France Libre et des francs-tireurs et partisans
français, ils avançaient victorieusement sur le sol français. Une véritable
explosion patriotique a secoué toute la France. La population des villes et des
villages dans son ensemble s’est tournée vers une lutte déterminée contre les
oppresseurs et les traîtres nationaux. La panique s’est emparée des occupants
et de leurs collaborateurs.
Le jour même du
débarquement, le Comité central du Parti communiste français incite :
« Les Français doivent par tous les moyens intensifier la lutte contre
l’ennemi, et pendant que les troupes alliées débarquent sur le sol français, le
peuple français par la lutte et dans la lutte doit se préparer au soulèvement
populaire ».
La bataille pour la
France prend un nouvel élan. Dans le Nord et l’Est de la France, dans le Massif
central, dans les départements de la
Corrèze, du Lot, de la Creuse, de la Drôme, de l’Ardèche et ailleurs,
les forces patriotiques déployaient de puissantes attaques partisanes,
sabotages, grèves et manifestations de masse, libéraient villes et villages.
L’ennemi était en
rage. Dans son impuissance et le pressentiment d’une fin catastrophique, il a
cherché le salut dans les assassinats de masse.
Le 8 juin, 99 otages
ont été pendus dans la ville de Tulle.
Le 10 juin, des
unités hitlériennes de la division du général Lammerding ont envahi en plein
jour le paisible village d’Oradour-sur-Glane, ont appelé les habitants de tous
âges sur la place avec une trompette, ont même soulevé les malades de leur lit,
ont entassé les hommes dans plusieurs boutiques, cafés, la boulangerie, ont
réuni les femmes et les enfants dans l’église. Des Schmeissers ont grondé et
tué les hommes. Les flammes ont englouti l’église, brûlant vifs des centaines
de femmes et d’enfants. Avant de battre en retraite, les tueurs ont incendié
tout le village. 634 Français et Françaises sont morts, vieillards et enfants,
mères avec bébés, jeunes femmes. Mais les traces de l’œuvre de Satan n’ont pas
été brûlées dans les cendres. Les ruines des maisons et de l’église rappellent
encore aujourd’hui que les barbares du siècle sont passés par là[95].
Le débarquement des
troupes alliées me trouva dans l’Est de la France. Là, avec le trio dirigeant
Mariana, Joseph et l’Italien Aldo, nous avons célébré la victoire très proche
et réfléchi à nos tactiques et tâches à venir. Nous avons particulièrement
insisté sur le fait que les camarades forment immédiatement des détachements de
milice populaire dans les mines, les entreprises, les villes et les villages.
Tous les patriotes français et antifascistes étrangers, quelle que soit leur
affiliation partisane, devaient être recrutés dans ces unités. Les armes
dissimulées disponibles ont été distribuées à de nombreux membres de la milice
populaire ; les autres se sont armés aux dépens de l’ennemi, tendant des
embuscades, se faufilant dans les armureries, attaquant par surprise et
désarmant des soldats et des officiers des forces d’occupation. Dans cette
partie de la France, les unités des partisans des anciens prisonniers
soviétiques ont joué un rôle de premier plan. Aux abords des mines de
Montceau-les-Mines, avec de nombreux partisans italiens, ils détenaient un
vaste territoire libéré.
Le 15 juin, Irène
m’appelle à Paris. La ville ne s’était pas beaucoup transformée. Elle gémissait
comme avant sous les bottes de l’occupant. De plus en plus de magasins et de
cafés étaient fermés. Les taxis étaient rares dans les rues. Les bicyclettes
constituaient le principal moyen de transport. Mais les Parisiens avaient
clairement changé. Ils se déplaçaient plus légèrement, souriaient plus
brillamment, regardaient plus audacieusement. Apparemment, les occupants
continuaient à se comporter avec insolence et arrogance. Et pourtant, ils ne savaient
pas toujours cacher leur angoisse devant l’issue tragique qui était si proche
d’eux. Ils se réunissaient de plus en plus souvent en groupe, de moins en moins
effrontés dans leur comportement, de plus en plus silencieux.
Le camarade Irène
m’a ordonné d’utiliser l’élan patriotique général et de concentrer mes efforts
dans la zone occupée, où nos milieux émigrés devaient entrer en masse dans la
milice populaire, s’armer de toutes les manières possibles et à tout prix,
immédiatement, jour et nuit, pour ne pas laisser en paix l’occupant et ses
collaborateurs.
J’ai contacté Yves,
qui était devenu le chef militaire des forces intérieures françaises en
Île-de-France, comprenant les départements de la Seine, Seine-et-Oise,
Seine-et-Marne, Oise, Aisne et une partie de la Somme.
Yves était
métallurgiste et Lapierre aussi. Tous deux étaient des hommes grands et
énergiques. L’un — Lapierre, au visage rond et sombre, avait les cheveux et les
yeux noirs charbon, l’autre — Yves, au visage légèrement allongé et aux cheveux
bruns peignés en douceur, regardait pensivement avec ses yeux marron clair. Les
deux impressionnaient par leur franchise, la simplicité dans leurs relations et
leur pensée politique pointue. Mais Yves, contrairement à Lapierre, se
distinguait par son ton calme et son caractère. Il savait écouter attentivement
son interlocuteur et exprimer son opinion après réflexion. Il faisait valoir
son point de vue avec la bonne intention de persuader et non de commander.
Lapierre, trop vif et agile, réagissait souvent spontanément. Plus d’une fois
il m’a dit :
— Je n’ai pas
besoin de t’expliquer longtemps. Tu comprends ce que je veux dire. L’important
est d’agir dès que la tâche est définie. L’heure n’est pas aux effusions
verbales.
Irène et Yves m’ont
transmis une mission : faire du 14 juillet — la fête
nationale de la France — une puissante action patriotique du peuple français.
Aux combattants et partisans organisés — français et étrangers – de se tenir à
la tête des manifestations de rue et de garder les manifestants avec leurs
armes.
Ma première tâche a
été de contacter les dirigeants des neuf régions du parti de la zone occupée de
France. J’ai tenu mes réunions dans différentes banlieues et villes autour de
Paris. Les secrétaires étrangers ont accepté la tâche avec enthousiasme —
transformer les manifestations de juillet de cette année en actions armées. Les
camarades du Nord et de l’Est de la France entendaient eux-mêmes appeler la
population à célébrer la fête nationale avec les groupes de combattants armés.
Les responsables de la Normandie ont expliqué que dans leur région, où des
batailles se livraient 24 heures sur 24 entre les troupes alliées et
hitlériennes, le 14 juillet ne pouvait pas avoir d’allure festive et qu’ils le
fêteraient sur le champ de bataille en multipliant les attaques armées contre
l’ennemi. Je me souviens de la Vendée, je n’ai contacté que le responsable
français. Je n’ai pas appelé le Bulgare Tsviatko Kiryakov, car je ne voulais
pas me révéler devant lui. D’ailleurs, le Français Jacques me décrivait la
situation de la Vendée en des termes assez pessimistes : la majorité de la
population était sous la forte influence de l’Église catholique, et nous-mêmes
n’étions pas en mesure de l’élever à une action plus audacieuse. À ma question,
pourquoi dans un tel cas nous ne devrions pas agir avec les catholiques, il a
répondu qu’ils essaieraient, mais il en doutait.
Je n’avais aucun
lien organisationnel avec les chefs directs des partisans étrangers à Paris à
cette époque. Je voyais Nikolai Zadgorski comme un ami. Après l’échec des 23,
il avait été recruté comme commissaire politique à l’état-major des combattants
émigrés de la région parisienne. Lors d’une réunion au café à l’angle du
boulevard Malesherbes et de la rue de la Pépinière, Nikolai, qui avait également
amené son amie Denise, nous expliqua à Mariana de l’Est de la France et à moi
ce que nous savions déjà : le 14 juillet à Paris, les groupes de
combattants français et des étrangers agiront ensemble.
Ce soir, nous étions
de bonne humeur. Nous pouvions voir la catastrophe imminente de l’occupant,
nous l’avions prédite et nous nous réjouissions de notre victoire. Nikolai, qui
imaginait clairement le risque que nous prenions avec la rencontre amicale non
autorisée, a plaisanté : « La victoire est à deux pas, mais cela peut
nous coûter cher. Si les supérieurs découvrent que nous nous réunissons pour
boire de la bière, ils nous chasseront du parti comme des gosses têtus et
frivoles. » La blague était sérieuse, mais n’était pas en situation de
perturber notre ton cordial. Mariana a suggéré que nous trinquions pour la
victoire et pour notre salut en tant que conspirateurs renégats ! Alors
nous l’avons fait.
La soirée s’est
vraiment passée à échanger des pensées, des blagues et... des rêves !
Nikolai et moi pensions que nous reviendrions bientôt dans notre patrie...
Les derniers jours
de juin et les premiers jours de juillet 1944 furent remplis d’actions
remarquables.
20 juin — Les
troupes alliées prennent la ville de Wallon.
26 juin — la
garnison hitlérienne du grand port français de Cherbourg se rend.
28 juin — Les
Français lisent dans les journaux et entendent sur Radio Londres qu’une grande
partie de Hambourg a été détruite par les bombes au phosphore britanniques.
28 juin — la main
des vengeurs du peuple a fermé à jamais la bouche du cynique agitateur
radiophonique Philippe Henriot, ministre de l’Information. Il a été assassiné
dans son propre bureau de la rue Solferino à Paris.
1er juillet — une
véritable manifestation de masse qui part de la rue Saint-Denis, longe le
boulevard Strasbourg et se termine au boulevard Magenta devant la gare de
l’Est. Deux groupes de combattants, armés de pistolets et de Schmeissers,
gardent les manifestants ; des jeunes lancent des tracts, lus avidement
par les milliers de manifestants et de spectateurs ; un orateur prend la
parole à l’angle de la rue Château d’Eau et s’adresse à la foule :
« Parisiens, cette manifestation a montré que malgré les boches et les
bandits de la milice vous êtes les maîtres des rues de Paris ! »
« LE
14 JUILLET — TOUS AUX ARMES ! »
C’est un cri, un
slogan, un appel du Front National pour la libération et l’indépendance de la
France ! Cet appel sera collé sur les murs, passé de main en main, déposé
dans des boîtes aux lettres, disséminé dans les rues et les cours. Parisiens et
Parisiennes y liront des mots enflammés :
« Pas un homme,
pas une femme, pas un jeune homme, pas un vieillard au travail, grève
générale ! »
« En ce jour
anniversaire de la prise de la Bastille, tout patriote doit, par tous les moyens,
en abattre un, un boche, un milicien, un traître ! Chaque patriote doit
participer aux manifestations devant les monuments aux morts, devant les
mairies, sur les grands axes routiers ! »
« Chaque
patriote doit agiter le drapeau tricolore, épingler sa cocarde sur sa
boutonnière, distribuer des milliers de tracts et de journaux !... »
« Au combat
avant le 14 juillet ! »
« Au combat le
14 juillet ! »
« Au combat
après le 14 juillet ! »
« Volontaires
de la liberté, comme en 1789, en marche et en avant ! »
« Au bout de la
lutte, c’est la victoire, comme à Valmy ! »
« La France sera libre, démocratique,
indépendante ! »
Les patriotes
entendirent et répondirent à cet appel de combat.
Voici des données
extraites de télégrammes originaux qui furent soumis par des agents impliqués
dans la Résistance. Le texte des télégrammes originaux a été rapporté par le Dr
Roger, chef du secteur Seine, La Seine et Oise du mouvement de résistance
Union :
« Dans le
faubourg de Gentilly dans la
nuit du 14 juillet, un grand ruban tricolore est tendu sur le Monument aux
morts, inscriptions de la lettre V (Victoire) sur les murs... À 11 heures, une
voiture Citroën s’arrête près de la mairie, deux personnes armées de
Schmeissers en descendent et déposent une couronne tricolore au pied du
Monument aux morts. Un des patriotes du perron de l’hôtel de ville fait un
discours à la foule assemblée, qui entame la Marseillaise. »
« Dans la
banlieue de Vitry, 500 à 600 personnes avec à leur tête un drapeau tricolore
déployé sont parties de l’atelier ferroviaire à 17 heures et se sont dirigées
vers le Monument aux morts. Ils sont accompagnés de voitures Citroën, dans
lesquelles on peut voir des ouvriers armés de pistolets et de
Schmeissers. »
« Dans la
banlieue d’Ivry, vers 9 h 30, des manifestants ont envahi la place devant la
mairie. Ils se dirigent vers le cimetière, où ils déposent des bouquets de
fleurs sur les tombes des partisans tombés. Quatre patriotes armés de
Schmeissers dans une voiture Renault protègent les manifestants. »
Et à Paris
même ?
« Dès 6 h 30
devant l’entrée des usines Gnome et Rhône sur le boulevard Kellermann, de
courageux orateurs travailleurs ont appelé la foule rassemblée à lutter contre
l’ennemi. »
« À 11 heures,
place de la Convention, un communiste brandit les mots d’ordre de la lutte
armée, parle de la victoire de l’Armée rouge, et termine par le mot
d’ordre : « Vive la France ! » La foule chante La Marseillaise et avec des drapeaux
déployés se dirige vers la mairie du 15e arrondissement et s’arrêtent devant le
Monument aux morts. Aux cris de « Vive la libération », les 900
manifestants se sont dispersés sans que personne ne les dérange. »
« Dans le 5e
arrondissement, le quartier des étudiants, environ 8 000 patriotes se sont
rassemblés sur la place Maubert et ont défilé vers la rue Mouffetard en
entonnant l’hymne La Marseillaise.
Des manifestations
similaires se sont déroulées tout au long de la journée dans différents
quartiers de Paris : le long de l’avenue Gobelin, autour des Halles, sur
la place de l’Étoile, à l’hôpital de la Salpêtrière, où malades et personnels
hospitaliers ont chanté la Marseillaise et où le drapeau tricolore flottait sur
le dôme du vieil hôpital.
Mais la
manifestation la plus impressionnante, la plus courageuse et la plus massive
s’est déroulée dans le quartier prolétarien de Belleville. Les gens sont
descendus dans les rues là-bas, déterminés à célébrer librement et vaillamment
leur fête nationale. Les cafés étaient bondés de gens qui trinquaient avec des
« Vive la France ! » De joyeux groupes dansaient sous le regard
des forces de l’ordre densément rassemblées, notamment autour du métro
Belleville. Des filles vêtues de bleu, de blanc et de rouge — les couleurs du
drapeau national — ont marché démonstrativement dans les rues. Les anciens combattants
étaient fiers de leurs croix de bravoure. Les jeunes portaient des cocardes à
l’effigie de Marianne, symbole de la France. Une agitation patriotique générale
régnait dans le quartier.
À 18 h précises, à
l’intersection de la rue Belleville et du boulevard Belleville, un groupe de
jeunes a agité un grand drapeau tricolore. Au même moment, des milliers de
tracts apparaissaient en l’air à partir de nombreux endroits de la place. Les
gens descendaient, attrapaient les tracts en l’air, les ramassaient du sol et
les lisaient avec voracité. Le drapeau est monté sur la rue Belleville et des
milliers d’hommes, de femmes et d’enfants l’ont suivi. La Marseillaise a explosé comme d’une seule voix. Sur les deux
trottoirs depuis les fenêtres des maisons des gens ravis applaudissaient. Des
partisans parisiens apparaissaient devant et sur les côtés de la manifestation
armés de pistolets, de Schmeissers et de bombes. Leur apparition n’a semé la
confusion et la peur ni chez les manifestants ni chez les observateurs. De nombreux
passants ou familiers des bistrots et des cafés se sont précipités pour
rejoindre la démonstration qui chantait vaillamment. Parmi les combattants
armés, j’ai reconnu nos étrangers : l’Italien Secondo et le jeune Polonais
Jean. Lorsque la colonne de tête a atteint l’intersection de la rue de
Tourtille, elle a fait face à des bus de la police qui barraient la route. Des
gendarmes à cheval et à pied leur nt donné l’ordre d’arrêter et de disperser la
manifestation. Deux policiers ont tenté d’atteindre les porteurs du drapeau et
de le leur enlever. Puis de fortes voix féminines ont scandé : « La
police avec nous ! La Po-li-ce avec nous ! » Puis un miracle
s’est produit. Les gendarmes ordinaires sont descendus des autobus et des chevaux
et ont refuser d’obéir à leurs supérieurs. Les chauffeurs ont monté les
voitures sur les trottoirs pour laisser passer les manifestants. La rue était
libre. Des cris se sont fait entendre : « Vive les policiers
patriotes ! » De nombreux gendarmes, au nez et à la barbe de leurs
supérieurs, se sont joints aux héroïques Bellevillois et, coude à coude avec
eux, ont manifesté leur patriotisme. Un gendarme jeune, blond, grand et mince a
débouclé sa ceinture et a demandé de remettre l’étui du pistolet à l’un des
combattants armés. Le combattant n’a pas accepté l’arme. Je l’ai entendu
dire : « Garde-le. Tu en auras besoin contre les boches ! »
L’enthousiasme du
peuple ne connaissait pas de bornes. La
Marseillaise et La Carmagnole ont
été chantées en même temps. Au coin de la rue Piat, un homme solide au visage
rouge, une casquette à la main, juché sur les épaules de deux ouvriers, éleva
la voix. Dans son bref discours enflammé, il a dénoncé les hitlériens, les
traîtres de Vichy et assuré le peuple momentanément silencieux : « Ce
14 juillet est le dernier que nous célébrons sous un joug étranger. Bientôt,
très bientôt, la France sera libre. Les jours de l’occupant et de ses
collaborateurs sont comptés. Vive la lutte des partisans et des
patriotes ! Vive la France libre et indépendante ! »
À pleins poumons et
à pleine gorge, la manifestation de 20 000 personnes a assourdi tout le
quartier de ses cris : « Vive la France ! »
La journée du 14
juillet 1944 à Paris s’est imposée aux yeux de tous les patriotes français
comme une journée de lutte ouverte contre les oppresseurs nationaux. Dans la
mémoire des témoins oculaires, elle restera comme une manifestation éclatante
de l’héroïsme traditionnel du peuple français. Et pour moi, ce sera à jamais
une journée inoubliable !
Du 14 juillet au 19
août — les jours de l’insurrection de Paris — il n’y avait qu’un pas. Les
événements se sont développés précipitamment. L’Armée rouge a libéré le
territoire national et a prêté main forte à nombre de peuples asservis par
l’hitlérisme, se dirigeant vers l’Elbe et Berlin. Les troupes américaines,
britanniques et françaises, avec l’aide de combattants et de partisans
français, ont libéré la Normandie et la Bretagne et ont avancé sur Paris.
D’autres troupes françaises sous le commandement du général de Lattre de
Tassigny avaient débarqué dans le sud de la France, libéré la Provence et pris
sans relâche ville après ville sur les routes de la capitale française. Des
généraux allemands ont déjà tenté d’assassiner Hitler. La tentative d’assassinat
a échoué. La tentative de putsch échoue également avec lui. Le général Von
Stülpnagel, commandant militaire de la France, et le maréchal Kluge, tous deux
impliqués dans le complot, se sont suicidés. Le comte von Scholtitz, qu’Hitler
chargea personnellement de la sinistre mission d’incendier et de détruire la
« ville lumière » fut nommé commandant de Paris. Les cinémas et
théâtres parisiens fermèrent leurs portes les uns après les autres. Le gaz et
l’électricité ne fonctionnaient que 2 à 3 heures par jour. De nombreuses lignes
de métro furent fermées et les autres fonctionnaient à un rythme ralenti. Les
rations alimentaires furent de nouveau considérablement réduites. Les
boucheries furent complètement vidées. Les légumes étaient rares. Les taxis
étaient introuvables. Les cyclistes n’étaient pas autorisés à sortir du
département de la Seine. Les journaux invitaient les Parisiens à partir à la
campagne, mais peu acceptaient l’invitation. Le couvre-feu commençait à partir
de 9 heures du soir jusqu’à 6 heures du matin... La Résistance s’intensifiait
en région parisienne et dans la capitale elle-même. Des dizaines d’occupants
furent abattus par la colère populaire grandissante. Les autorités allemandes
se vengeaient sur des patriotes français capturés par hasard en leur tirant
dessus dans la rue et en plaçant un carton sur leurs cadavres avec
l’inscription : « Ici, j’ai tué un soldat allemand. C’est pour cette
raison que j’ai été fusillé.» Le camarade Yves, devenu colonel Rol-Tanguy,
promulgue le 7 août l’ordre n° 3, par lequel « tous les patriotes doivent
se considérer mobilisés et intensifier leurs attaques contre l’ennemi pour
s’armer à ses dépens ». Le 10 août, le Conseil syndical d’Île-de-France
appelle les cheminots à déclarer la grève générale. Les trains s’arrêtent. Le
Comité de la police libre de Paris lance le mot d’ordre :
« Grève ! » Les gendarmes jettent leurs uniformes, mais pas
leurs revolvers. Le 17 août, le gouverneur militaire de la France, le général
Kitzinger, quitte Paris. Les officiers de la Gestapo Oberg et Knochen le
suivent. Le lendemain, les Parisiens lisent avec enthousiasme de grandes
affiches de mobilisation générale sur les murs. Les affiches sont signées par
le gouvernement provisoire de la France et par l’état-major des francs-tireurs
et partisans français. En vain, le commandant suprême de Paris, le général von
Scholtitz, publie des affiches similaires mais falsifiées, sur lesquelles ils
ont collé une bande de papier avec l’inscription : « Nous vous
prévenons. Pensez au sort de Paris ! » Les patriotes parisiens
déchirent les faux de von Scholtitz avec l’avertissement sinistre que Paris
sera miné et détruit.
Le 19 août, selon
l’ordre du chef de l’Insurrection de Paris, Rol-Tanguy, les unités combattantes
de la Résistance attaquent, assiègent et s’emparent des bureaux du
gouvernement, en premier lieu des ministères, des mairies et autres bâtiments
importants administratifs et publics. La mairie de Paris et la préfecture de
Paris arborent désormais des drapeaux nationaux tricolores.
L’insurrection de
Paris bat son plein !
Quelques jours
avant, Irène m’a appelé pour une réunion d’urgence. Son regard était aussi
mystérieux que joyeux. Sans plus tarder, il m’a dit :
— Cher Gaby,
nous voilà au bout de notre affaire. La tâche était de conduire le peuple à un
soulèvement. Maintenant c’est un fait accompli. Les masses ont leur mot à dire.
Elles ont pris les armes, descendent dans la rue, et il n’y a plus aucune
puissance qui puisse arrêter leur marche victorieuse... On te donne la banlieue
de Montreuil et ses environs. L’émigration italienne et espagnole y est
massive. Tu dirigeras la participation de la population des émigrés aux
événements proches... Quand se reverra-t-on ? Si nous survivons comme nous
l’avons fait jusqu’à présent, je fixe notre prochain rendez-vous au Comité
Central du Parti ! Tous les vivants s’y retrouveront... Souhaitons-nous la
vie et la santé !
Eh bien, alors que
nous nous promenions dans une rue déserte du faubourg de Bagnolet, Irène m’a
pris dans ses bras et m’a embrassé. Cette explosion de sentiments m’a beaucoup
surpris, car mon supérieur était d’une nature froide et rationnelle.
Me voici dans la
banlieue de Montreux. Que voir ? Là, les combattants communistes, soutenus
par des patriotes français et par de nombreux groupes de combat émigrés,
étaient descendus dans la rue et contrôlaient la circulation. Le 18 août, ils
ont capturé un camion allemand et deux soldats. Le même jour, ils ont tenté
d’arrêter un bus transportant deux militaires allemands. Les militaires, pistolets
dégainés, ont tenté de mettre pied à terre, mais une décharge de Schmeisser
d’un partisan prévoyant les a empêchés d’utiliser leurs armes. Et malgré cet
incident, la banlieue, qui pendant des dizaines d’années élisait Jacques Duclos
comme député du parlement, était relativement calme. Sa gloire sans tache de
faubourg « rouge » obligeait les hitlériens et les vichystes de le
contourner. Un jour avant le soulèvement dans la capitale, le drapeau national
flottait sur la commune, mais aucun ennemi n’avait osé l’enlever. La population
joyeusement excitée se rassemblait devant la mairie et saluait avec
enthousiasme la France libre face au drapeau tricolore fièrement agité.
L’état-major des
forces combattantes françaises et émigrées était logé dans un bâtiment bas sur
le côté gauche de la place devant le bâtiment municipal. L’étage supérieur
était occupé par des responsables du parti et de l’armée. Entre les combattants
français et étrangers, il y avait une union fraternelle, une parfaite harmonie.
La police municipale était à notre disposition. Il n’y avait pas d’unités ou
d’institutions militaires hitlériennes dans la banlieue. Toute notre activité
se concentrait sur la recherche et l’arrestation soit des vichystes déclarés,
soit des collaborateurs des autorités hitlériennes. Parmi les détenus
figuraient deux Italiens qui avaient dirigé des bureaux de recrutement pour
l’Allemagne. L’un — assez vieux, l’autre — jeune. Les deux - très bien habillés
avec des bagues aux doigts et des montres en or poignet. Terriblement effrayés,
ils se justifièrent de n’avoir forcé personne à partir, conseillant même à
certains de ne pas aller en Allemagne. Mes amis italiens les ont dénoncés comme
de méchants fascistes qui, en Italie, ont persécuté et torturé des dizaines de
fils du peuple. Ici en France, ils ont aussi livré des gars à nous à la
Gestapo.
Deux jours après
leur arrestation, j’ai reçu, à mon nom, Gaby, du nouveau commandant français du
département de la Seine, monsieur Lise, un ordre écrit de suspendre l’enquête
des deux Italiens et de les envoyer immédiatement au ministère de l’Intérieur
rue des Saussaies. Les camarades
italiens ont interprété l’ordre comme une manœuvre pour que les fascistes
capturés échappent à un juste châtiment. Une sorte de conflit s’éleva entre moi
et les camarades français, d’une part, et les responsables italiens, d’autre
part. Nous soutenions que c’était un ordre d’une autorité supérieure, et que
moi, à qui il était nommément adressé, je ne pouvais manquer de l’exécuter. Les
Italiens ne voulaient en aucun cas que les scélérats leur échappent.
Finalement, une issue a été trouvée en adoptant la tactique suivante : il
est maintenant 20 heures, j’ai été absent et je n’ai pas reçu l’ordre ; le
lendemain matin je recevrai l’ordre, je chercherai les personnes en question,
mais je ne les trouverai pas, et je m’excuserai auprès du commandant, le
colonel Liset.
Une de nos camarades
était tombée dans une situation presque désespérée. Un groupe armé français
arrêta une jeune Polonaise. Des voisins l’ont accusée d’être en bonnes
relations avec les officiers hitlériens, d’être au service de la Gestapo. Elle
réfutait les accusations en vain, ne provoquant que des rires lorsqu’elle
affirmait qu’elle était membre du parti, qu’elle avait accompli une tâche de
parti dans l’armée hitlérienne. Elle a dit qu’elle connaissait des camarades de
la direction des émigrés et a mentionné mon nom Gaby. J’ai demandé qu’on
l’amène, mais les camarades m’ont décrit la situation dans laquelle elle se
trouvait : les voisines françaises l’ont attaquée, l’ont rouée de coups et
d’insultes, et lui ont coupé les cheveux ; ils entouraient maintenant la
maison en criant et en exigeant qu’on la leur donne pour la lyncher.
Que s’est-il
avéré ? C’était bien notre magnifique Lily, la secrétaire d’Irène. Après
l’échec des 23, Irène la mit en contact avec le responsable de l’activité AMI,
et ainsi pendant plusieurs mois elle évolua au milieu des soldats et officiers
hitlériens. Il arrivait parfois qu’elle ne pût se débarrasser d’un jeune homme
plus arrogant, et il l’accompagnait jusqu’à chez elle. Les voisins l’ont
observée, ont noté à quelle fréquence la belle locataire changeait de petit ami
et en sont venus à la conclusion qu’elle était une femme légère au service de
la Gestapo.
Je me suis porté garant
de Lily, j’ai ordonné qu’on s’occupe d’elle, j’ai rassuré la misérable
elle-même et j’ai promis de lui rendre visite dans les prochains jours.
Je n’ai pas pu tenir
ma promesse. Le tourbillon des événements m’a saisi et m’a emporté au milieu de
l’insurrection de Paris.
Or, alors que la
France était au seuil de sa liberté, je pensais que nous, les Bulgares, devions
mener une action qui nous unirait aux luttes de notre peuple. À cet effet, j’ai
rencontré mes amis proches et combattants de la Résistance française, Vlado
Shtarbanov et Nikolai Zadgorski. La rencontre a eu lieu dans l’appartement de
la Française Marcella Géré, qui habitait rue de Viroflay n° 1 bis. Denise, la
petite amie de Nikolai, était également présente. Je leur ai présenté l’idée de
saisir la légation du gouvernement fasciste bulgare à Paris, d’expulser les
fonctionnaires royaux et d’y établir notre pouvoir, celui du peuple. Convaincus
que dans les prochains jours les drapeaux de la liberté flotteront sur toute la
Bulgarie, les camarades ont approuvé avec enthousiasme la proposition...
Vlado et moi nous
sommes mis à organiser l’attaque (Nikolai avait d’autres tâches urgentes à
accomplir). Sterbanov a fait venir Petar Avuski, un inter-brigadiste, et j’ai
persuadé mon ami cordonnier Stancho Blagoev d’être avec nous. Comme ils étaient
inconnus des fonctionnaires de la légation, nous avons envoyé Peter et Stancho
pour reconnaître la situation — si la légation fonctionnait, si ses gens
étaient armés et s’ils avaient pris des précautions. Ils nous ont
rapporté : la légation était fermée au public ; les fonctionnaires,
même le garde lui-même, ne venaient que de temps en temps ; aucune
sécurité n’est visible de l’extérieur.
Le 21 août, à huit
heures du matin, Vlado et moi avons quitté l’appartement de Marcella. Armés et
à bicyclette, nous avons dû traverser presque la moitié de Paris. À un autre
moment, flâner dans les rues de Paris aurait été un plaisir. Or la traversée
était un vrai passage entre les gouttes. Et des gouttes — ardentes. Très
souvent, des coups de pistolets, de fusils, de Schmeissers étaient entendus
soudainement et de sources inconnues. Des soldats hitlériens des camions et des
officiers des fenêtres des voitures tiraient avec et sans raison. Les feldgendarmes,
qui contrôlaient la circulation dans les rues, arrêtaient souvent les citoyens
et les fouillaient. Ce n’est que par miracle que nous nous sommes glissés à
travers une douzaine de postes. Nous avons fait du vélo et avons traversé une
ville hérissée où la mort rôdait à chaque coin de rue. Nous avons choisi des
rues petites et étroites, fait attention aux intersections bruyantes, et
finalement, à 9 heures, nous avons atteint le coin du boulevard Malesherbes et
de la rue de Monceau. Peter et Stancho nous attendaient sur un banc de la rue
devant un café. Ils ont confirmé à nouveau : la légation est fermée, ils
n’ont remarqué personne à l’intérieur. À ce moment-là, ce coin du 8e
arrondissement aristocratique était relativement calme. Le trafic routier était
faible, aucune voiture à moteur avec des Allemands armés ne passait, aucun feldgendarme
n’était visible.
La légation était
logée dans un grand bâtiment de pierre à l’angle de la rue de Vézelay et de la
rue de Monceau. Une seule des fenêtres de la rue de Vézelay avait des barreaux.
Nous avons décidé
d’agir... Vlado et moi avons sonné à la porte de l’entrée de la légation, rue
de Vézelay. Nous avons attendu et appuyé à nouveau sur le bouton de bronze.
Pause. Aucune réponse, personne. Nous sommes allés sonner à l’entrée principale
qui se trouvait rue de Monceau. Encore une fois aucun signe de vie. Nous nous
sommes tournés vers le portier pour qu’il nous donne une clé afin d’ouvrir la
porte. C’était un homme âgé, italien. Il a nié avoir la clé des portes de la
légation et nous a conseillés de ne pas recourir à la violence, car on ne
savait pas ce qui pourrait arriver, si les Allemands ne revenaient pas de
nouveau en maîtres. Nous lui avons répondu avec le bulgare « na kukuvden[96] »
et avons commencé à réfléchir à la façon de traiter la porte massive peinte en
vert foncé. Peter a proposé de casser une fenêtre du côté de la rue et de nous
ouvrir de l’intérieur. Nous ne voulions pas attirer l’attention des piétons en
brisant une fenêtre. Nous avons remarqué qu’au-dessus de la large et haute
porte principale, qui se trouvait dans la cour de la maison, il y avait une
fenêtre ronde. Notre plan d’action s’est imposé de lui-même. Je me tenais dos à
la porte. Peter Avuski est monté sur mes épaules. Aidé par Stancho et moi-même,
l’agile Vlado a grimpé. Puis aidé par Peter, il a brisé la vitre ronde avec la
crosse de son revolver. Il a dû bien nettoyer les restants de verre pour passer
sans se blesser.
Après que Vlado ait
ouvert la porte de l’intérieur, notre premier travail a été, revolvers à la
main, de fouiller les lieux à la recherche de toute personne cachée. Nous
n’avons pas trouvé âme qui vive, mais nous avons trouvé deux sacs de riz, de
farine, de sucre et d’autres denrées alimentaires en bas dans la cuisine. De
plus, dans l’un des couloirs, nous sommes tombés sur deux grandes caisses
remplies de thermomètres — preuve du marché noir dans lequel les diplomates
royaux étaient impliqués.
Nous avons décidé de
passer toute la journée dans les locaux occupés, et d’y passer également la
nuit. Les téléphones sonnaient. Au début nous avons répondu « Non, le
monsieur que vous cherchez n’est pas là », et après une heure ou deux avec
une confiance en soi accrue, nous avons annoncé : « Le Comité
antifasciste bulgare est là ! Que voulez-vous ? » La plupart du
temps, il y avait le silence à l’autre bout du fil.
Je connaissais le
numéro de téléphone d’un seul Bulgare — le tailleur Georgi Paskov. Nous
voulions le surprendre. Nous avons appelé :
— Bonjour
bonjour ! Citoyen Paskov ?
— Oui, au
téléphone.
— Avez-vous
caché des communistes et est-ce que vous et votre femme avez soutenu les
inter-brigadistes ?
— … ? …?
— Répondez.
Qu’est-ce qui vous fait flipper ? Nous vous demandons. Avez-vous des
prunes dans la bouche, et pourquoi êtes-vous silencieux ?
— ...Et moi...
qui sait... mais je pense que vous méritez un juron bulgare... Dis-moi, n’es-tu
pas Boris Milev, le déclamateur ? Et qu’est-ce qui t’a pris de plaisanter
alors que tout Paris s’enflamme ?...
— Ha, ha...
est-ce que tu as eu peur ?... Écoute maintenant, camarade Paskov. Le
comité antifasciste bulgare t’appelle, lui qui a occupé il y a deux heures les
locaux de la légation royale et établi l’autorité du Front patriotique.
Rappelle-toi, la date — 21 août 1944. Si tu as le courage, faufile-toi et viens
nous voir de tes propres yeux. Tu peux prendre ta femme Stella pour le courage.
Nous sommes ici avec Vlado Shtarbanov, Petar Avuski et Stancho Blagoev. Tu peux
annoncer la nouvelle aux autres Bulgares... Vive le pouvoir populaire !
Et en effet des amis
à nous, bulgares et français s’attroupaient. Nikolai Zadgorski et sa petite
amie Denise, la française Koké, Nikola Gaidadjiev et sa femme Germaine, la
famille Dora et Boris Kazakov, et bien sûr les deux Stella et Georges Paskov,
ont été parmi les premiers à nous embrasser et à être heureux pour nous. Les
femmes se sont empressées de chercher des produits et ont réussi à nous
proposer un déjeuner copieux et des boissons rares. Le déjeuner s’est déroulé
dans une très bonne humeur, accompagné des chansons « Jiv e toj, jiv e[97] »,
« L’Internationale » et « Da
jivej, jivej trudat[98] ».
Après avoir établi le nouveau pouvoir, nous nous sentions comme les maîtres
libres du territoire bulgare libéré.
Dehors, Paris était
en pleine bourrasque. Le tonnerre — proche et lointain — devenait de plus en
plus fréquent. Près de la légation, le long du boulevard Malesherbes, des rues
de Courcelles et des Batignolles, des camions, des voitures et des motos ont
commencé à passer, depuis et sur lesquels des coups de feu étaient tirés.
Nous nous tenions derrière
les portes solidement fermées et étions prêts à riposter avec notre faible
armement contre toute surprise. Le premier jour s’est bien passé, mais nous
n’étions pas détendus. Victorieux d’un petit bout de territoire, nous avons été
coupés de l’insurrection parisienne qui faisait rage. La joie de la tâche
limitée accomplie a été obscurcie dans le temps par le sentiment aigu de notre
isolement factuel de la ligne de feu.
Nous avons passé la
nuit debout et à réfléchir. Nous avons volontairement imposé une décision, qui
pour nous était un comportement naturel — le lendemain, contacter le comité
local des forces françaises de l’intérieur, demander des armes et un soutien
pour la défense de la légation contre une éventuelle attaque et rechercher et
capturer des Bulgares qui ont collaboré avec les occupants hitlériens.
Les combattants
français nous ont félicités de la bonne idée d’envahir la légation, nous ont
permis de prendre autant d’armes que nous en avions besoin, et nous ont fourni
des rubans rouges avec les lettres FFI, les initiales des forces françaises de
l’intérieur.
Nous avons laissé
Petar Avuski et Stancho Blagoev en poste à la légation, et nous trois — Vlado
Shtarbanov, Nikolai Gaidadjiev et moi — sommes allés « chasser ».
Armés de pistolets et de brassards rouges, nous sommes partis à pied vers l’une
des adresses indiquées. Le Bulgare X... vivait place Gustave-Toudouze dans le
9e arrondissement. Il avait fait du marché noir au profit des Allemands et
avait recruté de la main-d’œuvre pour l’Allemagne nazie. La route vers son
logement s’est avérée semée de nombreux dangers : escarmouches entre des
groupes de Français et d’Allemands, embuscades, perquisitions, rues interdites,
barricades... Nous avons atteint difficilement la place de l’Europe, carrefour
de nombreuses rues et un pont sur des dizaines de lignes de la gare
Saint-Lazare toute proche. Sur la place — des soldats armés de Schmeissers,
gardant le pont et les lignes, sur lesquelles aucun train ne passait. Nous nous
sommes aperçus que nous nous étions lancés dans des travaux qui nécessitaient
un temps plus calme, qu’il était trop tôt pour débarrasser Paris des
malfaiteurs avant que leurs maîtres d’hier n’aient été balayés. À la suggestion
de Vlado, nous avons retiré les rubans rouges de nos manches et sommes
lentement et prudemment retournés à notre base — notre territoire bulgare
libéré.
Peter et Stancho
nous ont informés : des combattants français sont venus chercher Gaby,
nous demandant d’envoyer nos gens soutenir les camarades du Comité central du
Parti communiste français ; le bâtiment du Comité central a été attaqué
par des fascistes et une bataille s’y livre maintenant.
La route vers le CC
du parti était longue et périlleuse.
Petar Avuski et moi
avons enfourché nos vélos pour y aller plus vite et découvrir quelle était la
situation sur la place Kossuth, où se trouvait le bâtiment du Comité central.
Avec difficulté, mais sans incident, nous sommes arrivés à la rue Lamartine
voisine, avons caché les vélos dans la cour d’une maison abandonnée et nous
nous sommes dirigés vers la place à pied. Il n’y avait pas de coups de feu à
proximité. La maison du parti était barricadée. Des sacs de sable étaient
empilés devant les portes et les fenêtres du rez-de-chaussée. Les pavés de la
place avaient été déterrés et entassés aux entrées des rues traversant la
place. Des ambulances renversées stationnaient çà et là avec la prétention
d’empêcher les camions ou chars ennemis de traverser la place. Des combattants
armés de Schmeissers étaient accroupis derrière des tas de pavés, de caisses et
de sacs de sable sur le trottoir devant le bâtiment du parti. Les canons des
fusils et des Schmeissers dépassaient des fenêtres des étages. Tout le bâtiment
était en état d’alerte.
Une grande question
s’est posée à nous — comment contacter les camarades ? Nous ne
connaissions personne et ils ne nous connaissaient pas, nous n’avions et ne
connaissions aucun mot de passe. Et nous devions apporter la preuve que nous
avions répondu à l’appel des défenseurs de la maison du parti.
Nous avons mis les
brassards rouges sur nos manches et nous nous sommes approchés de la place. Des
camarades armés nous ont arrêtés. Nous leur avons dit qui nous étions, d’où
nous venions et que nous étions venus au signal pour prêter assistance. J’ai ajouté
que j’étais membre de la MOI[99], que
j’ai été en contact avec les camarades Yves et Lapierre, qui me connaissaient,
et que je m’appelais Gaby.
Un jeune homme est
allé annoncer notre présence. Il revint bientôt et nous emmena à la maison du
Comité central. Dans la grande salle du parterre, il y avait 20 à 30 Français,
tous armés. Ils semblaient harassés par le manque de sommeil, mais ils étaient
de bonne humeur. Un ou deux groupes jouaient aux cartes. Des camarades armés de
pistolets montaient et descendaient les escaliers.
Nous avons été
introduits dans un bureau de taille moyenne et bien meublé. Stupéfait, j’ai vu
en face de moi... Lapierre. Juste un instant plus tard, nous nous étreignions
et nous embrassions comme de vieux compagnons d’armes. Il murmurait :
« Cher Gaby, cher Gaby ! » Je répétais à travers les
larmes : « Mon cher Lapierre. »
— C’est fini
avec Lapierre. Tu peux maintenant m’appeler Robert, Robert Ballanger. Je suis
chargé de protéger la maison du parti. Plus tard… nous verrons !
J’ai également
révélé mon vrai nom et lui ai expliqué pourquoi nous étions venus. Le grand
homme basané, crépitant de santé et de courage, m’a dit qu’ils avaient été
attaqués par des Allemands et des légionnaires, que la situation avait été
critique pendant un moment, mais qu’ils avaient repoussé les assaillants, reçu
des renforts, et que maintenant en ce moment tout était relativement calme. Il
nous a remerciés d’être prêts à venir à l’aide.
— Mais vous
pouvez nous aider non pas avec des combattants, mais avec autre chose. Vous
avez conquis la légation – très bien. Il doit y avoir des voitures de la
légation là-bas. J’ai désespérément besoin de voitures. Peux-tu en mettre deux
ou trois à ma disposition ?
— Nous n’avons
pas de clés et aucun de nous n’est chauffeur.
— Je vous
donnerai des camarades qui ouvriront les portes et savent conduire. Et puisque
tu es ici. On t’a donné une camarade française comme secrétaire. Elle est
dactylographe. Peux-tu me l’amener ici ? Je dois écrire des notes, donner
des ordres et informer la direction du parti toutes les heures sur la façon
dont les choses se passent ici. S’il te plaît, trouve-la et envoie-la-moi tout
de suite.
Bisous et câlins à
nouveau et nous nous sommes séparés.
À midi, deux des
voitures de la légation étaient déjà à la disposition du CC du PCF, et dans
l’après-midi la jeune fille Daniela, de son vrai nom Odette Tibble, tapait déjà
sous la dictée de Robert Ballanger.
Les affaires de la
légation se déroulaient normalement. Tout Bulgare antifasciste qui risquait de
traverser le Paris insurgé venait mettre le pied sur le territoire de la
Bulgarie nouvelle. De nombreuses femmes s’occupaient de l’alimentation des
hommes qui gardaient le bâtiment 24 heures sur 24.
Des camarades
italiens de Montreuil étaient venus me chercher. J’ai dû retourner à mon poste.
Nous avons convenu avec Vlado Shtarbanov qu’il me chercherait à Montreuil dès
que les circonstances exigeraient que je sois à la légation.
J’étais très attendu
à la banlieue. De nombreux étrangers, pour la plupart des Italiens, avaient été
arrêtés. Ils étaient principalement accusés d’avoir fait du marché noir en
faveur des occupants. Sans avoir de formation juridique, nous exercions trois
fonctions : enquêteur, procureur et juge. La situation des détenus était
difficile, mais la nôtre, surtout la mienne en tant que chef responsable,
n’était pas facile du tout. Les conditions nous obligeaient à prononcer
seulement deux sentences : mort ou libération. Et devant nous se
présentaient des cas qui méritaient un troisième verdict. Sous l’influence de
l’ambiance surchauffée des barricades parisiennes, mes « confrères »
enquêteurs, procureurs et magistrats ont raccourci les procédures et penché
davantage vers le verdict final. Non seulement par conscience, mais aussi par opportunisme
politique, j’ai rejeté souvent les mesures extrêmes proposées. J’ai accepté que
nous devions être stricts et impitoyables envers ces grands commerçants du
marché noir qui, en même temps, commettaient des trahisons, se pavanaient de
l’amitié des oppresseurs nationaux et menaient une propagande anti-française et
anti-communiste. Les agents de police, espions et provocateurs découverts ont
été à juste titre condamnés à de lourdes peines.
Je n’ai pas eu de
nouvelles de Vlado pendant deux jours entiers. Je croyais que tant qu’il n’y
avait pas de nouvelles, tout allait bien à la légation. Mais Denise Zadgorska
est arrivée avec l’ordre de me rendre rapidement chez les camarades bulgares.
Denise et moi avons traversé Paris à vélo. Ce n’était pas une balade à vélo, mais
un véritable dédale dans les rues et boulevards parisiens. Les patriotes
parisiens — hommes, femmes, jeunes et vieux, même des enfants — avaient jonché
la capitale de barricades et d’obstacles de toutes sortes. Nous étions obligés
de tourner souvent en rond, de revenir, d’attendre ici et là que les
grondements soudains s’éteignent, puis de continuer notre avancée. Je me
souviens, à la vue de ce Paris aux rues dépavées et aux barricades improvisées,
toutes hérissées, échevelées et armées, j’ai dit à la brave jeune
française :
— Les
événements qui secouent Paris sont historiques. Mais combien ressentent leur
importance ? Regarde de côté. Les gens de ce bistrot prennent
tranquillement l’apéritif, tandis que d’autres jouent à la belotte et aux
dames. Regarde ce jeune couple, ils s’embrassent et s’en foutent du sort de la
France !
Denise m’a
objecté :
— Ne sois pas
pessimiste. Peut-être que le gars rompt avec sa copine pour aller se battre sur
une barricade !
Hé, Denise, quel
pessimiste ! Maintenant, je vis l’un de mes jours les plus heureux.
J’enviais les Communards de se battre pour leur idéal dans les rues de Paris.
Je n’ai jamais supposé vivre jusqu’à l’âge de voir de mes propres yeux un
soulèvement parisien.
Quelques surprises
m’attendaient à la légation. J’ai été accueilli par des soldats soviétiques
dans les couloirs, les bureaux et en bas dans la cuisine. Georgi Radoulov et
Nikola Marinov les avaient amenés des environs de Paris, où ils avaient été
partisans ensemble pendant quelque temps dans les forêts. Pendant ces deux
jours, nos combattants et les combattants soviétiques ont attaqué des camions
et des unités allemands qui passaient devant le bâtiment de la légation. Ils
ont réussi à arrêter un camion, à désarmer et à capturer plus de vingt soldats hitlériens.
Vlado m’a informé qu’ils avaient appelé du quai d’Orsay — le ministère des
Affaires étrangères — ils voulaient que nous quittions la légation ;
l’agent de la préfecture de police, monsieur Jando, est venu en personne et a
prévenu que la responsabilité serait recherchée pour l’occupation illégale des
locaux d’un bâtiment d’État et pour le vol des voitures de la légation.
Nous avons consulté
les combattants soviétiques et nous nous sommes aussi consultés entre nous.
Nous avons unanimement décidé : tant que l’insurrection parisienne bat son
plein, de ne pas céder d’un cheveu aux positions que nous avons prises ;
si les messieurs de la préfecture continuent à faire pression, déclarons-leur
que nous sommes entrés de force dans la légation et n’en sortirons qu’en
combattant.
Je suis allé
m’enquérir de la situation dans la légation occupée par les patriotes
yougoslaves sur le boulevard Delessert. Là, sur un palier près de l’escalier,
se trouvait un canon de campagne. Il y avait deux mitrailleuses et une douzaine
de combattants armés dans le grand salon du rez-de-chaussée. La rencontre avec
le général inter-brigadiste Ilitch, avec lequel nous nous connaissions du camp
de concentration du Vernet et de notre travail commun dans la Résistance, a été
extrêmement cordiale. Après un bref échange de souvenirs de camarades
familiers, j’appris que le même monsieur Jando était venu également dans leur
légation.
— Quand nous
expulserons les hitlériens de France et de Yougoslavie, alors vous négocierez
avec Belgrade, pas avec moi, lui a dit Ilitch, qui un peu plus tard a été
officiellement autorisé à représenter le gouvernement de la Yougoslavie libre.
Les jours suivants,
les gens du quai d’Orsay et de la préfecture n’ont plus appelé. Il semble
qu’ils ont anticipé notre réponse, notre comportement.
Et les événements se
sont enchaînés. Les troupes françaises commandées par le général Leclerc
avançaient comme l’éclair vers Paris. Toute la capitale était sur le pied de
guerre. Les occupants la quittaient par vagues et par vagues en combattant. Les
plus fanatiques sont restés dans les bâtiments qu’ils occupaient : le
Sénat — dans le jardin du Luxembourg et la Caserne du Prince Eugène sur la
place de la République. De nouvelles forces arrivaient de la banlieue pour
soutenir les combattants parisiens.
Le 24 août, les
troupes du général Leclerc pénétrèrent dans le sud de Paris, presque libéré par
les patriotes. Ils ont aidé les hommes du colonel Pierre Georges-Fabien à
liquider la résistance désespérée des officiers hitlériens retranchés dans le
jardin et la cour du Sénat. À une heure tardive, à 30 kilomètres à la ronde,
les Parisiens ont entendu les sons assourdissants et solennels des cloches de
la cathédrale de Notre-Dame, annonçant la libération, la victoire. Des
Parisiens et des Parisiennes ont couvert de fleurs, de baisers et de câlins les
troupes alliées entrant triomphalement dans Paris.
Le 25 août, sur
ordre du colonel Rol-Tanguy, chef des armées françaises en Île-de-France, une
attaque générale est lancée contre tous les nids ennemis de la capitale,
notamment contre la caserne de la place de la République. L’ordre a été exécuté
rapidement et avec précision. Les combattants parisiens prennent d’assaut la
dernière forteresse hitlérienne.
Le commandant
militaire de Paris, le général von Scholtitz, déploie un drapeau blanc aux
fenêtres de l’hôtel Maurice de la rue de Rivoli et se rend à la gare
Montparnasse où, en présence du général Leclerc et du colonel Rol-Tanguy, il
signe la capitulation intégrale de la puissance occupante à Paris.
Le général de Gaulle
sur la place devant l’Hôtel de ville a félicité les braves et vaillants
Parisiens pour la victoire, qui, dans un enthousiasme délirant, ont applaudi à
tout rompre. À côté de lui, sur l’estrade, se tenait le métallurgiste colonel
Rol-Tanguy, le partisan et communiste Yves, le véritable libérateur de
Paris !
Le 26 août, la
capitale française libérée était en liesse. L’avenue des Champs-Elysées, les
Grands Boulevards, les places de la République, de la Bastille, de la Nation,
de l’Opéra — c’étaient des rivières et des lacs de gens éperdument ravis de
tous âges.
Dans les jours
suivants, nous avons raccompagné les combattants soviétiques comme des frères.
Ils ont rejoint leurs compatriotes qui avaient été libérés des camps de
prisonniers.
Nous avons terminé
la tâche abandonnée — nous avons arrêté et remis au poste de police en face de
la Banque Nationale monsieur X. Le lieutenant américain, qui y avait pris le
pouvoir, nous a remerciés de notre coopération. Il a promis d’enquêter sur l’affaire
avec la rigueur requise. Il nous a bien regardés, a vu sur nos manches le ruban
avec l’inscription FFI et nous a demandé : « Allez-vous amener
d’autres collaborateurs de l’occupant ? » Nous avons répondu :
« Nous avons de telles intentions. » Alors monsieur le lieutenant
s’est présenté à nous sous un jour différent :
— Vous ne
connaissez pas de communistes ? Des communistes membres du Parti
communiste français qui ont combattu dans la Résistance ? Nous sommes
intéressés par leurs noms, leurs adresses et ce qu’ils font maintenant. C’est
ce que nous attendons de vous. Conduisez-nous des collaborateurs des Allemands,
mais il est plus important de nous signaler les communistes du quartier. Je
serai très reconnaissant et je verrai comment je peux vous récompenser.
La surprise a été
terrible. Nous trois, avec Vlado Shtarbanov et Nikola Marinov, nous nous sommes
regardés et avons rapidement pris nos repères en déclarant :
— En ce moment,
nous cherchons les ennemis du peuple, nous ne connaissons aucun communiste.
Dehors, sur le
trottoir de la rue des Bons-Enfants, nous avons exprimé notre
indignation face au lieutenant cynique par des grossièretés bulgares répétées.
En direct, de nos yeux, nous avons rencontré la mission de
« libération » des alliés américains. Bien sûr, monsieur le
lieutenant et moi ne nous sommes plus revus.
Nous avons
transformé la légation en siège officiel du Comité antifasciste bulgare. Tous
les citoyens bulgares progressistes venaient sereinement dans ces locaux pour
se rencontrer pour du travail et discuter. Notre comité a commencé un travail
intensif. Des réunions fermées et ouvertes avaient lieu. Leur fréquentation
était massive. L’unité patriotique de la colonie bulgare a mûri dans ce climat
de liberté.
Nous avons accueilli
le nouveau gouvernement du Front patriotique dans notre pays le 9 septembre
avec une immense joie ! Nous avons immédiatement convoqué une assemblée
solennelle et de notre propre initiative, au nom de toutes les personnes
présentes, nous avons salué le nouveau pouvoir.
Nous avons renouvelé
l’organisation de masse interdite des Bulgares vivant en France, avec son
ancien nom « Amicale bulgare ». Dans le statut voté, nous avons
inséré un paragraphe soulignant le caractère antifasciste de l’organisation.
Dans un autre paragraphe, il était interdit d’accepter comme membres des
Bulgares qui avaient collaboré avec les occupants hitlériens.
Grâce à des
sacrifices privés et avec beaucoup d’enthousiasme, nous avons commencé, sous ma
direction éditoriale, à publier le journal Nouvelle Bulgarie en
français. Dans ses pages, nous avons défendu et popularisé la politique du
gouvernement du Front patriotique.
Avec l’autorisation
du parti, j’ai accepté l’offre de créer et de diriger la section d’émission en
bulgare de Radio Paris. Quand, au bout de trois ou quatre mois, la ligne
politique du gouvernement a commencé à manifester son caractère réactionnaire,
j’ai volontairement renoncé à cette fonction.
Par décision du CC
du Parti communiste français, j’ai été nommé secrétaire du nouveau Comité d’action et de
défense des immigrés (CADI).
Il réunissait tous les comités de libération, qui incluaient plus de trois
millions d’étrangers antifascistes. Son organe imprimé était l’hebdomadaire Unis.
Le 25 février 1945,
le premier Congrès des étrangers antifascistes en France a eu lieu à la Maison
de la Chimie, rue Saint-Dominique. Ce n’était pas seulement un congrès, mais
aussi la première réunion nationale de tous les émigrés qui ont pris une part
active à la Résistance française. Avant le début des réunions et pendant les
pauses, nous avons été témoins de scènes touchantes. Le plus souvent, les
délégués s’embrassaient chaleureusement et longuement, et à travers les rires
et la joie, leurs larmes coulaient. Beaucoup d’entre eux n’en croyaient pas leurs
yeux, car ils étaient sûrs que le camarade X ou Y avait été capturé, torturé,
fusillé, déporté, mort dans les chambres à gaz hitlériennes.
D’autres se sont
revus après une longue séparation de l’époque de la guerre civile espagnole et
ont appris qu’ils avaient participé à la Résistance sur le même front, mais
dans des secteurs différents. Tous se questionnaient sur le sort de
connaissances communes et se réjouissaient comme des enfants lorsqu’ils
apprenaient qu’ils s’étaient battus et avaient survécu sains et saufs.
Dans la salle,
décorée de drapeaux rouges et tricolores français, une ambiance festive vibrait
— intimiste, chaleureuse, conviviale. Les personnalités éminentes Justin Godart[100],
Emmanuel d’Astier[101],
Pierre Villon[102],
Florimond Bonte[103],
Paul Bastid[104]
ont pris place au Présidium du congrès. Entre eux et envers nous, les
combattants émigrés ils se sont comportés tout naturellement et librement. Le
Congrès, premier et manifestation imposante à l’échelle nationale, était
vraiment solennel, mais sa solennité n’était pas pompeuse et creuse ; il
respirait encore l’air des combats des partisans et rugissait avec l’écho des
décharges des Schmeissers. Les costumes modestes, les casquettes et les visages
pâles parfois mal rasés des 1 200 délégués ont donné à l’atmosphère générale
simplicité, chaleur humaine, sincérité.
Dans le silence qui
a suivi, le président Justin Godart m’a donné la parole pour présenter le
rapport sur la participation des étrangers au mouvement de la Résistance
française. Je me suis tenu sur la tribune, j’ai regardé dans la salle de
l’amphithéâtre, d’où des milliers d’yeux de camarades familiers et inconnus me
fixaient, et j’ai ressenti le grand honneur d’un Bulgare, et la lourde
responsabilité des paroles que j’étais sur le point de prononcer.
Intérieurement excité, j’ai commencé à lire.
FRÈRES
D’ARMES
« Après juin
1940, la France était enchaînée à l’occupation nazie et à la trahison de Vichy.
Un engourdissement général régnait dans le pays où, malgré tout, vivait
l’espoir.
Les émigrés se sont
rangés côte à côte avec les vrais patriotes français. Ils se sont lancés dans
la lutte à mains nues, mais le cœur débordant de courage et d’amour pour la
France, pour la liberté.
Quand la Résistance
devait diffuser des tracts, les émigrés n’ont jamais refusé.
Si des panneaux de
signalisation devaient être arrachés, les émigrés étaient toujours prêts ;
semer des pointes de fer sur les routes — les émigrés l’ont fait avec
enthousiasme ; effectuer un certain sabotage — les émigrés l’ont fait avec
persévérance et habileté.
Si les bureaux de
recrutement pour l’Allemagne devaient être détruits, les émigrés se portaient
volontaires.
Lorsque des tâches
difficiles étaient accomplies, les émigrés étaient partout avec leurs frères
français...
Il y avait une
organisation, il n’y avait pas d’armes. Et nous devions nous procurer des armes
à tout prix. Commencent alors les sorties nocturnes des combattants, qui
n’emportent que des couteaux de poche ou de cuisine, des marteaux de cordonnier
ou des ciseaux de tailleur...
Voici ce qu’a dit
Pierre Villon à cette occasion : « Je peux témoigner que vous, les
émigrés, avez été avec nous dès le début contre l’agresseur et que vous êtes
restés avec nous jusqu’à la fin ; je peux également témoigner que vous
étiez mains nues ; que vous avez été courageux et avez montré que la lutte
armée, ouverte et directe était possible malgré la présence de l’occupant armé
jusqu’aux dents, malgré la Gestapo et la police de Vichy. »
Les revolvers
capturés de l’ennemi ne suffisaient plus. Les actions de nos combattants se
multipliaient. Ils avaient besoin de bombes, de machines infernales, d’obus.
Ensuite, nous avons eu recours à... l’imagination. Je répète...
l’imagination ! Nous devions créer quelque chose à partir de rien. De
rien, d’un tuyau rouillé et décrépi, d’une boîte de conserve remplie de clous,
de vis, de boulons, de clés, de pierres au lieu de fer, une machine infernale
se créait...
Ainsi, une série
d’actions a pu être réalisée à l’aide de ces machines primitives, fabriquées
avec amour...
En 1942, l’hôtel
Alésia à Paris fut le premier à subir les terribles effets de ces bombes...
1943 a été une
période d’actions de grande ampleur. Les détachements des étrangers
rivalisaient entre eux.
Chaque jour une
compagnie passe dans la rue Monsieur le Prince. Chaque jour, elle chante fort
et avec fanfaronnade ouverte. Un beau jour deux bombes explosent au milieu de
la compagnie. La rue est jonchée de cadavres. Une vingtaine d’officiers de
l’aviation ne chanteront plus jamais. Deux heures plus tard, la radio suisse
diffusera la nouvelle dans le monde entier. Le lendemain, Londres et Moscou se
feront l’écho de l’exploit des partisans parisiens.
Les mêmes
combattants — Tommy et Paul, de leurs vrais noms Elek et Simo — renouvelleront
leur attaque contre les officiers nazis dans un restaurant de la banlieue
d’Asnières.
Le matin, la foule
se presse pour monter dans le métro Porte de Champerret. Dans les immeubles
voisins, les gens se réveillent à peine. Soudain, ils entendront une bombe
exploser, puis — des tirs de fusils et de Schmeissers. Il s’agit de la première
bombe larguée par le légendaire chef des combattants émigrés parisiens, Georges
Manouchian...
Chaque matin, un bus
emmène les soldats allemands de la Porte d’Italie à l’aéroport d’Orly. Mais un
matin, alors qu’il vient de partir, il est arrosé de grenades lancées par un
groupe italien. Il se renverse et prend feu... Pendant deux heures entières,
des ambulances emporteront morts et blessés. Emmené par leur chef Artur, le
groupe va s’offrir un coup dans le café d’en face.
De telles attaques
seront menées à toutes les sorties de Paris. L’ennemi mettra des barreaux de
fer aux fenêtres des hôtels, interdira aux Parisiens de marcher sur les
trottoirs, lui-même n’arpentera pas les mêmes rues. Les occupants marcheront au
moins trois par trois. Mais malgré ces mesures, rien ne peut arrêter le combat,
qui se poursuit sans relâche...
Le 23 février, des
combattants émigrés parisiens détruisent à la même minute les batteries
anti-aériennes des ponts de Saint-Cloud et de Passy. C’est ainsi que la France
en lutte fête les 25 ans de l’Armée rouge !...
Plus de cinq mille
actions d’importance différente sont inscrites au patrimoine des combattants
émigrés de la région parisienne.
Et dans les
campagnes, les émigrés sont au cœur de la lutte.
Dans l’Est de la
France, le célèbre détachement Stalingrad a soulevé un train après l’autre dans
les airs. Des groupes de la Gestapo de Paris le recherchent en vain. Le
détachement est insaisissable... et effrayant. Pas un seul Allemand ne sort
vivant de ces embuscades...
Dans la ville de
Toulouse, un train s’arrête en gare, chargé de matériel militaire et d’une
dizaine d’avions démontés. La nouvelle parvient aux oreilles des combattants
émigrés... Le train est anéanti avec tout son matériel...
Et il en était ainsi
partout sur le sol français...
Le 21 août 1944, à
Marseille, un millier de manifestants se rend à la Direction de la Police. À 16
h 25, un groupe de choc s’infiltre dans la préfecture. D’autres groupes entrent
après lui. Les combattants agitent des drapeaux. La Marseillaise retentit. Un Bulgare[105] et
une Polonaise peuvent être vus dans les premiers rangs des combattants.
Les 20, 21 et 22
août — jours de la libération — nos combattants à Lyon ont participé à la prise
de la radio de la ville, de la gare, de la caserne Dodd, du parc d’artillerie,
de l’école Vaucanson. Ils s’installent dans les casernes, sécurisent les
institutions publiques et étatiques, patrouillent dans les rues.
Le 28 août à
Toulouse – attaque contre un train avec canons, mitrailleuses et autres armes.
La bataille dure de 10 heures du soir jusqu’à 9 heures le lendemain matin. Le
train est capturé. Les ennemis soulèvent des serviettes blanches. Nos
combattants se battent magnifiquement. Le commandant de région de la Résistance
les félicite tout particulièrement.
Pour compléter ce
tableau très sommaire, il faut dire que plus de 10 000 émigrants ont participé
à la lutte de la libération du sud de la France...
Après la libération,
les combattants étrangers du Pas-de-Calais et du Nord défilent devant le
général de Gaulle qui les félicite pour leur bravoure.
Pendant la période
illégale, sept régiments ont été formés dans ces régions, dont chacun comptait
de 7 à 11 compagnies avec un total de 6 778 soldats...
Nous, les émigrants,
n’avons jamais négocié quand il s’agissait d’aider le pays de la démocratie.
Nous savons qu’une France libérée du fléau teutonique est nécessaire pour la
paix en Europe et dans le monde entier !... »
Le Congrès est
terminé.
CHAPITRE
SIXIÈME
RETOUR
Avec tout le peuple
français, nous, les combattants bulgares, nous étions réjouis du fond du cœur
de la liberté conquise après l’Insurrection de Paris. Mais notre désir de
retourner au plus vite dans notre patrie n’a pas sombré dans l’ivresse
générale. L’amour de la patrie, longtemps dorloté dans une émigration
difficile, s’est encore renforcé. Nous avons constamment cherché les moyens les
plus différents pour nous rendre à nos lieux de naissance. En tant que
secrétaire de l’organisation du parti, je fus envoyé à Marseille dans l’espoir
d’organiser le voyage sur place par quelque navire soviétique ou yougoslave. Il
s’est avéré que les officiers de la marine soviétique avaient reçu l’ordre de
ne prendre aucun passager sans autorisation spéciale. Le consul yougoslave
Lazar Latinovich, une vieille connaissance des camps de concentration français,
était également impuissant, car leur flotte avait temporairement suspendu ses
voyages vers Marseille.
Nous avons frappé à
différentes portes. Nous avons obtenu des réponses différentes, mais toutes les
réponses se résumaient à une seule, cruelle pour nous les exilés :
« Il faut attendre, la guerre fait toujours rage ». Et nous ne
voulions pas supporter cela — nous étions prêts à traverser les flammes, mais
au plus tôt, la terre bulgare chanterait sous nos pieds.
Nos amis français
nous ont assuré à plusieurs reprises qu’ils faciliteraient le départ dès que
des circonstances favorables se présenteraient. Ils ont tenu leur parole
communiste. À la fin de la troisième semaine après la victoire du 9 mai 1945,
les conditions souhaitées étaient réunies : on nous a dit de nous préparer
à partir. Les préparatifs devaient être modestes : nous traverserions des
terres et des frontières de Paris à Sofia ; on ne nous promettait ni papiers
réguliers, ni argent, ni transports sûrs ; on nous a fait savoir que nous
devions compter sur l’endurance de nos propres jambes et, bien sûr, sur notre
esprit.
Le jour tant attendu
est arrivé. Les adieux aux amis — Bulgares et Français – ont traîné en
longueur. Nous avons été conviés à un repas d’adieu, nous n’avions jamais vu
ça : plus de dix plats au menu, plus de 15 types de vins, des liqueurs,
des apéritifs, des bières et un gâteau au chocolat... presque aussi gros que la
tour Eiffel. Les mots prononcés n’étaient pas rhétoriques, mais simples et
sincères, les souhaits chaleureux et francs d’un heureux retour aux foyers de
la patrie.
Un jour ou deux
avant le départ, j’étais convoqué au CC du Parti communiste français. On m’a
confié les filières du parti par lesquelles nous nous déplacerions en France et
par lesquelles nous franchirons la frontière italienne.
Choisi comme chef du
groupe, j’ai jugé nécessaire d’obtenir des documents du parti pour notre
participation à la Résistance française. À cet effet, j’ai souhaité m’adresser
au camarade Jacques Duclos, alors le communiste le plus responsable sur le sol
français. À ma grande surprise, il m’a accueilli immédiatement comme une
vieille connaissance, même s’il s’agissait de notre première rencontre personnelle.
Le camarade Duclos s’empressa de dissiper lui-même mon étonnement : en
tant que dirigeant du parti illégal pendant l’occupation, il recevait des
informations sur tous les camarades responsables de la Résistance. Il
connaissait mon pseudonyme Gaby en tant que membre de la Commission des émigrés
au CC du Parti communiste français et en tant que responsable politique et
militaire des combattants et partisans étrangers en zone occupée. Il m’a
rappelé qu’il avait également lu mes informations et mes rapports — parmi les
meilleurs qui soient parvenus au CC illégal. (Le même bilan, en présence de
Georgi Dimitrov, sera donné plus tard à Sofia par Benoit Frachon, membre de la
direction illégale du PCF, venu comme délégué au IIe Congrès des
syndicats bulgares). L’ami Duclos a répondu avec empressement à ma demande. Au
cours de notre conversation cordiale, les documents de chacun de nous dix lui
ont été présentés pour signature. En ma présence, il les signa de sa grande et
claire écriture. Notre séparation a résonné dans une chaleureuse étreinte
fraternelle.
La veille de notre
départ, deux prisonniers de guerre bulgares, qui avaient trouvé un soutien dans
notre société « Amicale bulgare », ont souhaité rejoindre le groupe.
L’un, un ancien instituteur, s’appelait Alexandar Tiankov, et l’autre, un jeune
soldat dont j’ai oublié le nom. Nous les avons acceptés comme compagnons de
voyage et il n’y a eu aucune raison de le regretter.
Pour Grenoble, nous
avons décidé d’utiliser le train même s’il était souvent irrégulier. Après
avoir acheté nos billets avec des fonds du parti et des fonds propres, nous
avons attendu à la gare de Lyon. Les accompagnateurs n’étaient pas plus
nombreux que ceux qui partaient. Incroyable mais vrai : personne n’avait
pensé à embellir la séparation avec des fleurs — signe de la dure époque de
l’occupation, qui avait dévasté avec les jardins et quelques belles traditions
humaines. Et encore un fait : aucun des agents des chemins de fer, des
policiers – secrets et publics ! — n’imaginait que nous avions un long
chemin devant nous, d’un bout à l’autre du continent. Les anciens et nouveaux
sacs à dos, les sacs de voyage effilochés, les pantalons de golf dans lesquels
certains d’entre nous se prélassaient, ne témoignaient-ils pas que leurs
propriétaires étaient partis pour une courte excursion quelque part autour de
Paris ?
Jusqu’alors, nous
avions bien gardé le secret — se fondre dans la foule sans visage, rester
inaperçu. Nous avions de sérieuses raisons à notre comportement : la
plupart d’entre nous s’étaient brouillés depuis longtemps avec la police
française, et pas seulement avec elle.
Dispersés par deux
dans les compartiments du train, nous avons continué le jeu de cache-cache. Les
fumeurs donnaient l’air d’être indifférents ou pensifs. Le reste d’entre nous
lisions « à fond » des journaux et des livres. Deux camarades ont
fait une exception : Kosta Dramaliev et César Kovo. Ils avaient des cartes
d’identité françaises, maîtrisaient bien la langue du pays et s’autorisaient à
se comporter plus librement.
À Grenoble, les
effets de l’occupation n’étaient pas aussi visibles qu’à Paris : pas de
signes de bombardement, la circulation dans les rues des premiers jours de juin
témoignait d’un calme urbain normal, les vitrines des magasins rivalisaient en
montrant une pauvre abondance et en scintillant avec l’éclat de la mode
tardive. Et ici, comme dans la capitale récemment quittée, on apercevait des
uniformes militaires, des camions avec des prisonniers revenant d’Allemagne...
Le secrétaire du
parti du comité de région de Grenoble a accepté la lettre du CC du PCF en
pleine connaissance de cause. Très franchement, il nous parla dans le sens
suivant :
— Nous avons de
nombreuses tâches devant nous, dont certaines sont plus importantes et plus
rapides que d’autres. Les principales sont, bien sûr, au nombre de deux :
restaurer, resserrer les organisations du parti, ne pas renoncer à en créer de
nouvelles là où les conditions le permettent ; organiser l’accueil,
l’hébergement et le traitement des prisonniers et internés des camps de
concentration en provenance d’Allemagne. Vous comprenez vous-même les
difficultés dans lesquelles nous luttons ; manque de personnel, dont
beaucoup sont morts en tant que partisans ou dans les camps de concentration;
la propagande active de De Gaulle qui attribue tout ce qui est bien à De Gaulle
seul. Un grand sujet important de cette propagande et celle de l’Église sont
nos malheureux compatriotes qui arrivent nuit et jour. Une question
psychologique importante est de savoir qui les accueillera, qui sera le premier
à leur prêter main-forte et en même temps qui sera le premier à les informer de
la situation pendant la guerre, du comportement des différents partis et des
personnalités publiques célèbres. Vous voyez, le travail est énorme, et les
forces et les moyens sont modestes. Mais nous croyons que nous y arriverons.
C’est vrai, le courage et l’enthousiasme vont et viennent, mais ils ne cessent
de nous inspirer. Nous prendrons soin de vous aussi. Il faut attendre — pour
trouver un moyen de transport et tomber sur des amis gardes-frontières ;
nous devons les persuader de fermer les yeux. Et jusque là, probablement
pendant deux ou trois jours, nous vous logerons dans une école, vous serez dans
une salle commune, nous vous fournirons de la nourriture — soit dans une
cantine soit en vous donnant une certaine quantité d’argent — comme vous
préférez…
Les trois premiers
jours se sont passés relativement facilement : nous avons appris à
connaître les beautés et la vie d’après-guerre de la ville alpine, nous avons
visité ses monuments historiques, bu de la limonade et de la bière — production
en temps de guerre, et... discuté des problèmes du passé.
Les six
inter-brigadistes : César Kovo, Vasil Vodenitcharov, Ferdinand Vitchev,
Issac Moshev, Robert Melamed, Stefan Bakalov, se sont racontés à cœur ouvert
des épisodes de combat, des histoires drôles ou se sont disputés jusqu’à
l’épuisement sur le déroulement d’opérations militaires célèbres en Espagne,
comme si demain ils allaient y participer. Georgi Stoyanov, Kosta Dramaliev et
moi, qui n’avons pas participé à la guerre civile espagnole, lancions parfois
un mot comme bois d’allumage et les discussions faisaient rage jusqu’à minuit.
Le sommeil n’était qu’un entracte. Le lendemain, les discussions éclataient
avec une nouvelle force. On les a compris : les combattants ont donné leur
jeunesse, ils ne pouvaient pas s’empêcher de se soucier pour le sort de
l’Espagne. Aveuglés, ou plutôt poussés par leur optimisme inné, aucun d’entre
eux ne pouvait prévoir le long et sombre avenir de l’Espagne sous la botte de
fer du détesté général Franco. Lorsque l’un de nous trois essayait d’introduire
une note pessimiste pour refroidir leur optimisme irréaliste, ils se
contentaient de se montrer hautains :
— Vous ne
connaissez pas le peuple espagnol !
Le quatrième jour
est venu et s’en est allé, le cinquième jour venait et la nuit est tombée, et
ma tâche de guide se compliquait : les gens commençaient à s’énerver, à
douter de la bonne volonté des amis français, à proposer des solutions
extrêmes, aventureuses, par exemple, de partir seuls, à nos dépends et de nos
propres forces pour franchir la frontière.
Heureusement, la
sixième journée a mis fin aux moments critiques, à la confiance chancelante.
Tôt le lendemain matin, nous devions être prêts pour la route.
Nous avons voyagé en
camion jusqu’au village ou plutôt près du village de Saint-Michel et avons
admiré la beauté de cette partie des Hautes Alpes. L’été avait étendu son
magnifique vert luxuriant sur les prairies, les vallées, les forêts. Soufflée
par une brise légère, une symphonie magique de couleurs scintillait. Ici et là
des voyageurs en chapeaux de paille à larges bords, montés sur des mulets
surchargés, ne faisaient qu’ajouter à l’idylle bucolique de la beauté alpine.
Les personnes
prévenues du village nous saluèrent en silence. Un seul d’entre eux nous
accueillit avec un « bonjour ». Ils n’ont pas dit leurs noms et nous
n’avons pas osé les connaître. Ils n’ont pas posé de questions sur les nôtres
non plus. C’était une rencontre entre des personnes ayant des idéaux communs.
Elle est restée sans nom, mais elle s’est gravée dans les cœurs comme un
souvenir inoubliable, et quelque part au fond de l’esprit flottait le sentiment
chaleureux du sacrifice de soi, du service à la cause. Armée du communisme sans
nom, omniprésente et immortelle !
Le chauffeur a mis
le camion en marche arrière, a fait un signe d’adieu et a salué du poing
levé : « Courage, camarade ! »
Apparemment, nous
nous étions refaits une santé pendant notre semaine de vacances à Grenoble,
mais même au premier test, notre faiblesse de gamins de la ville était
évidente. Avec des gémissements, des soupirs, avec des repos fréquents au bord
de la rivière Arc et le long des sentiers de montagne escarpés, nous sommes arrivés
près de Modane — un point frontière entre la France et l’Italie. Le guide
français nous a demandé de nous arrêter à couvert près de quelques rochers. Il
s’est éloigné en direction du poste frontière. Il est revenu un instant plus
tard. Un groupe de familles italiennes traversait en ce moment, nous devrions
approcher la frontière plus tard, dans 20-30 minutes.
— Vous avez le
temps de manger quelque chose de vos sacs à dos. Buvons du vin rouge à
l’heureux retour dans votre patrie — notre guide anonyme a porté un toast.
Alors que nous
grignotions les sandwichs et buvions à petite gorgées l’agréable vin français
sec, il nous a donné les dernières instructions :
— Vous vous
ferez passer pour des Italiens, persécutés par Mussolini ; maintenant vous
rentrez chez vous. Laissez parler un seul d’entre vous si possible. Les
douaniers des deux côtés savent déjà quel genre de personnes vous êtes. Ils
fermeront les yeux.
Dans le groupe, seul
Vasil Vodenitcharov, sec, faible comme un bâton et pâle comme un citron
« mâchait » un peu les discours italiens, les mélangeant avec ses
mots espagnols plus connus. Nous l’avons propulsé en tant que guide. Nous
étions blottis sur le côté. Vaska a bien fait face à la tâche. Nous n’avons pas
écouté ce qu’il leur disait. Nous l’avons vu nous faire signe de la main et
nous commander en italien :
— Andiamo[106] !
Sans autre
incitation, nous sommes partis réjouis. Vasil saluait les douaniers avec Grazie et Arrivederci[107].
Nous avons suivi son exemple avec Saluto,
compagnio[108].
Ainsi, nous nous
sommes plongés profondément dans la terre italienne. Les Alpes ici aussi nous
ont souvent émerveillés par leurs couleurs de fleurs, de prairies, de buissons,
d’arbres. Les couleurs nous sont apparues plus denses, plus vives : vert
plus vert, rouge plus rouge, jaune et rose plus soutenus que nous ne les avions
vus ailleurs. Les pics escarpés, poussant leurs fronts à travers des forêts de
pins denses, se dressaient haut avec leurs lignes nettes et leurs capots de
neige empilés de travers. Et des cascades — étroites et larges, rapides et
claires, scintillantes, apparaissaient très souvent et partout. Leurs eaux ont
étanché notre soif constante. Les chemins étaient escarpés et le soleil tapait
fort. Et la route... on ne voyait pas sa fin sauf sur la carte. Notre
destination était Turin, la ville italienne la plus proche, mais elle se
trouvait à environ 80 kilomètres. Évidemment, nous n’allions pas la voir
aujourd’hui. Nous devions passer la nuit loin d’elle. Nous avons accéléré nos
pas, afin de pouvoir au moins échapper à l’étreinte de la montagne, qui, si
attrayante qu’elle fût le jour, n’augurait rien de bon pour nous la nuit. Les
plaisanteries qui nous avaient accompagnés jusqu’à présent se sont tues,
parfois des plaintes timides ou même ouvertes se sont fait entendre. Et le
soleil déclinait inexorablement. Nous devions organiser une « réunion
ambulante ». Les opinions, bien sûr, n’étaient pas pareilles, elles se
sont divisées. Alors mon vote est devenu décisif.
— Regardons
les montres, ai-je dit. — Il est plus de 19 heures. Si nous n’arrivons pas à un
endroit plat et abrité à 20 h, 20 h 30, nous nous arrêterons. Et maintenant —
lentement, prudemment — continuons.
À la joie de tous,
nous nous retrouvâmes bientôt au pied de la colline que nous descendions.
Personne ne disait mot, chacun jeta ses bagages par terre et s’étala dessus,
exténué. Nous avons regardé autour de nous... la montagne était derrière nous.
Devant nos yeux dans la pénombre, un champ assez large se profilait. Aucune
maison, aucune personne ne pouvait être vue. Après une courte pause, nous avons
décidé de dîner. Notre appétit est venu en mangeant, comme dit le proverbe.
Seul César, plus fatigué que nous autres, en raison des graves blessures reçues
pendant la guerre civile espagnole, ne put se montrer à la hauteur du proverbe
français : il prit une ou deux bouchées d’une boîte de poisson et
s’empressa de s’envelopper dans sa couverture de soldat. Rapidement nous avons
fait comme lui. Nous nous sommes endormis profondément. C’est ainsi que dorment
de jeunes soldats après une marche de 24 heures en armure complète.
Le matin, nous nous
sommes réveillés par intervalles. Le soleil pointait derrière les sommets des
montagnes. Notre premier souci sérieux était de prendre la route de Turin. Une
fois que nous y aurions mis les pieds, avec l’aide du guide
« italien » Vasil, nous chercherions un moyen d’utiliser un véhicule
de voyage.
Nous n’avions pas de
lires. Nous avions une modeste somme de francs français. Nous paierions notre
voyage avec cette monnaie. Nous n’avons pas pensé et ne pouvions pas penser à
un train. Tous les trains réguliers (dans la mesure où ils étaient réguliers)
avaient reçu l’ordre de ne transporter que des militaires et des prisonniers de
guerre. De temps à autre, ils mettaient en marche un train de voyageurs et
donnaient la priorité aux mères avec enfants, aux personnes âgées et infirmes.
Nous comptions sur la chance de trouver un chauffeur de camion prêt à nous
emmener sur la route d’un endroit à un autre. Bien sûr, nous n’avons pas abandonné
notre principal soutien — nos propres jambes.
Et ainsi, après
quelques errances, nous avons posé le pied sur la route asphaltée de Turin. Là
le trafic du transport ne nous a pas beaucoup plu : les camions militaires
passaient rarement, et tous bondés de monde ; encore moins souvent, des
voitures avec des civils approchaient et passaient. La plupart du temps, elles
étaient également très encombrées. Par conséquent, lorsque le conducteur d’une
charrette tirée par des chevaux avec des ridelles élevées a accepté de nous
faire avancer de 4 à 5 kilomètres, nous avons sauté dedans avec soulagement et
agilité. Vasil, qui était assis à côté de lui, avait pour tâche de lui
expliquer, comme il l’entendait, notre odyssée. Et Vaska, un jeune sentimental,
ne souffrait pas de manque d’imagination. Ainsi nous fûmes présentés comme des
partisans yougoslaves capturés par les fascistes allemands, sortis des camps de
concentration en France. Le pépé, avec un chapeau à larges bords, des joues
rouges et une moustache blanche rase, a maudit Mussolini et Hitler de ne pas
voir la paix dans l’autre monde, s’est arrêté à un carrefour et s’est excusé de
devoir vaquer à ses occupations. Il n’était pas question d’argent et ça ne
pouvait pas l’être : est-ce qu’une telle personne qui ne jure que par le
Duce pendu la tête en bas aurait jamais pu demander de l’argent à des
partisans ?!
Notre route
serpentait maintenant le long de la rivière Doire. C’était une sorte de bonheur
pour nous. De temps en temps, nous débarquions, trempions nos pieds fatigués
dans ses eaux froides, nous nous éclaboussions le visage et, quand nos estomacs
grognaient, nous déjeunions à l’ombre de son rivage. Comme ça jusqu’à la tombée
de la nuit. Et Turin nous fuyait toujours, restait toujours inaccessible.
Et encore une fois,
nous avons dû dormir à l’air libre.
Nous avons été
réveillés par le rugissement d’un gros camion cargo qui avait passé la nuit
près de nous. Au moment où nous nous demandions où nous étions et ce que nous
allions faire, le clairvoyant Vaska avait entamé des « négociations
diplomatiques » avec le chauffeur. Au bout d’une minute ou deux, il nous
fit signe de monter.
— Cette fois,
nous devrons payer, a déclaré Vaska. — Il n’était pas d’accord autrement. Il
accepte les francs français.
— Demande-lui
de nous arrêter près du comité municipal du Parti communiste. Assure-lui que
nous le paierons bien — je suis intervenu en tant que guide.
Nous nous attendions
tous à voir une ville grande et bruyante. Après tout, Turin a été la capitale
de l’Italie et le centre de la Renaissance italienne (risorgimento) au XIXe
siècle. La quatrième plus grande ville italienne à ce moment-là semblait juste
se réveiller et n’avait pas été en mesure de changer sa transformation en temps
de guerre. De nombreuses personnes en uniforme marchaient sur les trottoirs et
traversaient les rues. Les visières étaient également majoritaires à
l’intérieur des véhicules. Très souvent, les soutanes papales et les longues
robes plissées des religieuses étaient ballottées par le vent. Habituellement,
les prêtres amenaient avec eux un groupe de militaires, apparemment des
captifs. Où et pourquoi ils étaient emmenés, nous l’avons vite appris de nos
amis italiens.
Nous avons
honnêtement et décemment payé le chauffeur, qui nous a remerciés avec un
« Viva la bandiera rossa[109] ».
L’homme avait compris quel genre de marchandises il avait transporté.
Au comité du parti
de la ville, un ou deux camarades ont lu la lettre du CC du Parti français
confirmant notre participation à la Résistance française. Afin de les assurer
de la qualité de combattants décrits dans notre lettre, j’ai commencé à
énumérer des noms de camarades italiens connus du camp de concentration du
Vernet et de la Résistance. Je me suis arrêté aux noms de toutes les grandes
figures du parti italien : Luigi Longo, Nicola, Alberganti, Reale,
Colombo, Mireille, Fernand (pseudonyme) et d’autres.
— Connais-tu
Alberganti ? — m’a demandé le camarade à lunettes, que l’on nous a désigné
comme secrétaire.
— Très bien, du
camp du Vernet. Il est cheminot de profession — ai-je répondu.
— Et depuis
combien d’années ne vous êtes-vous pas vus ?
— Presque 4
ans.
— Est-ce qu’il
te reconnaîtra ?
— J’espère.
— Bien. Nous
allons l’appeler. Il est à Turin, secrétaire du conseil syndical de la ville.
— Alors dites-lui :
c’est Boris Milev, chef de baraque 19 au camp du Vernet.
Ils ont appelé.
Alberganti était absent, mais de l’autre côté du fil, on lui assura qu’il
serait de retour dans une heure au plus. On nous suggéra d’aller là-bas et
d’attendre.
— Puisque nous
nous verrons dans environ une heure, je vous suggère de laisser nos bagages, de
laver nos yeux quelque part et de nous montrer où prendre le petit-déjeuner.
Les camarades ont
adhéré à la proposition, acceptable pour eux, en raison du travail considérable
qui les entourait. Sans frapper, des hommes et des femmes continuaient d’entrer
dans la pièce où nous avions la conversation. Beaucoup d’hommes avaient leurs
manteaux d’été bombés de leurs étuis de revolver, et d’autres, en chemise, les
portaient ouvertement sur leurs hanches. Le ton des conversations était rapide,
nerveusement coupé. Des gestes vifs, larges, étaient assortis au ton.
L’atmosphère respirait la guerre et les combats de partisans...
La rencontre avec
Alberganti, le premier camarade connu sur le sol italien, fut touchante. Dans
l’étreinte, nous avons exprimé tout ce qui nous émouvait sur le moment :
le souvenir des camps de concentration avec ses douleurs, ses fardeaux, ses
épreuves héroïques et la joie de se voir vivants, inchangés par rapport à la
croyance commune. Malgré l’argent dans ses cheveux, l’ancien intérné du camp de
concentration avait conservé son intense gaieté : une lueur encore plus
brillante dans ses yeux bleu verdâtre, plus de métal dans sa voix ouverte de
baryton, un feu intérieur plus fort rayonnant et illuminant toute sa grande et
forte silhouette. Nous nous souvenions des dures minutes du mois d’isolement
passé ensemble, nous parlions de connaissances communes vivantes et mortes dans
la lutte, nous nous racontions comment nous nous étions échappés des camps de
concentration en France, quel rôle il avait pris dans la Résistance italienne,
et moi et mes camarades de la Résistance française.
Nous avons prévu une
réunion d’affaires pour cinq heures de l’après-midi. L’aimable ami Alberganti a
promis de s’arranger avec les camarades du comité du parti, dont il était
lui-même membre, pour notre nuitée, pour notre voyage en direction de Milan, et
a glissé une liasse de lires dans ma main.
— Cela vous
suffira pour la journée. Et puis – c’est facile. Tout ira bien.
Dans l’après-midi,
les camarades italiens n’avaient pas somnolé : ils ont écrit une lettre
aux organisations du parti de Verceil, Novare et Milan pour nous aider avec de
l’argent, du transport et de la nourriture jusqu’à la ville la plus
proche ; ils se sont occupés de l’hébergement, de la nuitée et de la
nourriture du lendemain ; et, surtout...
— Le
transport, c’est ce qui vous intéresse le plus, je vous comprends, a conclu
Alberganti. — Nous avons cherché un moyen de prendre un train pour Milan.
Impossible. Après trois ou quatre jours peut-être, mais cela ne vous convient
pas. Vous ne devez pas rester immobiles, mais progresser. Nous avons trouvé un
camion pour demain. Il se rend au village de Vercelli. 70-80 km de Turin. Là, les camarades
s’efforceront de vous conduire, sinon à Milan, du moins à Novare, avant Milan.
Et à Milan, Boris, tu verras Luigi Longo. C’est un grand chef là-bas
maintenant.
Nous avons remercié
chaleureusement l’aide amicale, embrassé notre ami Alberganti aussi vivement
que le matin et nous l’avons quitté avec le souhait et l’espoir de nous voir à
quelque congrès international de communistes ou d’antifascistes. En fait, cette
chaleureuse rencontre amicale était la dernière.
La route de Vercelli
nous a révélé l’une des richesses de cette partie de l’Italie du Nord : de
nombreuses rivières, des ruisseaux et apparemment d’innombrables canaux pour
irriguer les champs, les prairies et les jardins. S’ils avaient existé du temps
de César, il n’aurait pas crié après l’invasion de la Belgique :
« Des canaux, des canaux, des canaux partout ! »
Nous sommes arrivés
à Vercelli tard dans la soirée. Nos camarades nous attendaient avec une
impatience visible. Ils ont supposé que nous étions en retard quelque part,
soit à cause du moteur, soit parce que nous étions détenus par la police.
Et ici, nous avons
été comblés par le cher amour des compagnons d’armes anonymes — ils nous ont
emmenés dans un bâtiment scolaire, nous ont offert du gigot froid (gigot de
mouton à l’ail et aux carottes), du vin et des fruits.
Nous avons quitté la
localité le lendemain. Nous sommes partis à pied. (Ici, les camarades n’ont pas
réussi à fournir un véhicule.) Mais nous n’avons pas remarqué comment nous
avions parcouru 5 à 6 km jusqu’aux rives de la rivière Sesia. Nous nous sommes
rafraîchis dans ses eaux claires, nous avons pris le petit déjeuner, que les
accueillants amis de Vercelli avaient mis dans nos sacs à dos, et nous sommes
repartis… La route était balisée, large, mais non asphaltée. Principalement
nue, sans arbres de côté, serpentant à travers les champs moissonnés. Le soleil
nous dupait le matin, mais maintenant il nous brûlait de ses rayons.
Le soir nous sommes
arrivés à Novare. Après environ 20 km, nous étions épuisés. Vaska s’est
rapidement informé du siège de l’organisation du parti de la ville.
Les camarades
communistes de Novare ont traité notre situation de manière fraternelle. Ils
nous ont logés dans deux grandes pièces de la maison du parti, nous ont offert
un bon dîner dans un modeste restaurant et nous ont promis un camion pour Milan
le lendemain.
Au lieu d’un camion,
nous avons voyagé en train. Les communistes de Novare ont erré ici et là, ont
réussi à persuader un ami cheminot de nous assurer des places dans le train
pour Milan. Nous avons quitté la petite ville, fondée par César et détruite par
les barbares au Ve siècle, avec les meilleures impressions de ses merveilleux
habitants.
Le train n’était pas
rapide. Et même si cela avait été le cas, il n’aurait pas pu se déplacer rapidement
à cause des arrêts fréquents en cours de route. La lenteur du trajet nous
inquiétait : nous voulions arriver au moins en début d’après-midi — nous
avions besoin d’assez de lumière du jour pour joindre nos camarades milanais.
Nous n’avons vu la
gare centrale de Milan qu’à 16 h - 17 h. Elle nous a impressionnés par son
vaste hall de transport voûté. Les architectes l’avaient regardé avec l’œil de
l’homme futur. Tout autour respirait l’espace, la beauté, la majesté. Comme à
Turin, ici une race hétéroclite de prêtres et de religieuses s’imposait très
souvent aux regards ; les uniformes gris et verts prédominaient, bien sûr.
Il y avait encore une atmosphère militaire.
Reposés dans le
train, nous avons traversé joyeusement la belle salle. Devant la place de la
gare, nous avons regardé avec tendresse les taxis disponibles. Nous avions
beaucoup d’argent dans nos poches. La tentation de rouler en voiture comme des
hommes a facilement percé l’armure de notre pudeur. Notre justification morale
était le besoin de vigilance — pour éviter les regards questionneurs des
policiers.
Les chauffeurs de
taxi nous ont déposés devant un grand immeuble au style austère du XIXe siècle.
Le portier, étonné à notre vue, demanda des laissez-passer. Vaska lui expliqua
quel genre de personnes nous étions, d’où nous venions et où nous allions, et
il a voulu que nous soyons présentés au camarade Gallo — Luigi Longo, à
l’époque secrétaire général adjoint du PCI. Le portier nous regarda encore plus
surpris, mais sans l’ombre d’un soupçon, et lança :
— Bien.
Attendez. Je vais appeler des gens pour s’occuper de vous.
Le camarade qui est
arrivé nous a un peu intrigués avec ses vêtements et son arme : une
casquette bleue, un anorak, une mitrailleuse à l’épaule. C’est pourquoi il nous
a tout de suite mis dans l’ambiance avec ses jolis yeux et son doux sourire. Il
nous écoutait attentivement, lisait consciencieusement la lettre du parti
français, et nous a parlé dans un français correct avec un accent du sud :
il parlerait aux camarades et si nous pouvions l’excuser, il faudrait attendre
un peu. Avant qu’il ne parte, j’ai ajouté d’où nous nous connaissions, le
camarade Longo et moi, et je lui ai demandé de lui dire mon nom.
Au lieu d’arriver
seul, il est revenu avec deux autres jeunes hommes, également armés. Ils ont
aidé à porter nos bagages dans une vaste salle très haute, qui avait deux
rangées de lits superposés.
— Maintenant,
reposez-vous, dit le premier camarade. — Vous resterez probablement ici ce
soir. Le camarade Longo est hors du comité. Nous le contacterons et verrons ce
qui doit être fait pour vous.
Nous nous sommes
alignés dans le coin le plus éloigné d’une rangée. Dans la conversation que
nous avons entamée avec le premier camarade, nous avons appris qu’il était
peintre de profession, avait participé à la Résistance française près de la
ville de Marseille, connaissait le Bulgare Kolyo Atanasov, qui fut le premier à
conquérir la préfecture de Marseille. Quand il s’agissait de Marseille, notre
compatriote Robert prenait une part active à la conversation et harcelait, pour
ainsi dire, le camarade pendant au moins une demi-heure. Ayant trouvé non
seulement une langue commune, mais aussi de nombreuses autres connaissances
communes de différentes nationalités, ils éclataient de rire ou se taisaient en
soupirant au souvenir d’un camarade péri. Si l’un des jeunes n’avait pas appelé
le camarade italien à part, la conversation aurait sauté de souvenir en
souvenir et se serait probablement poursuivie jusqu’à minuit. Le camarade est
bientôt revenu et nous a communiqué ce qui suit : ils ont contacté le
camarade Longo, il m’envoie ses salutations, il nous recevra demain ; que
nous dînions et qu’après le dîner les camarades italiens pouvaient sortir avec
nous, si nous le souhaitions.
Aucun de nous
jusque-là n’avait douté de la réactivité amicale des communistes italiens, et
en particulier du chef des Brigades internationales et du co-interné du Vernet
Luigi Longo. Mais la joie épanouit tous les visages à la promesse d’être
acceptés par le communiste le plus en vue du nord de l’Italie.
Le camarade Luigi
Longo nous a reçus dans son bureau peu spacieux le lendemain vers 17 heures.
Trois d’entre nous étaient présents : Issac Moshev, Stefan Bakalov et
moi-même. Il m’a pris dans ses bras en me disant : « Toujours souriant »,
et a ajouté : « C’est bon signe — tout s’est bien passé depuis le
moment de la séparation — 1941. » À mon tour, j’ai noté que je le trouvais
en « bonne forme » comme dans le camp du Vernet, mais il avait déjà
un léger gel dans les cheveux. Je présentai mes deux compagnons comme
inter-brigadistes et l’informai de ma participation à la Résistance, de ma
camaraderie de combat avec les communistes italiens Pierrot de Toscane,
Secondo, Fernand et d’autres.
De son côté, Luigi
Longo nous a raconté son évasion du train[110] en
Italie avec l’aide de camarades cheminots, comment il avait combattu en tant
que chef de la Résistance dans le nord de l’Italie et comment les partisans
italiens avaient traité les occupants fascistes d’Hitler. Puis il parla en ce
sens :
« Les troupes
des Anglais s’entrelaçaient les pieds sur les hauteurs de Rome, quand nous ici
nous agitions des drapeaux nationaux et rouges. Le 26 avril de cette année, un
véritable soulèvement a éclaté dans les rues de Milan. Le parti était l’organisateur
et le chef du peuple insurgé[111]. La
liberté a été conquise par les partisans avec leurs propres efforts et de
nombreux sacrifices. Les Italiens furent donc profondément indignés lorsqu’ils
apprirent que le général anglais Harold Georges Alexander, commandant en chef
des forces alliées en Méditerranée, organisait un défilé militaire dans les
rues de Milan pour y défiler avec ses troupes en libérateur. Les Milanais ont
réagi vivement contre cette insolence prétentieuse et ont affronté en masse le
général éhonté. Le parti a lancé le mot d’ordre de boycotter le cortège
solennel. Les citoyens le suivirent. Ils ne sont pas descendus dans la rue,
mais sont restés chez eux ou dans les usines. De nombreuses petites et grandes
boutiques ont fermé leurs portes au passage du cortège. Les rues étaient
presque désertes, et les quelques piétons se cachaient apparemment dans les
rues avoisinantes. Le général éclata de colère. Il avait espéré être accueilli
comme un libérateur avec des fleurs, et devant lui s’étendait une ville
apparemment morte avec des rues désertes et des regards hostiles derrière les
fenêtres. Alors le général enragé prononça son incantation : « Si
dans une autre guerre je dois entrer une seconde fois dans Milan, je la
détruirai jusque dans ses fondements, j’en ferai une nouvelle
Pompéi ! » — Il me semble — ajouta Longo avec un sourire sournois —
que le monsieur ne pourra jamais mettre ses menaces folles à exécution.
De mot en mot j’ai
partagé mes impressions sur l’accueil des prisonniers de guerre en France et en
Italie : là-bas, les communistes français s’emploient activement à faire
en sorte que les prisonniers de guerre soient bien reçus, qu’ils soient
correctement informés de la situation dans le pays et que l’on veille à les
aménager au plus vite dans les hôpitaux, les sanatoriums, les maisons de repos,
pour accueillir ceux en bonne santé au travail. Et ici, en Italie, il semble
que seuls les prêtres, les religieuses et quelques dames miséricordieuses
s’occupaient de ceux qui se sont échappés des camps de concentration et des
prisons. L’esprit clairvoyant de l’interlocuteur a compris mon allusion
amicale.
— Vous voyez,
les amis français vont bien. Ils ont la force pour cette action. Leurs rangs
n’étaient pas aussi clairsemés que les nôtres. N’oubliez pas, le fascisme nous
a tenus hors la loi pendant plus de 20 ans, a massacré massivement nos cadres,
a persécuté chacune de nos manifestations. Notre tâche principale en ce moment
est de rassembler nos propres forces. Ainsi, parmi les prisonniers et les internés
des camps de concentration, nous recherchons avant tout nos camarades.
Nous avons
longuement parlé des conséquences de la guerre encore transpirantes de feu, des
rapports de forces politiques à l’échelle nationale et internationale...
— Finalement, s’est
reproché l’internationaliste Longo, je suis désolé, je ne vous ai pas demandé
votre situation financière. Si vous n’avez pas d’argent, voilà... et d’un geste
il ouvrit la porte d’un grand coffre en fer rempli de liasses de billets. —
Prenez autant que vous voulez. C’est le coffre de la banque dans laquelle nous
nous sommes installés.
J’ai été stupéfait
par le spectacle que je voyais pour la première fois de ma vie — de haut en
bas, le coffre était bourré de billets de banque. Et comme dans un rêve, j’ai
entendu : « Prenez autant que vous voulez. » Je me suis tourné
vers mes camarades — ils m’ont regardé d’une manière inhabituelle, d’une
manière nouvelle, avec des feux étincelants dans les yeux. La séduction me
brûlait aussi. Mais la brûlure dura quelques instants.
— Nous
avons de l’argent. Les camarades de chaque ville nous donnent tout jusqu’à la
prochaine étape — me suis-je décidé à dire tandis que je me sentais en sueur.
— Quand même,
prenez quelque chose venant de moi, a plaisanté l’ami. Vous êtes combien de
personnes ?
— Dix.
— Bien.
Cinquante, cent mille — est-ce assez pour vous ?
— Oh non...
qu’est-ce qu’on va en faire ? Nous voyageons. Nous serons bientôt en
Bulgarie. Les camarades nous donnent autant que nous avons besoin — ai-je
balbutié avec effort, ne voyant pas l’effet des sommes proposées sur mes
compatriotes.
— On peut
prendre quelque chose, pourquoi pas, lança l’un d’eux.
La peur des
querelles dans le groupe m’a effleuré et j’ai vite raisonné :
— Bien. Dix
mille. Mille pour chacun. Cela nous suffira jusqu’à Vérone.
Avec des mouvements
de main inhabituels et un mépris total de son expression faciale, le camarade a
compté dix gros billets de 1000 lires et me les a tendus...
Avec ces derniers
mots chaleureux, nous nous sommes étreints et nous nous sommes séparés dans
l’espoir de nous rencontrer lors de futures conférences internationales.
Après avoir franchi
le seuil du bureau, je ressentais encore l’impact de la rencontre avec le bon
ami. J’ai été sorti de cet état par deux coups sourds des deux côtés de mes
hanches.
— Bâtard,
pourquoi tu n’as pas pris plus d’argent ? — mes chers amis ont grogné.
J’ai dû ensuite
expliquer les raisons de ma décision devant tout le groupe. Le travail, ou
plutôt « l’affaire de l’argent » ne s’est pas réglé à la légère. En
cours de route, lorsque l’appétit des camarades dépassait nos capacités
financières, elle empoisonnait constamment l’air entre nous.
Après cette
rencontre mémorable, un train nous emmena à Vérone. La route faisait environ
150 kilomètres de long. Normalement, nous devrions la couvrir en 3-4 heures.
Nous n’avons atteint la ville natale d’Alexandre de Battenberg que le
lendemain. Les escales prenaient plus de temps que le voyage lui-même.
Selon la pratique
établie, en entrant dans une nouvelle ville, nous ne regardions pas ses
particularités et ses beautés, peu importe à quel point elles nous
impressionnaient. Notre première tâche était de trouver l’adresse que nous
recherchions.
Peu de temps après
avoir erré, nous avons trouvé le siège du comité de région du parti. Je ne
m’attendais pas à une telle surprise : le secrétaire du comité était ma
bonne connaissance Augustino. Notre travail commun nous avait liés en 1944,
jusqu’à la libération de Paris en août et même après cette date.
L’étreinte
fraternelle fut suivie d’une « information brève » de qui avait fait
quoi depuis notre séparation à Paris, puis vint l’ordre du jour de notre
hébergement.
Le lendemain, la
première tâche de mon ami fut de nous emmener à « son » théâtre,
c’est-à-dire l’ancien amphithéâtre Arène, qui nous a frappés par son espace —
long, étiré en demi-cercle, des rangées de pierres décrivaient comme des côtes
d’une poitrine profonde la salle de l’amphithéâtre. L’ancienneté de l’Arène ne
changeait pas l’aspect général médiéval et Renaissance de la ville natale du
célèbre peintre du XVIe siècle Paul Véronèse. Partout – des palais, églises,
monuments, bâtiments construits dans le style caractéristique de
l’époque : strict et dur et en même temps décoratif, riche et harmonieux.
En parcourant les rues, dont certaines étaient pavées de dalles de pierre, nous
avions l’impression de cheminer sur les places où des chevaliers italiens en
armure splendide avaient marché en compagnie des dames de leur cœur. Et tandis
que nous contemplions de loin les immeubles de pierre aux longs balcons et aux
larges fenêtres, il nous sembla que les sérénades des troubadours amoureux
volaient vers nous.
Notre guide nous
raconta avec non moins de fierté des pages de l’histoire révolutionnaire et
patriotique de sa ville natale.
— Vérone —
dit-il — a été le centre de la lutte de libération d’une vaste région — de
Vérone à Mantoue et Crémone jusqu’à Plaisance — contre les occupants hitlériens
de l’Italie de l’automne 1944 au printemps 1945. En avril 1945, lors du
soulèvement antifasciste qui éclate dans le nord de l’Italie, les patriotes
véronais expulsent le gouvernement de Mussolini provisoirement installé dans
leur ville et proclament la liberté et le pouvoir du peuple.
Vers la fin de la
journée, Augustino m’a vraiment fait plaisir : « Tu as été interné au
camp de concentration du Vernet. Tu dois connaître un de nos vétérans
syndicalistes célèbres, Nikola.
— Oui bien sûr.
Nous avons été en isolement ensemble pendant un mois entier.
— Alors tu vas
le voir bientôt. Il est aujourd’hui secrétaire des syndicats de la ville
voisine de Vicence. Je l’appellerai demain pour vous attendre. Vous n’allez pas
y aller à pied. Nous vous avons réservé un camion. Demain matin il vous prendra
tôt pour arriver avant midi. Ce n’est pas loin — environ 50 km, mais, comme
vous le savez, les routes sont souvent encombrées de transports de prisonniers,
il est donc préférable de partir plus tôt.
Jusqu’à Vicence nous
nous sommes sentis comme des voyageurs privilégiés. Le camion n’était pas
grand, il nous convenait parfaitement, et nous nous sommes détendus sur les
deux bancs en bois latéraux presque comme sur des fauteuils. Georgi Stoyanov a
finalement accepté de nous prendre en photo ensemble. Il remettait à plus tard
sous le prétexte pessimiste qu’on ne savait pas combien d’entre nous allaient
tenir jusqu’à la fin du voyage. Maintenant, grâce à la bonne humeur générale,
lui-même, envahi par l’optimisme, sans invitations insistantes, a profité de
l’arrêt temporaire du véhicule et nous a immortalisés sur une photo que nous
n’avons jamais vue.
Nous sommes entrés
dans la paisible ville de Vicence de bonne humeur. Notre optimisme dominant de
Vérone s’est transformé en un ferme espoir que de bons camarades nous
accueilleront également dans cette ville. L’espoir ne nous a pas trompés. Le
camarade Nikola nous a reçus avec son sourire extrêmement gracieux. Il s’était
arrangé pour que nous soyons conduits dans un restaurant modeste, où nous
étions traités comme de bons amis, avec une cuisine délicieuse, chaude et
variée, accompagnée de bon vin rouge.
Mes camarades
écoutèrent avec plaisir quelques mots courts sur la biographie de mon
co-interné. Déjà en tant que jeune ouvrier menuisier, Nicola était captivé par
les idées socialistes. Il était actif dans le mouvement syndical. Arrêté pour
activité antifasciste, il avait été torturé par les bourreaux de Mussolini, par
la famine et l’injection forcée de grandes quantités d’huile de ricin dans son
corps. Après avoir enduré toute la gamme du harcèlement policier, le fils
fidèle de la classe ouvrière, l’un des fondateurs du Parti communiste italien a
émigré en France. De là, il a répondu à l’appel du peuple espagnol pour la
défense de la république. Après la défaite de l’armée républicaine,
l’inter-brigadiste Nicola a été jeté dans le camp de concentration
disciplinaire du Vernet dans le sud de la France. En tant que camarade, Nicola
était la personnification de la bonté humaine elle-même. Cela irradiait de ses
yeux bleus, de ses cheveux grisonnants, de son visage rose et de son sourire
constant.
À tout cela, je
voudrais ajouter l’extrait d’un vieux carnet de notes :
« Vicence est
une ville avec des traces évidentes d’architecture médiévale et Renaissance.
Murs de forteresse impressionnants. Une grande tour d’horloge. Le théâtre
olympique rappelle les amphithéâtres grecs. La basilique — un bâtiment
intéressant de deux étages avec des colonnes aux deux étages. L’art
architectural de la ville est associé au nom du grand architecte Andrea
Palladio. Palladio était à l’origine un tailleur de pierre. Fondateur d’une
école d’architecture. Vicence, environ cinquante mille habitants. Céramique
développée. Usines de soie et de verrerie. De nombreux petits artisans. Forte
influence du catholicisme. Notre parti a de bonnes traditions. Dans la lutte
contre Mussolini, la ville a donné des dizaines de victimes, ainsi que dans la
Résistance armée. »
Et que ce soit la
fin des réflexions sur une rencontre malheureusement non renouvelée. Fin,
aussi, de la description détaillée de notre voyage à travers l’Italie du Nord.
J’ajouterai seulement que de Vicence via Trévise, Pordenone, Udine jusqu’à
Gorizia — à la frontière yougoslave — nous avons voyagé encore dix jours.
Durant cette
transition rapide, nous sommes restés plus de deux jours dans la ville
d’Udine : le temps nécessaire aux camarades italiens pour nouer des
relations avec les autorités frontalières yougoslaves de Gorizia. Notre séjour
à Udine a été le bienvenu : nous avions besoin d’un sérieux repos. Les
hôtes nous ont proposé des lits de camping confortables, des plats copieux et
chauds. Nous n’avons pas osé chercher un bain chaud, dont nous avions
désespérément besoin. Nous l’avons remplacé par les jets d’eau de la fontaine
de la cour d’école. Après s’être reposés et rafraîchis selon nos possibilités
de vagabonds, nous avons décidé de nous promener dans la ville. Les piétons ont
d’abord attiré notre attention : la plupart d’entre eux nous semblaient
être des ouvriers, à en juger par leurs casquettes et leurs pantalons usés. De
nombreux uniformes militaires et policiers apparaissaient ici aussi. La soutane
noire de prêtre et la robe bleue des religieuses et des sœurs de charité ne
manquaient pas non plus. Pourtant, l’aspect ouvrier de la population et les
cheminées fumantes qui s’élevaient au loin suggéraient que nous nous trouvions
dans une petite ville industrielle.
Dans un jour ou
deux, nous poserions le pied sur le sol balkanique. Soudain, les lires pesaient
lourd dans nos poches. Nous avons commencé à regarder dans les vitrines de
divers magasins. Nous avons acheté de petites choses : des miroirs, des
peignes, des savons. Seul Sharmana — Stefan Bakalov, a acheté de nouvelles
chaussures, car les siennes avaient « fleuri » à toutes les coutures.
Certains se sont souvenus de leurs proches et ont acheté des cadeaux bon
marché. Moshev et moi avions des femmes et des enfants qui nous attendaient à
Sofia. Je ne sais pas si le camarade social-démocrate et inter-brigadiste à ce
moment-là a choisi des cadeaux pour ses proches. Je l’avoue de tout cœur — je
n’ai rien acheté. Et je brûlais de joie de voir mes proches au plus tôt. Il ne
m’est pas venu à l’esprit que je pouvais et que je devais leur faire plaisir
avec un présent. N’avais-je pas passé près de dix ans pour ainsi dire « à
l’étranger pour gagner de l’argent ? » L’explication ? Il me
semble que c’est purement personnel. Bien que j’aie passé près de deux
décennies à l’étranger, je ne me suis jamais senti comme une personne qui est
partie dans un but lucratif. Et maintenant, à chaque fois que je pars à
l’étranger, même pour une courte durée, je n’oublie pas d’offrir des cadeaux à
mes petits-enfants ! Evolution humaine !
Mais ceci, entre
autres. Revenons à l’après-midi d’Udine.
Avec leur sourire,
les camarades d’Udine nous ont annoncé la nouvelle : « Demain matin,
vous partez. Deux de nos camarades vous accompagneront. Tout a été arrangé avec
les gardes-frontières italiens et yougoslaves. À Gorizia, le camarade général
Dusan Kveder de Ljubljana a convenu de vous attendre. » Et se tournant
vers moi, le camarade italien responsable m’a dit : « Il te connaît
du camp du Vernet. Il attend votre rencontre à Ljubljana. »
Et donc le
lendemain, le camion nous a emmenés sur une route relativement plate. Les
guides connaissaient bien les localités que nous traversions. Pendant la
guerre, ils ont escorté le long de cette route les prisonniers yougoslaves qui
se sont échappés d’Allemagne ; ils ont contribué à grossir les rangs de
l’armée des partisans yougoslaves. Le transfert de la frontière était alors accompagné
de grandes difficultés et de dangers. Ce sont maintenant nos amis des deux
côtés de la frontière. « Le transfert n’est plus un problème — nous ont
expliqué les sympathiques guides. – Il faudra marcher à pied une distance de
deux ou trois kilomètres. Puis les frères yougoslaves vous prendront en
charge. »
Nous n’avons pas
réalisé quand nous avons parcouru les kilomètres. Nous sommes entrés dans une
zone boisée. Les Italiens nous ont dit de nous installer là où nous pouvions et
se sont éloignés. Nous sommes restés seuls. Mais très vite les camarades
italiens sont apparus en compagnie de trois gardes-frontières yougoslaves armés
avec des étoiles rouges sur leurs chapeaux gris. Le moment de se séparer de
compagnons fidèles et sincères était venu. Nous avons remercié nos derniers
compagnons italiens à poings levés et avons prononcé, en italien « Arrivederci ! »
Les camarades
yougoslaves se sont comportés assez sérieusement au début. Ils nous ont
observés avec une certaine retenue professionnelle, même s’ils n’exerçaient le
service des gardes-frontières que depuis peu. Après un court silence, ils nous
ont posé plusieurs questions : sommes-nous tous Bulgares, sommes-nous tous
inter-brigadistes, qui d’entre nous est communiste, qu’a-t-on fait en France...
Enfin, ils ont demandé, qui s’appelle Boris ? Je me suis présenté et j’ai
dû fournir les informations demandées pour membre du groupe. J’ai commencé avec
Ferdinand Vitchev – inter-brigadiste, ancien étudiant, ouvrier non qualifié. Je
les ai tous décrits ainsi : six communistes inter-brigadistes, parmi
lesquels un avocat, un étudiant, deux émigrés politiques, deux antifascistes
chassés par le chômage de Bulgarie, des combattants de la Résistance française
et deux soldats évadés des camps allemands des prisonniers de guerre.
— Eh bien, vous
êtes les bienvenus, tonna le « chef » des trois, un grand jeune homme
qui ne s’était pas rasé depuis quelques jours. — Et allons-y tout de suite, on
verra ce qu’il en sera.
Et de nouveau sur un
camion, pour renforcer notre conviction que nous nous sommes débarrassés de
l’odyssée des piétons. Et nous ne nous sommes pas trompés dans nos
pressentiments.
Bientôt, le camion
s’engagea dans de larges rues pavées bordées de solides immeubles du XIXe
siècle. Ljubljana — la capitale de la Slovénie. Forte influence autrichienne.
Environ cent mille habitants. Tenaces, travailleurs, disciplinés et propres.
Une université où de nombreux Bulgares ont étudié. C’est ce que je savais de
cette ville slovène aux airs autrichiens. Et je n’en ai pas appris plus à ce
moment. Notre séjour a été riche émotionnellement, mais court dans le temps.
Dusan Kveder nous
attendait dans le club du comité municipal du parti. L’uniforme du général
embellissait encore plus ce merveilleux garçon, mais ne le raidissait pas. Il
était toujours, pour moi, le même « colocataire », actif, énergique
et sérieux du camp du Vernet. Notre étreinte a duré une minute ou deux ;
nous nous sentions comme des frères, heureusement retrouvés après une longue
séparation.
Maîtrisant
rapidement l’effusion d’émotion, Dusan, d’un ton calme, a confié notre groupe à
deux camarades slovènes. « Ils vont vous installer et vous nourrir —
a-t-il dit et s’est excusé auprès de mes camarades qu’il va me garder chez
lui : « Vous comprenez, nous ne nous sommes pas vus depuis près de
quatre ans, il y a beaucoup de choses à se raconter, et demain vous êtes en
route pour Belgrade. Tout est prêt. »
Il m’entraîna dans
un modeste bureau : un petit bureau, des canapés en peluche violette, une
petite table ronde avec un placage foncé et deux chaises en velours
rouge ; une fenêtre, à travers laquelle les rideaux voilés jaunes
laissaient passer librement le soleil.
— C’est le
bureau de ma camarade, également partisane. Membre du comité municipal du
parti. Peut-être qu’elle viendra à un moment… Et maintenant — dis-moi, pour
l’amour de Dieu. Comment et où étais-tu après Vernet ?
J’ai décrit
brièvement mon évasion du camp de concentration Des Milles, ma participation à
la Résistance française, etc.
— J’ai atteint
le rang de major dans la Résistance, même si je travaillais à l’échelle
nationale — j’ai terminé mon récit. Et toi, comment as-tu gagné tes épaulettes
de général ?
Avec une bonne
volonté amicale, Dusan a brièvement brossé la période des quatre ans de sa vie.
Après l’attaque d’Hitler contre le Parti des Soviets, la direction du parti du
camp de concentration a pris une décision : « Nos camarades doivent
aller en Allemagne avec le prétexte qu’ils veulent y travailler ; au
début, qu’ils travaillent, qu’ils fassent quelque chose de temporaire, mais à
la première occasion, et les conditions se présentent toujours pour une telle
opportunité, qu’ils quittent l’Allemagne et se rendent dans leur pays
natal. »
— Et en fait —
m’a précisé Dusan — le travail en Allemagne était le chemin le plus court pour
arriver en Yougoslavie. On m’a installé pour travailler dans une ferme
d’élevage bovin. Je suis resté là-bas pendant huit mois. Après cela, j’ai
réussi à me rendre en Yougoslavie. Dès mon retour, j’ai immédiatement contacté
les partisans slovènes. Ils m’ont vite nommé commissaire politique de la
compagnie. Alors j’avais aussi le rang de major. Mais lorsque Trieste a été
prise le 1er mai 1945 j’ai gagné les épaulettes de général.
On frappa à la
porte. Un vieil homme blond est entré avec un Schmeisser sur l’épaule. Un
visage sec et, à ce moment-là, soucieux. Il a demandé à dire quelque chose au
général en privé. Isolés dans le coin près de la fenêtre, les deux se
chuchotèrent quelque chose pendant deux ou trois minutes. L’homme avec le Schmeisser
sortit. Dusan, légèrement agité, se tourna vers moi : « Mon ami
Boris, la guerre est finie pour certains ; pour nous — pas encore. Nous
avons des Oustachis qui sévissent dans nos parages. Nous devons les extirper
jusqu’au dernier. On m’appelle à l’état-major de la garnison. Je dois y être
dans dix minutes. Pardonne-moi. Si je suis libre, je te verrai ce soir. Si je
suis occupé — j’espère te rencontrer de nouveau ici ou en Bulgarie. Juste au
cas où, laisse-moi t’embrasser. »
Le lendemain matin,
le charmant Dusan est passé rapidement, n’ayant manifestement pas assez dormi,
les yeux rouges et un manteau militaire par-dessus. Il s’est excusé pour la
séparation forcée d’hier soir, il m’a souhaité un heureux voyage de la part de
sa camarade.
Le train circulait
assez régulièrement, comme par temps de paix, mais à la gare de Zagreb, il
s’est arrêté deux heures de plus que l’heure prescrite. Les voyageurs,
contrairement à ceux d’Italie, étaient pour la plupart des civils. Il y avait
aussi beaucoup de militaires, mais pas de prisonniers de guerre, d’officiers et
de soldats blessés, mais souvent des jeunes gens énergiques, qui portaient des
uniformes d’officiers ou encore de partisans et qui avaient un très bon moral.
Et dans le train, et dans les gares, partout nous avons vu des gens armés. Non
seulement les hommes, mais aussi de nombreuses femmes portaient des étoiles à
cinq branches sur leurs chemisiers et des revolvers bien visibles à leur
ceinture.
Nous nous sommes
présentés à notre légation du front patriotique à Belgrade. Les nouveaux
diplomates nous ont accueillis très joyeusement. Avec une disponibilité
amicale, ils se sont occupés de notre hébergement et de notre départ. Pour
Sofia nous avons voyagé la nuit. Le train n’était pas éclairé. Il ne nous restait
rien d’autre à faire que de dormir, si possible. Mais l’impatience tenait tout
le monde éveillé. Le train s’arrêtait presque toutes les demi-heures. Les
arrêts étaient soit en garesoit en plein champ. Les sifflets des cheminots
perturbaient notre léger assouplissement.
Tôt le matin nous
sommes arrivés à Niš. Nous sommes descendus nous dégourdir les jambes. Le matin
de juillet nous a paru inhabituellement froid. Nous avons cherché en vain dans
la gare et autour d’elle quelque chose de chaud à manger. Nous avons mangé de
la nourriture reçue à Belgrade.
L’arrêt du train a
duré plus de deux heures. Personne n’a dit exactement quand le train
repartirait. À contrecœur, nous avons visité la gare — un vieux bâtiment qui
rappelait l’ancienne gare de Sofia. Après un long arrêt, nous sommes arrivés
rapidement à Tzaribrod (Dimitrovgrad).
Les autorités
frontalières yougoslaves se sont séparées de nous en bons camarades et nous ont
confiés à leurs collègues de l’autre côté.
Nous avons marché
sur notre terre bulgare natale.
Une de nos odyssées
était terminée. La Liberté, pour laquelle nous nous étions battus loin de la
patrie, nous accueillait.
P A R T I C O M M U N I S T E F R A N Ç A IS
23 mars 1973
AU COMITÉ CENTRAL DU PARTI COMMUNISTE
BULGARE
Chers amis,
Par une lettre du
15.I.1973 vous nous demandez de confirmer la participation du camarade Boris
Milev dans la Résistance française. Le récit des activités du camarade, que
vous donnez dans votre lettre est tout à fait exact.
Boris Milev a
effectivement occupé des postes de responsabilité dans l’accomplissement des
tâches spécifiques du parti parmi les travailleurs émigrés et en particulier
dans l’organisation et la direction des unités nationales, liées à
l’organisation militaire illégale des « Francs-tireurs et partisans ».
Dès le début de
l’année 1942 Boris Milev a tout d’abord entrepris ses activités parmi
l’émigration bulgare, dont les unités des « Francs-tireurs et
partisans » ont accompli des exploits remarquables dans la lutte contre
les occupants hitlériens.
Après cela, il a
occupé des postes de responsabilité au
niveau régional, puis au niveau national, dans l’état-major des unités des
participants à la Main-d’œuvre immigrée (MOI), qui représentaient une
partie indivisible des « Francs-tireurs et partisans ».
Après la libération
de la France, Boris Milev a été promu au poste de secrétaire du Comité d’action et de
défense des immigrés (CADI).
Pendant
l’occupation, Boris Milev a travaillé en contact étroit avec le parti et sous
sa direction.
Les postes qu’il a occupés
ont été confirmés par plusieurs camarades et plus particulièrement par Henri
Rol-Tanguy, membre du Comité central de notre parti, qui était l’un des chefs
militaires de la Résistance française — le chef militaire régional des
« Francs-tireurs et partisans » et des « Forces françaises de
l’intérieur » en Île de France.
En conclusion, nous
confirmons que pendant l’occupation hitlérienne le camarade Boris Milev a
occupé des postes de responsabilité comme communiste. Il a pris une part active
dans la Résistance et dans la lutte patriotique du peuple français pour la
libération.
Veuillez agréer,
chers amis, nos sentiments fraternels.
(s) GASTON PLISONIE
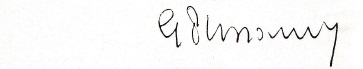
secrétaire du
Comité central,
membre du
Bureau politique
Je soussigné, Louis
̶Lajb Grojnowski, pseudonyme Louis Bruno,
Chevalier de la
Légion d’honneur, titulaire de la « Croix militaire avec palmes »,
médaille de la Résistance française et de la guerre de 1939-1945, major des
Forces françaises de l’intérieur,
Pendant
l’occupation, responsable national de la Main-d’œuvre immigrée (MOI).
J’atteste sur
l’honneur que Monsieur BORIS MILEV, de nationalité bulgare, au début de 1942,
passe à la lutte armée dans les rangs des combattants et des
partisans-émigrés ; participe à de nombreuses actions de combat à Paris et
en banlieue parisienne. Dans cette activité, M. Milev se distingue par son
dévouement à la lutte contre les occupants et ses qualités militaires. Pour
cette raison, il a été nommé en septembre 1942 à la direction des « Combattants
et partisans-émigrés » en région parisienne. Sous sa direction, un certain
nombre d’actions notables ont été menées par des combattants émigrés de
diverses nationalités.
Au mois de novembre
1943 M. Milev a été nommé comme membre de la direction centrale de la MOI pour
la zone nord, spécialement chargé d’organiser les sabotages et autres actions
militaires contre les occupants.
Monsieur Boris Milev
a participé activement, arme à la main, à l’insurrection de Paris.
Montreuil, le 25 mai
1972
LOUIS
GROJNOWSKI
|
Le
jeune Boris Milev. Héraklia Mileva,
la mère.
Stefan
Dimitrov, le
maire rouge de Sofia, 1932. |
|
|
|
|
|
|
|
|
La citadelle de Namur,
Belgique. Le camp de
concentration du Vernet. |
|
|
|
|
|
Dans les rues de
Marseille avec l’ingénieur Atanas Bratanov. |
|
|
|
|
Avec des camarades dans le camp de
concentration Des Milles. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Les participants
du groupe bulgare de combat à Paris : Nikolai Radoulov, Vladimir
Shtarbanov, Boris Milev, Nikola Marinov.
|
|
|
|
|
|
Combattants
bulgares de la Résistance parisienne :
Nikolai Radulov, Vladimir Shtarbanov, Georgi Stoyanov, Hristina Radulova,
Boris Milev, Nikolai Zadgorski, Nikola Marinov. Benoît
Frachon, membre du bureau politique du CC du parti communiste français, un
des dirigeants de la Résistance française. |
|
Odette Tibble,
secrétaire de Boris Milev pendant la Résistance.
|
Pierre Hentgès,
camarade dirigeant français, ayant travaillé dans la Résistance. |
|
|
|
|
|
|
|
Robert
Ballanger, responsable des FTP français dans la zone occupée de la France (à
gauche). |
|
|
|
|
|
|
Boris
Milev comme interné du camp de concentration du Vernet, dessiné par le
peintre espagnol Eladio (20 mai 1940). Georgi Stoyanov, capitaine
de la Résistance française.
Major Roger,
responsable militaire des FTP-MOI de la région parisienne. |
|
|
|
|
|
|
Colonel Henri
Rol-Tanguy, le libérateur de Paris (août 1944). |
|
|
Cette affiche
dégoûtante était l’œuvre des occupants allemands. Les photographies des
accusés ont été prises après trois mois de torture afin de rendre les accusés
répugnants. Mais les Français dans de nombreuses villes mettaient des fleurs
devant les affiches. |
|
|
|
|
|
Missak Manouchian,
Georges, ayant temporairement remplacé la muse par l’arme de la Résistance. |
Joseph Boczov,
ingénieur chimiste, ayant mis ses connaissances au service de la libération
de la France. |
|
|
|
|
Marcel Rajman, 21
ans. On l’appelait « Tchapaev ». |
Celestino
Alphonso, capitaine de l’armée républicaine espagnole. |
|
|
|
|
|
|
|
Spartaco Fontanot.
Après ses frères Jacques et Nerone il meurt lui aussi, pour que la liberté
triomphe. |
Tommy Elek, étudiant,
ayant préféré l’arme à l’enseignement. |
|
|
|
|
Boris
Milev et Pierre Villon, secrétaire général du Conseil national de la Résistance,
1946. |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
En discussion avec Jacques Duclos et
Vladimir Bonev, 1972. |
|
|
|
|
|
Les amis de la lutte antifasciste : B. Milev et le
vétéran-centenaire Jordan Milev. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Le peuple parisien
élève des barricades pendant l’insurrection de Paris, août 1944. |
|
|
|
|
|
Des barricades dans les rues de Paris. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Les anciens amis
du journal RLF : Hristo
Radevski, Liubomir Ognianov – Rizor, Boris Milev – Ogin, Angel Todorov, 1979. |
|
|
|
Mihail
Antonov, capitaine soviétique, caché par la famille Dora et Boris Kazakov. |
|
B. Milev et Hristo
Hrolev en excursion à Vitosha, aux environs de « Zlatni mostove »,
1932. |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
|
Le
garage rue de Laborde, incendié par les combattants émigrés bulgares, roumains
et polonais. |
|
Stefan Hristov,
secrétaire du comité régional du PCB, Sofia, en 1932-1933. |
Petar Hristov, ami
d’enfance de Boris Milev. |
|
|
|
INDEX
DES NOMS
[donné à titre
indicatif : faire une recherche dans le texte.]
(en bleu les membres de la famille Milev)
|
Abetz : Alberganti : Albert : Aldo : Alexander,
Harold, Georges : Alfonso : Anastas, frère
de Boris Milev : Anavi,
madame : Andreev,
Dimitar : Andreev,
Georgi : Andreev,
Ivan :
Andro : Angheloff, Théodore, Bojanata : Anguel,
baï : Anguelov,
Ratcho, Dr : Antoinette, Mme : Antonov, Mihail, Misha : Apostolov, Asen : Apostolova, Kunka : Aristophane : Arnold, lieutenant : Artik, Mme : Asa, David : Astardjian, M. : Atanasov, Nikola Savov : Augustino : Avramov,
Georgi : Avuski,
Petar : Bakalov,
Georgi : Bakalov,
Stefan, Sharlana : Bakalova, Lora : Bourmov, Alexandar : De Monzie, Anatole : Déat, Marcel : Delmelle, Hippolyte : Deltchev, Gotsé : Deluque, M. : Denise : Desjardins : Deter, Adolf : Detilleul : Diankov, Doncho : Diavolski, Petar : Dimchev, Pr associé, Dr : Dimitrievich,
Sergei : Dimitrov,
Georgi : Dimitrov,
Ivan, Shishko : Dimitrov, Ivan, Zoin : Dimitrov, Sabi : Dimitrov, Stefan, baï : Dimitrov,
Stoyko : Dimitrov-Goshkin,
Georgi :
Dimova, Maria : Diustabanova, Dora : Doriot, Jacques : Doudov, Zlatan : Doukov,
Hristo, baï : Doukov, Petar : Doychev, Doycho : Draganov : Drago : Dragoycheva,
Stefka : Dramaliev Kosta,
Maïstora : Dramaliev, Kiril : Dubois, major, viconte : Duclos, Jacques : Dufriche, Marcel, Maxime : Gomez, général : Gonzalez : Goretsky,
Anatoly : Gougoushev,
Andon : Govedarski : Gradinarov,
Milko : Grafa, agent, Grantcharov,
Ivan : Grantcharov,
Petar : Grigorov, Petar, baï : Grojnowski,
Louis, Lajb, Bruno : Grozev : Grzywacz,
Szlama : Guénchev, Dimitar, Bateto : Guénchev, Kolyo : Guenov, Todor : Guérganova, Petya : Guéshev, Nikola, Rimski :
Guéshkov, Marin, P. : Guytchev :
Gyoza : Hadjiiski,
Lyuben : Hadjiliev,
Dimitar : Halatchev,
Karamfila : Heinemann : Henriot,
Philippe : Hentgès, Pierre, Robert : Herbst,
Joseph : Hermès : Hershkovich, Isidor : Himmler : Hitler : Jelul : Jeromski : Joseph : Jouvet, Louis : Kabakchiev,
Hristo : Kalaïdjiev, Hristo : Kaltchev,
Kamen : Kaltchev,
Vasil : Kamara : Kambourov,
Svetloslav : Kamenov,
Todor : Kaminski,
Jacques, Hervé, Irène : Kanev,
Ivan : Kaprielov,
Kapriel : Karamazov,
Aliosha : Karan : Karaslavov,
Georgi : Karastoyanov,
Metodi : Karev,
Gavrail : Kasprowicz : Kazakov,
Boris :
Kazakova,
Dora : Kazar,
Yves : Kehua,
Hook :
Kirkov,
Georgi : Kiryakov, Tsvyatko : Kisimov, Konstantin : Kitzinger, général : Klintcharova, Stefana, première épouse de Boris Milev : Kluge,
maréchal : Knochen : Kocho,
Daskala : Longo,
Luigi, Gallo : Losserand, Raymond : Louis
XVI : Lozan, le gros, baï : Machado : Maeterlinck, Maurice : Maïakovski,
Vladimir : Manchev, Boris : Manolov, Ferdinand : Manouchian, Missak, Georges : Margarita : Marie-Antoinette, : Marinchevski, Asen : Marinov, Nikola, Kolyo, Pierre : Marinski, Ivan : Markov, Vasil : Martinov, Ivan : Marty, André : Marx : Matić : Maupassant, Guy de : Maurice, Jean : Max :
Mayer,
List, Richard : Mehandjiiski,
Tzviatko : Mehandov,
Boncho : Melamed,
Robert : Metzker, Paul : Meunier, Constantin : Meyer, Israel : Mező, Imre,
Edgar : Michels, Charles : Nadia, sœur
de Boris Milev : Naïdenov, Dimitar : Naoumov, Alexandar : Napetov, Petko : Napoléon : Nastev,
Petar : Nathan, Jacques : Nedialkov, Grigor : Nemirov, Dobri : Nenov, Atanas : Nenova,
Trajana : Neumann : Nicola : Nielsen, Asta : Nikita,
bogomile : Nikolov, Atanas,
Kolata : Nikolov,
Kruger : Nikov, Hristo : Nino : Oberg : Ognyanov,
Liouben, Rizor : Ognyanov, Sava : Osipov, metteur en scène : Palladio,
Andrea : Panchev,
Kutyo : Paskov,
Georgi, Georges : Paskova, Stella : Passeur, Steve : Passionaria : Patsev, Atanas : Patsev, Vasil : Paulus de Châtelet, Pierre : Paulus :
Pavlov, Todor : Pavlova, Gana : Pendjerkov, Georgi, Dialektkata : Radoulov, Georgi : Radoulov, Nikolai, Nikola, Jean-Pierre : Radoulov, Radi : Rajman, Marcel, Chapaev :
Rakhmetov : Rakovski, Krastan : Rau, Heinrich : Razlogov,
Nikola : Reich, Laszlo : Remarque,
Erich
Maria : Ritter,
Julius : Rizov,
Georgi : Robert : Robespierre : Robov,
Alexandar, Shishko : Roger,
inspecteur : Roger,
mécanicien : Rolland,
Romain : Rol-Tanguy,
Henri, Yves : Romain, Jules : Romanov, Atanas : Rouge, Ivan,
Katia : Roumenov,
Boris : Rousinov, pope
rouge : Rouxel, Roger : Sakharov,
Nikola : Sandanski, Yané : Santos :
Saraliev, Totyo : Savov, Boris, Pileto : Savov, Stefan : Scævola,
Mucius : Schaumburg, général : Schnitzler, Arthur : Stoyanov,
Avram, baï : Stoyanov,
Georgi, Martin : Stoyanov,
Lyudmil : Stoyanov,
Penko : Stoyanov,
Stoyné : Stoyanov,
Todor, Toshkata : Stoychev, Petar : Stülpnagel, von,
général : Tabakova, Tzvetana : Tagore, Rabindranath : Tanev,
Tatcho : Tanev,
Yordan : Tarabanov,
Milko : Targovski,
Asen : Tashkov, Georgi, oncle de Boris Milev : Tashkov, Vasil : Tashkova, Anastasia, grand-mère de Boris Milev : Tashkova, Mileva, Héraklia, mère de Boris Milev : Taskov, Boris : Tatarov, Atanas : Thelmann,
Ernst : Thenardier : Thorez, Maurice : Tiankov, Alexandar : Tibble, Odette, Danielle : Tillon, Charles : Tinchev :
Tipov,
Pando : Todorov,
Anguel : Togliatti,
Palmiro : Tonchev,
Hristo, Itseto : Topentcharov,
Vladimir : Yanakiev,
Ilia, Kadiyata : Yanka : Yankov,
Dr : Yankov,
Kosta: Yavorov,
P.K., Peyo : Yordanova,
Zorka : Yosif : Yurgandzhiev, Petroush :
Yuroukov,
Andrei, Victor : Zadgorski,
Nikolai : Zaré,
baï : |
Boyadzhiev, Asen : Boykikev : Branichev,
Avakoum : Bratanov,
Atanas : Bratkov,
Yordan : Brecht,
Bertolt : Breton, André : Bronstein : Budevska,
Adriana : Carré, Lucien : Catherine : Chamberlain : Chaumas, Yvonne : Chopin : Chopov,
Toushé : Churchill,
Winston : Claude : Clemenceau : Cloarec, Georges : Colombo : D’astier, Emmanuel : Daladier :
Dalem, Franz : Damianov,
Atanas : Damianov, Raiko : Damianova, Maria, Micheto : Daniel, Issac : Dante :
Danton :
Darev, Georgi : De Gaulle, général : De Lattre de Tassigny : Dukas, Paul : Dullin, Charles : Dyulguerov,
Ivan : Eisler, Gerhard : Eladio : Elek, Tommy :
Éluard, Paul : Engels :
Eschyle :
Étienne, M. : Ezekiev,
Boris : Ferdo,
baï : Fingercwajg : Fontanot, Jacques : Fontanot,
Nerone : Fontanot,
Spartaco : Frachon,
Benoît : Fromage : Furen,
Svetoslav : Gaidandjiev, Nikola,
Nikolai : Ganchev, Boris : Ganovski, Sava, Trudin : Garvanov, Ivan : Garvanski,
Netzo : Gémier, Firmin : Georges, Pierre, colonel Fabien : Georgiev,
Ivan : Georgiev,
Spas : Géré, Marcella : Gilbert : Ginestet, Edmond : Godart,
Justin : Goebbels : Goethe :
Holban,
Boris, Roger, Olivier, Bruhman, Baruch, major :
Homère : Hranova,
Olga : Hrelkov,
Nikolai : Hristov,
Kiril : Hristov,
Petar, Petarcho : Hristov,
Stefan, l’indien : Hrolev,
Hristo, Grafa :
Hugo : Ibrishimov,
Veltcho, baï : Ignatov,
Boris : Ignatov,
Stoil : Igov,
Ilko : Ikonomov,
Mateï : Iliev,
Borislav : Ilitch, général : Irena-Wanda : Ivanov, Boris : Ivanov, Nacho : Ivanov, Stamat : Jacques : Jamois, Marguerite : Jando, M. : Jar, Alexandru, Étienne : Jaurès, Jean : Jean : Koké, Andrée : Kolarov : Kolev, Docho : Komitski, Ivan : Konstantinov, Dimitar,
Mitreto : Kostov, Georgi : Koulev,
Zhecho : Koutouzov : Kovaliov,
Vasil : Kovatchev,
Kiril : Kovo, César : Krapchanski,
pope : Krapchev, Danail : Krapchev, Dr : Krosnakov,
Ivan : Kubatski : Kun, Béla : Kveder, Dousan : Kyosev, Dino : Lai, Tin : Lamouche, consul : Lankov, Nikola : Lasser, Jean : Latinovich, Lazar : Laurent, Mme : Laval, Pierre : Lazarov, Atanas : Lazarov,
Georgi et Toma : Leclerc, général : Lénine : Leonard :
Lermontov : Liaptchev, Andreï : Liaptchev, Dimitar : Lily : Liset,
colonel : Mickiewicz, Adam : Mikhailov,
Atanas : Mikhailov,
Vancho : Mile, père
de Boris Milev : Milev,
Boris, Ogin, Charles, Gaby, Bore, Mircho, Juro Petrovich :
Milev,
Geo : Milev,
Lazar, Zaharchouk :
Milev,
Stoyan : Milev,
Yordan : Mileva, Odette,
Micheline, Mariana, Michèle, Henriette, Louise, (Erna, Dunka), deuxième femme de Boris Milev :
Millet, Jean : Mirko :
Mitovich : Mitra, mamie : Mitsiev, Ivan, Nayden : Molière :
Monge, M. : Montgomery : Mood,
Petar, Laporte : Moser,
major : Moshev,
Issac : Moulin, Jean : Moushanov : Moutev, Ivan : Münnich, Ferenc: Mussolini : Penev, Krum : Pereira : Perenovski,
Nedialko : Pergelov,
Tchitchoto : Pétain : Petev,
Nikola : Petko,
cousin de Boris Milev : Petkov,
Kosta : Petkov,
Yanko : Petrov,
Georgi : Petrov, Ivan : Petrov, Todor : Pianechki,
Ivan : Pientka : Pierre, M. : Pierrot : Pilsudski, Józef : Pipkov, Lyubomir : Pirinski,
Geo : Pisarev : Pitoëff, Georges : Plisonie,
Gaston : Plochev,
Danyo : Politzer,
Georges : Polyanov,
Dimitar : Popandov, Pavel : Popov, Krum : Popov, Nikola : Popova,
Roza : Porten,
Henny : Pouchkine : Prahov,
Asen : Pramatarov : Przybyszewski : Radevski,
Hristo : Scholtitz, von : Secondo : Seikov, Yordan: Sharlandzhiev,
Dimitar : Shatorov,
Metodi, Atanasov :
Shelgounova, Lydia : Shimon : Shivarov : Shtarbanov,
Vlado, Gaston : Shtibi,
Georg : Sidérov,
Emil, Bolsheto : Simo, Pavel, Paul : Simon : Slaveykov,
Pencho : Smirnenski,
Hristo : Snezhina,
Elena : Solange : Spasov,
Mircho : Spasov,
Pavel : Staline : Stamatov,
Georgi : Stamboldjiev,
Vasil : Stamboliiski,
Alexandar : Stamenov,
garde : Stanev, Lazar : Staykov, Encho : Stefan, archimandrite : Stefanov, Ivan : Stefanov,
Tzvetan : Stoev, Georgi, Georges, Dr
Schwartz : Stoichkov,
Ivan : Stoublenska,
Milka : Totev : Traikov,
Hristo : Trakiiski,
Boris : Trandafilov,
Vladimir : Transki,
Kolyo : Trayanov : Trendafila : Tsankov,
Alexandar : Tsankov,
Georgi : Tsolov,
Petar : Tsviatkov, Anton : Vaillant-Couturier, Paul : Valéry, Paul : Vassilev, Orlin : Vassilev, Vladimir : Velev, Boris : Velev, Krastyo : Velio, baï : Veliotz,
Valentin : Velitchkov,
Kiril : Velitchkov, Nikola,
Kolyo : Véronèse, Paul : Veselinov,
Kosta : Videnov,
Ivaïlo : Villen, Sébastian : Villon, Pierre : Vinarov, Ivan,
Petrovich : Vinarova : Vitchev,
Ferdinand : Vladikov,
tailleur : Vodenitcharov,
Vassil, Vaska : Voïkov,
Alexander : Volodia : Wajsbrot : Wilhelm,
Kaizer : Witchitz : Wolf,
Freidrich : Zhechev,
avocat : Zhechev,
Nikola : Zhendov,
Alexandar :
Zhivkov, Todor : Zimmer,
Bernard : Zlatev, Dr : Zlatko, baï : Zmiyarov, Stoyan : Zola, Emile : Zuibarova, Katerina : |
Texte établi par la Bibliothèque russe et slave ; déposé sur le site de la Bibliothèque le 22 avril 2023.
* * *
Les livres que donne la Bibliothèque
sont libres de droits d’auteur. Ils
peuvent être repris et réutilisés, à des fins personnelles et non commerciales,
en conservant la mention de la « Bibliothèque russe et slave » comme origine.
Les textes ont été relus et corrigés avec la plus grande attention,
en tenant compte de l’orthographe de l’époque. Il est toutefois possible que
des erreurs ou coquilles nous aient échappé. N’hésitez pas à nous les signaler.