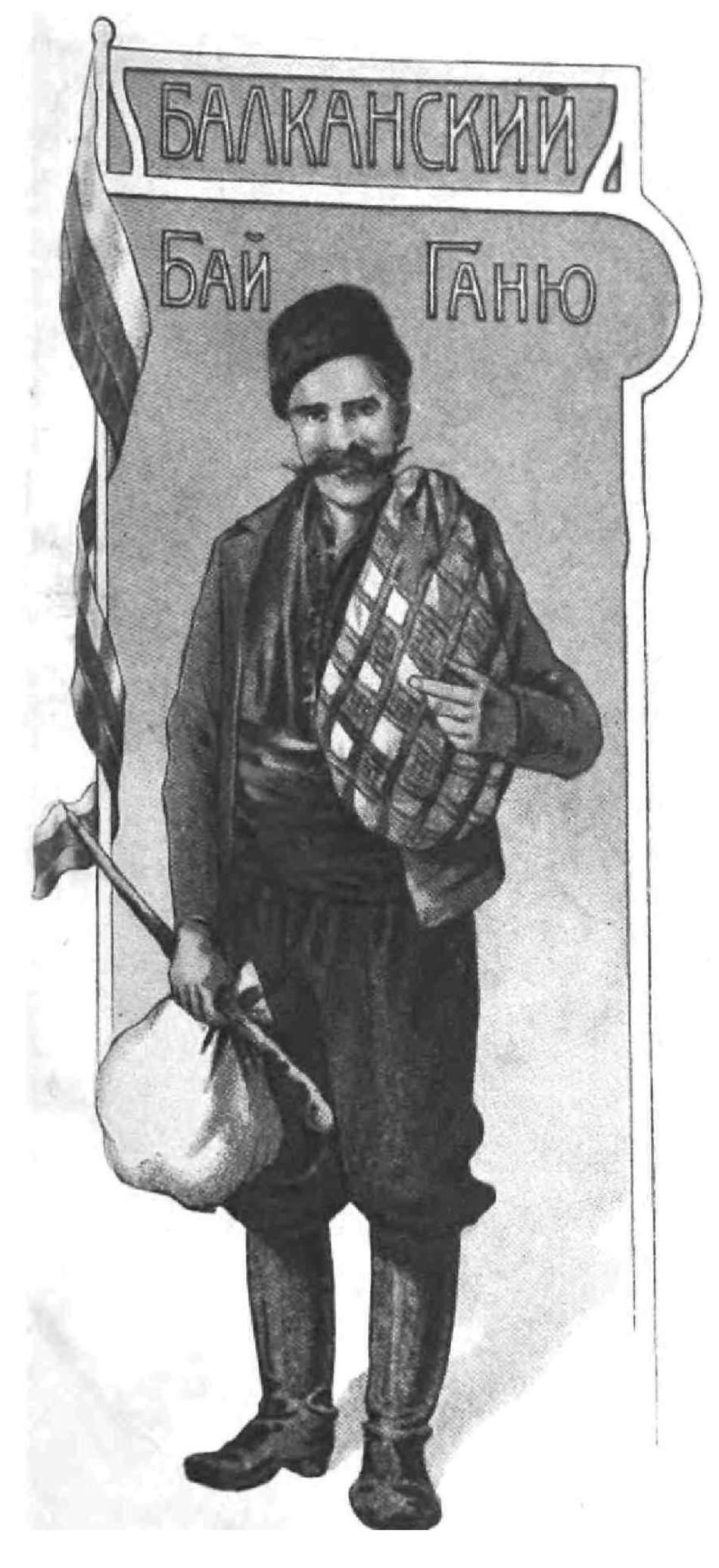
LA BIBLIOTHÈQUE RUSSE ET SLAVE
— LITTÉRATURE BULGARE —
Aleko Konstantinov
(Алеко Константинов)
1863 – 1897
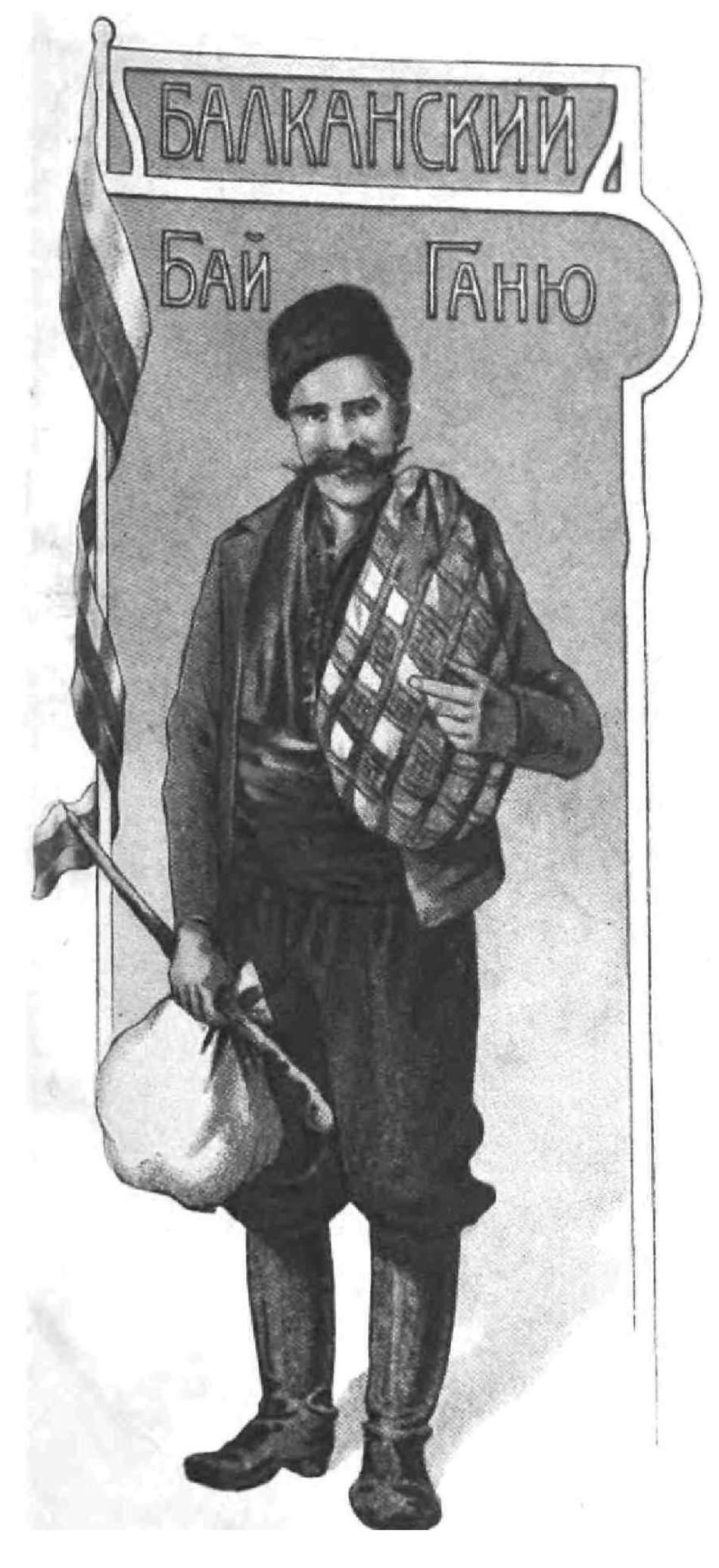
BAÏ GAGNO
(Бай Ганьо)
1895
Traduction de Matei Gueorguiev et Jean Jagerschmidt, 1911.
Ce texte est publié avec l’accord des héritiers de Jean Jagerschmidt ; le téléchargement est autorisé pour un usage personnel, mais toute reproduction est strictement interdite.
V. Baï Gagno à l’Exposition de Prague
XI. Baï Gagno fait les élections
CHEZ les Bulgares, comme chez certains peuples congénères, la renaissance politique a été précédée par la renaissance littéraire. Le précurseur fut un moine du Mont Athos, Païsii, qui termina vers 1762 un ouvrage intitulé Histoire slave-bulgare du peuple, des tsars et des saints bulgares, compilation écrite dans une langue incertaine, mélange de slavon d’église et d’idiome populaire.
Après lui un prélat, Sofroni, évêque de Vratsa, écrivit en simple bulgare des ouvrages de théologie ou d’édification et des mémoires fort curieux dont j’ai donné jadis la traduction1. Après ces deux précurseurs sont venus d’abord des publicistes et des historiens comme Rakovski et Veneline, puis des écrivains originaux comme Liouben Karavelov qui écrivit d’intéressants tableaux de la vie nationale, comme Vazov qui est le Sienkievicz de la Bulgarie renaissante et qui dans un roman célèbre en partie traduit en français2, a retracé les douloureuses épreuves de la Bulgarie renaissante. Les publicistes, les poètes ne manquent pas à la Bulgarie contemporaine et l’auteur de Baï Gagno tiendrait une place éminente parmi eux si une mort tragique prématurée ne l’avait pas enlevé à l’âge de trente-quatre ans.
L’œuvre qui a surtout rendu son nom populaire est celle dont M. Jagerschmidt nous présente aujourd’hui la traduction. M. Jagerschmidt est l’un de ces Français assez nombreux qui sont venus apporter à la jeune Bulgarie le concours de leur science théorique et de leur expérience professionnelle. Il est forestier comme son illustre prédécesseur La Fontaine, mais il sait mieux que lui distinguer :
le bois de grume
Du bois de marmenteau.
Quand Peau d’Âne lui est contée il y prend comme le bonhomme un plaisir extrême et ce plaisir il ne veut pas le garder pour lui tout seul. Les aventures de Baï Gagno sont aussi classiques et populaires en Bulgarie que chez nous celles de Tartarin ou de M. de la Palisse. Baï Gagno symbolise une bonne partie du peuple bulgare arraché tout à coup à la vie grossière qu’il menait avant l’émancipation et mis brusquement en contact avec cette civilisation européenne qui l’éblouit et le déconcerte. J’ai encore rencontré ce type à Paris même, sur le boulevard Saint-Michel. Il devient de plus en plus rare au contact de l’Occident et il ne sera bientôt plus qu’un souvenir. Raison de plus pour remercier M. Jagerschmidt de nous avoir fait connaître cette œuvre singulière et piquante qui rappelle tour à tour la manière de Daudet, de Rabelais... et même de Paul de Kock.
LOUIS LÉGER.
ALEKO IVANITSOV CONSTANTINOV3 est né à Sistovo, près de Roustchouk, sur les bords du Danube, le 1er janvier 1863. Son père était l’un des plus intelligents et des plus cultivés des Bulgares de sa génération. Il possédait à fond, en dehors de sa langue maternelle, l’italien, le grec, le roumain et le turc.
À l’âge de onze ans, Aleko fut envoyé au Gymnase de Gabrovo, où il resta jusqu’à la guerre de l’Indépendance en 1877. Son père, qui l’avait fait alors revenir auprès de lui à Sistovo, le confia au Gouverneur de la ville dont il était l’ami. Et, par une curieuse coïncidence, Aleko se trouva placé dans le même bureau que deux « rimailleurs » qui sont devenus célèbres : Nicolas Jivkov, l’auteur du chant national bulgare, Choumi Maritsa, et le grand poète Vazov. Les appointements que le jeune Aleko touchait alors — un rouble par jour — lui servaient à s’acheter des paquets de tabac et des cahiers de papier blanc sur lesquels il griffonnait des vers, à la manière de son compagnon Jivkov.
Après la guerre, en 1878, Aleko part pour la Russie, où, comme beaucoup de ses compatriotes, il va compléter son éducation. Pendant les sept années qu’il passa au pays du Tsar libérateur, il fit un peu de droit et beaucoup de musique et de littérature. Il écrivit à cette époque quelques petites pièces de théâtre, un poème comique qui fut publié en 1882, et rédigea, en collaboration avec quelques amis, une gazette humoristique.
Cependant en 1885 il termina ses études de droit et rentra dans son pays. Quelques mois plus tard Aleko Constantinov est nommé Juge au Tribunal d’arrondissement à Sofia et peu de temps après Substitut du Procureur à la Cour d’appel.
Mais bientôt une série de malheurs viennent l’accabler. Dans l’espace de cinq ans, il perd toute sa famille. Successivement il voit disparaître son père, sa mère et ses trois sœurs. Le sort s’acharne sur l’homme public aussi bien que sur l’homme privé : Aleko Constantinov, dont le caractère indépendant déplaisait à Stamboulov, est brusquement révoqué pour les plus misérables des motifs politiques.
Seul et sans ressources, le pauvre Aleko essaie d’abord de gagner sa vie au barreau.
« Devant la porte de sa maison, raconte M. Pentcho Slaveikov, il cloue un petit écriteau : Aleko Constantinov, avocat. Le soir même, quelques amis se réunissent et vident un verre de bière en lui souhaitant bonne chance. Et Aleko attend les clients. Au bout de quelques jours, une vieille femme vient le trouver, mais elle meurt avant qu’il ait pu lui faire gagner son procès. Une semaine, deux semaines se passent. Un jour un Chop4 jovial et rusé frappe à sa porte. Aleko lui fait avoir gain de cause. Notre Chop en remerciant son défenseur promet de lui envoyer ses honoraires « la semaine prochaine », mais jamais Aleko ne voit arriver cette fameuse semaine. Un beau jour, longtemps après le Chop, il reçoit la visite d’un de ses parents. Il lui fait encore gagner son procès. Mais l’autre n’avait pas été sans remarquer que la jaquette de son défenseur était percée aux coudes ; il jugea donc inutile de le rémunérer pour sa peine... Aleko était trop fier pour courir après lui. »
Il se consacre alors à la littérature et va chercher ses modèles parmi les auteurs russes et français. C’est de cette époque que datent ses traductions des poèmes de Pouchkine, de Lermontov, de Nekrassov, du Pater de François Coppée, et de Tartufe. Il écrit en même temps des articles de critique.
Avec les quelques billets de cent francs que lui rapportèrent ces traductions et grâce à un emprunt qu’il fit à la Banque Nationale Bulgare, en mettant en gage des bagues et des bijoux ayant appartenu à sa mère, il put enfin réaliser un projet qu’il caressait depuis longtemps : visiter l’Exposition de Paris en 1889 et celle de Chicago en 1893.
Le pauvre Aleko crut même un instant qu’il devait renoncer à aller à Paris : il comptait sur sa traduction de Tartufe pour lui permettre de faire ce voyage. Mais au moment où celle-ci allait paraître, son éditeur, compromis dans l’affaire de l’assassinat du ministre Beltchev, est arrêté. Adieu la traduction ! Adieu les beaux « napoléons » qui allaient lui permettre de faire un voyage tant désiré ! Un ami intime, Golovanov, le tira d’embarras et lui fournit les fonds nécessaires pour aller à Paris d’abord, en Amérique ensuite.
C’est après avoir parcouru l’Europe et l’Amérique que de retour à Sofia, Aleko commença à produire ses œuvres vraiment personnelles. Entouré de quelques amis, le soir, devant des verres de bière et dans un nuage de fumée il racontait gaiement ce qu’il avait vu, ce qu’il avait entendu, il comparait la vie des peuples occidentaux à celle de ses compatriotes. Et réunissant des idées éparses et des remarques jetées un peu à tort et à travers dans la conversation, il créa, sans même s’en rendre compte, une figure qui allait devenir plus populaire dans son pays que celles de tous les héros et de tous les Tsars, Baï Gagno.
Baï Gagno5 est un paysan bulgare rusé et finaud, mais à peine dégrossi, qui part pour l’Europe, la ceinture bourrée de petites fioles d’essence de roses qu’il va offrir comme échantillons dans les diverses capitales.
Aleko, s’aidant de ses propres souvenirs, l’imagine au milieu d’une civilisation qu’il s’assimile mal et dont il n’apprécie souvent que les mauvais côtés.
Née dans ce milieu d’étudiants pleins de gaieté et d’insouciance, l’idée de Baï Gagno se précisa peu à peu dans l’esprit plus mûr et plus sérieux d’Aleko. En publiant les aventures de son héros, il eut pour but de contribuer à l’éducation populaire. Il voulut montrer à ses compatriotes leurs défauts et leurs travers. Il fit œuvre de moraliste.
Les premiers chapitres Baï Gagno part pour l’Europe, Baï Gagno à l’Opéra, au bain, à Dresde, à Prague, parurent sous forme d’articles séparés dans le journal l’Idée (Misseul) en 1894.
Aleko qui n’avait pas grande imagination et qui était encore assez inexpérimenté, puisque Baï Gagno n’est que son second essai en prose, conserva à ses articles la forme d’une conversation dialoguée entre étudiants, ce qui ne fait qu’alourdir le récit.
Il s’aperçut certainement d’ailleurs de ce défaut, puisque dans les derniers chapitres, Baï Gagno fait les élections et Baï Gagno journaliste, l’introduction est à peu près ou même tout à fait supprimée et l’auteur entre immédiatement au cœur de son sujet. On sent aussi que, depuis le début jusqu’à la fin de l’œuvre, l’auteur s’efforce de creuser toujours plus profondément l’âme de son héros. Il abandonne la manière anecdotique pour faire de plus en plus œuvre de psychologue.
Le type de Baï Gagno ne se fixe pour l’auteur lui-même qu’au fur et à mesure qu’il publie ses aventures. Dans les premiers articles, il s’amuse à nous en montrer des esquisses de profil ou de trois quarts. Baï Gagno n’est vraiment bien campé, ne devient réel et vivant que dans les derniers chapitres.
Et lorsque Aleko vit ses articles réunis en un seul ouvrage, il en saisit lui-même les imperfections et les faiblesses. Il se proposa de refondre son œuvre, de la reprendre depuis le début, mais la mort vint trop vite et il ne put mettre son projet à exécution.
Ses amis publièrent après lui La correspondance de Baï Gagno, mais d’autres articles comme les Principes de morale de Baï Gagno qui avaient été lus un soir par l’auteur à un groupe d’étudiants ne purent être retrouvés.
Bien qu’imparfait sous sa forme actuelle, Baï Gagno est et restera une œuvre nationale, au même titre que chez nous Tartarin de Tarascon ou Joseph Prudhomme.
Aucune autre production littéraire n’a été plus utile à la conscience bulgare que ces esquisses négligemment écrites. « On dirait, selon la charmante expression de M. Slaveikov, les morceaux de quelque grand et précieux miroir que l’artiste insouciant aurait brisé avant de le mettre dans son cadre. »
C’est en 1894, à l’époque des élections au Sobranie qu’Aleko Constantinov se mit à faire de la politique active en se lançant dans les rangs du jeune parti démocratique dont le chef était Karavelov6 et il se révéla tout de suite journaliste de premier ordre. Il écrivit alors ses admirables Feuilletons qui ont été réunis et publiés en volume. Comme beaucoup de mots pris aux langues occidentales, le mot « feuilleton » n’a pas en bulgare le sens que nous lui attribuons. Les « feuilletons » d’Aleko Constantinov sont de simples articles politiques. Il les signait Chtastlivetz, ce qui signifie heureux, veinard, bien qu’à la même époque, dans une de ses lettres, il écrivît à l’un de ses amis ; « Que je suis un veinard, cela, toute la Bulgarie le sait. Mais ce que tout le monde ignore, c’est que je n’ai pas aujourd’hui 45 stotinki7 pour m’acheter du tabac. » Et pourtant il était sincère en se disant heureux, car il était devenu maître de sa pensée et de sa plume. Les idées les plus généreuses le hantaient et il les exprimait harmonieusement. Il connaissait les joies pures du lutteur consciencieux et convaincu. « Seuls le caractère et les qualités morales de l’homme public, écrivait-il, donnent une signification et une valeur à ses idées et à ses principes. »
Les « feuilletons » d’Aleko eurent un succès énorme en Bulgarie. Non seulement son nom devint populaire, mais ses mots à l’emporte-pièce, mais ses formules hardies coururent de bouche en bouche. Il avait commencé une série d’articles intitulés Divers hommes, divers idéals, où il faisait défiler un cortège de politiciens et où il dévoilait la corruption nationale de l’époque. La grande autorité qu’il avait peu à peu acquise inquiéta les hommes au pouvoir. On décida sa perte. Il le savait mais ne s’en troubla pas.
Le soir du 11 mai 1897, Aleko s’en revenait de Pechtera, près de la frontière de Macédoine, en compagnie de M. Takev8. Le même soir, à Sofia, on recevait un télégramme ainsi conçu : « Aleko mortellement blessé », et peu de temps après un second : « Aleko est mort ».
À l’endroit où fut frappé l’auteur de Baï Gagno s’élève un monument sur lequel est gravée l’inscription suivante :
« Passant, transmets à la génération future qu’ici est tombé, assassiné par des meurtriers mercenaires, le poète-écrivain Aleko Constantinov, le 11 mai 1897. »
ON aida Baï Gagno à se débarrasser de son « iamourlouk9 » d’esclavage ; on jeta sur ses épaules un manteau venant de Belgique — et tout le monde déclara que Baï Gagno était devenu un véritable Européen10.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Et maintenant chacun de nous va raconter quelque chose sur Baï Gagno.
— Très bien !
— Je demande la parole !
— Attends un peu. J’en sais bien plus long que toi...
— Non, ce n’est pas vrai. Toi, tu ne sais rien du tout.
Le bruit devint assourdissant. Enfin l’on se mit d’accord pour laisser Stati commencer. Et il commença.
LE train s’engouffra sous l’immense voûte de la gare de Pest. Nous entrâmes, Baï Gagno et moi, dans le Buffet. Comme je savais que nous avions une grande heure à attendre, je m’installai tranquillement à une table et je commandai de la bière et de quoi manger. Autour de moi la foule grouillait. Une vraie fourmilière. Et du beau monde, ma foi ! Les Hongrois, vous savez, je ne les porte pas dans mon cœur. Mais les Hongroises... c’est une autre affaire. Tout étourdi par le bruit, je ne m’aperçus pas que Baï Gagno avait filé sans rien dire en emportant sa besace. Où est-il passé ? Son verre est vide. Je regardai tout autour de moi, je parcourus des yeux le restaurant. Pas de Baï Gagno.
Je sortis sur le quai. Je le cherchai vainement de tous les côtés. « C’est curieux, me dis-je. Il a dû aller jusqu’à son wagon pour voir si on ne lui avait pas chipé sa couverture. »
Je rentrai dans le restaurant. Il y avait encore plus d’une demi-heure avant le départ du train. Je me remis à siroter tranquillement ma bière. Toutes les cinq minutes, un employé entrait, agitait une cloche, et d’une voix dolente annonçait la direction des trains : « Heu-Gueuch-Feu-Keu-Teu-Hê-Gui... Kich-Keu-Reuch... Szé-Gué-Din... Ouï-Vi-Dek. » Quelques voyageurs anglais l’ayant considéré avec stupéfaction, il ne s’en troubla point. On voyait qu’il était habitué à épater les gens par l’originalité de sa diction. Il se mit à sourire, en ouvrant la bouche jusqu’aux oreilles, et d’une voix encore plus haute et plus enrouée, il continua : « Ouï-Vi-Dek... Kich-Keu-Reuch... Heu-Gueuch-Feu-Keu-Teu-Hê-Gui » en accentuant avec conviction chaque syllabe.
Il y avait encore dix minutes avant le départ du train. Après avoir payé ce que je devais, ainsi que la bière de Baï Gagno, je sortis sur le quai avec l’espoir de retrouver mon compagnon. À ce moment un train entrait lentement en gare. Et savez-vous qui je vois apparaître, penché à une portière, la moitié du corps en dehors ? Baï Gagno.
Il m’a aperçu, et le voilà qui se met à me faire des signes avec son kalpak11 et à me raconter de loin une histoire que je ne peux entendre qu’à moitié à cause du bruit que fait la locomotive. Je finis pourtant par comprendre ce qui lui était arrivé.
Aussitôt que le train fut arrêté, il s’élança sur le quai, courut à moi et me raconta, en émaillant son discours de jurons énergiques (qu’avec votre permission je ne vous répéterai pas) l’histoire que voici :
— Ah ! ne m’en parle pas, mon vieux ! Je suis en nage, tant j’ai couru...
— Pourquoi donc as-tu couru, Baï Gagno ?
— Ah ben ! Pourquoi j’ai couru !... N’est-ce pas, pendant que tu bayais aux corneilles, là-bas, dans le restaurant...
— Eh bien, et après ? répondis-je.
— Eh bien... pendant ce temps-là, comprends-tu, voilà le type qui était près de la porte qui se met à sonner... j’entends la locomotive siffler... je sors, sans même avoir le temps de t’appeler... je regarde. Notre train partait. Sapristi ! Et ma couverture ! Alors je me précipite. Plus le train file, plus je cours après lui... Ah ! ne m’en parle pas. Mais voilà qu’à un moment donné, le train s’arrête et hop ! je saute dedans. Un individu me crie après — il bafouille quelque chose, je ne sais quoi — mais moi, tu sais, je ne me laisse pas faire. Je le regarde dans le blanc des yeux. Je lui montre ma couverture. Enfin il a l’air de comprendre et me laisse tranquille. Et même il se met à rire. Est-ce que je pouvais savoir, moi, que nous reviendrions en arrière ! Ah ! ces Hongrois !
Et moi aussi, je l’avoue, j’ai bien ri en moi-même de l’aventure de Baï Gagno. Le pauvre ! Le train manœuvrait pour changer de voie, et mon bonhomme a couru après ! Le malheureux ! Il a fait trois bons kilomètres pour le rattraper... Après tout, sa couverture était dedans !...
— Mais, dis-moi donc, Baï Gagno, dans ta précipitation, tu as oublié de payer ta bière...
— En voilà une affaire ! Est-ce qu’ils ne nous plument pas assez, ceux-là ? répondit Baï Gagno sur un ton qui ne supportait pas de réplique.
— C’est moi qui l’ai payée.
— Eh ! si tu l’as payée, c’est que tu avais de l’argent. Allons, monte, monte vite, pour que nous ne soyons pas encore obligés de courir après le train.
Nous montâmes dans notre wagon. Baï Gagno s’accroupit devant sa besace en me tournant le dos. Il en tira une moitié de kachkaval12, s’en coupa avec soin un tout petit morceau, se tailla une large miche de pain et commença à faire travailler ses mâchoires avec un merveilleux appétit, gonflant ses joues tantôt à droite, tantôt à gauche, puis tendant le cou pour faire passer le morceau de pain sec.
Baï Gagno a assez mangé. Après avoir fait entendre un ou deux hoquets, il ramassa les miettes dans le creux de sa main et les avala. Puis il murmura entre ses dents : « Ah ! si quelqu’un pouvait m’offrir maintenant un petit verre de vin... » Il s’assit en face de moi, se mit à sourire avec un air de satisfaction, et après m’avoir regardé pendant une bonne minute :
— Dis donc toi, l’ami, est-ce que ta seigneurie s’est promenée un peu à travers le monde ?
— J’ai pas mal voyagé, Baï Gagno, oui.
— Ah ! moi, combien de pays j’ai parcourus ! Combien !... Je ne parle pas d’Andrinople ou de Constantinople... Mais la Roumanie, par exemple, Giurgevo, Mogureli, Ploïesti, Pitesti, Brada, Bucarest, Galatz, — attends, que je ne te raconte pas de balivernes... Galatz, je ne me rappelle pas bien si j’y ai été — mais enfin, j’ai été partout par là.
Notre voyage jusqu’à Vienne fut assez monotone. J’offris à Baï Gagno un de mes livres pour passer le temps. Mais il me remercia aimablement, en me disant qu’il avait « bien assez lu dans le temps ». Et il trouva plus pratique de faire un petit somme. Pourquoi donc resterait-il éveillé ? Il a donné, n’est-il pas vrai ? bien assez d’argent au chemin de fer pour avoir le droit de dormir un peu. Et il s’assoupit. Bientôt même il ronflait si fort qu’on aurait cru entendre rugir le lion de l’Atlas.
Nous arrivâmes à Vienne et nous descendîmes au traditionnel hôtel de Londres. Les domestiques prirent dans la voiture mon sac de voyage. Ils voulaient prendre aussi la besace de Baï Gagno. Mais lui, par délicatesse peut-être (est-ce qu’on sait ?) ne voulut pas la leur donner :
— Comment veux-tu que je leur confie ça, mon vieux ! c’est de l’essence de roses. Il ne faut pas blaguer avec ça. Ça sent très fort. Ils seraient bien capables de me chiper un moskal13, et alors, tu pourrais courir après !... Je les connais, ces gaillards-là ! Il ne faut pas te laisser prendre à leur air... « mielleux ». (Baï Gagno voulait dire « poli », mais ce mot-là est encore nouveau dans le vocabulaire bulgare, et il ne vient pas sur ses lèvres.) Il faut les laisser tourner autour de toi sans te troubler. Et pourquoi donc tournent-ils autour de toi ? Crois-tu qu’ils te veulent du bien ? « Eins, zwei, gût’morgen ». Et ils ne pensent qu’à te chiper quelque chose. S’ils ne peuvent rien attraper d’autre, au moins un peu de bakchich ! Voilà pourquoi j’ai toujours soin de filer des hôtels sans tambour ni trompette... Espèces de mendiants ! À celui-ci, un kreutzer. À l’autre, un kreutzer. Ça n’en finit plus !
Comme l’essence de roses que portait Baï Gagno avait réellement une assez grande valeur, je lui conseillai de la donner à garder à la caisse.
— À la caisse ? s’écria-t-il sur un ton qui voulait dire qu’il avait pitié de ma naïveté. Vous êtes épatants, vous autres, les savants ! Mais sais-tu seulement ce que c’est que les gens qui sont à la caisse ? S’ils prenaient ton essence, s’ils te la subtilisaient... Après ? Qu’est-ce que tu ferais ? Va, laisse-moi tranquille. Vois-tu cette ceinture ? — et Baï Gagno relève son large gilet — tous les moskals, je vais les fourrer là-dedans. C’est peut-être bien un peu lourd, mais c’est ce qu’il y a de plus sûr.
Et Baï Gagno me tourna le dos... « Vaste est le monde, pensait-il, il y a des gens de toute espèce. Qui sait ce que c’est aussi que ce blanc-bec-là ? » Et il se mit à empiler les moskals dans sa ceinture.
— Veux-tu que nous allions déjeuner ? dis-je à Baï Gagno.
— Où ça ?
— En bas. Au restaurant.
— Merci. Je n’ai pas faim. Ta seigneurie peut y aller. Je t’attendrai ici.
Je suis bien sûr qu’à peine ai-je été sorti de la chambre, Baï Gagno a ouvert sa besace. « Il a de quoi déjeuner... Pourquoi donc jetterait-il son argent par les fenêtres pour manger chaud ? » Ce qui est sûr, c’est qu’il ne mourra pas de faim.
Après avoir conduit Baï Gagno dans les bureaux d’un commerçant bulgare, je le laissai et je pris un tramway pour aller à Schœnbrunn. Je montai à l’Arc de Triomphe pour contempler Vienne et ses environs, je me promenai à travers les allées et le Jardin zoologique, je regardai les singes pendant une grande heure, et vers le soir je m’en retournai à l’hôtel.
Baï Gagno était dans sa chambre. Il aurait voulu me cacher ce qu’il était en train de faire, mais il n’en eut pas le temps, et je remarquai qu’il était occupé à coudre une nouvelle poche à l’intérieur de son « antéria14 ». En homme pratique qu’il était, il portait l’été une « antéria » sous ses habits à l’européenne. « L’hiver, emporte du pain, et l’été, des vêtements », disent les vieux de chez nous. Et Baï Gagno suit ce conseil.
— Je me suis assis pour recoudre quelque chose, dit-il tout confus.
— Tu te couds une poche ? Tu dois avoir roulé quelqu’un avec ton essence de roses, lui dis-je en blaguant.
— Qui ça ? Moi ? Tu n’y es pas ! Tu veux savoir pourquoi j’ai une poche ici ? Des poches, j’en ai bien assez ! C’est de l’argent qu’il me faudrait ! D’ailleurs, ce n’est pas une poche, ça. Ce n’est rien du tout. Mon gilet était un peu déchiré. J’y ai cousu un bout d’étoffe... Mais où étais-tu, toi ? Tu te promenais ? Tu as eu raison.
— Et toi, Baï Gagno, tu n’as pas été te promener pour voir Vienne ?
— Qu’est-ce qu’il y a à voir à Vienne ? Une ville, c’est une ville. Des gens, des maisons, du luxe. Et partout où tu vas, on te dit toujours : « Gût morgen », et puis on te demande de l’argent. Pourquoi donnerions-nous notre bonne galette aux Allemands ? Chez nous aussi il ne manque pas de gens pour la manger...
JE proposai à Baï Gagno d’aller nous promener jusqu’à l’Opéra et de prendre des billets pour le soir. On donnait le ballet « Puppenfee » et je ne sais plus quoi encore. Après être passés devant le café grec, nous nous dirigeâmes vers le café Mendel, où se réunissent les Bulgares, puis vers l’église Saint-Étienne. Là, sur la place, j’invitai mon compagnon à entrer dans une pâtisserie. J’étais loin de me douter que Don Juan pût se glisser dans la peau de Baï Gagno ! Quels miracles la civilisation ne peut-elle donc pas accomplir ! Il faut que je vous dise qu’à cette époque je faisais mes études à Vienne. J’étais venu passer les vacances dans ma famille, et pendant le voyage de retour j’avais fait la connaissance de Baï Gagno. J’étais allé souvent dans cette pâtisserie, et je connaissais fort bien la caissière, une fille aussi belle que gaie, gaie mais de très bonne tenue et ne permettant pas qu’on prît avec elle trop de libertés. Représentez-vous alors la scène, mes amis !
Nous entrons, Baï Gagno et moi, dans la pâtisserie. Nous nous approchons du comptoir. La jeune personne me souhaite aimablement la bienvenue. Je lui réponds quelques paroles enjouées et je me retourne pour choisir un gâteau. Au même instant, une exclamation furieuse fait sursauter le magasin tout entier...
— Qu’est-ce qui est arrivé, Baï Gagno, est-ce toi qui lui as fait quelque chose ? m’écriai-je sur un ton plein de reproche.
— Mais non, ce n’est pas moi, mon vieux. Qu’est-ce que je lui ai fait ? répondit Baï Gagno d’un air embarrassé et d’une voix qui tremblait un peu.
Rouge de colère, la petite me raconta tout haut que Baï Gagno s’était permis de l’offenser. Il l’avait pincée. Et il ne s’était pas contenté de la pincer, il lui avait aussi tordu le bras en serrant les dents ! Elle voulait appeler la police. Enfin, un vrai scandale !
— Fiche-moi le camp d’ici, Baï Gagno, lui dis-je, et rapidement ! Si tu te faisais cueillir par la police, ce serait une belle affaire ! Suis cette rue qui monte. Je te rejoins.
J’avais pris un air indigné, mais en réalité j’avais bien de la peine à ne pas éclater de rire, en voyant la mine tragico-comique de Baï Gagno.
— Aussi pourquoi fait-elle des manières ? dit le bonhomme lorsqu’il fut dehors et qu’il eut repris courage. En voilà une fausse prude ! Je les connais, les femmes de ce pays-ci. Montre-leur ton porte-monnaie, et tout de suite elles te diront : « Gût morgen ! » Il n’est pas si naïf, ton Baï Gagno !.....
Il était écrit que je devais ce soir-là rester sous l’impression d’une aventure dont le héros est encore notre Baï Gagno.
À l’Opéra on donnait, comme je vous l’ai dit, le ballet « Puppenfee ». Nous prîmes des places au parterre. Le théâtre était bondé. Les habits jaune clair de Baï Gagno faisaient tache au milieu des vêtements de teinte généralement foncée des autres spectateurs. Le rideau se leva au milieu du plus profond silence. Le public avait les yeux fixés sur la scène dont la décoration était merveilleuse. Je sens qu’à ma droite Baï Gagno gesticule en poussant des soupirs, mais je ne peux détacher mes yeux du spectacle. C’étaient de perpétuels changements de tableaux comme sous l’influence d’une baguette magique. Des groupes de danseuses apparaissaient et disparaissaient. La scène était tantôt sombre et tantôt illuminée, d’une seule couleur ou de plusieurs à la fois. C’était féerique. Du groupe des danseuses, une étoile se détacha. À petits pas rapides elle s’avança vers la rampe, s’arrêta, puis s’élançant comme si elle allait s’envoler, resta sur la pointe d’un pied.....
Au même instant, un éclat de rire partant derrière mon dos me fit retourner. Tous les spectateurs qui étaient assis au-dessus de moi se tenaient les côtes en montrant quelque chose à ma droite.
Tout de suite, l’idée d’un malheur me traverse l’esprit. Je me retourne vers Baï Gagno... Dieu ! qu’est-ce que je vois ? Baï Gagno a enlevé son veston et il a déboutonné son gilet qui le serrait à cause des moskals d’essence empilés dans sa ceinture. Un des huissiers du théâtre le tirant par la manche avec deux doigts lui fait signe de sortir. Baï Gagno le regarde bien en face et lui répond par d’autres signes qui veulent dire : « Eh ben, quoi ? tu ne me fais pas peur !... »
C’est précisément en cet instant héroïque qu’une jeune fille qui était assise derrière nous partit d’un éclat de rire — et le rire, par contagion, gagna bientôt tous les spectateurs. Tableau !...
Quant à moi, mes amis, tout rouge de honte, je jette un coup d’œil du côté des loges, comme si mon regard était attiré par quelqu’un, et mes yeux rencontrent ceux de toute une famille allemande que je connaissais fort bien et qui m’avait très aimablement reçu. Je crus lire sur leurs visages l’expression de la pitié sincère que leur inspirait ma lamentable situation.
Et au même moment Baï Gagno me tirait vigoureusement par la manche en me disant :
— Allons ! viens, sortons. Laissons ces sales juifs. Si jamais il m’en tombe un sous la patte !...
— VOULEZ-VOUS savoir comment j’ai fait la connaissance de Baï Gagno, dit tout à coup Stoïtcho.
— Oui, oui, s’écria toute la compagnie.
Nous savions en effet que Stoïtcho était passé maître dans l’art de conter des anecdotes de ce genre.
— La scène se passe encore à Vienne. J’étais assis un beau matin à la terrasse du café Mendel. J’avais commandé un thé, je m’étais mis à feuilleter quelques-uns de nos journaux et j’étais plongé dans un article fort intéressant qui expliquait comment il serait possible de reviser la Constitution, et même de la chambarder depuis le premier article jusqu’au dernier, ce qui ne l’empêcherait pas d’ailleurs de rester identique à elle-même.... J’étais donc absorbé dans ma lecture, lorsque tout à coup j’entendis quelqu’un m’interpeller : « Oh ! oh ! bonjour ! » tandis qu’une main moite se posait sur la mienne.
Je levai les yeux et je vis un individu à la forte carrure, aux yeux bruns, aux cheveux bruns, à la peau brune, la moustache en croc, le visage aux traits rudes encadré par une barbe de huit jours, habillé (je ne blague pas) avec une redingote, et une redingote déboutonnée, laissant voir sous le gilet deux ou trois doigts de ceinture rouge et dans l’échancrure du col une chemise blanche (mais d’un blanc... bulgare), sans cravate, coiffé d’un kalpak noir sur l’oreille, chaussé d’une paire de bottes à la russe et tenant sous son bras un bâton de Vratsa15.
Un homme jeune encore, aux environs de la trentaine.
— Pardonnez-moi, monsieur, lui dis-je en prenant un air à la fois surpris et réservé. Je n’ai pas le plaisir de vous connaître.
— Comment ? Vous ne me connaissez pas ? Est-ce que tu n’es pas Bulgare ?
— En effet, je suis Bulgare.
— Eh bien !
— Eh bien ?
— Eh bien ! Lève-toi un peu, et viens faire un petit tour avec moi. Allons ! Qu’est-ce que tu as à faire ici ? Moi, on m’appelle Gagno Balkanski. Allons, lève-toi.
Il n’avait pas besoin de me le dire, qu’il était Baï Gagno.
— Excusez-moi, monsieur Gagno, lui répondis-je, mais je ne suis pas libre en ce moment.
— Alors pourquoi es-tu installé au café, si tu n’es pas libre ?
Je jugeai inutile de lui fournir des explications. Mais mon bonhomme ne manifestait pas le moindre désir de me laisser la paix, et brusquement il me lança cette phrase :
— Allons, viens, et conduis-moi au bain. Où peut-on trouver ça ici, un établissement de bains ?
Hein ? Le conduire au bain ! Il commençait à me porter sur les nerfs. Je réussis pourtant à me contenir. J’eus même de la peine à ne pas éclater de rire. Effectivement, Baï Gagno avait grand besoin de prendre un bain : on s’en apercevait de loin, au parfum qu’il dégageait. Qu’auriez-vous fait à ma place ? Entre compatriotes, il faut bien s’entr’aider. Et puis, pensai-je, je profiterai de l’occasion pour prendre une douche. Il fait chaud. Ça me rafraîchira.
Nous partîmes donc et nous nous dirigeâmes vers un bain d’été avec une grande piscine. Chemin faisant, lorsque nous rencontrions quelque chose d’intéressant, je me donnais la peine de l’indiquer à Baï Gagno. Mais je remarquai bien vite qu’il ne m’écoutait pas. De temps à autre, il me répondait sur le ton de l’indifférence : « Ah ! vraiment ! » ou bien : « Je sais, je sais », et par ces paroles il voulait me montrer qu’il connaissait tout ça. Ou bien il m’interrompait pour me poser une question qui n’avait aucun rapport avec ce que je lui racontais. Par exemple, j’étais en train de lui réciter un petit boniment sur le monument de Marie-Thérèse, au milieu de la Place des Musées. Mais lui, me tirant par la manche :
— La vois-tu, celle-là, là-bas, avec la robe bleue ? Qu’est-ce que tu en penses ? Voyons, dis-moi donc un peu comment tu fais pour distinguer celles qui sont... n’est-ce pas... de celles qui ne le sont pas ? Moi, je me suis fourré dedans... combien de fois ! Et Baï Gagno accompagne ses paroles d’un petit clignement d’œil plein de malice.
Nous arrivons au bain. Mon cœur se serrait, car je pressentais ce qui allait se passer. Nous prenons des tickets à la caisse. Baï Gagno, passant la main par le guichet, fait signe qu’on lui rende la monnaie. La caissière la lui donne avec un sourire, et Baï Gagno la regarde en lui faisant les yeux doux. Il prend l’argent et se met à toussoter pour exprimer son opinion. La jeune personne éclate de rire. Baï Gagno ravi retrousse sa moustache gauche et dit en hochant la tête :
— Tchê fromosa ech domnêta16 ! Stoïtcho, demande-lui donc si elle sait parler roumain. Chti roumounechti17 ? » ajoute Baï Gagno sans attendre.
À ce moment arrive un autre client. Nous entrons dans la grande salle. Un couloir circulaire. Tout autour, des cabines pour se déshabiller, fermées avec de petits rideaux. Au milieu, une piscine, séparée du couloir par un treillage en bois. On descend dans le bassin par quelques marches. Nous prenons, Baï Gagno et moi, deux cabines voisines. Je me déshabille rapidement et j’entre dans l’eau tiède, où quelques Allemands paisibles et silencieux gesticulent en soufflant.
Baï Gagno n’en finit pas. Derrière le rideau de sa cabine, on l’entend pousser des soupirs et remuer des objets en verre. Enfin le rideau s’ouvre, et Baï Gagno apparaît en académie, montrant son torse velu et ses extrémités inférieures couvertes des rayures de ses bas de couleur. Il tient à la main un petit paquet. Ce sont les plus précieux de ses moskals d’essence de roses qu’il a réunis dans un mouchoir d’une propreté douteuse. Il craint en effet de les laisser dans sa cabine. « Sait-on seulement, se dit-il, si les cloisons sont solides ? On pourrait bien y donner un coup d’épaule... Et puis, cours après tes moskals ! » Baï Gagno inspecte tout autour de lui les murs du couloir. Il cherche un clou pour y accrocher son paquet. Brusquement il se tourne vers moi :
— Eh ben ! ils ne sont pas malins, ces Allemands ! Ils n’ont pas même l’idée de planter un clou au mur, et ils nous traitent, nous autres, de naïfs !
Lorsqu’il eut définitivement acquis la preuve de la simplicité d’esprit des Allemands, Baï Gagno déposa d’un air inquiet le mouchoir aux moskals à l’entrée de sa cabine, de manière à ne pas le perdre de vue pendant qu’il prendrait son bain. Puis il me dit :
— Écoute un peu, jeune homme. Tout en te baignant, surveille bien les moskals. Et puis regarde-moi aussi, regarde un peu ce que je vais faire.
En disant ces mots, Baï Gagno leva une jambe et monta sur la balustrade...
— Regarde-moi bien...
Il se redressa, leva l’autre jambe, fit le signe de la croix et s’écria :
— Regarde-moi bien... Et que Dieu me vienne en aide ! Hop !...
Et il s’élança dans le vide, replia ses jambes et plouff ! tomba au beau milieu du bassin.
Des gerbes d’eau jaillirent en l’air et retombèrent sur les têtes des Allemands effarés. Des vagues circulaires coururent du centre jusqu’aux bords, sautèrent par-dessus la balustrade, revinrent en arrière, et, au bout de quelques secondes, lorsque l’eau fut redevenue calme et claire, les baigneurs purent voir Baï Gagno gesticulant sous l’eau avec énergie.
Mais il remonta bientôt à la surface, rapprocha ses deux pieds, et les posant sur le fond de la piscine, se redressa de toute sa taille, puis, fermant les yeux et se bouchant les oreilles, il se secoua — fff — et, à travers ses moustaches tombantes, souffla l’eau qui remplissait sa bouche — fff — enfin il essuya l’eau qui ruisselait de ses cheveux sur son visage, rouvrit les yeux, me regarda et se mettant à rire :
— Ha, ha... ha ! Qu’est-ce que tu dis de ça ?...
Il ne me laissa d’ailleurs pas le temps de répondre, car, s’élançant à plat ventre, il se mit à frapper avec les mains la surface de l’eau et à nager à la manière d’un « guémidji18 » Floc ! une main lancée en avant, et en même temps une ruade des deux jambes. Puis, floc ! avec l’autre main, en ruant encore des deux jambes. Le bassin tout entier commençait à se couvrir d’écume. Nous croyions être sous une cascade. Des vagues couraient frapper le bord du bassin ; des giclées d’eau allaient éclabousser les murs.
— C’est ce qu’on appelle nager à la « guémidji », s’écria du milieu des vagues Baï Gagno triomphant. Et maintenant, attends un peu que je leur montre ce qui s’appelle « faire le vapeur ».
Et, se retournant sur le dos, il se mit à frapper avec ses pieds des coups si violents à la surface de l’eau écumante, que des éclaboussures jaillirent jusqu’au plafond. En même temps il faisait avec ses bras un moulinet rapide pour imiter la roue du vapeur. « Toup ! loup ! toup ! loup ! » — « Pfiou, ou, ou... » et Baï Gagno fit entendre un sifflement strident.
Les Allemands restaient à leur place, comme pétrifiés. Vraisemblablement ils prenaient mon compagnon pour quelque Oriental arrivé de la veille, et sur le point d’entrer dans une maison de fous. Et je remarquai sur leurs visages moins d’indignation que de pitié.
Baï Gagno, lui, avait lu sur leurs physionomies le plus complet ébahissement dont son art était la cause. Aussi, grimpant au plus vite en haut de l’escalier, il se redressa, se planta sur ses jambes, et, regardant les Allemands de toute sa hauteur, il se mit à frapper avec fierté sur sa poitrine velue et à crier sur un ton de victoire :
— Boulgare ! Boul-gare ! et il s’appliquait sur l’estomac des coups toujours plus vigoureux.
Le ton plein d’orgueil sur lequel il avait fait cette déclaration en disait long : « Le voilà ! Regardez-le bien, le Bulgare ! C’est lui. C’est comme ça qu’il est. Vous n’avez fait qu’en entendre parler, du héros de Slivnitsa, du génie des Balkans ! Eh bien ! le voilà maintenant devant vous, tout entier, des pieds à la tête, nature ! Le croyiez-vous capable de pareils tours de force ? Et vous figurez-vous que ce soit tout ? Hé, hé ! Il pourrait faire encore bien d’autres choses ! Des niais, les Bulgares ? Hein ? Tas de juifs que vous êtes ! »
— Dis donc, toi, demande donc si on peut avoir du savon, me dit Baï Gagno, lorsque son enthousiasme patriotique fut un peu calmé. Regarde mes pieds, à quoi ressemblent-ils ?...
En vérité, ses membres inférieurs n’auraient pas pu servir de modèles pour l’Apollon du Belvédère. Les rayures de ses bas s’étaient imprimées sur sa peau qui, au naturel, était déjà brune et velue. D’ailleurs, au point de vue de la malpropreté, il ne faut pas essayer d’étonner les Bulgares : il serait inutile de mettre en frais l’imagination la plus brillante pour décrire quelque chose de plus malpropre que ce que peut nous offrir la simple réalité.
Et c’est par ces paroles que Stoïtcho termina son récit.
— ET moi aussi, j’ai eu l’occasion de rencontrer Baï Gagno, dit Colio. C’était à Dresde. Voulez-vous que je vous raconte cette histoire ?
— En voilà une question ? Bien sûr ! s’écria toute la compagnie.
— Il y a quelques années, toute la société dresdoise, je ne sais si vous en avez entendu parler, fut émue par un accident tragique dont furent victimes une étudiante bulgare et un jeune Américain. Je vous rappellerai en deux mots cette triste histoire.
La jeune fille faisait ses études à Dresde où, comme vous le savez, il y a de véritables colonies d’Anglais, d’Américains, de Russes et d’autres étrangers dont les enfants suivent les cours des écoles de la ville. Une étudiante américaine se lia d’amitié avec notre jeune Bulgare. Les Anglaises et les Américaines ont la manie de prendre sous leur protection celles de leurs compagnes qui sont abandonnées : telle leur parut notre timide, modeste et silencieuse compatriote. Elles devinrent amies, et l’Américaine l’invita chez elle les jours de fête. La jeune Bulgare fit bientôt la connaissance de toute sa famille et en particulier de son frère, un jeune homme de vingt ans qui étudiait la peinture. Est-ce ce penchant particulier aux jeunes artistes, qui les pousse vers tout modèle vivant un peu différent du type auquel ils sont habitués ? Est-ce ce goût instinctif des Américains pour l’originalité ? Qui pourrait dire pourquoi ? Toujours est-il que le jeune homme, après quelques rencontres avec notre modeste et timide Bulgare, se sentit bientôt attiré vers elle. Il ne perdait pas une occasion de la rencontrer, sous prétexte de lui faire partager ses impressions artistiques, mais plutôt pour se rapprocher d’elle ; en un mot, ils commencèrent à s’aimer. Cet amour devait leur coûter la vie !
Un certain jour de fête, pendant les vacances, toute la famille, ainsi que notre Bulgare, partit en promenade dans la Suisse saxonne. Près d’un escarpement très pittoresque, le jeune peintre et son amie tout absorbés par leur conversation, s’éloignèrent du groupe. Un rocher abrupt attira l’attention du jeune homme qui voulut en tenter l’escalade. Sa compagne le suivit. Mais ils ne purent atteindre le sommet. Au milieu de leur dangereuse ascension, le jeune Américain glissa, entraînant la jeune fille dans sa chute au fond du précipice. On les retrouva morts.
Les deux corps furent ramenés à l’hôpital de Dresde. La ville entière fut profondément émue à la nouvelle de cette mort tragique. Une foule de gens défilèrent pour les voir étendus côte à côte sur une grande table de marbre. On télégraphia immédiatement au frère de la jeune fille de venir à Dresde : elle n’avait pas de plus proche parent. On embauma les corps pour les conserver jusqu’à son arrivée. De nombreuses couronnes ornaient leur lit funèbre.
Le troisième jour on reçut de Vienne un télégramme annonçant la venue du frère de la jeune fille. Les corps furent transportés dans la maison des Américains. Comme on y attendait avec impatience le frère de la morte, une foule de « masters » et de « mistresses », de « ladies » et de « gentlemen » s’y trouvait réunie. Car ces Américains appartenaient à la haute société de Dresde. Je m’y étais rendu moi-même, avec quelques étudiants bulgares. Nous avions été invités, vous le comprenez, comme compatriotes de la jeune fille. D’autres camarades étaient allés à la gare à la rencontre du frère. Nous attendions. Une triste cérémonie ! L’appartement était rempli d’invités. On parlait à voix basse. Le silence n’était interrompu parfois que par les sanglots et les soupirs désespérés de la malheureuse mère du jeune homme.
Dans un moment de mortel silence, du côté du corridor on entendit un vacarme épouvantable : de lourdes bottes frappaient le sol — le bruit que fait un cheval qu’on vient de referrer. Puis on entendit des voix : « Où est-ce ? C’est là ? Hein ? » — « Chut !... Plus bas ! » Et l’on vit entrer dans la chambre mortuaire, le kalpak sur l’oreille... Baï Gagno.
— Bonjour ! dit-il sur un ton et avec une expression qui signifiaient moins la douleur que le mécontentement, comme si les personnes qui l’entouraient étaient responsables de la mort de sa sœur.
Baï Gagno s’approcha du lit et, au hasard, souleva le voile qui recouvrait le visage du jeune homme.
— Quel est celui-ci ? Qui est cet homme ? demanda-t-il en dévisageant les assistants, d’un air presque féroce. Et, les yeux fixes, il attendit la réponse.
Un étudiant, un Bulgare, tout rouge de honte, s’approcha de Baï Gagno, le prit doucement par la main et découvrit le visage de la morte. Baï Gagno enleva son kalpak, se signa et baisa sa sœur sur le front.
— Ah ! pauvre ! Était-ce donc là ta destinée ? Marie ! Mariette ! dit Baï Gagno en hochant la tête. Mais, voyez-vous, ce hochement de tête avait plus l’air d’une menace à l’adresse des assistants que de l’expression d’une grande douleur.
Il jeta un regard méfiant vers celui qui était couché près de sa sœur ; puis, secouant la tête et remuant les doigts de la main gauche d’un air interrogateur, à la mode orientale, il se tourna vers l’étudiant :
— Quoi ? Qu’est-ce que c’est que cette affaire-là ? Pourquoi a-t-on mis celui-là ici ? Que fait cet homme dans un pensionnat ?
— Chut !... Je vous en prie, je vous en supplie, monsieur Gagno, parlez plus bas !
— Pourquoi donc ? Je paie ici, quoi ! Où est la directrice ?
— Ce n’est pas un pensionnat ici. Vous êtes dans une maison particulière, répondit l’étudiant anéanti.
— Quelle maison particulière ?
— Mais, chut !... Pour l’amour de Dieu, parlez plus bas ! supplia l’étudiant assourdi par le sang qui affluait à son visage et sur le point de pleurer de honte.
Non seulement les manières brutales et la conduite étrange de Baï Gagno qui semblait vouloir se moquer des sentiments si dignes de respect des assistants, mais son extérieur même, n’inspiraient aucune sympathie aux Anglais et aux Américains, et en particulier aux dames.
Baï Gagno était vêtu de grossiers habits de bure, chaussé de bottes malpropres et crottées. Autour de son cou était noué un grand mouchoir de deuil, sous lequel on apercevait une chemise déboutonnée, d’une propreté douteuse. Dans sa main un bâton et sous son bras un paquet enveloppé de papier jaune. Ses moustaches étaient toujours retroussées, mais sa barbe était longue de plusieurs semaines.
— C’est monsieur, le frère de mademoiselle Marie ? me demanda quelqu’un de la maison.
Je lui répondis affirmativement, en ajoutant bien vite un mensonge pour essayer de justifier la conduite et la tenue de Baï Gagno. « Le télégramme qui lui annonçait la triste nouvelle l’avait trouvé dans sa ferme, tandis qu’il surveillait les travaux des champs, et sans prendre le temps d’aller jusqu’à sa villa (la villa de Baï Gagno !) il avait couru à la gare, avait emprunté de l’argent en cours de route à un ami et était arrivé à Dresde sans s’arrêter nulle part. Quant à sa conduite actuelle, si elle semblait étrange, il fallait la lui pardonner, en songeant au coup terrible que lui avait porté la mort inattendue de sa sœur, et aussi... aux pertes importantes que lui causerait le brusque abandon de ses travaux agricoles en ce moment. »
— Oh ! le malheureux ! me répondit avec émotion mon interlocuteur. Et il alla faire partager ses sentiments à l’égard de Baï Gagno aux membres de la famille et à leurs amis.
J’avais un poids de moins sur le cœur !
Mais ce ne fut pas pour longtemps. Le maître de la maison avait déjà communiqué l’histoire que je lui avais racontée, à la plus grande partie des assistants. Le juste mécontentement causé par les manières de Baï Gagno avait disparu, et il avait même fait place à de la bienveillance et à de la compassion : l’arrivée inattendue d’un si affreux télégramme, le départ précipité pour un si long voyage, les pertes considérables subies... Voilà bien de quoi vous faire perdre la tête ! Et ces explications les incitaient à se montrer indulgents à l’égard de Baï Gagno.
Mais, dites-moi donc, messieurs, je vous prie, comment nous aurions pu, nous, les Bulgares, excuser les dernières paroles et les derniers gestes du bonhomme. L’étudiant qui s’efforçait de calmer ses fâcheux élans, lui racontait à voix basse comment s’était produit l’accident dans les rochers de la Suisse saxonne. Pendant qu’il parlait, Baï Gagno exprimait par des mouvements variés de la tête et des mains les sentiments qui l’agitaient : tantôt il faisait claquer sa langue et laissait échapper ; « Jamais on n’a vu une histoire pareille ! » tantôt il regardait sa sœur et hochait la tête : « La pauvre ! » tantôt il jetait un coup d’œil sur le jeune homme et prenait un air menaçant : ses yeux lançaient des éclairs, comme s’il voulait dire : « C’est sûr ! ce gaillard-là... »
Les étrangers interprétèrent ces mimiques à leur façon. Il est peu probable qu’ils en devinèrent le sens, car ils n’auraient pas regardé avec tant de compassion Baï Gagno qu’ils prenaient pour quelqu’un que la douleur avait rendu fou. À un moment donné, Baï Gagno, sous l’impression du récit, fit claquer si fort sa langue que tout le monde tourna les yeux vers lui. Et il choisit cet instant précis pour appliquer un doigt de sa main droite sur sa narine droite, et, en regardant de côté et en faisant une grimace avec sa bouche, pour incliner légèrement la tête et souffler vigoureusement par la narine gauche... Puis il appliqua de même un doigt de sa main gauche sur l’autre narine... Nous étions décidément perdus !
Mais, me direz-vous, on pouvait excuser aussi ce geste par la précipitation de son départ : le malheureux avait oublié de prendre un mouchoir. Hélas ! non. Immédiatement après cette opération, Baï Gagno ouvrit son paquet qui était enveloppé dans du papier jaune, et il en tira... vous devinez quoi... une douzaine entière de mouchoirs qu’il se mit à distribuer aux assistants, aux Bulgares en particulier, « pour que Dieu lui pardonne », comme il répétait en les donnant.
— Allons, disait-il, prends-en un, et que Dieu lui pardonne ! ou bien il faisait signe à quelqu’un de venir à lui et il lui disait :
— Il y en a un pour toi aussi, mon garçon. Prends et dis : « Que Dieu pardonne à Marie19 !... »
Je ne veux pas vous en raconter davantage, dit tristement Colio. Vous n’avez pas besoin de moi pour imaginer la physionomie des Anglais et des Américains qui entouraient Baï Gagno, Je vous dirai seulement que lorsque le service funèbre fut terminé, suivant le rite orthodoxe, à l’église russe, et après l’enterrement, Baï Gagno fut invité à demeurer chez les Américains jusqu’à son départ de Dresde. Il n’y passa qu’une nuit. Comment se conduisit-il ? Je l’ignore. Mais au moment de partir, il raconta l’histoire suivante à l’étudiant qui le conduisait à la gare :
— Ah ! ne m’en parle pas, mon vieux ! J’ai failli faire une de ces gaffes... Je ne connais pas les habitudes de ces Américains, moi ! Ils m’ont donné un de ces dîners... et comme c’était à l’œil, tu penses si je m’en suis flanqué... jusque-là ! J’ai cru que j’allais éclater. Et puis, pendant la nuit... Ne m’en parle pas, vois-tu ! Le matin... nouvelle gaffe ! On frappe à ma porte. Moi, je réponds : « Entrez ! » Une femme entre. Elle m’apportait du café, du lait et des gâteaux. Elle pose son plateau sur la table. Tu vois ça. Et puis la voilà qui se met à renifler... Diable ! Qu’est-ce qu’elle pouvait bien sentir ? L’odeur de la rose, ou... autre chose ? Moi, tu sais, je ne suis pas si bête. Je me lève d’un bond, je prends un moskal d’essence et je lui fourre sous le nez. Elle sourit. Je la regarde... Diable ! Habillée comme ça, aussi simplement, c’est sûrement la servante, que je me dis... Je lui fais de l’œil. Elle rit. Alors, hop !... je lui prends la taille. Mais la voilà qui se retourne et... (que le Diable l’emporte !) qui m’applique sa main sur la figure. Ah ! ne m’en parle pas ! Je m’étais fourré le doigt dans l’œil. C’était la tante du jeune homme !... Enfin, les bons comptes font les bons amis. La gifle a terminé l’affaire. De braves gens, au fond !...
— SI je vous racontais aussi comment nous sommes allés avec Baï Gagno à l’Exposition de Prague... dit en souriant Tsvetko.
— Bravo ! Tsvetko, voilà longtemps que nous attendons cette histoire !
Et Tsvetko commença :
— Si vous vous souvenez, nous partîmes de Sofia dans un train entier de « nos » wagons et avec « notre » locomotive. Des wagons de première et de deuxième classe seulement, neufs, absolument neufs, arrivés d’Europe depuis peu, propres et confortables. Dans le même wagon, il y avait des compartiments de première et de seconde classe. Un monde fou — nous étions bien cent soixante — je ne me souviens plus du nombre exact. Des vieux, des jeunes, des femmes, des hommes, des enfants, de la marmaille... (oh ! cette marmaille !...)
Et comme nous étions fiers ! Partir pour l’Exposition avec « notre » train ! Il faudra bien qu’ils voient, les Européens, nous disions-nous, que la Bulgarie ne dort pas. Ce qui nous réjouissait le plus, c’était de voir combien nos wagons étaient propres, neufs et de construction moderne. Mais hélas ! La joie patriotique que nous causaient la perfection de nos wagons et la pensée que nous allions épater l’Europe avec notre progrès ne fut pas de longue durée.
Lorsque nous eûmes quitté la gare et dépassé les positions de Slivnitsa et de Dragoman — les lieux de nos glorieuses victoires — notre enthousiasme s’accrut à mesure que se vidaient les bouteilles et les paniers de provisions dont, en touristes pratiques, nous nous étions munis abondamment. « Nous déjeunerons avec ce que nous avons emporté, c’est sûr. Pourquoi donc donnerions-nous notre argent aux Serbes ? » s’écriait Baï Gagno plein de patriotisme et de vin de Plevna.
Comme nous approchions de Tsaribrod et qu’il commençait à faire nuit, on essaya d’éclairer les wagons. Mais il fallut constater qu’on avait oublié de préparer les lampes. Quand il fit tout à fait sombre et que les enfants commencèrent à pleurer et à crier... oh ! alors, petit à petit, tandis que nous nous enfuyions loin du territoire bulgare, notre enthousiasme patriotique aussi s’envola. Les uns souriaient tristement, d’autres ricanaient tout bas d’un air moqueur (il n’y avait pas que des Bulgares), d’autres étaient furieux. Baï Gagno murmura même à mon oreille : « Est-ce que ton cochon apprécie l’eau de puits20 ? » Quelques-uns d’entre nous lancèrent des injures à l’adresse d’un étranger qui était au service de l’Administration de nos chemins de fer. Soutenu par eux, Baï Gagno s’écria : « Je sais bien que ce n’est pas de notre faute, à nous autres Bulgares. Ce sont encore ces étrangers. Que le diable les emporte ! Ils l’ont fait exprès, pour se ficher de nous ! Et savez-vous pourquoi ? Par jalousie, comme toujours ! Ils sont tous pareils ! »
Et en disant ces mots, il regarda de telle façon l’un des étrangers que celui-ci toussa et passa dans un autre compartiment.
Quand nous nous arrêtâmes à la station de Tsaribrod, il faisait complètement nuit dans les wagons. Nous ne pouvions plus nous voir les uns les autres. Nous nous agitions, nous nous mettions en colère, et puis nous recommencions à rire. Un chapelet de plaisanteries et d’injures était égrené en l’honneur de l’administration de nos chemins de fer. On entendait crier : « Donnez-nous des bougies, vous autres, nos enfants ont peur ! » — « Hé ! l’oncle ! va donc nous acheter un paquet de bougies. Nous te donnerons un bakchich. » — « Voyons, rien qu’une pauvre chandelle ! » Seul Baï Gagno se refusait à convenir que des Bulgares pussent être responsables de cet oubli.
— Regardez-le un peu, celui-là, là-bas, dit-il lorsqu’on eut apporté quelques misérables bougies. Et il montrait un étranger de chez nous. Je voudrais l’enduire de goudron et le faire flamber. C’est intolérable ! Eh ! qu’est-ce que ça nous fait d’être dans l’obscurité ? Qui est-ce qui y fait attention ? Au contraire, avec nos bougies, nous sommes la risée des Serbes. Voyez-le donc là-bas, hein ! l’employé serbe. Il se tord. Il se tord. C’est évident !
Le bouillant patriotisme de Baï Gagno ne lui permit pas de supporter plus longtemps la raillerie d’un Serbe. Il se tourna vers lui et, fronçant le sourcil :
— Dis donc, toi, là-bas, qu’est-ce que tu as à rire, hein ?
Et il voulait sauter sur le quai et aller prendre à partie le Serbe. Quel sang de héros !
— Chut !... Tiens-toi tranquille, Baï Gagno, lui disaient ses compagnons. Pas de scandale. Pense un peu que tu entres en Serbie...
— Et puis après ? J’entre en Serbie ! Est-ce qu’ils me font peur ? Et Slivnitsa ? Et « la lutte fratricide »21 ? Et, dans la bouche de Baï Gagno, un juron fit explosion comme une bombe.
— Est-ce sa faute, au Serbe, si nos wagons sont dans l’obscurité ? disaient les autres pour le calmer.
— Qui ça ? Lui ? Je les connais, ces gaillards-là ! répondait Baï Gagno en hochant la tête.
On nous distribua une bougie par compartiment. Je crois me rappeler qu’on réussit aussi à installer et à allumer quelques lampes. Le train repartit. Les voyageurs firent couler un peu de suif sur les portières et y fixèrent les bougies. Et ce fut la première « bulgarisation » des wagons neufs. La seconde eut lieu pendant la même nuit : tous les W. C. (je vous demande pardon, messieurs) se transformèrent en cloaques.
Quoi qu’il en soit, nous traversâmes la Serbie. Mais n’allez pas croire que ce fut sans bruit et modestement. Oho ! Le Bulgare n’est pas un naïf ! Chaque fois que c’était possible, Baï Gagno ne ratait pas l’occasion de faire enrager les Serbes et de leur rappeler Slivnitsa.
Nous arrivâmes en Hongrie... À la frontière, encore quelque chose ; la roue d’un wagon prend feu ! Que le diable emporte les constructeurs ! Il fallut nous arrêter longtemps. On jeta de l’eau, on éteignit le feu, on gratta, on graissa... enfin nous repartîmes. Et les Hongrois... de rire ! On savait qui nous étions, des touristes bulgares !... Un peu plus loin, le wagon recommença à prendre feu. On finit par le laisser au diable... à réparer.
Baï Gagno, en homme expérimenté et qui était déjà passé par là bien des fois, racontait à ses naïfs compagnons :
— Maintenant, nous allons arriver à Pest. Après Pest, Vienne. Prague est au-delà de Vienne. J’ai parcouru tous ces pays-là. Je les connais sur le bout du doigt.
Nous brûlions les petites stations. Aux grandes, nous ne nous arrêtions que pour laisser à la voie le temps de s’ouvrir. La riche Moravie attira l’attention de tout le monde. Des vallées admirablement cultivées, des jardins superbes, des fabriques et des haras innombrables firent reconnaître à Baï Gagno lui-même la supériorité de la Moravie sur notre patrie : « Nous aussi, nous travaillons. Mais il faut avouer que ces gaillards-là ne sont pas au-dessous de nous, hé ! Ils ne sont pas au-dessous. Ils travaillent, les gaillards ! » Mais, s’apercevant qu’il se répandait en louanges exagérées, il ajouta : « Tout ça, d’ailleurs, c’est pour le roi de Prusse ! Ils travaillent, et c’est encore l’Allemand qui les mangera. »
Le voyage ne se passa pas sans incidents comiques. Nous — c’est-à-dire moi, Vantcho, Philiou et le fils d’Ivanitsa (je ne crois pas que vous le connaissiez) avions pris un compartiment de première classe. Dans le compartiment voisin, de seconde classe, s’était installé Baï Gagno avec quelques compagnons, largement munis de provisions. Dans sa hâte, Baï Gagno avait oublié de prendre dans sa besace de quoi déjeuner. « Après tout, n’est-ce pas, nous sommes Bulgares. Nous nous passerons nos provisions. Celui-ci me donnera un bout de pain, cet autre, du fromage. Bah ! Je ne mourrai pas de faim. »
Et, en vérité, il ne mourut pas de faim. Ses compagnons lui offrirent à manger et à boire, et lui leur donna en échange le plus chaud patriotisme, assaisonné d’un solide appétit et d’une soif ardente. Mais rien ici-bas ne dure éternellement. Les provisions de nos voisins s’épuisèrent bientôt et leurs gourdes se vidèrent. (Pour ne pas commettre une erreur, il faut que je rectifie ce que je viens de vous dire : les gourdes étaient déjà vides alors que nous filions devant Slivnitsa et Dragoman. « Vive la Bulgarie ! Hurrah ! Passe-moi un peu la gourde que je m’humecte la bouche. Hurrah ! »)
Baï Gagno commence alors à se rapprocher de notre compartiment. Il cherche quelque prétexte. Il demande une allumette, puis un verre de cognac, parce qu’il a mal à l’estomac. Et petit à petit il se rapproche, se met à nous interpeller, engage la conversation, enfin ne sort plus de notre compartiment. Il oublie ses compagnons. Dame ! À quoi peuvent-ils lui servir ? Ils n’ont plus rien de rien. Ils ont tout mangé, tout bu, tandis que chez nous, grâce à Dieu, on peut trouver encore quelque petite chose — nous avions acheté des provisions en cours de route. Baï Gagno, par pure curiosité sans doute, ne veut pas manquer l’occasion de goûter des produits étrangers :
— Ça, qu’est-ce que c’est ? Du raisin ? Bravo ! Voyez donc ! Passez-m’en un petit grappillon. Hum ! Excellent ! Bravo !
C’est encore la curiosité qui le pousse à faire connaissance de la même manière avec nos provisions, notre cognac, nos tabatières :
— Tiens, cette tabatière est en argent du Caucase, n’est-ce pas ? dit Baï Gagno d’un air intéressé, en voyant l’un de nous se disposer à fumer.
— Non, elle a été faite à Vienne, répondit le propriétaire de la tabatière.
— Vraiment ? Donne-la-moi donc un peu que je voie ça. Tiens, tiens ! Et il y a du tabac dedans, du tabac bulgare, n’est-ce pas ? Bravo ! Attendez. Je vais me rouler une cigarette. J’ai du papier à cigarettes, vous savez. Si vous en avez besoin, je suis là !
Que Baï Gagno fût là, nous ne nous en apercevions que trop : à l’odeur de ses bottes, aux arômes sui generis que répandait son corps en sueur et au mouvement savant et progressif qu’il exécutait pour occuper à lui tout seul la banquette entière. En arrivant, il s’était assis au bord ; il s’installa ensuite plus confortablement ; bientôt nous fûmes obligés tous les trois de nous asseoir sur la même banquette et le fils d’Ivanitsa dut se pousser tout au bout de l’autre pour permettre à Baï Gagno de se placer dans la position horizontale. Notre homme n’en laissa pas d’ailleurs échapper l’occasion. Nous nous demandions où s’arrêterait Baï Gagno dans la recherche de ses aises. De lui-même, à cœur ouvert, il donna satisfaction à notre curiosité :
— Pousse-toi un peu, veux-tu. Jusqu’au bout, pour que je puisse placer aussi mon autre jambe. Ah ! comme ça ! Bravo ! Par ma vieille mère ! Quel kief !... Écoutez le bruit que fait la machine : toup-toup, toup-toup ! Elle file !... J’aime beaucoup m’étendre comme ça. De l’autre côté on est à l’étroit. Et puis mes compagnons sont des rustres. Pas de conversation possible avec eux !... Qu’est-ce que vous mangez là, une poire ? Bravo ! Voyons un peu si, couché comme je suis là, je pourrai avaler une poire. Merci. Où avez-vous donc pris toutes ces provisions ?
— Nous les avons achetées, répondit l’un de nous en se contenant à peine.
— Vraiment ? Bravo ! approuva-t-il, la bouche pleine de poire juteuse. J’aime beaucoup les poires.
Baï Gagno bercé par le bruit monotone de la locomotive, ne tarda pas à s’assoupir. Et je me demandais quel tour nous pourrions bien lui jouer. Tout à coup il me vint une idée de génie. Je fis un signe à mes compagnons et je dis?:
— Si nous faisions un peu de café ? Passez-moi donc l’esprit de vin et l’appareil.
— Du café ? s’écria Baï Gagno, et il sauta de la banquette, comme si on l’avait piqué. Parfait !
— Comment pourrons-nous faire du café ? Nous n’avons pas d’eau, insinua fort habilement le fils d’Ivanitsa.
— De l’eau ? s’écria Baï Gagno. Ce n’est que l’eau qui vous manque ! Attendez. Un petit moment. Et il quitta brusquement le compartiment.
Nous partîmes d’un éclat de rire. Le jeune Ivanitsa étendit ses jambes et prit toute la banquette. Baï Gagno revint bientôt, feignant d’être très essoufflé. Il nous dit le mal qu’il s’était donné et les tribulations qu’il avait endurées dans notre intérêt. Il tenait à la main une petite cruche.
— Na, j’en ai trouvé, regardez. J’ai fouillé dans tous les wagons. À la fin, j’aperçois cette cruche, je la saisis bien vite ; une femme me crie : « Hé ! ne prends pas cette eau, c’est pour mon enfant ! » Quelle histoire est-ce que je vais bien pouvoir lui raconter ? Il me vient à l’esprit : « Pardon, madame, mais il y a là-bas quelqu’un qui s’est trouvé mal... » — « Vraiment ? » — « Oui. » — « Alors, portez-lui vite de l’eau et puis vous me rendrez la cruche. « Est-elle stupide, cette femme !... Ouf ! J’en ai chaud. Allons, maintenant, un petit café !
— Vous n’avez pas honte, monsieur ? dit l’un de nos compagnons qui ne pouvait plus maîtriser son indignation.
Baï Gagno le regarda, les traits tirés, comme s’il s’efforçait d’exprimer le mieux possible un étonnement très sincère ; après quoi il répondit de la façon la plus inattendue :
— Je me figurais bien que c’était une blague. Mais, allons-y tout de même, que je me suis dit. Eh bien « alors » donnez-moi donc à la place une petite cigarette et un verre de cognac.
Nous lui donnâmes une cigarette et du cognac et il s’en retourna dans son compartiment auprès des « rustres », comme il les appelait.
— Ces intellectuels sont de vraies brutes, disait peu de temps après la voix de Baï Gagno qui nous arrivait du compartiment voisin : je ne sais pas comment on peut supporter des gens pareils dans l’administration. Mais attendez un peu. Quand votre Baï Gagno sera de retour en Bulgarie, vous verrez quel protecteur, quel parrain il sera pour eux !
Nous approchions de la frontière tchèque. Avec nous voyageaient aussi les commissaires envoyés par le gouvernement pour apprendre comment on organise une exposition, en vue de celle de Philippopoli. L’un d’eux attacha sur la poitrine de tous les voyageurs un ruban aux couleurs bulgares. Pendant le trajet, le bruit se répandit aussi que nous serions reçus triomphalement à la frontière et à Prague. Nous étions donc préparés à cet accueil, mais la réalité dépassa toutes nos prévisions.
Voici la station frontière. La locomotive siffle. Nous apercevons à droite et à gauche de la ligne une foule de gens qui accourent vers la gare. Il tombait une pluie fine, et tous, hommes, femmes, enfants, portaient des parapluies ouverts. Nous nous arrêtons. Les curieux encombrent le quai. Immédiatement une musique joue l’hymne national Choumi Maritsa. Puis un chœur entonne Kdé domuv muj, à la grande joie de nous tous et en particulier de Baï Gagno qui nous faisait admirer la nation tchèque : « Ils savent assez correctement, disait-il, l’air du chant national « bulgare » Dé ié rodeut mi22, bien que les paroles ne soient pas prononcées très clairement et qu’on ne puisse pas tout comprendre. »
Je rougis de honte lorsque je me rappelle notre conduite lors de cette première réception. Figurez-vous la scène, messieurs. Toute la ville est là ; il est venu des gens des villages pour accueillir les frères bulgares ; on a mobilisé une musique, un chœur ; un grand nombre de jeunes filles sont rangées sur le quai, des bouquets à la main ; on attend que les « frères » descendent du train pour les recevoir, pour les saluer avec des discours, des chants, de la musique, des bouquets ; et les « frères » ont passé leurs têtes par les portières et regardent ! Je n’invente rien, messieurs ! Les fenêtres des wagons, vous le savez, sont étroites : l’un a passé sa tête, l’autre se penche sur l’épaule du premier, un troisième ne montre par-dessous que la moitié de son visage avec un seul œil... et ils regardent ! J’en suis encore en ébullition. Ah ! si on avait pu les prendre en instantané ! Les gens qui étaient venus nous recevoir hésitaient. Ils ne savaient que faire, où mettre leurs bouquets. La musique s’arrêta, le chœur aussi, peu à peu le silence se fit et on s’entre-regarda.
C’est alors que Baï Gagno descendit de son wagon. Tous les Tchèques braquèrent leurs yeux sur lui et lui firent un chemin pour le laisser passer. Et il passa... Dieu ! Avec quel air d’importance passa Baï Gagno devant des centaines d’yeux, devant des centaines de mains qui lui tendaient des bouquets ! Il prit à pleine main sa moustache gauche et la retroussa ; il joua des coudes, toussa gravement et regarda du coin de l’œil une jeune fille qui mettait un bouquet presque sous son nez. Et en même temps il esquissa un geste avec les doigts de sa main gauche, comme s’il voulait dire : « Tu es venue à notre rencontre, ma fille, tu es venue à notre rencontre ? Tu as bien fait. Reçois-nous, j’en suis fort aise ! » Et il passa, sans lui faire l’honneur d’accepter son bouquet. La jeune fille toute confuse retira sa main. Quelques instants après, Baï Gagno reparut, boutonnant d’un geste qui n’avait rien de très gracieux une partie de son costume. De nouveau on lui fraya un chemin, de nouveau il retroussa sa moustache gauche, de nouveau il toussa, se moucha dans ses doigts et remonta dans son wagon. La locomotive siffla et nous repartîmes...
Et n’allez pas croire que j’exagère et que je fais exprès d’enjoliver mon récit pour mieux caricaturer Baï Gagno. Bien au contraire. Je passe sous silence un certain nombre d’histoires, parce que maintenant encore mon cœur se serre quand j’y repense. J’ai omis par exemple de vous peindre le tableau que présentait notre train dès le second jour du voyage. Vous ai-je dit que nos touristes avaient emmené avec eux de la marmaille ? Sans parler des pleurs et des cris, je vous dirai seulement que les W. C. avaient été transformés en blanchisseries (on y lavait les chemises et les pantalons des bébés) et les couloirs des wagons étaient devenus des sécheries pour la lessive. On avait tendu des cordes sur lesquelles avaient été disposés les linges mal lavés, qui remplaçaient les drapeaux dont nous aurions dû orner notre train. Au lieu de nos trois couleurs — blanc, vert et rouge — dans nos wagons resplendissaient au soleil d’innombrables drapeaux bicolores — blancs et jaunes. Tels étaient les ornements dont était paré notre train, lorsque nous nous arrêtions aux stations tchèques et que la foule avec de la musique, des chants, des bouquets, des discours de bienvenue des maires et des autres autorités, nous accueillait. Ces drapeaux jaunes et blancs flottaient encore sur leurs ficelles lorsque notre cicerone, M. Vassilaki, haranguait les Tchèques dans des discours ronflants et bien sentis, et lorsque M. Petko, à chaque station, faisait vibrer la corde de l’amour-propre national de la nation-sœur tchèque, par quelques belles périodes oratoires dont les auditeurs un peu éloignés n’entendaient clairement que les mots : « Frères ! Jean Hus... Ah ! Jean Hus, frères ! » et lorsque Baï Gagno, furieux de ce que dans les discours on ne faisait pas allusion à nos gloires historiques, poussait du coude un instituteur en lui disant : « Eh ! toi, le magister, dis-leur donc quelque chose, voyons ; il faut leur montrer qui nous sommes ; c’est le moment ; dis-leur quelque chose sur Philippe Totia, sur Kroum le Terrible ; ou bien chante-leur quelque chanson... » Et les drapeaux bicolores se balançaient toujours !...
Notre voyage depuis la frontière tchèque jusqu’à Prague ne fut qu’une longue marche triomphale ; dans les villes, dans les villages, dans la campagne, le long de la voie que suivait notre train, les chapeaux volaient en l’air et le cri de « nazdar ! » retentissait. Je me rappelle avoir remarqué une paysanne qui travaillait dans son champ ; lorsqu’elle vit que les hommes lançaient en l’air leurs bonnets, elle dénoua le fichu qu’elle avait sur la tête et l’agita en s’écriant : « nazdaaar ! » Autre chose encore : nous traversions une ville (je ne me rappelle plus laquelle, et cela n’a rien d’étonnant, nous étions alors complètement abrutis) ; dans les rues, aux fenêtres, sur les arbres, sur les barrières et même sur les toits, un tas de gens. Il y avait, je me rappelle, à un certain endroit, une maison neuve presque terminée ; la charpente du toit était achevée ; au faîte était attaché un long bâton avec un bouquet de feuillage, qui portait un drapeau (comme chez nous, quand on construit les maisons) ; quelques ouvriers voyant d’en haut que dans la rue et à tous les étages on agitait des mouchoirs en criant « nazdar ! » s’élancèrent sur les poutres jusqu’au faîte du toit, empoignèrent la hampe du drapeau et s’efforcèrent de la détacher pour nous saluer. Mais le drapeau était solidement fixé. Impossible de l’enlever. Alors ils le secouèrent jusqu’à ce qu’il pût osciller un peu à droite et à gauche. Ces deux petits faits — la paysanne dans son champ et les maçons sur leur toit — m’émurent au plus haut point. Cela ne ressemblait pas à nos manifestations à nous et aux récits de nos journaux : « Tous les intellectuels faisaient retentir des hurrahs frénétiques »... Ou bien : « Aujourd’hui le peuple tout entier est rempli d’allégresse »...
Nous arrivons à la gare de Prague. Sur le quai peu de monde. Il n’y avait que les personnages officiels venus à notre rencontre : l’adjoint au maire, si je ne me trompe, et les membres du comité de l’exposition. Cet accueil me parut froid. Nous nous attendions à un triomphe ! Mais « toute poire a sa queue23 » : les gens avisés savent bien que lorsque cent soixante personnes descendent d’un train, s’il y a foule sur le quai, il n’en résultera que du désordre et de la confusion, Tout sera mélangé : ceux qui arrivent, ceux qui reçoivent, les bagages ; aussi avait-on laissé le quai libre : le comité seul était venu à notre rencontre. Nouveaux souhaits de bienvenue, nouveaux discours : d’un côté : « Bratry Bulhary !... Veliky Slovansky... Cyrilla a Methodie24 ! » et de l’autre : « Bratry, my jsme prisli poucitise a velikeho Ceskeho Naroda25 !... » et encore : « Bratia ! Velikia Ivan Hus !... Da, bratia, Ivan Hus ie velik26 ! » Mais Baï Gagno est mécontent de voir citer seulement Cyrille et Méthode, et il pousse encore une fois le coude de l’instituteur : « Allons, dis-leur quelque chose, voyons, toi, le magister ; est-ce que nous en avons moins qu’eux des grands hommes ? Parle-leur d’Asparouch, ou bien prends ta flûte, c’est le moment !... »
On nous informa que nous allions nous rendre tous au club municipal, la « Mestanska Beseda », et que de là on nous répartirait dans nos logements respectifs. On s’occupait du transport de nos bagages. Nous partons. Du quai nous passons dans la salle d’attente et que voyons-nous ? Une foule ! C’était noir de monde ! Littéralement on n’aurait pas pu laisser tomber un œuf. Au milieu on nous avait réservé un étroit passage. À droite et à gauche étaient rangées des dames avec des bouquets. Tout ce monde en habits de fête.
Un immense « nazdar ! » retentit, et tandis qu’on nous distribue des bouquets et qu’on nous couvre de fleurs, nous sortons dans la rue et nous regardons. Dieu ! aussi loin que peut aller notre vue, du monde et encore du monde, de nouvelles files de dames, et toujours « nazdaaar ! nazdaaar ! hurrah ! » et une nouvelle grêle de bouquets. Une réception royale !...
Nous montons, au milieu des cris et des fleurs, dans des landaus, et nous partons. Mais étions-nous assis d’une manière très gracieuse ? Et quel spectacle bariolé offrions-nous avec nos familles entières et nos marmots ? Je vous le laisse à penser. Nous étions abasourdis par cette réception aussi inattendue que grandiose ! Nous donnions des coups de chapeau à droite et à gauche, jusqu’à ce que l’idée nous vînt de rester découverts. (Bien d’autres idées encore nous vinrent à l’esprit : nous nous entendons si bien aux questions d’étiquette !) Un sourire s’était figé sur mes lèvres qui tremblaient convulsivement. Je ne savais pas si je voulais rire ou pleurer... ou bien rentrer sous terre !
Nous arrivons à la « Mestanska Beseda » et nous nous asseyons autour des tables dans le jardin en attendant la venue de nos bagages et la distribution de nos logements. Quelques malheureux cochers attendirent une heure entière à la porte qu’on les eût payés ; mais un grand nombre de nos touristes trouvaient inutile de régler les voitures. « La belle affaire, disait Baï Gagno, qu’est-ce que ça leur coûte de nous payer les landaus ? En fin de compte, nous sommes des Slaves ! Qu’ils nous montrent un peu s’ils ont ici l’esprit slave, hein ? Eh quoi ? Tout est à l’œil ! S’il nous faut payer, ce n’est pas bien malin ! Un simple « nazdar », ce serait bien sec... »
Les bagages arrivèrent et on se mit à nous distribuer nos logements. Nos hôtes avaient pris soin de nous trouver des gîtes. Je ne vous dirai pas les discussions avec les cochers, avec les garçons du club, avec les membres du comité pour des bagages en retard ou mal répartis, pour les logements dont on n’était pas satisfait, pour les marchandages, et cætera. Que je vous fasse entrer seulement pour une minute dans notre chambre. (Ne vous effarouchez pas, madame.) Nous étions quatre dans une vaste pièce où nous avions toutes nos commodités. Notre chambre donnait sur la cour... En face, il y avait le même nombre d’étages. À un moment donné, Anouchka, la bonne qui nous servait et qui était en train de retirer les vases de fleurs pour pouvoir fermer les fenêtres, leva tout à coup les yeux :
— Pardon, monsieur, me dit-elle en tchèque, là-bas en face, est-ce que ce n’est pas un Bulgare ? Il fait des gestes. Il a le torse tout velu, velu comme un singe. Ha ! ha ! ha !
Je regarde dans la direction indiquée et qu’est-ce que je vois ? Baï Gagno, devant la fenêtre ouverte, sans fermer ni rideaux, ni jalousies, s’est débarrassé de ses vêtements. Au moment où je le regardais, il faisait de l’œil à notre servante et caressait sa poitrine velue ; il espérait ainsi, cela se voyait, faire sa conquête...
Les journaux du soir saluaient les chers hôtes (chers ! en effet) — « Bratry Bulhary » — les frères bulgares. Ils indiquaient aussi le programme suivant lequel nous visiterions l’Exposition et les curiosités de la ville de Prague. On donnait le compte rendu de notre arrivée : on disait où nous avions été, comment on nous avait reçus, ce que nous avions répondu. On ne voyait que le nom de notre cicerone, M. Vassilaki : ses innombrables discours avaient attiré l’attention. Et de fait, il faut bien le dire, s’il n’y avait pas eu M. Vassilaki pour leur jeter de la poudre aux yeux, nous n’avions plus qu’à nous cacher.
À l’entrée de l’Exposition nous fûmes reçus par les membres du comité. Nouveaux discours sur « la nation tchèque » et « la nation bulgare ». Comme vous voyez, ils ne se trompèrent point et ne nous prirent pas pour des Serbes en nous recevant. Ils évitèrent l’erreur qui, dit-on, fut commise à l’entrée de l’Exposition de Philippopoli. Les gens de Sliven et ceux d’Iamboli ont toujours été en perpétuel antagonisme — jalousie ou rivalité, je ne sais pas bien pourquoi. Une députation d’habitants de Sliven se présente à l’entrée de l’Exposition de Philippopoli et un membre du comité, les prenant pour des gens d’Iamboli, s’embarque dans un discours des plus élogieux : « Braves habitants d’Iamboli, glorieux habitants d’Iamboli ! » Et les gens de Sliven se taisent, toussotent dans le creux de leur main et clignent de l’œil... Tableau !...
Nous entrons dans l’Exposition. Un membre du comité nous invite à faire un tour d’ensemble rapide dans les principales sections. Mais qui donc conduit-il ? Nos touristes — de vrais Anglais !... Une fois dans la section de botanique, voilà nos bonshommes qui ne veulent plus en sortir !
— Ivantcho, Ivantcho, viens voir, viens voir un peu, regarde cette tulipe, est-elle grande ?
— Te souviens-tu ? Chez ta tante, il y en a une toute pareille, s’écrie un autre.
— Marie, Marie, viens voir, viens voir ici, regarde le mimosa, c’est du mimosa, le vois-tu ? Te souviens-tu ? Il y en avait dans le petit atlas que je t’ai acheté pour Pâques, s’écrie un troisième d’un autre côté.
— Regarde un peu le basilic ! Ts... ts... ts... ! Les Tchèques aussi ont du basilic, bravo ! fait remarquer un autre, et tout le monde se pousse pour voir le basilic.
— Tiens, je ne vois pas de géranium ici, observe Baï Gagno d’un air mécontent. Ils ne sont pas bien malins, s’ils n’ont pas le géranium ! Hi, hi ! chez nous ! dans le Balkan ! ah ! par ma vieille mère27 !
Et pendant ce temps-là, le membre du comité est sur des épines ! Il attend que ses « chers hôtes » se décident !...
N’y tenant plus, je sortis de la section de botanique et j’allai flâner dans les autres pavillons. En mon absence, on photographia les « chers hôtes » et le lendemain dans un journal illustré on put voir le groupe tout entier.
On nous conduisit au Hradschin, où se trouvent les palais des rois tchèques. On nous montra divers endroits historiques : la chambre du Conseil, où se produisirent les événements qui furent le signal de la Guerre de Trente ans ; la fenêtre par laquelle furent précipités les patriotes tchèques. On nous conduisit dans le vieil hôtel de ville, dans l’ancien et dans le nouveau musée. On donna en notre honneur une représentation d’opéra au « Narodni Divadlo28 » ; on nous offrit une soirée à la « Mestanska Beseda ». Nous allâmes chez M. Naprstek, un des citoyens les plus considérables, qui fut compromis autrefois auprès du Gouvernement autrichien, qui s’enfuit en Amérique où il fit fortune et qui, de retour à Prague, comblé d’honneurs et jouissant de la plus grande considération, s’occupe maintenant de philanthropie. Il a son musée et sa bibliothèque. Le Maître nous accueillit avec sympathie et nous fit goûter une hospitalité toute slave. Les discours les plus cordiaux furent échangés. Dans l’une des salles, il y avait un grand registre sur lequel les visiteurs inscrivaient leurs noms. À un moment donné, alors qu’on se pressait autour du registre et qu’on s’arrachait la plume dans l’espoir d’immortaliser son nom, Baï Gagno me tira par la manche et me demanda d’un air inquiet :
— Pourquoi donc s’inscrit-on là ?
Je savais par expérience que Baï Gagno n’accepterait jamais de signer s’il ne pensait pouvoir en retirer quelque bénéfice. Aussi lui dis-je très sérieusement :
— Celui qui ne veut pas continuer à visiter les vieilleries de Prague peut s’inscrire sur ce registre, et il sera invité à déjeuner chez M. Naprstek.
— Vraiment !? s’écria Baï Gagno. Au diable les vieilleries ! Passez-moi un peu la plume ! Donnez-la-moi vite, allons ! Est-ce qu’on ne peut pas signer avec un crayon ?... Donne, donne, je suis pressé ! Et il jouait des coudes pour se frayer un chemin vers la table où se trouvait le registre. On s’écrasait, on se bousculait, on s’arrachait la plume des mains, on couvrait le livre de taches d’encre. Enfin la main fiévreuse, moite et velue de Baï Gagno ornementa l’une des pages du registre avec deux mots majestueux :
Tsvetko nous déclara qu’il ne voulait pas continuer son récit.
— Et la soirée ? Ne nous as-tu pas dit qu’on en avait donné une en l’honneur des Bulgares ? fit remarquer l’un de nous.
— Je n’ai pas assisté à cette soirée. Mais Baï Gagno y était. À propos, le même jour, nous allâmes Baï Gagno et moi chez un coiffeur. Il avait l’intention de faire, ce soir-là, la conquête des dames tchèques et il prenait ses dispositions pour briller de tout son éclat. Il s’acheta une cravate, il astiqua sa décoration (qu’est-ce que vous pensez donc de Baï Gagno ?) et nous nous rendîmes chez le coiffeur parce que ses cheveux et sa barbe étaient en broussailles.
Il s’assied sur une chaise. Le coiffeur lui met avec soin une serviette autour du cou et commence son travail. Ne sommes-nous pas restés là une heure entière ? C’est qu’il n’était pas si facile de satisfaire Baï Gagno !
— Ici, ici. Dis-lui donc qu’ici — et Baï Gagno montrait son cou — il faut passer un peu le rasoir. Et puis recommande-lui d’ouvrir l’œil et de ne pas me couper quelque petit bouton... ou bien, que le diable l’emporte !
Le coiffeur vit dans la glace l’expression de mécontentement que reflétait le visage en sueur de Baï Gagno, et il me regarda sans comprendre.
— Co pán mluvi29 ? me demanda-t-il modestement, croyant qu’il avait commis quelque faute contre le goût de Baï Gagno.
— Dis-lui donc qu’il laisse un peu de côté ses discours, dit Baï Gagno en se tournant vers moi et sur un tel ton qu’on aurait pu croire qu’il me payait pour traduire ses paroles. Dis-lui qu’il me laisse la barbiche et qu’il me la taille un peu plus en pointe, comme à Napoléon, comprends-tu ? Et puis qu’il donne un coup de brosse à mes moustaches, comme ça, pour qu’elles bouffent, comme hé, hé ! celles du roi d’Italie ! As-tu vu son portrait ? qu’il me fasse des moustaches pareilles ! Dis-lui, hein ?
Je n’eus pas le courage de traduire mot pour mot les modestes désirs de Baï Gagno ; j’aurais donné au coiffeur une lourde tâche : est-ce facile, à l’aide d’un rasoir et d’un peigne, de faire ressembler quelqu’un à la fois à Napoléon III et au roi Humbert ? Et de qui donc s’agissait-il ?...
L’opération terminée, Baï Gagno tira sa bourse, dénoua le cordon, l’ouvrit, fouilla au fond, en sortit une poignée de monnaie et, en nous tournant le dos, se mit à trier les pièces. Il en choisit une et la tendit au coiffeur, mais de telle façon qu’il semblait dire : « Allons, c’est pour que tu te souviennes de moi ! » C’était une pièce de vingt kreutzer. Mais pensant qu’il se trompait peut-être, et craignant qu’on ne le prît pour un naïf, il fit signe au coiffeur avec ses doigts : « Et puis, rends-moi la monnaie »...
Le barbier ouvrit brusquement son tiroir, y jeta la pièce, en prit deux autres de dix kreutzer et les lançant d’un air furieux sur le marbre de la caisse, disparut par la porte du fond. Les pièces roulèrent à terre. Au premier moment, Baï Gagno fut surpris ; il ne parvenait pas à comprendre ce geste. Et puis se baissant, il ramassa l’argent et dit :
— Tu te fâches, Pierre ? C’est bon, ton sac restera vide ! Allons, laissons-les tranquilles ! Ils ne savent que plumer les gens ! Je les connais, ceux-là ! Des Slaves ?... Quelle bonne blague !...
— CE que Tsvetko vous a raconté, répartit le timide Iltcho, c’est la dernière histoire ; mais je sais que Baï Gagno était déjà venu à Prague, qu’il y était resté longtemps et qu’il y avait vendu pas mal d’essence de roses. Voulez-vous que je vous raconte cette histoire-là ?
— Puisqu’il s’agit de Baï Gagno, pourquoi le demander ? Allons, raconte !
— Bon. Alors, écoutez. Baï Gagno arrive de Vienne à Prague, il descend à la station, met sa besace sur son épaule et sort de la gare. Les cochers se précipitent au devant de lui pour lui offrir leurs services. Il leur fait signe de la tête qu’il n’en veut pas. Les cochers comprennent qu’il leur fait un signe affirmatif31, et une voiture vient se ranger devant lui. Baï Gagno furieux se met en colère et fait des gestes irrités. Un agent de police l’ayant remarqué, ordonne aux voitures de s’en aller. Mais Baï Gagno se dit que cet homme pourrait lui indiquer où habite Jireczek, notre historiographe. Jireczek a vécu en Bulgarie, il aime les Bulgares, Baï Gagno ira le trouver, il lui dira : « Bonjour », « Que Dieu te comble de ses bienfaits32 » ; et peut-être le professeur l’invitera-t-il chez lui à demeure ; à quoi bon donner son argent aux hôtels ? Tandis qu’il songeait ainsi, un portefaix à casquette rouge s’approcha de lui et lui offrit de porter sa besace. Baï Gagno lui demanda s’il savait l’adresse de Jireczek ; l’homme répondit d’une manière évasive : il espérait bien pouvoir trouver ; et il essaya de nouveau de lui prendre sa besace. Baï Gagno ne la lâcha pas, d’abord parce que ses moskals étaient dedans et que l’homme pourrait bien « filer avec », et puis parce que le portefaix avait des habits propres : qui sait combien il lui demanderait ?
— Marchez devant, seigneur ; je vous suivrai, dit poliment Baï Gagno ; laissez ma besace, je la porterai.
Ce n’est pas sans calcul que Baï Gagno est si poli. Il compte d’abord bien disposer le portefaix à son égard ; il veut aussi lui montrer qu’il n’est pas un richard, un gros personnage, de façon que l’autre ne songe pas à le plumer.
Ils vont, et à chaque carrefour ils s’informent de la demeure de Jireczek ; à la fin, un passant ayant deviné qu’il s’agit du professeur Jireczek, leur indique l’endroit où ils trouveront son adresse ; ils s’enquièrent et finissent par trouver.
Baï Gagno lance au portefaix un « merci ! porte-toi bien », et, sans lui laisser le temps de répondre, il entre dans la maison de Jireczek.
— Tiens ! bonjour, père Jireczek, comment ça va-t-il ? comment vous portez-vous ? s’écrie Baï Gagno du ton le plus amical, en entrant dans le cabinet du maître.
Celui-ci lui tend la main d’un air étonné, l’invite à s’asseoir, et en veut à sa mémoire de ne pas lui rappeler le nom de cet aimable hôte.
— Tu ne me reconnais pas ? dit Baï Gagno, qui mélange les « tu » et les « vous ». Est-ce que ce n’est pas vous qui avez été Ministre à Sofia ?
— Oui.
— Eh ! moi aussi je suis de là-bas ! conclut triomphalement Baï Gagno ; cela veut dire que nous sommes compatriotes, hé, hé ! n’est-ce pas ? Te souviens-tu de l’article du journal Slavianine ?
— Oui, oui, je me souviens, répond Jireczek à la fois réservé et indulgent.
— Ah ! t’ont-ils assez attrapé !... Mais toi, tu restais bien tranquille, ça ne te faisait rien du tout ! Comme j’ai pris votre défense, moi !... on criait : Jireczek par ci, Jireczek par là. « Pardon, pardon ! que je répondais, ce n’est pas vrai. »
Jireczek connaît bien les Bulgares, aussi ne s’étonne-t-il nullement de la familiarité de Baï Gagno. La conversation continue pendant quelques minutes sur le même ton, puis elle prend une tournure plus pratique : Baï Gagno fait compliment à Jireczek de sa maison et lui insinue assez clairement que « somme toute, il y a même suffisamment de place pour recueillir un étranger » ; il lui parle du caractère hospitalier des Bulgares : « Les autres, vois-tu, ne sont pas comme nous, les Bulgares, lui dit-il d’un air de regret ; si un étranger entre dans une maison bulgare, on lui donne à manger, à boire, à coucher. » Jireczek tâche de lui faire comprendre que sa maison est déjà petite pour sa famille. Baï Gagno semble ne pas entendre et repart sur le thème de l’hospitalité bulgare. Puis la conversation dévie sur le commerce de Baï Gagno. Il apprend au professeur qu’il est venu vendre de l’essence de roses, et il ajoute : » Demain, si tu veux, tu me conduiras voir les fabriques, ça me va ; tu me serviras d’interprète, parce que je ne sais pas la langue, hein ? « Jireczek s’empressa de répondre qu’il ne connaissait pas les fabricants d’huiles essentielles, parce que ce n’était pas du tout sa partie, et que de plus il n’avait pas le temps ; mais il lui indiquerait l’endroit où se réunissaient les étudiants bulgares ; l’un d’entre eux pourrait lui rendre ce service.
— C’est bon, si vous voulez, conclut Baï Gagno : je ne te force pas. Je ferai cadeau à Madame (est-ce qu’elle est ici ?) d’un moskal d’essence. Je la connais aussi, elle. (Jireczek n’arrive pas à deviner de quelle dame il s’agit.) Et puis si vous avez ici des parents, des amis, dites-leur que j’ai apporté de l’essence, il n’y a rien de déshonorant à cela ! Je reviendrai souvent vous voir, nous causerons de la Bulgarie. Et puis, si vous voulez, je veux bien aussi habiter chez vous, pendant que je serai à Prague. Hein ?
— Pardonnez-moi, mais...
— Je veux dire, n’est-ce pas, si vous voulez, reprit Baï Gagno un peu embarrassé. Pour moi, je suis mieux à l’hôtel. Mais allons ! que je me suis dit, Jireczek, notre Jireczek...
— Merci de votre bonne pensée ; je vous aurais gardé chez moi bien volontiers, malheureusement je ne dispose pas d’un bien grand appartement. Mais par exemple aujourd’hui vous serez notre hôte et vous déjeunerez avec nous.
— Déjeuner ? pourquoi pas ? acquiesça Baï Gagno. Votre seigneurie, on peut le dire, a mangé aussi, si ce n’est à ma table, du moins à la table bulgare33.
Jireczek était occupé à un travail urgent que l’arrivée de Baï Gagno avait interrompu. Aussi le maître est-il sur les épines ; il ne sait comment expédier délicatement pour quelque temps son loquace visiteur. Il sonne. Un domestique se présente. Il l’envoie prévenir les siens qu’il leur est arrivé un hôte de Bulgarie. Peu après entre la mère de Jireczek. Baï Gagno se soulevant à peine, porte deux fois la main à son front34, et dit avec suffisance : « Salut ! comment vous portez-vous ? donnez-moi la main, que je vous la serre, comme ça, à la bulgare ! Comment allez-vous ? Allons, tant mieux ! »
La dame l’accueille aimablement et lui pose une série de questions, paraissant s’intéresser vivement à la patrie de son hôte.
— Allons, dites-moi maintenant bien franchement, demande Baï Gagno, quelle est la plus belle ville : Prague ou Sofia ?
La dame ne sait que répondre : elle n’a jamais été à Sofia. Mais Baï Gagno en posant cette question regarde Jireczek avec un sourire malin, comme s’il voulait lui suggérer son opinion sur les femmes : « N’est-ce pas une femme ? hein ? qu’est-ce que tu veux qu’on raconte avec elle ? »...
— Sa seigneurie déjeunera aujourd’hui avec nous, dit Jireczek en se tournant vers sa mère ; et, pour pouvoir continuer son travail, il la pria en allemand de conduire Baï Gagno dans une autre pièce.
La dame proposa à Baï Gagno de passer dans la chambre voisine. Notre homme regarda d’un air méfiant Jireczek, puis sa besace qui contenait ses moskals, et réfléchit en fronçant les sourcils : « Ils se sont dit quelque chose en allemand, qui sait ? Je ne crois pas tout de même... Après tout, il a été ministre chez nous... Oui, mais les ministres ! Qui sait ce qu’ils valent ? Celui-là, tout de même, je ne peux pas croire »... Et, se levant sans avoir rien décidé, il se dirigea à la suite de la dame vers la chambre voisine. Mais arrivé à la porte, il se retourna et chercha à lire sur le visage de ses hôtes quelle était leur intention. Il surprit justement quelques signes qu’ils échangeaient au même instant ; cette mimique signifiait : « Tâche de l’occuper pendant un bout de temps, j’ai un travail très pressé » ; mais Baï Gagno l’interpréta tout différemment.
— Ces affaires-là peuvent vous gêner ici, fit-il remarquer, en indiquant du regard sa besace.
— Mais non, nullement. Je vous en prie, ne vous dérangez pas, répondit Jireczek.
— Si, si ! Elle vous gênera, j’en suis sûr ! Attendez. Je vais l’emporter avec moi dans l’autre pièce, — et il se disposait à la prendre, mais ses hôtes l’en empêchèrent aimablement. Ce n’est pas que j’aie peur, non, mais, je voulais dire...
Ils passent dans le salon et la dame ferme la porte derrière elle, pour qu’on n’entende pas de bruit dans le cabinet de travail. Elle tâche de trouver le moyen d’occuper Baï Gagno avec quelque chose d’intéressant : elle lui présente divers albums, lui montre des tableaux, met près de lui une boîte pleine d’images, mais l’esprit de Baï Gagno est ailleurs, et, aux amabilités de la dame, il semble répondre d’un air indifférent :
— Merci, merci, je n’en veux pas ; regardez-les, vous. Combien en ai-je vu de semblables, de tableaux et de portraits ! Ne me prenez pas pour un blanc-bec !
Baï Gagno regarde avec impatience à sa volumineuse montre d’argent et engage une conversation fort intéressante et pleine d’à-propos :
— Je suis très curieux d’étudier l’Europe. Ainsi par exemple chez nous quand vient l’heure de midi, on s’assied pour déjeuner. Chez vous c’est arrangé autrement. Vous autres, à quelle heure déjeunez-vous, par exemple ?
— Nous déjeunons ordinairement à cinq heures, mais nous pouvons déjeuner plus tôt aujourd’hui. Excusez-moi si je vous laisse une minute, dit la dame, et elle sortit par l’autre porte.
Baï Gagno est seul dans le salon. Il regarde les tableaux sans penser à rien, tout en crachant de temps en temps sur le tapis (il n’a pourtant pas encore faim !) et en remuant ses bottes. Il prête l’oreille au moindre bruit venant du cabinet. À un moment donné, il entend Jireczek se lever de son fauteuil, faire quelques pas et s’arrêter : « Mais que je suis donc bête ! pourquoi n’ai-je pas apporté ma besace dans cette chambre ? » Baï Gagno est sur les épines ; à la fin, n’y tenant plus, il se lève, marche sans bruit sur le tapis jusqu’à la porte du cabinet, colle son oreille contre le trou de la serrure, et écoute ; il n’entend que son propre souffle précipité et que les battements du sang dans ses oreilles. Mais Baï Gagno n’est pas encore rassuré, car il ne voit rien par le trou de la serrure. En prenant avec un peu d’hésitation le bouton de la porte, il l’ouvre, passe doucement la tête dans le cabinet, et voit Jireczek, penché près de sa besace, sur un rayon du bas de sa bibliothèque. Il se retourne. Baï Gagno sourit :
— Hi, hi, vous travaillez, vous travaillez ! hi, hi ! Attends, que je me suis dit, je vais jeter un coup d’œil... Travaillez, ce n’est rien ; je referme la porte.
Jireczek étonné le regarde, sans que la cause de cette étrange curiosité lui vienne à l’esprit.
Le déjeuner est servi. On passe dans la salle à manger, et l’on s’assied autour de la table : le père et la mère de Jireczek, sa sœur, Baï Gagno et lui. Avant de commencer à manger, Baï Gagno n’oublie pas de faire un signe de croix, mais tout en se signant, il esquisse un sourire ; et ce sourire veut montrer à ses hôtes qu’il n’est pas de ces gens simples, et que sa croyance ne va pas jusque-là ; mais ça ne peut pas faire de mal. (Soyons en bons termes avec le diable, mais brûlons aussi un peu d’encens au Bon Dieu. À l’occasion, ça peut servir).
— Je suis « lébéral », j’appartiens au parti « lébéral », explique Baï Gagno, mais de temps en temps j’y vais d’un signe de croix, ça ne peut pas faire de mal, nous sommes des hommes, après tout... Qu’est-ce que c’est que ça ? de la soupe ? Ah ! j’aime ça, la soupe, moi. La « tchorba35 », c’est de la cuisine turque. Et nous autres maintenant, nous mangeons surtout de la soupe. Ah ! pardon, excusez-moi, j’ai sali la nappe... ts... ts... ts... Attendez ! pour qu’on ne le voie pas !...
Tout préoccupé qu’il était de passer pour quelqu’un de civilisé, Baï Gagno ne fut pas capable de prendre convenablement l’assiette de soupe que lui passait la maîtresse de maison, et il en répandit un peu sur la nappe. Avant qu’on eût pu l’en empêcher, il en ramassa une partie avec sa cuiller et la reversa dans son assiette. La dame ne voulait pas lui permettre de manger cette soupe, mais lui, par délicatesse, entoura de ses deux mains son assiette et refusa qu’on la lui changeât.
— J’ai des piments dans ma besace, fit remarquer brusquement Baï Gagno. Il brûlait du désir d’écraser un petit piment, en morceaux, dans sa soupe ; son estomac la trouvait absolument fade ; mais il craignait, en sortant ses piments, qu’on ne le prît pour un rustre. Aussi voulait-il auparavant sonder ses hôtes.
— Oui ? Vous avez des piments ? répondit Jireczek.
— Comment donc ! j’en ai toujours avec moi, des piments. Vous savez bien qu’on ne peut pas imaginer « la Bulgarie, ma tendre mère » sans « lutitchko36 », dit ironiquement Baï Gagno. Et sans plus attendre, il quitta sa chaise, se précipita dans le cabinet, s’accroupit devant sa besace, le dos tourné vers ses hôtes, et apporta sur la table deux piments.
— Deux suffiront pour nous cinq ; ils sont terriblement forts, remarqua-t-il, en jetant dans son assiette la moitié d’un piment avec ses graines. Puis il offrit aimablement le reste à la maîtresse de maison : na ! je vous en prie, écrasez-le, hé, hé ! à la bulgare ! Non, non, écrasez-le, et vous verrez un peu ce que c’est, je ne vous dis que ça ! Mais vous savez ; je ne vous force pas : quand on agit contre son gré, on ne fait rien de bon. Attendez. Je vais écraser mon piment, moi, et je vous montrerai ce qu’on appelle de la soupe.
Et en effet, Baï Gagno mit une telle dose de piment dans sa soupe, qu’elle eût empoisonné une personne qui n’en aurait pas eu l’habitude. Et il se mit à humer ; mais un Bulgare qui hume, c’est sérieux. Trois cents chiens qui se battraient, ne pourraient pas couvrir le bruit qu’il fait. De grosses gouttes de sueur perlaient sur son front et menaçaient de tomber dans son assiette. Baï Gagno humait une gorgée, de la pointe de sa cuiller, posait ensuite celle-ci et faisait descendre le liquide pimenté au moyen de deux ou trois bouchées de pain ; puis il reprenait sa cuiller, humait encore un peu de soupe, reniflait, et absorbait deux ou trois nouvelles bouchées de pain.
— Donnez-moi donc encore un petit bout de pain. Vous mangez absolument sans pain, dit avec étonnement Baï Gagno ; aux Bulgares, il faut donner du pain ; nous autres nous mangeons beaucoup de pain ; je ne veux pas me vanter, mais avec une « tchorba », pardon ! avec une soupe pareille, j’avalerais une boule de pain entière. Je le parierais.
Personne ne tint le pari, ce qui n’empêcha pas Baï Gagno d’engloutir un gros morceau de pain.
— Et ce petit vin, d’où le faites-vous venir ? demanda avec curiosité Baï Gagno, non pas que la réponse l’intéressât, mais simplement pour avoir l’occasion de s’en faire verser encore un verre.
— Nous l’achetons, répondit le professeur ; vous le trouvez bon ?
— Ah ! de première qualité ! Vous l’achetez, ah ? Passez-moi donc un peu la bouteille. Je me suis si bien mis le feu à l’estomac avec le piment, comme avec un fer rouge, que je sifflerais bien maintenant la bouteille tout entière. Eh ! chez nous, le vin, c’est un demi-lev37 l’oka38. Quand on a avalé une petite oka, ça va mieux !... Ah ! j’ai le hoquet, pardon ; ce n’est pas très distingué, je sais bien ; mais faites excuse, c’est la nature qui veut ça, on ne peut pas se retenir !...
Le déjeuner chez Jireczek, grâce à Baï Gagno, fut assez animé. On apporta le café dans le salon. Pour le remercier de son savoureux et surtout copieux repas, Baï Gagno voulait offrir au maître une cigarette. Mais son tabac est dans sa besace. À dire vrai, il avait sa tabatière dans sa poche, mais il lui fallait trouver une raison pour aller voir sa besace. Peut-on abandonner ainsi ses moskals chez des étrangers ? Tout arrive en ce monde.
Baï Gagno ne veut pas entendre le refus du professeur de fumer de son tabac : « Allons donc ! ne pas fumer de tabac bulgare ! c’est impossible ! »
Baï Gagno allume une cigarette et se met à humer son café avec volupté. Voilà ce qui s’appelle humer !... Se trouver dans d’aussi agréables dispositions, passer de longues heures à faire la conversation avec quelqu’un, être dans une pièce où personne ne peut écouter ce que vous dites (et si même on écoutait, on ne pourrait pas comprendre) dans des conditions aussi favorables, se retenir et ne pas parler politique, c’est au-dessus des forces de Baï Gagno. Il ne peut pas s’en empêcher ; il laisse déborder son cœur :
— Voyons, père Jireczek, dis-moi un peu, ta seigneurie est-elle « lébérale » ou conservatrice ? Hé, hé ! tu es « dans la conserve », à ce que je vois. Et moi, si tu veux le savoir, je ne peux pas les comprendre, pas plus les uns que les autres ; mais surtout ! il ne faut pas les mettre en colère... Tu sais, quand on achète et qu’on vend, comme moi, il n’y a pas à plaisanter... Et puis, veux-tu que je te dise la vérité ?... (Il n’y a personne ici, n’est-ce pas, pour nous écouter ?) Veux-tu que je te dise la vérité ? Ce sont des fumistes, les uns comme les autres... Écoute-moi bien ! Ce sont des fumistes jusqu’au dernier !... Mais qu’est-ce que tu veux que j’y fasse ? C’est le pot de terre contre le pot de fer ! J’ai mon commerce, mes entreprises, mes procès en instance : il n’y a pas à dire, si tu n’es pas avec eux, tu es fichu ! Et puis ça m’irait assez, vois-tu, d’être élu député ou maire. Il y a quelque chose à faire dans ces situations-là. Ces gens-là amassent de l’argent, tu sais bien. Oui, mais si tu ne leur tires pas un coup de chapeau, le diable lui-même ne pourrait pas te faire élire ! C’est comme ça ! Je connais le fin fond de ces histoires-là, je m’y entends...
Jireczek a-t-il jamais mis en doute que son hôte s’entendît à « ces histoires-là » ?
QUAND Baï Gagno fut définitivement persuadé qu’il ne lui était pas possible de loger chez Jireczek, il reprit sa besace sans avoir l’air d’entendre le maître du logis qui l’invitait à la laisser chez lui jusqu’à ce qu’il eût trouvé un logement, et il partit, accompagné du domestique, pour la « Narodni Kavarna39 », le café où se réunissent les étudiants bulgares. Il était déjà sept heures lorsqu’il entra dans le café, sa besace à la main et son kalpak sur la tête. Comment pourrait-on ne pas deviner qui il est, ni d’où il est ? À gauche de la porte, autour d’une table, étaient assis quelques étudiants bulgares.
L’un d’eux voyant entrer un compatriote, poussa ses voisins du coude : « Un Bulgare, un Bulgare ! » Ils se retournèrent tous ensemble, au moment où Baï Gagno, avisant un garçon qui portait des cafés sur un plateau, s’efforçait d’écorcher les mots bulgares le plus qu’il le pouvait pour les rendre compréhensibles à l’étranger et demandait à haute voix : « Où sont donc les jeunes gens bulgares ? » en accompagnant sa question d’un mouvement de la tête et de sa main libre. Un éclat de rire parti du côté gauche donna au garçon la clef de l’énigme. Baï Gagno se retourna et reconnut ses compatriotes à leurs yeux noirs, à leurs cheveux bruns, à leur air étriqué.
— Tiens ! bonjour ! c’est ici que vous étiez ? s’écria-t-il très cordialement, et, déposant sa besace, il se mit à serrer les mains des étudiants. Qu’est-ce que vous avez à me regarder ? Ne vous effrayez pas, je suis Bulgare... Faites-moi donc un peu de place, que je m’asseye avec vous.
— Comment vous appelez-vous, monsieur ? demanda l’un des étudiants.
— Moi ? Pourquoi veux-tu le savoir ? Gagno Balkanski. J’ai apporté dans votre Prague un peu d’essence de roses ; elle est ici, dans ma besace.
— Ah ? s’écria dans un élan de patriotisme l’un des plus jeunes étudiants, donnez-la un peu, que nous la voyions.
Celui-là sûrement n’avait fait qu’entendre parler de l’essence de roses.
— Qu’est-ce que tu veux voir ? de l’essence, c’est de l’essence, répondit Baï Gagno, ce n’est pas pour vous autres. Laissez un peu l’essence tranquille, et dites-moi autre chose : où est-ce que je vais pouvoir passer la nuit ? Je sors de chez le père Jireczek...
— Ah ! s’écria de nouveau l’étudiant enthousiaste.
— Quoi ? « ah ! » Pourquoi n’y serais-je pas allé ? J’ai donc été chez lui, je pensais qu’il ferait preuve de philanthropie, qu’il m’inviterait à demeurer chez lui. Je t’en fiche ! « Ma maison, qu’il m’a dit, n’est pas grande », et je ne sais quoi encore. « J’aime beaucoup, qu’il m’a dit, les Bulgares !... » Lui ? s’il y trouve son profit, ton Baï Gagno aussi sait bien aimer les gens. Est-ce comme ça qu’on reçoit un Bulgare ? un Bulgare !!... Je le reconnais, il m’a nourri, cet homme. Mais pour le reste, il ne faut pas lui en parler !... Comme les Bulgares sont plus hospitaliers ! N’aurait-il qu’une seule chambre, un Bulgare vous inviterait quand même...
Quelques-uns des étudiants commençaient à deviner le jeu de Baï Gagno ; ils attendaient le moment où il abattrait ses cartes. Seul l’étudiant enthousiaste l’écoutait avec sympathie et partageait son indignation à propos du caractère peu hospitalier des étrangers.
— C’est vrai, nous autres Bulgares, nous sommes très hospitaliers, appuya-t-il d’un air convaincu, les gens d’ici ne veulent pas nous connaître. Nous moisissons dans les cafés...
L’étudiant qui prononça ces paroles était fort avancé dans la voie de la civilisation, mais, je ne sais pourquoi, il ne jouissait pas d’une excellente réputation auprès de ses camarades ; il avait apparemment quelques péchés sur la conscience ; on disait, entre autres choses, qu’il aimait beaucoup « les petits bénéfices ». Rien d’étonnant à cela ! Ce misérable défaut, l’avarice, sous l’influence du milieu familial, avait germé en lui dès son enfance ; il avait desséché son cœur de jeune homme, en faisant de lui l’égoïste le plus froid : aucun sentiment désintéressé n’avait subsisté en lui. C’est l’intérêt matériel qui guide l’avare dans tous ses actes et qui détermine ses rapports avec les gens qui l’entourent ; aucune bonne impulsion ne précède, aucun regret ne suit ses actions, toujours dirigées, sans tenir compte des moyens, vers le profit qu’il peut en tirer. Alors même que ses actes engendrent pour autrui le malheur ou l’infamie, au lieu de remords, c’est de la satisfaction que ressent l’avare égoïste, comme si la perte d’autrui constituait son gain, comme si le malheur d’autrui faisait son propre bonheur. Une seule chose peut troubler notre jeune égoïste, c’est de trouver quelqu’un de plus rusé que lui. Tandis que chez les autres peuples le mot « rusé » est synonyme d’astucieux, de déloyal, et, lorsqu’il est attribué à quelqu’un, le rabaisse dans l’opinion publique, chez nous, on se pare de l’épithète « rusé », comme de la plus honorable des décorations. « Bigre ! voilà un gars qui devient rusé, que Dieu le conserve à son père, il nous roule tous ! nous ne pouvons rien lui faire avaler. Achkolsoun40 ! Bravo ! »
Aucune démarche, aucune relation n’avait de sens pour Botkov — c’était le nom de l’étudiant — s’il n’en retirait pas quelque profit, quelque « kélipir ». (Y a-t-il dans les langues européennes un mot correspondant à celui-là ?) S’il rendait visite à des familles de Prague, il ne le faisait pas par sociabilité ou par désir de connaître la manière de vivre de gens plus civilisés ; les préoccupations intellectuelles et morales de cette société non seulement ne l’intéressaient pas, mais lui étaient désagréables ; il les considérait comme d’ennuyeux obstacles qui le séparaient du but de sa visite, l’intérêt : c’est-à-dire quelque invitation, ou quelque promenade qu’il comptait faire à leurs frais. Il ne pouvait pas imaginer qu’on eût des relations avec des femmes sans une pensée de derrière la tête. Il avait dressé une liste complète des jeunes filles, avec leur dot ; rien d’autre ne comptait pour lui. C’était aussi l’intérêt qui déterminait ses relations avec ses camarades. Les flatteries, les médisances, les intrigues et les dénonciations étaient les instruments de ses petits profits. Des sentiments, comme les sympathies nationales et les antipathies de races, n’étaient exploités par lui qu’en vue de son intérêt personnel. Plus d’une fois il eut recours aux caisses de divers comités slaves, se faisant passer tantôt comme « de Batak41 », tantôt comme « émigrant ». (Mais pour ce genre de procédés, Aslanov42 est encore son maître.)
Tel était l’étudiant enthousiaste qui défendait l’opinion de Baï Gagno sur le caractère peu hospitalier des étrangers.
— Oui, nous moisissons ici dans les cafés, personne ne nous invite, répéta-t-il à la grande joie de Baï Gagno.
— Mais où veux-tu donc moisir ? répliqua avec un sourire méprisant un étudiant qui nourrissait — cela se voyait — une vieille haine contre le jeune égoïste. Veux-tu donc qu’ils te portent en triomphe ? Et pourquoi ? Est-ce parce que, ayant à peine franchi le seuil de leur maison, tu as commencé par prendre par la taille la servante qui te recevait dans l’antichambre ? Est-ce parce que, dans leur société, tu restes muet comme un soliveau, ou tu n’ouvres la bouche que pour tenir des propos grossiers et stupides ? Est-ce parce que tu dis du mal d’eux à leur barbe ? Est-ce parce que tu leur jettes de la poudre aux yeux et que tu te fais passer pour le fils d’un industriel millionnaire ou d’un armateur, alors que ton père possède deux bicoques où il fabrique de la ganse, ou deux barques percées, rien que pour pouvoir épater les parents et attirer à toi leur fille ? Pourquoi te recevraient-ils à bras ouverts ? Qui es-tu ? Comment te conduis-tu avec eux ? À qui as-tu fait goûter ton hospitalité ? Et en quoi consiste donc cette fameuse hospitalité ? Est-ce dans le tapis graisseux que le Bulgare jette pour toi par terre, est-ce dans la couverture malpropre dont il te recouvre ? Ah ! pour Dieu, cessons ces grossières vantardises ! Il est temps pour nous d’ouvrir les yeux.
— Qu’est-ce que tu as à monter comme une soupe au lait ? Est-ce le moment de se disputer, répliqua l’un des étudiants, quand il nous est arrivé un hôte ?
— Qu’il raconte ce qu’il voudra, celui-là ! Il ne nous demande pas d’argent ! dit pour le calmer Baï Gagno, avec cet argument typique : « Il ne nous demande pas d’argent ! » Il peut dire ce qui lui plaît, faire ce qui lui passe par la tête, pourvu qu’il n’en coûte rien à notre poche, à nos intérêts. Libre à lui de mentir, il ne nous demande pas d’argent !
Mais après cet incident, une conversation amicale ne pouvait plus se soutenir. Le silence tomba, et l’un après l’autre les étudiants commencèrent à se retirer. Des Bulgares, il ne resta plus que Baï Gagno et l’étudiant enthousiaste qui ne voulait pas lâcher l’occasion de tirer quelque profit de sa rencontre fortuite avec un commerçant bulgare en essence de roses. « Marmite qui roule trouve son couvercle43. »
Une heure ne s’était pas écoulée que l’étudiant avait déjà essayé de dire du mal de ses camarades à Baï Gagno, ce qui fit pousser à celui-ci un cri partant du cœur ; « Achkolsoun, nom d’un chien ! » Et une heure encore plus tard, Baï Gagno était déjà dans la chambre de l’étudiant, qui se proposait d’exploiter habilement à son avantage l’arrivée de son hôte, en le présentant chez lui comme un de ses parents, millionnaire, « possesseur d’une quantité de fabriques d’essence de roses ». Et il essaya d’emprunter à sa propriétaire, à laquelle il n’avait pas payé depuis longtemps le loyer de sa chambre, dix « gulden ».
Tandis que l’étudiant vantait les richesses de Baï Gagno, dans la chambre voisine celui-ci avait enlevé son « antéria » et y cherchait quelque chose avec la plus grande attention, en murmurant dans sa moustache : « Encore cette sacrée vermine qui a fait des petits ! »
L’instinct de la propreté n’est pas développé à un très haut degré chez Baï Gagno. « A-t-on jamais vu un mortel sans vermine ? » disent les vieux de chez nous, et, rassurés par cet axiome, ils ne font pas de bien grands efforts pour se débarrasser des petites bêtes. Et puis pourquoi se priveraient-ils d’un de leurs plus grands plaisirs ? À quoi servirait le bon soleil cuisant, si vous ne pouviez sortir sur le balcon de votre maison, vous étendre sur la natte, éternuer deux ou trois fois, appeler votre femme et poser votre tête sur son genou ? Et tandis qu’elle plonge dans vos cheveux ses doigts osseux aux ongles en deuil, comme si elle triait du riz, tchouk ! par-ci, tchouk ! par-là, les petites bêtes s’effraient, grouillent sur votre tête, et vous chatouillent agréablement, tandis que votre femme chantonne et que ce sacré soleil du Balkan vous brûle ! Idylle !...
Baï Gagno, après avoir terminé ses recherches entomologiques, répara le désordre de sa toilette, et entra sans frapper dans la chambre voisine, mais il s’écria immédiatement : pardon ! et il y avait de quoi : il surprit en très tendre « vis-à-vis44 » l’étudiant et la fille de la propriétaire : ils étaient dans les bras l’un de l’autre, comme il sied à deux jeunes gens qui s’aiment.
Un peu honteuse, la petite s’enfuit dans une autre chambre.
— Hé ! pourquoi entres-tu comme ça ? Tu as effrayé l’enfant, dit l’étudiant en clignant ironiquement de l’œil.
— Le beau gibier que tu as là ! murmura discrètement Baï Gagno, les yeux allumés, comme un matou de monastère. Sapristi ! elle est rudement bien ! c’est la servante ?
— Comment ! la servante ! c’est la fille de ma propriétaire !
— Pas possible ! On ne peut jamais savoir ici qui est la servante et qui est la maîtresse. Elles sont toutes gentilles, toutes bien habillées. Tu rencontres une femme, elle sourit doucement, tu te dis : c’est la servante ; tu la prends par la taille, et il te tombe quelque histoire sur la ; tu en rencontres une autre, gentille, réservée, tu te dis : ah ! cette fois, c’est la patronne ; tu restes debout, tu l’invites à s’asseoir, elle rougit — imbécile ! — tu lui parles politique et puis à la fin tu t’aperçois que c’est elle qui nettoie tes chaussures !
Des récits de l’étudiant, accompagnés de force gestes qui servaient à illustrer et à renforcer ses paroles, Baï Gagno conclut que le jeune homme, depuis quelques mois, sous prétexte d’amour pur et désintéressé, s’attaquait avec une persévérance irréfléchie à la fille de sa propriétaire qui était veuve.
— Et la petite, figure-toi ! expliquait l’étudiant, s’imagine que je vais l’épouser ! Elle y compte bien, elle me soigne gentiment, elle me coud des chemises. Si elle était riche, je la prendrais bien, mais elle est comme moi, elle n’a pas le sou. Elle tourne autour de moi, parce qu’elle me prend pour un richard. Mais si elle connaissait ma situation, crois-tu qu’elle me courrait après ? Ce sont de sacrés spéculateurs, les gens d’ici ! Mais je sais, moi aussi, les faire marcher ! — et il expliqua en long et en large comment il les faisait marcher...
— Achkolsoun ! s’écria Baï Gagno, les yeux brillants, émerveillé par son jeune interlocuteur.
— Attends un peu, celle-là, ce n’est rien. Mais il y en a une autre ; je n’ai fait que l’apercevoir. Qui sait ? Si je pouvais seulement lui tourner la tête, il y a quelque chose à faire. Elle est riche ! Je suis invité demain chez eux ; ils m’emmèneront faire une promenade dans un village.
— Mais quand me conduiras-tu dans les fabriques ? demanda Baï Gagno en homme pratique qu’il était.
— C’est facile, après-demain. Toi, reste ici demain, tourne autour d’eux ; quand ils verront que tu ne sais pas la langue, ils ne te laisseront pas aller au restaurant, ils t’inviteront chez eux et tu déjeuneras à l’œil.
Et en effet le lendemain matin l’étudiant se rendit à son invitation, et Baï Gagno resta à la maison avec les propriétaires. Comme d’habitude, il se leva de très bonne heure, éveilla son compagnon et assista à son départ, puis il attendit encore une grande heure que les propriétaires se fussent éveillées. Cette attente lui était fort pénible, car il éprouvait un grand besoin, commun à tous les mortels, et il avait oublié de demander à l’étudiant où se trouvaient les... choses, et, qu’il le voulût ou non, il lui fallait attendre que les propriétaires fussent levées, et, qu’il eût honte ou non, il lui fallait le leur demander. Il est fort désagréable dans certaines occasions d’ignorer une langue étrangère ; pour la chose la plus simple du monde on ne peut pas vous comprendre, et il faut avec les mains, avec les doigts, expliquer, montrer aux gens... Mais peut-on expliquer toute espèce de choses ? Baï Gagno savait plusieurs langues, il parlait le turc comme un Turc, il comprenait le roumain, le serbe, le russe comme ci comme ça, mais les Allemands et les Tchèques ne comprennent aucune de ces langues-là. On ne pouvait pas dire pourtant que Baï Gagno ignorât absolument l’allemand, il en savait bien quelques mots.
Dans la chambre voisine, les propriétaires se levaient et remuaient. Baï Gagno regarda par le trou de la serrure, non pour satisfaire une inconvenante curiosité, mais pour voir si elles étaient bientôt prêtes, et, attentivement, en retenant sa respiration, tandis qu’il étudiait leur façon de s’habiller, il cherchait dans sa tête une phrase d’allemand qui correspondît à notre : « Dé ié onova, za goléma rabota45 ? » et à la fin, en traduisant mot à mot, il composa la phrase : « Wo is diese für gross Arbeit ? » Toc ! Toc ! Toc !
— « Prosim46 ! » répondirent de la chambre voisine deux voix féminines.
Baï Gagno ouvrit la porte, demanda « pardon » et articula d’un air un peu honteux :
— Wo is für gross Arbeit ? et il remua les doigts pour renforcer sa question.
— Co pán47 ? demanda la jeune fille qui ne comprenait pas, tandis qu’elle s’appliquait à étudier l’extérieur du millionnaire dont lui avait parlé son amoureux.
— Für gross Arbeit, répéta Baï Gagno de plus en plus confus, et il recommença à faire des gestes avec les mains et avec la tête, mais il remarqua qu’elles ne le comprenaient pas.
Elles comprenaient, mais pas comme il le fallait ; il leur expliquait, pensaient les femmes, qu’il était venu pour faire de grosses affaires, un commerce important d’essence de roses.
Diable ! pensa Baï Gagno, comment m’y prendre ? — et, pour que la fille ne fût pas témoin de sa pénible situation, il appela de la main la maman dans sa chambre, ferma la porte et, en répétant sa question en allemand, il l’accompagna cette fois d’une mimique désespérée, qui fit se sauver dans l’autre chambre la dame prise de fou rire. La servante arriva et satisfit la curiosité de Baï Gagno. Un triple éclat de rire féminin fit vibrer les murailles.
Les parfums qui arrivaient dans le corridor par la porte ouverte de la cuisine excitèrent l’appétit de Baï Gagno. Par curiosité il s’approcha pour voir ce qu’on préparait. Il trouva la propriétaire et la servante.
— Was is das ? demanda Baï Gagno d’un ton plein de suffisance, non pas qu’il désirât être initié à la cuisine tchèque, mais plutôt pour montrer qu’il a roulé sa bosse à travers l’Europe, et qu’il connaît ces choses-là, et qu’il sait aussi parler allemand. C’est de la soupe, n’est-ce pas ? C’est de la soupe que vous faites cuire ? Je connais ça moi. Ich verstee supa !
Et Baï Gagno, en un mélange d’allemand et de bulgare écorché, s’aidant aussi d’énergiques gesticulations, laissa entendre à sa propriétaire qu’il ne refuserait pas de goûter à sa cuisine. S’apercevant d’ailleurs que les femmes parlaient plus volontiers tchèque, Baï Gagno se mit aussi à parler « tchèque », et il exprima son désir en disant : « Ia hotchem kouchaï48 ». Et il commenta cette phrase en approchant la main à plusieurs reprises de sa bouche ouverte, puis levant trois doigts, il toucha de l’index sa poitrine, celle de la propriétaire, et enfin montra quelque chose dans l’espace, comme pour désigner la jeune fille invisible, ce qui voulait dire : « Da kouchaï barabar, troïtsa49 ! »
Il importait aussi à Baï Gagno de savoir à quelle heure on déjeunerait, parce qu’il se proposait d’aller faire un tour. Il ne voulait pas être en retard, parce que, somme toute, « pourquoi dépenser son argent inutilement ? Si on peut déjeuner à l’œil, c’est tout bénéfice ! »
Il sortit donc sa grosse montre, la mit sous le nez de la propriétaire et l’invita du doigt à lui montrer sur le cadran à quelle heure on « kouchaï ».
Quand il fut certain que l’affaire était réglée, Baï Gagno rentra dans sa chambre, fourra ses moskals dans sa ceinture et sortit dans la rue pour se promener. Qui sait ? Tout en se promenant, il rencontrera peut-être quelque négociant en essence de roses.
Baï Gagno remarqua que beaucoup de rues se croisaient ; il pourrait bien se tromper de chemin et se perdre ; en homme pratique, il regarda autour de lui pour noter quelque signe qui lui permettrait de reconnaître la maison. Il vit en face, sur un mur, une inscription en grosses lettres. Il sortit son carnet, mouilla son crayon, prit la copie exacte de l’inscription et, absolument certain d’avoir sur lui l’adresse de son logement, il partit à travers les rues étroites du vieux Prague.
Et le voilà, regardant par ci, regardant par là, la boutique d’un négociant, puis d’un autre, se laissant entraîner, et bientôt se perdant.
Et maintenant ? Il s’agit de retrouver la maison. Mais il s’embrouille de plus en plus à travers les rues du quartier juif. Une heure se passe, puis deux. Il entre dans une maison — pas d’issue. Il part dans une autre direction, marche, marche et gravit la berge de la Vltava50.
« Diable ! et maintenant ? » L’heure du déjeuner approche, elle approche, et même elle est passée. Notre Baï Gagno allonge le pas, suant à grosses gouttes, hors d’haleine, méconnaissable. Les passants qui le croisent, les agents de police en particulier, le considèrent avec méfiance ; et tout cela l’agace encore davantage.
« Diable ! et maintenant ? » Il a faim, son estomac est tombé dans ses talons, ce serait enrageant tout de même de jeter sa bonne galette par la fenêtre quand on est invité à déjeuner !
Mais, direz-vous, pourquoi Baï Gagno déambule-t-il à travers les rues, lorsqu’il a son adresse dans sa poche ? C’est justement là la question ! Et Baï Gagno est assez malin, quoi que vous en pensiez, pour songer à sortir son carnet, pour accoster n’importe qui dans la rue et, en lui montrant l’adresse écrite, pour lui demander du geste : « Où est-ce ? » Il s’y connaît. Il arrête des hommes et des femmes, mais c’est extraordinaire ! dès qu’il montre à quelqu’un l’inscription, ou bien on le regarde avec étonnement et on se met à rire, ou bien on se détourne avec dégoût. Une dame même, sans doute quelque vieille fille grinchue, dès qu’il lui a montré l’adresse, fait une telle grimace que Baï Gagno perd courage. « Diable ! ou bien je me suis trompé, ou bien toute la ville de Prague est devenue folle », pense-t-il. Impossible de s’expliquer l’effet produit par son adresse ; il songe, il regarde à droite et à gauche. À un moment donné, — n’est-ce pas une chance ? — il voit se dresser devant lui la « Narodni Kavarna », le café où se réunissent les étudiants bulgares. Baï Gagno y pénètre et trouve l’étudiant au mauvais caractère.
— Bonjour ! Sapristi ! que ta seigneurie m’explique un peu si c’est moi qui suis toqué ou si ce sont les gens d’ici, demanda Baï Gagno essoufflé et les cheveux collés au front.
L’étudiant le regarda d’un air interrogateur. Baï Gagno lui raconta comment il s’était perdu, comment il avait demandé le chemin de sa maison et comment on lui avait répondu.
L’étudiant qui savait que les Tchèques ne sont grossiers et fanatiques qu’envers les Allemands, mais qu’autrement ils sont assez aimables, ne pouvait pas s’expliquer qu’ils n’eussent pas voulu rendre service à Baï Gagno.
— Lis-moi donc, s’il te plaît, ce qui est écrit là ! et Baï Gagno lui tendit son carnet. L’étudiant lut, commença par froncer les sourcils, et puis il s’esclaffa !...
— Vous avez montré cette adresse-là à une dame ? lui demanda-t-il dans un éclat de rire.
— Pourquoi ? mais oui, je l’ai montrée !
— Eh bien ! savez-vous ce qui est écrit là ?
— Quoi ?
— Il est écrit : « Zde zapovedano... » « Défense d’ur... » Tu as pris ça sur un mur.
— Zut ! Vois-tu ça ! Ts... ts... ts ! Tu dis la vérité ? Vois-tu ça ! dit Baï Gagno en claquant de la langue, et il se mit lui aussi à rire.
L’étudiant ne connaissait pas la demeure de Botkov ; ils n’allaient pas l’un chez l’autre ; aussi conseilla-t-il à Baï Gagno d’attendre un peu ; le premier Bulgare qui arriverait lui indiquerait la maison. C’est facile à dire, « d’attendre un peu », mais je ne sais pas si l’estomac de Baï Gagno était du même avis, à en juger par l’incessant gargouillement qu’il faisait entendre.
— Est-ce que vous n’avez pas faim ? lui demanda l’étudiant, qui remarquait les signaux de révolte de son estomac.
— Qui ? Moi ? Non ! répondit sans rougir Baï Gagno, parce que s’il avait dit la vérité, l’autre lui aurait indiqué le restaurant, et jamais il n’aurait osé lui avouer (« comment expliquer ça à un pareil entêté ! ») qu’il comptait sur le petit bénéfice d’un repas chez ses propriétaires.
La conversation entre Baï Gagno et « l’entêté » ne réussit pas à se nouer. Dès leur première rencontre et instinctivement ils avaient senti qu’ils n’étaient pas faits l’un pour l’autre, parce que, d’après un proverbe bulgare (ah ! que de remarquables proverbes a donc produits le génie bulgare !) « les ânes galeux se flairent à travers neuf montagnes ». L’un d’eux arrivait de Bulgarie, l’autre vivait en Europe. Ils auraient dû avoir quelque chose à se raconter, parce qu’il doit certainement exister quelque petite différence entre l’Occident et notre pays natal. Mais cette différence, Baï Gagno ne la sent pas, et comment d’ailleurs la sentirait-il ? Partout où il va, il transporte avec lui son milieu, ses mœurs et ses habitudes, il cherche un gîte selon ses goûts, ne fraie qu’avec ses compatriotes, auxquels il est accoutumé et chez qui, bien entendu, il ne découvre rien de nouveau : va-t-il à Vienne, il descendra à l’hôtel de Londres, où cela sent autant le renfermé, la cuisine et l’hydrogène sulfuré que chez lui ; il rencontrera les mêmes Turcs, Grecs, Arméniens, Serbes, Albanais, qu’il a l’habitude de voir chaque jour ; il n’ira pas au café de Habsburg, parce qu’il a peur qu’on ne l’écorche, mais il fréquentera encore le café grec, qui est aussi sale et constamment infesté de fumée que les cafés de chez nous. Part-il en tournée d’affaires, il ira trouver les commerçants bulgares, et il ne s’apercevra même pas que par leur intermédiaire, il entre en relations avec des Européens. Et quant à remarquer qu’au delà de cette petite sphère commence la vie européenne, il n’y songe pas, il ne veut même pas y songer. L’éducation, la tranquillité d’âme de l’Européen, le culte de la famille, fruits des traditions séculaires et des incessants progrès de l’intelligence, les luttes sociales et la manière de s’armer pour elles, les musées, les bibliothèques, les institutions philanthropiques, les beaux-arts, les mille manifestations du progrès, rien de tout cela n’attire l’attention de Baï Gagno,
« Est-ce que mon père a jamais été à l’Opéra ? » dit Baï Gagno, et fasciné par ce principe cristallisant et ultra-rétrograde, il ne se laisse guère troubler par la « nouvelle mode », ce qui signifie pour lui la civilisation. Pourtant Baï Gagno n’est pas aussi brave que les Chinois — qui s’entourent d’un mur contre l’invasion de cette civilisation. Bien qu’il répète ce principe fondamental : « Mon père n’a pas fait cela, moi non plus je ne le ferai pas », on le voit bientôt enfiler une chemise blanche et mettre des gants. Quand on veut lui faire endosser aussi un frac, il se fâche, il se met à rire, mais il l’endosse tout de même. Tu l’entends dire « pardon », il parle de la Constitution, il se vante d’aimer « la soupe », alors qu’au fond il préfère à tous les mets européens une « tchorba » qui emporte la bouche.
— Tiens, voici un compatriote qui arrive ; il sait où demeure Botkov, fit remarquer le « jeune entêté ».
— Allons, conduis-moi à la maison, dit Baï Gagno en s’adressant au jeune Bulgare sur un ton que nous n’oserions pas employer dans nos rapports avec nos serviteurs paresseux. Mais les mots « courtois », « poli » ont été empruntés récemment à la langue russe ; « délicat » a été pris aux Français ; chez nous, le terme le plus employé à la place de ces expressions est le mot « baveux ». Les manières délicates, courtoises, cordiales, qui caractérisent les rapports des gens civilisés et qui rendent la vie plus douce, plus agréable, sont incompréhensibles à Baï Gagno ; « parle donc, dit-il, le langage que Dieu t’a donné ! Allons, écoute un peu, conduis-moi à la maison. » Et pourquoi dirait-il donc : « je vous prie ; ayez la bonté, soyez assez aimable », qu’est-ce que c’est que ces expressions « baveuses » !...
Le jeune Bulgare conduisit son compatriote jusqu’à la porte de son logement et s’en retourna. Baï Gagno regarda la malheureuse inscription du mur d’en face, hocha la tête, fit claquer sa langue et entra dans la maison. Dans le corridor, il ne rencontra personne ; il jeta un coup d’œil dans la cuisine, — le feu était déjà éteint, le matériel lavé et rangé. « Zut ! mon petit bénéfice est dans l’eau », grommela Baï Gagno. Il entra dans sa chambre, s’accroupit sur sa besace, sortit de sa ceinture ses moskals, les fourra dedans, prit du kachkaval51 gras, se coupa une tranche de pain rassis, et se mit à apaiser les troubles de son estomac, en mastiquant avec un tel appétit que la vache suisse la plus paresseuse en eût été jalouse. Pour stimuler ses organes lymphatiques fatigués d’un vain travail, il ingurgita un piment d’Albanie qui lui fit venir les larmes aux yeux et des reniflements aux narines. La servante qui cousait dans la pièce voisine, entendant les bruits étranges dont Baï Gagno accompagnait son déjeuner ouvrit la porte et jeta un coup d’œil dans la pièce : Baï Gagno tout honteux, dissimula devant lui sa besace, tourna son visage couvert de larmes et de sueur, marmotta « pardon » ! renifla avec énergie et fit fuir la servante — non pas qu’il lui eût dit de sortir — mais elle s’empressa de filer, pensant que le « millionnaire » devait avoir reçu quelque triste nouvelle.
Botkov ne revint pas le soir. À la tombée du jour, les propriétaires rentrèrent ; on ralluma le feu dans la cuisine et on commença à préparer le dîner. Baï Gagno se montra déjà familier ; « après tout, avec des femmes, pourquoi faire des cérémonies ? » se dit-il, et sans autre préambule il entra dans la cuisine, et raconta, avec des gestes plus qu’avec des mots, qu’il s’était perdu dans les rues, qu’il avait laissé passer l’heure du déjeuner ; mais n’est-ce pas, c’est la même chose, il a droit à un déjeuner, il l’échangera contre un dîner.
Baï Gagno est versé dans l’art culinaire, et même toute faute commise contre cet art le met hors de lui-même. Il s’aperçut, par exemple, que la propriétaire se préparait à plonger dans l’eau bouillante un poisson frais. Il s’y opposa de toutes ses forces, saisit la main de la dame, s’empara du poisson, et fit de la tête et du bras un signe qui voulait dire : « Attendez, ne bougez pas, regardez un peu comment on prépare un poisson ! » — « Du sel ! » commanda Baï Gagno. On lui donna du sel. Il retroussa ses manches et découvrit jusqu’au coude ses bras velus ; il plongea dans la salière ses gros doigts et se mit à frotter à l’extérieur et à l’intérieur le poisson, qui était déjà salé d’ailleurs avant cette opération. « Du poivre rouge ! » Mais où ces sauvages-là trouveront-ils du poivre rouge ? « Du poivre noir ! » commanda Baï Gagno, et saisissant le poivrier, il en jeta sur le poisson. « Un gril ! » lança le cuisinier triomphant, mais en vain. Malgré tous ses gestes, on ne le comprenait pas. Il regarda autour de lui, mais ses yeux ne rencontrèrent pas de gril ; est-ce là un obstacle pour Baï Gagno ? Il n’est pas né d’hier ! Avec les pincettes, il rassembla tout le feu à l’entrée du fourneau, laissant les autres plats en souffrance (par bonheur ils étaient déjà prêts), puis écartant les branches des pincettes, il posa dessus le poisson et voulut l’introduire dans le fourneau. Mais l’ouverture était étroite, le poisson s’accrocha, glissa et vlan ! tomba dans le feu. « Aïe ! » s’écria la propriétaire. — « Ce n’est rien, ce n’est rien ! » dit pour la tranquilliser Baï Gagno, pendant qu’il saisissait le poisson et soufflait les petits morceaux de braise et les cendres qui y adhéraient. Puis il le remit sur le gril. La fumée et l’odeur du poisson emplissaient la cuisine. Les propriétaires, au désespoir, contemplaient Baï Gagno triomphant, dans son élément ; tout en faisant cuire le poisson, il en reniflait l’odeur appétissante. Puis de sa main restée libre, il donna l’ordre de mettre le couvert, pour que son plat ne refroidisse pas : « Si le poisson frais n’est pas chaud, jette-le », dit le proverbe. Le poisson cuit, orné de cendre sur la tête et sur la queue, fut placé dans une assiette, tandis que Baï Gagno distribuait aimablement ses ordres : « Vite ! vite ! pendant qu’il est chaud, donnez-moi du citron et du vin ; sans vin, il ne vaut pas un rouge liard ! »
On s’assit autour de la table, après avoir envoyé la servante chercher en courant du citron et du vin. Que faire ? Un millionnaire ne va pas changer ses habitudes pour leur bon plaisir ! La propriétaire se disposait à couper le poisson. « Je vous en prie ! pardon ! n’y touchez pas ! » s’écria Baï Gagno en lui prenant la main. Et retournant le poisson sur le ventre il le pressa avec deux doigts sur toute sa longueur et le poisson se partagea en deux parties égales. Comment après cela ne pas triompher ! La servante apporta le citron. Baï Gagno le coupa, en prit une moitié dans la paume de sa main et en exprima le jus au-dessus du plat avec une telle vigueur que des morceaux de pulpe tombèrent sur le poisson. Croyez-vous que Baï Gagno a de l’appétit ? Il ne coule certainement pas autant de jus de citron dans le plat que de salive dans le gosier de Baï Gagno. La servante apporta du vin et on se mit à dîner.
Les disciples d’Esculape recommandent Karlsbad et je ne sais plus quels autres « bains » encore à ceux qui souffrent de l’estomac ! Eh bien ! qu’ils prennent donc ces malades par l’oreille et qu’ils les amènent à la table de Baï Gagno ! Même si leurs estomacs sont en plus piteux état que les rues d’Ioutch-Bounar52,... vous verrez quel effet leur produira ce spectacle !... Baï Gagno mange ! je vous assure qu’il ne plaisante pas : il mange à s’en faire craquer les mâchoires ! Tout est en mouvement, en particulier les dents, la langue et le nez ! C’est ici qu’il nous faut reconnaître la pauvreté et la pâleur de notre langue ! Avec quels mots, avec quelles interjections, avec quels signes de ponctuation et même avec quelles notes de musique pourrait-on dépeindre le travail de mastication, les grognements, reniflements, chocs, sucements, claquements de langue, que fait entendre Baï Gagno comme une averse de grêle !... Heureuses propriétaires ! Toutes les femmes tchèques n’auront pas le bonheur d’assister à un pareil spectacle !
Le dîner achevé, ils passèrent dans le salon. Baï Gagno, rouge comme un coquelicot, s’essuya les moustaches et dissimula un hoquet dans la paume de sa main, en murmurant « pardon ! » Ils s’installèrent sur les chaises. Baï Gagno roula une cigarette entre ses doigts gras et se mit à faire des nuages de fumée. N’est-ce pas le moment le plus propice pour jouir de la musique, du chant, de l’amour ? La jeune fille devina l’état d’âme du millionnaire et lui demanda s’il aimait la musique. Qui ? Baï Gagno ? Mais si Baï Gagno n’aimait pas la musique, qui donc l’aimerait ? Quel autre que lui est capable d’inspirer aux tsiganes, c’est-à-dire aux musiciens par excellence, un pareil respect ? Qu’il leur jette seulement un coup d’œil, et vous verrez ce que deviendront ces tsiganes ! Ils prendront feu ! Le violon grincera, la clarinette poussera des cris aigus !
Ta taille est élancée comme un peuplier,
Et mon cœur est percé de deux flèches.
La couture de ta fustanelle
Met ma poitrine en feu...
— Taisez-vous les tsiganes ! Je ne veux pas de chants d’amour, mais une chanson pour l’heure du raki ! leur crie Baï Gagno en frappant la table avec son verre. Ils entonnent « Le petit, le petit œillet », Baï Gagno frappe avec son verre, ils s’arrêtent. Ils commencent encore « Nous ne voulons plus de la richesse53... » de nouveau il frappe avec son verre. Ils se rabattent sur « Le vert feuillage. » Ah ! maintenant, à moi, le kief !... et il jette la bouteille par terre ou par la fenêtre... Qui donc, si ce n’est lui, est passé maître pour ces jeux-là ? Et combien de fois a-t-il répété cette scène ? Mais « ces femmes » ! Comment pourraient-elles savoir qui est Baï Gagno ? Et si on leur disait combien de bouteilles la musique lui a fait casser, elles ne pourraient pas comprendre !...
— J’aime la musique ! répondit avec condescendance Baï Gagno. J’aime la musique ! et il hocha la tête, ce qui dans sa pensée voulait exprimer la triste nécessité d’écouter tapoter du piano pour faire plaisir aux femmes. « Qu’est-ce que vous comprenez, vous autres, à la manière de jouer et de se divertir ? » pensait Baï Gagno.
La jeune fille ouvrit le piano et commença un long morceau de la Prodana Nevesta de Smetana. Les harmonies que ses doigts faisaient naître ont le don de jeter toute âme tchèque dans l’extase. La maman, qui vraisemblablement écoutait ces morceaux pour la mille et unième fois, était au comble du ravissement, et dans son regard, tourné vers Baï Gagno, brillait l’orgueil national ; elle suivait de la tête la mesure d’après le mouvement du morceau, tantôt « adagio », tantôt « allegro », comme si elle ponctuait avec son nez les notes des fioritures. De temps en temps elle faisait un signe à Baï Gagno, prévenant ainsi son hôte de l’arrivée de quelque passage favori, mais les yeux du millionnaire lui répondaient : « C’est bon, ma chère dame, inutile de me regarder comme ça ; ce n’est pas le premier morceau que j’entends !... » Pour le lui faire mieux comprendre, il se leva de sa chaise juste au moment où la propriétaire s’attendait à jouir de l’effet produit par Smetana sur Baï Gagno, et brusquement, avec une idée en tête, il alla dans sa chambre, prit dans sa besace un moskal ouvert comme échantillon et revint dans le salon en faisant signe à la mère : « Regarde un peu l’effet que cela produira. » Il s’avança sur la pointe des pieds vers la jeune fille absorbée par la musique, ouvrit le moskal d’essence de roses et tout doucement le glissa sous le nez de la petite. Celle-ci, sentant l’odeur d’une main moite qui empestait le poisson, se recula avec dégoût, et, transportée qu’elle était par la musique, au premier moment, elle regarda Baï Gagno d’un air fâché. Mais il lui revint immédiatement à l’esprit qu’elle avait devant elle le millionnaire ; elle sourit et Baï Gagno lui demanda : « Est-ce que votre Smetana vaut plus cher que ce que je vous fais sentir là ? hein ? » Puis il replongea le moskal dans sa ceinture... La jeune fille s’arrêta de jouer. Baï Gagno se mit... (Qu’est-ce que vous dites ? Je ne vous comprends pas bien !...) Baï Gagno se mit à jouer négligemment, avec un doigt, sans s’asseoir sur le tabouret : « mais de manière à leur faire comprendre, à ces gens, que, nous aussi, nous connaissons tant bien que mal ces affaires-là. » Chez un parent de Baï Gagno avait échoué un accordéon, et, de temps à autre, quand il se trouvait là à l’heure du kief, Baï Gagno s’était cassé les doigts à écorcher quelque chanson. Il se mit à exécuter son terrible « pizzicato » qui dans sa pensée représentait la chanson : On t’a volé, la mère, ton lard, ton lard... chanson qui, comme le lard d’ailleurs, a été « volée » entièrement à la Slaninka tchèque54.
— Pan hrá Slaninka, maminko55 ! s’écria la jeune fille.
— Slaninka ? bien sûr ! répliqua Baï Gagno, et vous, comment savez-vous cette chanson-là ?
Encouragé par son succès, Baï Gagno s’assit sur le tabouret pour jouer quelque chose de plus sérieux. Et quoi de plus sérieux que : L’épouvantable nuit56... ? Baï Gagno se met à jouer, mais il est mécontent lui-même de son exécution. C’est tout naturel d’ailleurs ! L’épouvantable nuit... n’a pas été écrite pour le piano ; impossible de prolonger les notes ; on appuie sur le clavier pour « épouvanta-a-a-ble ! » et le son est coupé ; parlez-moi de l’accordéon ! Quand on met le doigt sur «... a-a-ble... » et qu’on appuie, ah ! parlez-moi de ça ! pendant une demi-heure l’instrument ronfle ; si on appuie encore plus, il se met à chevrotter, d’une façon tout à fait agréable et qui dispose au kief. Tandis qu’avec le piano, tu peux taper, taper, je t’en fiche !
Baï Gagno vit que l’effet produit par « Slaninka » était médiocre ; il réfléchit, et, se décidant : « Ah ! mais, attendez un peu que je me mette à chanter, moi, L’épouvantable nuit... à ces espèces de femmes !... » Il prit alors un air pensif, pour devenir triste comme la chanson elle-même, soupira profondément, appuya sa main droite contre son oreille, ferma les yeux et ouvrit la bouche !...
Grandissimo Maestro Verdi ! Tu n’as pas et tu ne peux avoir d’ennemis ! Mais si, par malheur, quelque démon te poursuivait, ce ne pourrait être que Satan lui-même. Dieu est grand, Esimio Maestro ! et les flèches de l’Esprit du Mal sont impuissantes contre toi ! Il n’en est qu’une seule... une seule, que puisse te décocher Satan et... et le monde musical tout entier serait plongé dans le deuil !... Nous prierons, et toi aussi, Divin Maestro, tu prieras le Créateur Tout Puissant, pour qu’il ne permette pas à Satan de te conduire dans le salon où Baï Gagno chante L’épouvantable nuit... Tandis que ton oreille délicate serait déchirée par des sons sauvages et pour toi incompréhensibles, l’Esprit du Mal te découvrirait la terrible vérité avec son rire diabolique : Ha ! ha ! ha ! Verdi ! écoute une chanson de ta « divine » Traviata ! ha ! ha ! ha ! ha-a !!!!...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Mais il est tard, messieurs ; dit Iltcho d’un air confus, en regardant sa montre, il est minuit ! Allons-nous-en. Une autre fois, s’il plaît à Dieu, nous conterons encore des histoires sur Baï Gagno.
— Voyons, Iltcho, dis-moi un peu pourquoi tu détestes à ce point les chansons bulgares, fit remarquer Dravitchko en sortant.
— Qui ça ! Moi, les détester? ! Je suis désolé, ma colombe, que tu m’aies si mal compris. Je suis capable au contraire de me délecter, de tout oublier, d’être remué jusqu’à l’extase en entendant nos beaux et mélancoliques chants nationaux, mais des chants bulgares, et non ces exécrables parodies de vulgaires chansons étrangères, que nos « Baï Gagno » nous rapportent défigurées et rendues méconnaissables par ces modulations et ces rugissements à la tsigane, avec ces trilles et ces fioritures d’ivrognes... Nous avons des chansons, mais nous n’avons pas de chanteurs. Je suis tout prêt à embrasser mon ennemi, s’il me chante d’un bout à l’autre et convenablement la chanson : Bogdane, que Dieu te frappe, ou bien Vela, ma fille, retrousse tes manches blanches, Je suis prêt aussi à regarder mon ami de travers, si je le vois se complaire dans Le vert feuillage, L’œillet, et autres merveilles tsiganesques du même goût...
— MAIS et toi, Dravitchko, pourquoi gardes-tu le silence, ne sais-tu rien sur Baï Gagno ? demanda l’un de nous à notre joyeux compagnon Dravitchko.
— Eh ! comment veux-tu que je ne sache rien, vieux frère ? Je sais un tas d’histoires. Mais comment les raconter ? répondit Dravitchko avec une fausse modestie.
— Comment les raconter ! Ah ! si j’avais ton bagout !
— Eh bien, écoutez. Je suis allé me promener un été à Genève, vous savez, en Suisse. Je pris une chambre dans un hôtel, et je sortis faire un tour à travers la ville. Une fort jolie ville, avec des environs pittoresques et magnifiques. En me promenant comme ça, sans but, et bayant aux corneilles, de rue en rue, j’arrive à une place où se trouve le théâtre de l’Opéra. Je vois en face de moi un café élégant ; ma foi, je me décide à m’y arrêter pour me reposer un peu. À droite de l’entrée, j’aperçois une terrasse vitrée, donnant sur la place, et j’entre — tant pour prendre un café que pour regarder les gens qui passent. Et qu’est-ce que je découvre là ? Trois tables entières occupées par des étudiants bulgares ! Et allez donc dire maintenant que les Bulgares n’ont pas le goût des belles choses ! Dans une si jolie ville, dans le plus beau quartier, dans le café le plus élégant, ils ont choisi la plus belle place ! Du bruit, de la fumée, des allumettes et des bouts de cigarettes par terre, des chocs, des cris, du tapage !... Ici on joue au jacquet, là à la préfa57, ailleurs au trente-et-un. Et j’entends de tous les côtés : « Six-cinq !... cœur !... paie !... quatre et un !... pourquoi regardes-tu mes cartes, eh !... Garçon !... La première du deuxième !... double cinq !... tu mens, ce n’est pas le double cinq !... trente et un !... pique !... Garçon !... Tu ne comprends rien à la préfa !... Je me passe bien de l’avis des socialistes !... Double deux !... Et moi je n’ai pas besoin de l’avis des bourgeois ! Je coupe !... Grec !... Garçon !... c’est à cause de tes décorations que tu fais le malin ?... Trèfle !... Eh mais, toi ! espèce de juif russe !... Messieurs, voilà le « crétin » qui arrive !... Ha, ha, ha, ha !... Garçon !... Une chope !... Prête-moi encore un franc, dis !... Tu es un filou !... Demande au garçon de te le prêter !... Double quatre !... »
Le particulier à qui ils avaient collé l’épithète peu flatteuse de « crétin » entra dans le café et salua les étudiants qui l’accueillirent, comme on dit, à bras ouverts ; il ne savait plus à quel groupe se joindre, parce qu’à toutes les tables on s’efforçait de l’attirer. Une telle sympathie à l’égard d’un « crétin » me parut tout d’abord incompréhensible, mais il ne fallut pas longtemps pour que les paroles qui s’entrecroisaient d’une table à l’autre sur le compte de ce particulier dissipassent ma perplexité. J’appris plus tard que ce « crétin » était le fils d’un gros propriétaire de l’Argentine, dans l’Amérique du Sud. Un jeune richard. Son père lui envoyait cinq cents francs par mois, dont la moitié passait, au moyen du trente-et-un, dans les poches de nos étudiants. Et parce qu’il se laissait débonnairement plumer en paraissant prendre plaisir à exciter l’avidité avec laquelle nos étudiants attiraient à eux son argent, il avait été gratifié du titre de « crétin ».
Quelle que fût l’heure à laquelle vous entriez dans ce café, de neuf heures du matin jusqu’au soir, fort tard, vous rencontriez toujours les mêmes individus, absorbés par les mêmes occupations : jacquet, préfa, trente-et-un. Quand cette jeunesse travaillait-elle, par quel moyen s’assimilait-elle la culture européenne, cela me rendait rêveur. Je ne voyais clairement qu’une seule chose, c’est qu’aucun d’entre eux ne commençait à bien parler le français. Ils ne faisaient aucun effort pour se perfectionner dans cette langue, et, à la grossièreté de l’intonation, à la diction, à la construction des phrases, on reconnaissait en eux des Orientaux. Tous les jours ou tous les deux jours venaient se joindre à cette compagnie quelques mécontents, quelques Juifs nihilistants, qui, dans les coins sombres du café, grognaient contre les tyrans. Je ne comprends pas comment ils pouvaient témoigner de la sympathie à ces héros obscurs qui étaient peut-être bien tout à la fois des nihilistes, des agents secrets politiques, des anarchistes, les plus bas échantillons des dilapidateurs de l’argent des associations, des bibliothèques et des autres biens publics. Au lieu de se joindre à des Français, à des Allemands, à des Anglais, qui sont toujours les premiers et pour la fête et pour le travail, au lieu de s’efforcer d’acquérir leur esprit d’organisation, leur amour du travailleur honnêteté, leur esprit chevaleresque, — eux, les nôtres, trouvaient leur idéal ou chez ces Juifs, ou chez ces Grecs, ou chez quelques Arméniens qui, par les moyens les plus bas, se livraient à l’exploitation de leurs ressources et de leurs forces, en les attirant dans l’atmosphère irrespirable de leurs discours haineux, grossiers et stériles. J’appris plus tard qu’il y avait dans cette ville d’autres étudiants bulgares qui ne fréquentaient pas ce café, mais qui s’occupaient très sérieusement de leurs études.
Un jour, dans le feu d’une partie de trente-et-un, au moment où l’Argentin avait déjà perdu une centaine de francs, je vis entrer dans le café un individu, le kalpak sur l’oreille, le bâton sous le bras et sa besace à la main.
— Oh ! oh ! Baï Gagno ! Salut ! s’écria toute la compagnie.
— Bien le bonjour ! Comment ça va ? répondit le nouvel arrivant. Ils lui offraient aimablement de lui faire de la place à leurs tables. Mais l’autre refusa, vint à la mienne et en s’asseyant renversa ma tasse de café. Le gaillard !
— Pardon !
— Ce n’est rien, ne vous dérangez pas, m’empressai-je de dire en bulgare, car j’avais remarqué tout de suite que ça ne le troublait pas beaucoup.
— Ah ! ah ! vous êtes Bulgare ! Eh ! bonjour, alors. Gagno Balkanski ! Et d’où est votre seigneurie ?
Je le lui dis. Nous fîmes connaissance.
— Avec cette maudite essence de roses, je fais le tour du monde, me dit Baï Gagno d’une voix geignante.
— Quoi ? Le commerce de l’essence ne marche pas ?
— Eh ! pour te dire la vérité, monsieur, il ne marche pas !
— Et pourquoi ça ?
— Pourquoi ? c’est bien de notre faute ! Autrefois, quand on leur parlait d’essence bulgare, ils vous couraient après comme des guêpes après le miel ; mais maintenant, je t’en fiche ! Entre dans une fabrique de savon, ouvre la bouche pour leur apprendre que tu es Bulgare, dis-leur ou ne leur dis pas « bonjour », et tout de suite ils te demanderont ; « Essence de roses ? » et en même temps ils se mettront à sourire. Et celui qui voit ce sourire comprend tout de suite qu’il n’y a rien à faire, et qu’ils n’en veulent pas ! « Donne-moi, qu’ils disent, un gramme comme échantillon. » Ils se fichent de toi ! Comment peux-tu leur donner un gramme ? Tu en verseras un gramme, et tu en répandras deux. « Mais, l’ami, leur dis-tu, mon essence n’est pas ce que tu penses, c’est de l’essence pure. — Ehé ! qu’ils disent, vous racontez tous ça, c’est toujours la même chanson. » Ils te répondent ça, à la figure, et ils ne veulent rien savoir. Et toutes ces histoires, c’est à cause du géranium, bien qu’il n’y en ait pas une larme !... C’est l’Anatolie qui nous a gâté le métier ! Et, vieux frère, il n’y en a pas qu’un seul, il n’y en a pas que deux : comme une invasion ils fondent sur l’Europe : Anatoliens, Arméniens, Turcs, Grecs, qui mentent, qui trompent le monde, qui échaudent les uns, qui volent les autres.... on en a par-dessus la tête ! Et si tu sens la rose, on t’enverra promener58 !...
Et l’Orient candide m’apparut avec tous ses charmes. Pour compléter le tableau, à toutes les tables autour de nous, on entendait jeter les dés, abattre les cartes... Du bruit et de la fumée qui montaient jusqu’aux cieux !...
— Ils me plaisent beaucoup, nos garçons, me dit Baï Gagno, en regardant les joueurs. La jeunesse ! Et il y a parmi eux des types épatants, qui pourraient rendre des points à leurs professeurs ! Voilà, par exemple, ce garçon-là, le plus âgé, le voyez-vous ? qui joue là-bas au trente-et-un. Vous ne savez pas qu’il a trois médailles ! pour la guerre serbo-bulgare, le mérite civil, et je ne sais plus quoi encore !... Il a été juge suppléant, il connaît les lois sur le bout du doigt. Et il a fallu encore qu’il étudie, ah ! ah !... c’est l’argent qui le pique ! Il y a trois mois qu’il est arrivé ici, mais si tu l’entendais parler français ! Ça coule de source ! Qu’il ne lui arrive pas malheur, et tu verras ce qu’il a dans son sac ! Il serait déjà docteur si les gens d’ici n’étaient pas des ânes bâtés. Le recteur, à ce qu’on dit, ne veut pas. En trois mois, qu’ils lui disent, il n’est pas possible de devenir docteur. Ah bah ! ça n’est pas possible ? Et si le garçon sait son affaire ? Interroge-le un peu, il te défilera toutes les lois, il les sait par cœur. « Il n’est pas possible, lui a dit le recteur, de les lire seulement en trois mois. Alors comment pourrait-on les savoir ? » Et notre type de répondre : « Non, en trois mois je serai docteur. » Et l’autre : « Non, c’est impossible. — Impossible ? — Impossible ! » Si bien qu’un jour notre garçon prit la mouche et les attrapa dans les journaux... C’est vrai, tu sais, demande-lui si tu veux...
Je crus Baï Gagno sur parole, et je n’allai rien demander au propriétaire des trois médailles. Baï Gagno poursuivit :
— Et sais-tu ce qui est advenu de cette affaire ? Ce n’est pas seulement le recteur qui s’est entêté à empêcher le garçon de devenir docteur, le doyen aussi, crois-tu. Ta seigneurie sait bien ce que c’est que le doyen... celui qui, chez les étudiants... quoi... tu sais bien... Notre garçon leur a présenté un tas de certificats — du conseil municipal, on n’en veut pas ; du procureur, on n’en veut pas ; Ses états de services, on n’en veut pas davantage. Est-ce qu’on peut faire comprendre quelque chose à des entêtés ? Et ce n’est pas un gamin, tu sais, mais un juge suppléant ! Et avec trois médailles sur la poitrine, s’il te plaît !... Le recteur s’est mis à lui raconter que, pour se rendre utile à lui-même et à son pays, il lui fallait travailler ; qu’il devait suivre régulièrement les cours ; qu’un plus long séjour à l’étranger lui ferait du bien... quelle brute !... et bien d’autres radotages du même goût. Et après le recteur, voilà le doyen — ils s’entendent comme larrons en foire — qui se met à répliquer : « Oui, moi aussi, je vous recommande de suivre les conseils de M. le Recteur ! » Alors la moutarde lui monte au nez : « Et puis vous, qu’il dit au doyen, de quoi vous mêlez-vous ? Est-ce que le recteur vous a pris pour avocat ?... » Ça, c’était envoyé, au doyen ! La queue entre les jambes, tous ces gens-là sont partis, muselés !... Hé ! Garçon ! un café !... Non, qu’est-ce que tu veux, nous avons des types qui n’ont pas froid aux yeux. Achkolsoun !...
— Eh bien, quoi, garçon ! un café ! cria Baï Gagno.
— Monsieur ! répondit vivement le garçon.
— Un café, et apporte gazettes boulgares59, commanda Baï Gagno. Et se retournant vers moi, il ajouta : Je ne l’ai pas oublié, ce sacré français !
Le garçon lui apporta le café et quelques couvertures usées qui contenaient des journaux bulgares, déchirés sur les bords.
— Attends un peu que nous voyions les nouvelles, ce qui se passe dans le monde, me dit Baï Gagno en ouvrant les couvertures des journaux ; et il se plongea dans la politique. Je regardais du coin de l’œil avec quelle soif il buvait les entrefilets, le sourire sur les lèvres, les yeux brillants, en poussant de temps en temps un « bravo ! »
À un moment donné, exultant de joie, cela se voyait, il se tourna vers moi :
— Eh ! ils les ont bien arrangés ! Écoute un peu que je te lise ça...
— Excusez-moi, monsieur Balkanski, mais ici je veux me reposer les oreilles de ce genre de politique, lui répondis-je, et je me levai. Adieu !
— Mais écoute seulement ça : « Cette bande de brigands, de souteneurs, de voleurs et de saligauds, qui promènent leurs groins dans les ordures »... Attendez, la suite est encore mieux !...
— Non, non ! Adieu, monsieur Balkanski, m’écriai-je résolument, et je sortis.
— DRAVITCHKO, messieurs, est un si merveilleux conteur, qu’après lui il est difficile de vous satisfaire. Pourtant je dois vous avouer que je sais, moi aussi, quelques histoires sur Baï Gagno, reprit Vasile. De Moscou, de Pétersbourg.
— Allons, commence. Et dépêche-toi. Quand tu auras fini de tortiller tes phrases ! lui répondit Dravitchko.
— L’expression « tortiller » ne me paraît pas très poétique, dit en plaisantant Mato.
— Taisez-vous, messieurs. Allons, Vasile, commence, ma colombe !
— Sur le chemin de Pétersbourg, commença Vasile, nous nous arrêtâmes à la station de Vilna. Nous voyagions tous les deux ensemble, Baï Gagno et moi. Nous entrâmes au buffet. Baï Gagno voulait se faire régaler parce que pendant la route j’avais fumé de son tabac. Je demandai de la bière et de quoi déjeuner. Le patron du buffet qui écoutait notre conversation s’aperçut que nous étions Bulgares et nous demanda en russe :
— Excusez-moi, messieurs, mais il me semble que vous êtes Bulgares.
Nous lui répondîmes qu’il ne se trompait point.
— Ne connaissez-vous pas M. Dimitrov, un étudiant ?
— Je ne le connais pas. Et toi, Baï Gagno, le connais-tu ?
— Dimitrov ? Attends un peu... Ah ! ça me revient. Dimitrov ? Je sais, je le connais. Un garçon à la physionomie ouverte. Je le connais, comment donc !
— Est-ce que vous ne pouvez pas me dire où il se trouve actuellement ? demanda le restaurateur.
— Il est maintenant à Constantinople, répondit Baï Gagno. Dans une huitaine de jours, il va se marier là-bas. Il a trouvé le sac !
— Comment !! s’écria le patron abasourdi. Il va se marier ! Mais il est déjà marié ici, messieurs !...
— Pas possible ! Elle est bien bonne ! s’écria Baï Gagno en partant d’un éclat de rire.
Le restaurateur le contempla avec étonnement.
— Tu ne le connais pas, ce gaillard-là ? continua Baï Gagno en se tournant vers moi. C’est un loustic, ce Dimitrov...
Et le patron nous raconta l’histoire que voici : Un jour M. Dimitrov arriva par le chemin de fer avec un jeune garçon de treize à quatorze ans, qui était sourd-muet. Je connaissais Dimitrov depuis un an déjà ; il habitait notre ville où il courtisait une jeune fille. Il l’épousa, puis partit pour Moscou ou pour Pétersbourg, je ne sais pas au juste. En arrivant avec le petit sourd-muet, il me dit que cet enfant avait là-bas, chez vous, en Bulgarie, un frère fonctionnaire ou officier — je ne me souviens plus — qui voulait l’envoyer en pension dans l’un des Instituts de sourds-muets de Pétersbourg, moyennant cent francs par mois. Mais comme M. Dimitrov devait partir pour quelque autre ville, — c’est du moins ce qu’il me raconta — il me pria de recueillir l’enfant chez moi, de le nourrir et de le garder jusqu’à son retour. Il m’assurait qu’il reviendrait au bout de dix jours. J’acceptai, je recueillis le pauvre petit et je le soignai comme mon propre fils. Dix jours, un mois, deux mois passèrent ; de Dimitrov pas de nouvelles. Je cherchai à savoir quelque chose par l’enfant, mais le pauvre petit sourd-muet ne put rien me dire. Comme je voyais l’enfant devenir morose, j’écrivis à Pétersbourg, à Moscou : personne ne me répondit. Le troisième mois, messieurs, le petit s’enfuit. Je demandai, je cherchai, je prévins la police, je télégraphiai dans plusieurs directions. Ce fut en vain. Le pauvre enfant était perdu. Qu’est-il devenu ? Je l’ignore. Si M. Dimitrov est responsable de sa disparition, je n’en ai pas moins subi, moi, une perte de cent roubles... Et maintenant vous me dites qu’il se marierait cette semaine ! Mon Dieu ! est-ce possible ! Je vous en prie, messieurs, informez votre administration de cette affaire. Prévenez la pauvre jeune fille avec laquelle il va se marier...
Je promis au restaurateur qu’aussitôt arrivé à Pétersbourg j’informerais quelqu’un qui télégraphierait immédiatement à l’Exarchat. Je payai. Nous remontâmes en wagon et partîmes pour Pétersbourg.
— Tu avais bien besoin de te mêler de cette affaire, me dit d’un air de reproche Baï Gagno. Sais-tu seulement quelle espèce de femme il a ici ?
Nous voyagions en troisième classe. Baï Gagno prit deux places et s’étendit pour dormir. À la station suivante, quelques nouveaux voyageurs montèrent dans notre wagon. Il fallait leur faire de la place. Mais Baï Gagno n’est pas si naïf. Il fit semblant de dormir et il ronfla, ronfla tant qu’il put. Un gros paysan allemand s’approcha de lui, un sac à la main, et essaya de le réveiller, en le poussant doucement par les bottes. Baï Gagno ne bougeait pas et faisait entendre des hrrr.... pfff.... hrrr... pfff... En se cachant de l’Allemand, il cligna de l’œil, comme pour me dire : « Vois comme je suis malin ! »
— Allons ! lève-toi ! s’écria l’Allemand en poussant plus fort mon compagnon.
— Hrrr... Pfff...
— Hé ! ne fais pas le singe, gros finaud ! grommela l’Allemand. Et avec son sac il balaya les jambes de Baï Gagno, le jeta sur ses bissacs et s’assit à côté de nous.
Baï Gagno fit semblant de se réveiller, se frotta les yeux et aussitôt, comme s’il n’avait rien entendu ni rien senti60, il sortit sa blague, l’ouvrit et la tendit à l’Allemand :
— Boulgarski tabak !
— Ah ! vraiment, vous êtes Bulgare. Je suis content de faire votre connaissance, dit l’Allemand d’un air aimable, en se mettant à rouler une cigarette. Et vous allez à Pétersbourg ! Moi aussi. Alors, nous voyagerons ensemble.
Dès notre arrivée à Pétersbourg, je m’empressai de tenir la promesse que j’avais faite au restaurateur de Vilna. Je rencontrai mon ami et je lui racontai l’aventure de Dimitrov. Il télégraphia immédiatement à Constantinople pour essayer d’empêcher le mariage projeté. Et lui, de son côté, me raconta la suite de l’histoire du sourd-muet. Quand et comment eut-il l’idée de s’enfuir de Vilna ? On ne le sut pas exactement. Mais un beau jour, l’enfant arriva à Pétersbourg et il y fut pendant longtemps victime de la plus honteuse exploitation de la part de Dimitrov. Non seulement celui-ci avait empoché l’argent adressé par le frère du pauvre petit, mais il l’avait envoyé de force mendier de porte en porte chez les personnalités les plus influentes et chez les philanthropes les plus connus de Pétersbourg. Et cela, pas seulement à Pétersbourg. Il l’avait envoyé plusieurs fois aussi jusqu’à Cronstadt, auprès du saint homme, célèbre dans le bas peuple, Jean de Cronstadt...
Comme je me trouvais presque sans le sou, j’étais obligé de vivre à la Dechovka, l’asile des étudiants pauvres. Baï Gagno s’était mis dans la tête de venir lui aussi à la Dechovka.
— Mais c’est impossible, Baï Gagno ; cet établissement est réservé aux étudiants.
— Quoi ? réservé aux étudiants ? m’objecta Baï Gagno. Les étudiants ne sont-ils pas des gens comme moi ? Et puis après, la belle affaire ! un Bulgare de plus ou de moins !
— Mais vous êtes riche, Baï Gagno, vous pouvez bien vous payer l’hôtel !
— Ah ! tu es encore naïf, toi, me dit sur un ton de reproche Baï Gagno. Je te croyais plus malin ! Ah ben ! pourquoi donc irions-nous, nous autres Bulgares, donner notre bonne galette aux Moscovites ? Quand tu trouves une occasion, saisis-la par les cheveux à deux mains ! Et puis comment sauront-ils que ma bourse n’est pas plate ?
— C’est impossible, Baï Gagno. Les étudiants pauvres protesteraient ; ils s’en prendraient à moi et ils pourraient me chasser de l’association.
— Tête têtue de Bulgare ! continua Baï Gagno. As-tu donc perdu ta langue ? Est-ce que tu ne peux pas imaginer de leur raconter que je suis ton frère, que je me trouve dans la misère ; et puis tu n’as qu’à leur dire que je suis Bulgare. Est-ce que tu ne sais pas que les Russes sont de braves gens ?...
— Non, non ! C’est impossible ! m’écriai-je d’un air décidé, et je partis pour la Dechovka.
— Ehé ! tu te figures que tu vas te débarrasser de moi aussi facilement que ça ! Attends un peu ! Tu en verras bien d’autres ! murmura Baï Gagno, et il emboîta le pas derrière moi. Bulgare ! Ça, un Bulgare ! Ça n’a pas pour quatre sous de patriotisme !... Attends un peu, l’ami. Ne te dépêche pas comme ça. Je ne peux pas te rattraper. Ma besace me pèse. Attends un peu, Bulgare de mon cœur !...
À ce moment nous offrions, cela se voyait, un assez curieux spectacle, car les passants qui nous croisaient sur le trottoir se retournaient et nous considéraient avec attention. Baï Gagno, à dix pas derrière moi, portant sur l’épaule sa besace attachée à son bâton et sur l’autre bras son kilimtché61 qu’il soulevait de temps en temps pour essuyer son front couvert de sueur, le kalpak en arrière, me criait ;
— Attends-moi donc, pour l’amour de Dieu ! Prends-moi un peu mon kilimtché. Il me casse le bras... Tu crois que tu vas te débarrasser de moi ! Tu ne sais pas quel crampon ça fait, ton Baï Gagno !...
Je marchais comme sur des épines et je tâchais de me représenter ce qui se passerait à la Dechovka avec Baï Gagno et comment je pourrais arranger ce caprice de mon compagnon. Il me faudrait mentir ! Quant à me débarrasser de lui, je voyais bien qu’il n’y avait pas à y songer. Après tout, c’était l’affaire de quelques jours. Je pris mon parti de cette situation à laquelle je ne pouvais rien. Baï Gagno marchait, marchait derrière moi en grognant, mais il avait cessé déjà ses fanfaronnades, et c’est sur un ton plus doux qu’il reprit :
— Écoute-moi donc, mon vieux Vasile ; attends un peu, je t’en prie, voyons, mon vieux Vasile. Nous sommes des Bulgares, après tout !...
Et figurez-vous, messieurs, qu’à ce moment j’eus pitié de Baï Gagno. Vraiment ! Je me disais bien que ce qu’il faisait là était honteux, que c’était un avare répugnant, un égoïste, un vieux rusé, un hypocrite, un exploiteur, un grossier personnage et un mendiant jusqu’à la moelle des os... Tout de même, j’avais pitié de lui. Dans les humbles vibrations du ton sur lequel il avait prononcé ses dernières paroles, mon oreille avait perçu une note tendre qui était cachée au fond du cœur de Baï Gagno, et qui ne s’échappait que rarement — combien rarement, mon Dieu !...
Je ne sais si cela ne vous paraîtra pas ridicule, extraordinaire, mais je vous dirai, messieurs, qu’à ce moment je me retournai vers Baï Gagno. Il me semblait que quelqu’un me soufflait à l’oreille :
« Ne méprise pas ce malheureux, ce finaud, ce misérable avare. Il est né dans un milieu grossier. Il est victime de l’éducation qu’il a reçue. Ce n’est pas en lui seul qu’est le mal. Il est victime de son milieu. Il est actif, sensé, intelligent — intelligent surtout ! Mets-le sous l’influence d’un bon guide, et tu verras quelles actions d’éclat il est capable de faire. Baï Gagno n’a laissé voir jusqu’ici que sa vive énergie. Mais en lui se cache, à l’état potentiel, une grande force d’âme qui n’attend qu’une impulsion morale pour se transformer en force vive... »
Nous arrivâmes à la Dechovka. La plupart des étudiants n’étant pas encore rentrés de vacances, il y avait pas mal de places libres. Mon lit avait été retenu par mon fidèle camarade Kotcho, un Albanais, un miséreux de la pire espèce, qui recevait de l’Association slave trois roubles par mois pour son thé et son sucre. Il avait suivi les cours de l’Université pendant deux ans, mais s’apercevant que ce n’était pas son affaire, il l’avait quittée pour entrer au Séminaire. C’était un brave garçon, ce Kotcho. Il aurait donné sa tête pour un ami. Mais, grands dieux ! il ne fallait pas le mettre en colère ! Subitement tous ses instincts d’Albanais entraient en éruption. Il devenait pâle, vert ; ses yeux s’injectaient de sang. Une vraie bête fauve !...
Quand nous entrâmes avec Baï Gagno dans la chambre, nous trouvâmes Kotcho sur son lit, dans la position horizontale. Ce lit ! Il était difficile de distinguer immédiatement où était l’oreiller, la paillasse, la couverture... Kotcho sauta sur ses pieds avec la légèreté de la panthère, s’élança au devant de moi, m’embrassa, fit connaissance avec Baï Gagno et, gaiement, les yeux brillants de joie, nous invita à nous asseoir, qui sur le lit, qui sur la malle, en s’excusant du « petit » désordre qui régnait dans sa chambre. Enfin il ouvrit la porte et s’écria en albanais :
— Ivan ! ma colombe, apporte le samovar !
— Mais qu’est-ce que tu veux faire avec le samovar, quand tu n’as ni thé ni sucre ? lui répondit la « colombe » du fond du corridor.
Kotcho se prit la tête entre les mains, se mit à arpenter la chambre, saisit son chapeau et, sans écouter nos supplications, nos offres d’acheter le thé et le sucre, s’enfuit en s’écriant : » Un instant ! » et disparut...
Nous l’attendons, Baï Gagno et moi, une demi-heure, une heure. Kotcho ne revient pas. Il doit lui être arrivé quelque chose. Pour que nous ne perdions pas une belle journée, je propose à Baï Gagno d’aller nous promener.
— Ah ben ! attends un peu. Il va nous donner du thé, l’autre, répond Baï Gagno. (Il ne peut pas se résoudre à lâcher un petit bénéfice, d’où qu’il vienne.)
Mais je lui fis de nouveau ma proposition. Baï Gagno fourra ses moskals dans sa ceinture et nous sortîmes.
Comme nous approchions du pont Anitchkine, nous entendons de loin un cri de bête fauve, au milieu des jurons et des blasphèmes les plus énergiques ; nous arrivons au pont et qu’est-ce que nous voyons ?... Kotcho, comme un tigre furieux, tenant au collet dans ses doigts de fer un inconnu dont le chapeau avait roulé par terre. Il lui courbait la tête et essayait de le jeter par-dessus le pont. La victime faisait tous ses efforts pour se dégager, mais il n’était pas si facile de s’échapper des mains de l’Albanais enragé.
— Charlatan ! hurlait Kotcho. Lâche, espion que tu es ! Ce n’est pas moi, c’est toi qui es un espion, fils de Satan ! Je te tuerai, espèce de vendu !
Je me précipitai pour les séparer. Mais Baï Gagno s’écria derrière moi :
— Laisse-les donc. Est-ce que tu as besoin d’attraper un mauvais coup ? Qu’ils se cassent la tête ! Laisse-les. Ils te prendraient comme témoin devant la police.
Je n’écoutai pas les conseils de Baï Gagno et je me précipitai vers l’Albanais qui ne cessait de crier à tue-tête et de lancer les épithètes les plus violentes à la face de sa victime qu’il avait entraînée déjà au bord du pont ; un instant de plus, à ce qu’il me semblait, et l’inconnu allait être précipité la tête la première dans les eaux limpides de la Fontanka.
— Charlatan ! Lâche ! criait Kotcho en enfonçant toujours plus fort ses doigts osseux dans le large cou de son adversaire.
Lorsque je ne fus plus qu’à quelques pas d’eux, la victime, terrifiée du sort qui l’attendait, fit un effort désespéré, s’arracha des mains de l’Albanais, saisit son chapeau qui était tombé par terre et prit la fuite.
— Arrête, charlatan ! Sale individu !
Kotcho saisit une pierre et la lança sur lui.
L’inconnu s’enfuit vers un tramway, sauta dedans et disparut... Mais l’Albanais ne se calmait pas.
— Je te tuerai, lâche charlatan ! continuait-il en montrant le poing dans la direction où son ennemi s’était enfui.
J’interpellai Kotcho par son nom. Il se retourna — et ne me reconnut point !... Dans son regard, il y avait quelque chose de sauvage. Ses yeux luisaient, son visage était devenu vert et sombre, ses dents claquaient comme s’il avait eu le plus violent accès de fièvre ; ses lèvres tremblaient convulsivement et laissaient échapper un sourd grognement.
— V... v... b... b... v.,. v... Charrll..., sat... l... l... lâche... m... m... m... charlatan ! s’écria-t-il encore une fois en se retournant pour menacer son ennemi invisible.
— Kotcho, ma colombe, qu’est-ce qui t’est arrivé ? Qui est ce monsieur ? lui demandai-je du ton le plus aimable.
Il tourna les yeux vers moi, me jeta un regard mauvais, l’esprit ailleurs, et de nouveau ne me reconnut pas !...
— Oui, je te tuerai, espèce de vendu ! Et je te montrerai celui qui est un espion ! grommelait Kotcho en menaçant un tramway qui passait, comme si dans chaque tramway se trouvait son ennemi.
— Kotcho, je t’en prie, dis-moi, qu’est-ce qui t’est arrivé ? demandai-je à mon ami fou de colère. Qui était ce monsieur ?
Kotcho me regarda encore une fois et s’écria :
— C’est le dernier des vauriens ! comprends-tu ? le der-nier des vau-riens !
Et de nouveau il détourna les yeux et se remit à crier ses injures. Je commençais à comprendre que mon ami était victime de quelque vilenie que son ennemi avait commise envers lui. Mais quelle était cette vilenie ? Je ne le devinais pas et je n’aurais pas pu le deviner.
Ce que me raconta Kotcho était tellement odieux qu’il m’était impossible de l’imaginer. Voici le récit que nous fit Kotcho lorsqu’il eut un peu repris son sang-froid.
— Figurez-vous, messieurs, que lorsque je sortis de la Dechovka, j’allai à l’Association Slave pour toucher mon secours et pouvoir acheter du thé et du sucre pour vous recevoir. Tu sais, Vasile, ma colombe, quelle mensualité je reçois ! Trois roubles par mois ! Trois méchants roubles ! Et croyez-vous que je découvre que cette canaille veut, par jalousie, me voler ma richesse ! Et qui est-ce ? Un de vos compatriotes. Mes félicitations !... Je lui casserai les dents, à ce charlatan !... Figurez-vous, messieurs, que je m’approche du caissier et que je le prie de me donner les trois roubles. Mais lui, se tournant vers moi d’un air irrité, me dit :
— « Comment n’avez-vous pas honte, jeune homme, de vous occuper de ces affaires malpropres ?...
— « Quelles affaires malpropres ? m’écriai-je en tombant de mon haut.
— « Nous avons des preuves, continua-t-il, que vous êtes un espion du gouvernement bulgare.
— « Quoi ? moi, un espion !
— « Oui, nous ayons des preuves certaines. Votre bourse vous est enlevée et donnée à M. Aslanov.
— « Mais pour Dieu ! qui vous a fourni ces preuves ? demandai-je, les larmes aux yeux de colère.
— « M. Aslanov lui-même, répondit-il tranquillement.
— « Ah ! c’est bon ! » hurlai-je, comme si j’étais devenu fou, et je m’élançai dans la rue jusqu’au pont Anitchkine... Vous savez le reste... Bon Dieu ! Messieurs, pouvez-vous imaginer quelque chose de plus ignoble !... Charlatan ! J’ai dit : « C’est bon ! » Je l’ai dit, moi... moi... moi ! Et je ne l’oublierai pas !...
Nous réussîmes à calmer petit à petit Kotcho et nous entrâmes avec lui dans une buvette pour prendre un verre de thé. Nous nous y attardâmes assez longtemps, à écouter les récits que nous faisait l’Albanais des aventures humiliantes d’Aslanov. Baï Gagno lui-même avait cessé de pousser ses « bravos ! » ou ses « achkolsoun ! » Au contraire, de temps en temps, il faisait claquer sa langue en signe de désapprobation, il hochait la tête et disait : « Oh ! c’est une vraie bourrique que cet individu-là ! »
Nous sortîmes du café et nous nous dirigeâmes vers la Perspective Nevski. Une foule bigarrée venue de toutes les parties du monde encombrait les trottoirs de la brillante artère. Nous nous faufilions au milieu des passants. Sur la chaussée circulaient sur deux rangs des voitures de toutes sortes. Des magasins plus luxueux les uns que les autres attiraient les regards du public. Baï Gagno daignait reconnaître que « somme toute, Pétersbourg n’était pas de la petite bière... » Pendant une heure entière nous nous glissâmes au milieu de la foule, jusqu’à la Néva. Au moment où nous arrivions au quai plus calme des Anglais, nous n’avions pas fait dix pas que Kotcho tout frémissant me saisit le bras et s’écria d’une voix rauque :
— Le voilà !
— Qui ça ?
— Quel charlatan ?
— Le plus impudent de tous. Arrête-toi. Cachons-nous pour qu’il ne nous remarque pas, murmura-t-il en nous entraînant par la manche derrière les colonnes d’une porte cochère.
Baï Gagno sortit le nez de derrière la colonne et regarda dans la direction indiquée par Kotcho.
— Qui voyez-vous ? demanda Kotcho.
— Je vois un individu, murmura tout bas Baï Gagno. Eh ! mais, Vasile, regarde un peu. Il ressemble rudement à « notre » Dondoukov-Korsakov...
— C’est lui-même, répondit Kotcho. Et qui voyez-vous encore ?
— Je vois deux autres individus, agenouillés devant Dondoukov. Regarde un peu. Ils lui... oh !... ils lui baisent les bottes ! ils pleurent ! ils le supplient ! ils se frappent la poitrine ! Regarde... oh !... il veut se débarrasser d’eux... ils ne veulent pas le lâcher... l’un d’un côté, l’autre de l’autre, accrochés à ses jambes...
— Regardez-les bien. Ne pouvez-vous pas en reconnaître un des deux ? dit l’Albanais d’une voix autoritaire.
— Je ne le peux pas. Comment les reconnaître ? Ils baissent constamment le nez sur ses bottes... Ah ! attends, s’écria Baï Gagno. Attends !... Je l’ai reconnu ! Ah ben ! c’est... ma foi ! c’est bien lui ! c’est celui que tu voulais faire passer par-dessus le pont... c’est lui !
— C’est bien lui... la canaille ! Vous êtes témoins maintenant de l’une de ses misérables comédies, grommela l’Albanais, les dents serrées. Et maintenant, allons ! retournons sur la Perspective Nevski.
— Attends, que nous voyions la fin de la scène, proposai-je.
— Ce n’est pas la peine, dit résolument Kotcho. La fin n’est pas douteuse. Ils s’accrocheront à ses jambes et ils pleureront, jusqu’à ce qu’il leur ait donné quelques roubles ou quelque recommandation pour une autre victime... Ces odieux personnages pourraient bien salir le nom de la nation tout entière !...
— Hé ! quelle sacrée bourrique que cet individu ! s’écria Baï Gagno en faisant claquer sa langue.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Eh bien ! pourquoi t’arrêtes-tu, Vasile ? Continue, fit observer quelqu’un de notre compagnie. Raconte-nous l’histoire d’Ermolov...
— Laissons cela. Ça me répugne, répliqua Vasile.
— ... Ou bien l’histoire de la Princesse Belozerskaïa...
— Laissons cela. Je ne peux plus !
— Savez-vous l’histoire de Baï Gagno chez le tripier ? dit un autre.
— Savez-vous aussi quelque chose sur les moustaches rasées.....
— Ça suffit, messieurs. Les histoires de Baï Gagno n’ont pas de fin. Passons maintenant à la deuxième partie de la soirée. Marc Avreli, ma colombe, chante-nous quelque chose. Ou bien toi, Kalina-Malina, quelque petite chanson !... Allons ! « Retrousse, Vela, ma belle fille, retrousse tes manches blanches »...
Et la deuxième partie de la soirée commença... Après minuit nous nous séparâmes.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Au revoir, Baï Gagno ! Parcours l’Europe. Répands un peu partout le produit de notre belle Vallée des Roses. Mais... je t’en prie, Baï Gagno, pénètre-toi davantage de la vie européenne. Tâche d’en voir un peu les bons côtés. Tu en as assez vu jusqu’ici les mauvais !...
— AVEZ-VOUS appris la nouvelle ? s’écria Marc Avreli en ouvrant la porte et se précipitant hors d’haleine dans la pièce.
— Quelle nouvelle ? demanda toute la compagnie.
— Baï Gagno est revenu d’Europe !
— Pas possible !
— Comment « pas possible » ! Je l’ai vu, messieurs, je lui ai parlé... Ses premiers mots... ha, ha, ha !... « Nous avons fait... » ha, ha, ha, ha !... « Nous avons fait une belle gaffe, nous autres... » a-t-il dit... ha, ha, ha !...
— Auras-tu bientôt fini de te tordre ? s’écria d’un air impatienté Arpakach. Raconte-nous cela. Veux-tu du thé ?
— Arpakach, laisse-moi déposer un baiser entre tes deux beaux yeux...
— Vieille bête ! riposta Arpakach en souriant. Et il tendit un verre de thé à Marc Avreli en lui tirant, de sa main restée libre, sa moustache retroussée. Triple buse !
— Capitaine, ne fais pas chavirer le navire, dit en plaisantant Marc Avreli ; puis il huma quelques gorgées de thé et commença son récit :
— Quelle chance j’ai eue là, figurez-vous, messieurs ! Il y a quelques jours, le 22 (ton chiffre favori, Aleko !), un dimanche, nous allâmes, Guervanitch et moi, à l’auberge de l’Isker, près de Vrajdebna. Nous y trouvâmes une foule...
— Les gens d’Ourvitch n’étaient-ils pas là ?...
— Non, ils n’y étaient pas. Ils étaient dans leur Ourvitch... Ne m’interromps pas, Arpakach... Il y avait un monde fou, des étrangers surtout, des Allemands, des Tchèques, et pas un, mais pas un seul de ces Chops62 apathiques comme des pierres... Je ne vis passer que le père Hadji allant à sa ferme. Le temps, comme vous savez, était superbe. On ne pouvait se lasser de respirer le parfum de ces prairies, de ces champs, de cette fraîche verdure de la forêt. Les étrangers étaient venus avec leur famille tout entière ; ils avaient apporté des provisions, des couvertures, des berceaux pour les enfants ; assis à l’ombre, de-ci, de-là, tous ces gens festoyaient. Ils faisaient plaisir à voir. Et n’allez pas dire que c’étaient des richards, des bourgeois. Non, c’étaient des artisans, des travailleurs — des ferblantiers, des forgerons, des menuisiers. Après avoir travaillé pendant six jours, le dimanche, ils s’amusent ! Et ils ne font pas comme vos seigneuries qui s’enferment dans des cafés enfumés pour jouer à votre sacrée « batchka63 »...
— Marc Avreli ! est-ce toi qui dis cela, ma colombe ? Ivan Zlatooust, viens que je t’embrasse !...
— Tais-toi, Arpakach, ne m’interromps pas...
— Voyons, Amonasro, ne l’interromps pas, répliqua Moïché.
— N’est-il pas vrai, messieurs, continua Arpakach en plaisantant encore, avec un regard mielleux, dites-moi un peu si Marc Avreli n’est pas exquis, surtout quand il prononce ce joli petit mot « batchka ». Ce « tch », c’est une vraie musique...
— Te tairas-tu, Amonasro l’Éthiopien ?...
— Et avez-vous remarqué, messieurs, quelle profonde haine nourrit notre doux Marc Avreli contre cette « batchka » ?
— Écoute, Amonasro, tais-toi. Ou bien j’enverrai Moïché te verser dans le gosier ce verre de cognac tout entier.
— « Mais quels blagueurs que les nôtres ! En voyant la vieille en pantalon ! Ils se sont tous mis à la suivre, et lui n’a pas eu la fille ! » Taaara-ra-boum : bié !... taa-ra-ra-boum !
— Tu es toqué, Arpakach, mais tu es fou ! dit sur un ton de reproche Marc Avreli. Tiens-toi un peu tranquille, je t’en prie...
— Ça suffit, Arpakach ! répliqua Ojilka.
— Et toi aussi, Ojilka, et toi aussi, Brutus ! Allons, chante-nous un peu : Je passais hier soir près de Sevlievo...
— Conspuez Arpakach ! s’écria Moïché.
Et toute la compagnie reprit après lui : « Conspuez ! » Enfin on força le « Roi d’Éthiopie » à se taire.
Marc Avreli continua :
— En vérité, messieurs, c’est une triste chose que cette « batchka » trois fois maudite qui nous cristallise, qui nous couvre le cerveau de moisissures et de toiles d’araignée. Croyez-moi. J’ai quelques amis qui pendant dix années entières — dix années ! — je ne plaisante pas, messieurs, — n’ont pas cessé de pourrir dans un coin enfumé du Panakov64, les cartes à la main. Et sous leur nez fleurissait ce joli, ce pittoresque jardin municipal et ils ne songeaient pas à profiter de son air pur et de sa fraîcheur. Et puis en dehors de Sofia, dans les environs, que d’endroits admirables ! Nous restons assis dans les cafés et nous soupirons en songeant à la Suisse, tandis qu’avec un tout petit effort nous l’avons près de nous la Suisse, la Suisse bulgare : le Vitoch, le Rilo, le Rhodope ! Le dernier des étrangers habitant Sofia s’est réjoui les yeux en contemplant le panorama grandiose du Pic noir. Mais dites-moi, voyons, y a-t-il un seul Chop, un seul ! qui soit monté au sommet du Vitoch ? Nous connaissons les exemples de ces ouvriers italiens qui ont quitté ici un travail tout prêt, simplement parce que sa monotonie les ennuyait et qui ont préféré le risque d’un départ pour l’étranger, dans l’espoir de voir du pays. Et à côté de cela, nous avons l’exemple du pâtre du monastère de Dragalevtsi qui pendant toute sa vie a regardé Sofia du haut de sa montagne, qui a vu la ville avant la libération, qui a assisté à sa destruction, à sa reconstruction et à ses agrandissements, qui continue maintenant encore à lézarder, assis à l’ombre d’un noyer et qui même aujourd’hui où le panorama qu’il a sous les yeux est si admirable, n’a pas la curiosité de sortir de sa forêt pour voir de près cette transformation si intéressante à tous points de vue de la capitale !...
Pourtant j’approuve ce philosophe à sa manière, et même, à vous dire vrai, j’envie cet enfant de la nature ! Mais que dire de la foule de nos riches concitoyens qui respirent pendant toute leur vie la poussière et les odeurs des vieilles rues de Sofia, contemplent pendant toute leur vie la belle forêt de Dragalevtsi et n’ont jamais eu le désir de se lever, d’y aller, et de jouir de son air pur et de sa fraîcheur, du bruit charmeur du ruisseau qui murmure et des rossignols...
— Peste ! tu es un vrai poète, Marc Avreli, ma parole ! Voyez-vous ça ?... Mais dis-moi un peu pourquoi tu nous sers ces histoires de vieilles femmes. Est-ce que tu ne devais pas nous parler de Baï Gagno ?
— C’est justement pour cela que je vous raconte « des histoires de vieilles femmes ». Je suis furieux de voir que nous sommes apathiques comme des morceaux de bois... Vous allez en conclure que nous ne comprenons rien aux beautés de la nature. Non. Nous ne pouvons pas n’y rien comprendre, parce que c’est un sentiment universel que les animaux eux-mêmes éprouvent. Mais nous sommes paralysés par notre indolence orientale. Si je t’attrapais, Arpakach, par le collet et si je t’entraînais jusqu’au monastère d’Ourvitch, dès que tu serais arrivé derrière la colline de Kokaliané au-dessus des gorges de l’Isker, et que tu entendrais chanter doucement la rivière écumante et sinueuse, tu te mettrais à faire claquer ta langue et tu t’écrierais, oui, certainement tu t’écrierais : « Ah ! c’est une vraie Suisse ! Vois, est-elle belle notre Bulgarie ! Et nous autres, imbéciles, qui ne le savons pas et qui passons tous les jours de fête dans les cafés !... » Mais dès que tu seras de retour à Sofia et que tu respireras son atmosphère étouffante, tu retomberas en léthargie, tu te cristalliseras de nouveau dans ton apathie, jusqu’à ce que quelqu’un d’autre t’empoigne encore par le collet.
Et maintenant, Baï Gagno. Nous nous promenâmes toute la journée dans la forêt, Guervanitch et moi ; nous nous roulâmes dans l’herbe sous les arbres ; nous mangeâmes, nous bûmes ; nous contemplâmes les groupes joyeux des étrangers qui s’abandonnaient corps et âme à leur gaieté. Ils s’étaient livrés à toutes sortes de divertissements, le chant, la course, le saut : tu en aurais été jaloux ! Vers le soir, après avoir absorbé un goûter savoureux, nous allâmes, Guervanitch et moi, à l’auberge pour prendre un café.
À un moment donné, sur la route d’Orhanié, nous entendîmes des grelots et tout de suite après, dans un nuage de poussière, arriva une voiture. Il en descendit un voyageur, puis un deuxième, et derrière le dos du cocher la voix du troisième se fit entendre :
— Baï Michel, prends-moi un peu ma besace ; fais bien attention de ne pas la cogner quelque part, de ne pas casser les moskals, parce que tu sais, je n’aurais pas de quoi rembourser... l’autre65.
Et à ces mots descendit de la voiture... Baï Gagno. Le même Baï Gagno, celui que vous connaissiez avant son départ pour l’Europe ; avec cette seule différence qu’il porte une cravate, et aussi qu’il a maintenant un air plus imposant et le sentiment de sa valeur personnelle et de sa supériorité sur ses compatriotes. Pour quelqu’un qui s’est promené à travers l’Europe, qu’est-ce que c’est que l’Europe ? Pas grand’chose... rien du tout.
Il tire sa moustache gauche, tousse dans la paume de sa main et promène sur ceux qui l’entourent un regard pareil à celui que nos policiers jettent sur les gens qu’ils ont arrêtés. À la façon dont il contemple les groupes joyeux des étrangers, à la façon dont il hoche la tête devant ses compagnons ignorants, on comprend qu’il veut leur dire : « Faut-il donc pleurer sur vous, pauvres gens, avant que vous soyez morts ? » Il pousse un profond soupir et dit d’un air important :
— Qu’est-ce que dit ta seigneurie ? Je n’ai pas bien entendu, fit remarquer le nommé Baï Michel.
— C’est sur vous autres que je pleure, avant que vous soyez morts, déclara Baï Gagno avec un air de pitié. Ah ! le Prater, le Prater !... Est-ce qu’il ne vous est pas venu tout de suite à l’esprit que cet endroit-là a quelque chose du Prater ? Mais, comment cela pourrait-il vous venir à l’esprit ? Si j’essayais de vous raconter... mais vous ne pouvez pas comprendre cela.
Et pour montrer un peu à ses innocents compagnons quels étaient les gens capables de le comprendre, il s’approcha de l’un des joyeux groupes, auprès duquel se trouvaient quelques tonneaux de bière vides et, en esquissant un sourire ironique, il indiqua des yeux la petite forêt et dit :
— Das is Boulgariche Prater, ha, ha, ha !...
Le groupe tout entier considéra de la tête aux pieds notre « Allemand », avec des yeux légèrement brouillés par la bière, et quelqu’un, sans faire attention à ce qu’avait dit finement Baï Gagno, lui offrit un verre de bière éventée, en disant :
— À votre santé, monsieur. Voulez-vous un verre de bière ?
— Ceux-là non plus ne me comprennent pas, se dit à lui-même Baï Gagno et, se tournant vers ses compagnons, il ajouta : Ils sont pleins comme... des cosaques.
Ils entrèrent ensuite dans l’auberge et s’assirent près de nous. Je leur tournais le dos et Baï Gagno ne pouvait pas me reconnaître. Il était certain d’ailleurs qu’il ne me reconnaissait pas, à en juger par la façon dont il s’exprimait sur notre compte :
— Et ceux-là aussi doivent être pleins. Du stock allemand !
Le garçon s’approcha des voyageurs et se mit à essuyer la table.
— Ne voulez-vous pas quelque chose ? demanda-t-il.
— Non. Rien. Nous avons ce qu’il nous faut. Mais apporte-nous un verre d’eau et du feu. Et de l’eau fraîche, hein ! recommanda Baï Gagno.
Les voyageurs entamèrent une conversation sérieuse à voix basse. Tous les mots ne parvenaient pas jusqu’à nos oreilles.
— Ce soir nous ne pourrons pas voir le patron ; il sera trop tard, chuchotait Baï Gagno. Nous lui enverrons nos armaganes66 et nous lui donnerons rendez-vous pour demain. Et puis il nous fixera le jour où nous irons chez le Prince.
— Mais dis-moi donc, pour le Prince as-tu quelque armagane ? demanda Baï Michel d’un air précautionneux.
— Il n’en faut pas, répondit Baï Gagno sur un ton autoritaire. Ici, c’est le patron qui est tout. Jette-lui de la poudre aux yeux, et tu pourras te promener en caleçon. Nous lui communiquerons ce que nous aura écrit l’avocat, pour qu’il le lise et le corrige au besoin. C’est son affaire ! Et devant le Prince, tâchez de vous tenir, hein ! et de ne pas avoir peur. Vous n’aurez qu’à me regarder faire. Quand je dirai, comme on nous l’a bien recommandé : « Votre Altesse Royale ne peut songer à accepter cette démission, parce que le gouvernement transdanubien... » vous répéterez après moi : « Votre Altesse Royale n’y peut songer ! »
— Parbleu ! qu’est-ce que tu veux que nous disions d’autre ? répondit d’un air docile Baï Michel.
— Hé, hé ! toi, Michel, tu sens un peu les bottes67 ! Qui sait ce que tu vaux ? Tâche de faire attention ! le prévint paternellement Baï Gagno.
— Qui ? moi ? répliqua Baï Michel. Ne parle donc pas ainsi, voyons, frère. Quelqu’un pourrait entendre. Les murs ont des oreilles. Moi, quand j’entends le mot « cosaque »... la fièvre me prend.
— La fièvre te prend. Bah ! murmura en clignant de l’œil Baï Gagno. Et quand les Russes sont venus, qui est-ce qui a raflé le bétail dans les villages turcs ? Hein ? Depuis quand es-tu devenu riche, hein ? Dis-le-moi un peu ?
— Eh bien, et toi, alors, Baï Gagno... Je te conseille de parler... murmura Baï Michel. Est-ce que ce n’est pas de l’époque russe que datent tes moulins ? Dis, n’est-ce pas vrai ?
— Allons, allons, avec toi il est impossible de causer. Ce qui est passé est passé. Maintenant, c’est autre chose. Maintenant, c’est le gouvernement transdanubien, comprends-tu ?
— Un peu, oui ! dit Baï Michel en faisant d’un air malin de petits signes à ses compagnons.
Et ils se mirent à rire tous les trois en se cachant avec leur main, pour qu’on ne pût pas les entendre.
— Hé, hé ! faites attention, méfiez-vous, si quelqu’un nous écoutait... cela ferait un beau tapage.. » Hé, garçon, qu’est-ce que c’est que ce journal qui est là-bas ? La Liberté ? dit Baï Gagno en se tournant vers le garçon.
— La Tribune Libre, monsieur.
— Hé ! j’aurais bien envie de le lire, chuchota Baï Gagno à ses compagnons, mais j’ai peur... Que le diable l’emporte ! Le patron apprendrait cela. Il faudrait ensuite que j’aille lui donner des explications.
Mais juste à ce moment se produisit un incident qui cloua les voyageurs à leur place. Un gamin de cinq à six ans se promenait désœuvré près du seuil de l’auberge en chantonnant quelques improvisations et, visiblement sous l’impression du cri de « à bas » hurlé sans interruption à Sofia pendant trois jours, sur l’air de Choumi Maritsa 68, tout absorbé par sa chanson, il employait les mots suivants qui s’étaient imprimés dans son cerveau : « À bas, à bas, à bas Stamboulov ! »
L’éclat de rire que laissèrent échapper les groupes joyeux arrêta net l’improvisation de l’enfant qui, excité par son succès inattendu, reprit sa chanson de plus belle en élevant la voix. Au lieu de « marche, marche ! » il criait : « À bas, à bas, à bas Stamboulov ! à bas, à bas Stamboulov ! »
Cette fois, au milieu du rire général, éclatèrent aussi des applaudissements et des cris de : « Bravo » ! « Conspuez » ! « Conspuez le débauché » ! « À bas le tyran » ! poussés par un groupe de jeunes gens qui rentraient de promenade.
Je me retournai vers la table des trois voyageurs.
Baï Gagno et ses compagnons étaient changés en statues. Ils avaient la bouche ouverte, les yeux fixes et hagards, et leurs visages exprimaient un si lamentable mélange de terreur et de stupéfaction, que je regrettais de ne pas avoir un appareil photographique69...
Le premier, Baï Gagno reprit ses sens. Il tourna les yeux vers les manifestants, et brusquement tressaillit comme s’il avait touché un fil électrique : un gendarme à cheval qui passait sur la route avait entendu ces cris effroyables, et au lieu de tirer son sabre et de le faire tourbillonner en tempête au-dessus des têtes de ces révolutionnaires insensés, de ces farouches individus, de ces brigands, de ces traîtres... il les regardait tranquillement, en souriant d’un air débonnaire... Si au même instant le volcan du Vitoch était entré en éruption, nos voyageurs n’auraient pas été plus effarés que devant cette scène étrange...
— Nous avons fait une belle gaffe, nous autres ! déclara Baï Gagno avec un soupir de désespoir. Dis-moi, Baï Michel, va rôder un peu, veux-tu, autour du comptoir, et tâche de voir dans la Tribune Libre si tu comprends ce que c’est que cette histoire-là !...
— Une belle histoire, oui ! mais pourquoi n’y vas-tu pas toi-même ? Voyons un peu si tu as du courage ! répondit Baï Michel.
— Hé ! que tu es donc bête ! Qu’est-ce que tu risques à loucher sur le journal ? Va te promener le long du comptoir, fais semblant de regarder le raki, sifflote un peu comme ça, et puis d’un œil tâche de voir... s’il n’y a pas un nouveau minis... il y en a un, c’est sûr !...
— C’est impossible, voyons... fais attention !...
— Le gendarme ne regarde pas, hein ?... Alors, attends un peu. L’ours aurait peut-être peur, mais moi pas.., je vais aller voir le journal, sacrebleu !
Et Baï Gagno se leva, quitta sa place, se mit à siffloter entre ses dents Le vert feuillage, et en faisant semblant de regarder au hasard devant lui, il commença à tourner, tel un oiseau de proie, autour du comptoir. Puis s’approchant, il saisit par le goulot une bouteille de cognac et en ayant l’air de lire l’étiquette, il se mit à loucher vers la droite, tellement qu’en le voyant de face on n’aurait plus aperçu que le blanc de ses yeux.
Son regard tomba sur un journal plié dont on ne pouvait lire que le titre : La Tribune libre. Il glissa de ce côté sa main droite et, tout en sifflant plus fort pour couvrir le bruit que faisait le journal, il en ouvrit un coin et lut en louchant : « Informations du Palais. Aujourd’hui... ont été reçus par Son Altesse Royale, le président du Conseil et ministre de l’Intérieur M. le Dr K. Stoïl... »
Quelque chose se contracta dans le gosier de Baï Gagno. Il toussa, passa sa langue sur ses lèvres sèches, puis jeta de nouveau un peu plus bas un regard oblique. Il lut en lettres capitales : « Chute de Stamb... » et le cœur de Baï Gagno tomba dans ses bottes.
Il lâcha la bouteille de cognac et, pour couvrir le bruit qu’il venait de faire, il se mit à tousser très fort... Baï Gagno en se retournant vers ses compagnons leur dit gravement :
— Il a vécu !
— Quelles sont les nouvelles, Baï Gagno ? demanda Baï Michel.
— C’est fini avec eux ! répliqua Baï Gagno et, en se rapprochant de la table, il murmura tout bas à ses compagnons : Stamboulov, mes amis, est dans la... mélasse ! Maintenant, c’est Stoïlov...
— Ça n’est pas possible. Qu’est-ce que tu racontes ? c’est « sur » le journal ?...
— Mais oui !
— Es-tu sûr que ce ne soit pas un canard ?
— Un canard ? s’écria Baï Gagno. Et ramassant tout son courage, il frappa sur la table et appela : Hé ! garçon, apporte-moi La Tribune libre !...
Involontairement ses compagnons baissèrent le nez et regardèrent autour d’eux d’un air effrayé...
Le garçon apporta le journal et le tendit au hasard à Baï Michel. Mais celui-ci, comme si on lui avait présenté un fer rouge, retira sa main et indiqua des yeux Baï Gagno. Le bonhomme prit la feuille et regarda autour de lui pour voir qui il y avait et qui il n’y avait pas dans l’auberge. (Mais enfin d’où peut venir un tel courage à Baï Gagno ? C’est qu’il en a encore en réserve, du courage, vous allez voir !) Il déplia La Tribune libre et se mit à lire : « Chute de Stamb... »
Baï Gagno toussa, ses compagnons toussèrent encore plus fort. Baï Michel jeta sur le journal un coup d’œil oblique pour voir si son audacieux compagnon lisait bien, s’il ne se trompait pas... Le troisième larron pencha la tête aussi sur le journal et lut à son tour... la fièvre le prit et tout se mit à tourner autour de lui... Combien de ses affaires et de ses procès, enterrés depuis des années dans les cartons du procureur, ces deux petits mots allaient-ils ramener à la lumière...
Rentrant le cou dans les épaules, grognant, toussotant, ils lurent d’un bout à l’autre l’article de tête et, en parcourant le journal, ils parvinrent à comprendre et à se persuader que tout était bien fini...
— Nous avons fait une belle gaffe, nous autres ! Et maintenant ? Maintenant, il est un peu tard pour demander au Prince de ne pas accepter sa démission. Ah ! que le diable l’emporte ! Hein ? Michel, qu’est-ce que tu en penses ? Dis-moi un peu, qu’est-ce qu’il faut faire ? demanda Baï Gagno.
— Que ta seigneurie le dise plutôt ! Je suis tellement abruti ! C’est comme si on m’avait flanqué un coup de battoir sur la tête, répondit d’un air désespéré, Baï Michel.
— Et toi, Gounio, qu’est-ce que tu en penses ? Dis quelque chose. Qu’est-ce qu’il faut faire maintenant ? Hein ?
— Est-ce que je sais, moi ?... Tout ce que voudra ta seigneurie, murmura Gounio d’un air éteint.
— Allons, voyons ! Est-ce que tu as complètement perdu l’esprit, imbécile ? Est-ce toujours à moi de vous remonter ? s’écria Baï Gagno prêt à pleurer de désespoir. Ce n’est rien ! Attendez un peu, que je vous montre le chemin... Savez-vous ce que nous allons faire ?
Et en même temps Baï Gagno se mit à réfléchir en fronçant le sourcil, se gratta à l’endroit où ça ne le démangeait point, toussota une ou deux fois dans le creux de sa main, chercha quelque chose dans la poche de sa redingote, en sortit un papier plié en quatre et le tendit à Gounio.
— Lis-nous encore une fois ce sale papier, et puis je vous dirai ce que nous aurons à faire.
— Mais pourquoi n’est-ce pas ta seigneurie qui lit ce papier ?
— Hé ! Gounio, ne m’agace pas. Tu sais bien pourquoi je ne le lis pas. C’est mieux ton affaire à toi, de lire ces encycliques.....
Gounio déplia le papier et lut depuis le commencement jusqu’à la fin ce qui suit :
« Votre Altesse Royale,
« Le feu du ciel est tombé sur nos malheureuses têtes ! Notre esclavage de cinq siècles est un songe délicieux en comparaison du coup terrible que l’Ennemi du Nord70 nous a porté en exigeant la démission de notre — ah ! pourrai-je trouver les mots ! — de notre chef génial71, de ce Cicéron, de ce Newton du ciel bulgare. O tempora, o mores ! Non, Votre Altesse Royale, nous avons confiance dans le solide bon sens de la vaillante nation bulgare, et nous espérons qu’elle ne voudra pas se séparer d’un homme qui est la personnification de nos aspirations et de notre idéal, l’honnêteté, la noblesse, l’austérité, le progrès, la liberté ! Nous ne pouvons pas croire que Votre Altesse Royale confiera le pouvoir à ces traîtres corrompus, à ces hommes nuls et sans éducation qui s’efforcent nuit et jour de saper les bases de notre édifice national et de précipiter notre chère Patrie sous la botte puante du Cosaque.
« Votre Altesse Royale ! Timeo Danaos et dona ferentes ! La résolution précédente émane de 11.000 citoyens des plus considérables qui ont délégué Gagno Balkanski, Michel Michaleu et Gounio Kilipirtchikov72 pour la déposer aux pieds de Votre Altesse Royale. Hurrah ! »
— Ah ! quel peuple de farceurs nous faisons ! dit Baï Gagno en hochant la tête et en faisant claquer sa langue. Quand il s’agit de mentir, les vieux tsiganes73 ne sont rien à côté de nous. Où a-t-on pris ça « 11.000 citoyens des plus considérables » ? ha, ha ! Mets de côté les zéros, combien restera-t-il ?
— Onze personnes, répondit Michel.
— Vous étiez autant que cela ?
— Oui, exactement, Baï Gagno. C’est la pure vérité. Même qu’il m’a fallu mobiliser un gendarme pour les réunir.
— Quel peuple de farceurs !... Maintenant, savez-vous ce que nous allons faire ? Revenir en arrière, il n’y a plus à y songer. Toi, Gounio, tu es un peu avocat. Retrousse tes manches, veux-tu, et rédigeons tous ensemble une autre adresse... pour le nouveau..... Na, j’ai du papier. Il ne faut pas qu’on sache que nous sommes venus pour intercéder en faveur de ce sacripant, que nos affaires vont mal. En particulier pour toi, Gounio..... S’il venait un autre procureur.....
Gounio toussota...
— Donne-moi le papier et la plume, dit-il fiévreusement. Vous, vous me regarderez. Moi, je vais écrire :
Et il se mit à écrire :
« Votre Altesse Royale,
« Le feu du ciel est tombé sur nos malheureuses têtes... » Maintenant il faut que nous mettions le contraire. Comment allons-nous dire cela ?... Attendez... Ça vous va-t-il ? « Les nuées se sont entrouvertes et les bénédictions célestes sont tombées sur notre Patrie... »
— Oui, mais « Patrie » ne fait pas assez d’effet, fit remarquer Baï Gagno. Il faut mettre « notre chère Patrie ».
— Moi aussi je trouve que sans le mot « chère », ça ne va pas, dit Baï Michel.
— C’est bon. Je mets « chère ». Après : « Notre esclavage de cinq siècles est un songe délicieux en comparaison du coup terrible... » Maintenant le contraire : « Notre affranchissement d’un esclavage de cinq siècles n’est rien en comparaison de l’heureux événement qui a brisé les chaînes de l’odieuse tyrannie » Ça vous va-t-il ?
— Il faudrait ajouter : « du rejeton des enfers » fit remarquer Baï Gagno. Mais ça ne fait rien. Continue.
— « ... que l’Ennemi du Nord nous a porté en exigeant la démission de notre — ah ! pourrai-je trouver les mots ! — de notre chef génial, de ce Cicéron, de ce Newton du ciel bulgare. »
— Maintenant, comment allons-nous retourner ça ?... Attendez... voilà : « ... et qui est uniquement l’œuvre de Votre Altesse Royale, Père plein de clémence, qui avez accepté la démission de ce — ah ! pourrai-je trouver les mots ! — de cet odieux tyran, de ce Caligula, de ce Tamerlan du ciel bulgare. »
— Bravo ! Gounio, s’écria Baï Gagno, les yeux brillants d’enthousiasme.
— Comment peux-tu bien inventer tout ça, Gounio ? dit Michel d’un ton flatteur.
— « O tempora, o mores !... » On peut laisser ça. On peut mettre cette phrase-là partout. Elle est toujours à sa place... « Non, Votre Altesse Royale, nous avons confiance dans le solide bon sens de la vaillante nation bulgare, et nous espérons qu’elle ne voudra pas se séparer d’un homme... » Maintenant, au lieu de « qu’elle ne voudra pas se séparer », nous mettrons « qu’elle fera disparaître de la face du monde », et au lieu de « un homme », nous mettrons « cette bête féroce ».
— Non, mieux vaudrait dire « ce monstre enragé », corrigea Baï Gagno.
— Et moi je trouve qu’il faudrait mettre « cette hyène aux yeux de feu », dit Michel.
— Eh ! je vais vous trouver le mot ! D’où nous sors-tu ça : « cette hyène aux yeux de feu » ? Il vaut mieux dire : « cet être ignoble et sanguinaire », répliqua Gounio.
— Très bien ! approuva Baï Gagno.
— ... « qui est la personnification de nos aspirations et de notre idéal : l’honnêteté, la noblesse, l’austérité, le progrès, la liberté ! » Mettons maintenant le contraire... « qui est la personnification des malheurs nationaux : de tout ce qui est malhonnête, malfaisant, honteux, rétrograde et tyrannique ! » Après : « Nous ne pouvons pas croire que Votre Altesse Royale confiera le pouvoir à ces traîtres corrompus, à ces hommes nuls et sans éducation... » Comment allons-nous retourner ça ?... Attendez ! Il me vient une idée. Voilà : « Que Votre Altesse Royale nous permette de Lui témoigner notre satisfaction et de Lui exprimer nos sentiments d’absolu dévouement, pour avoir confié le pouvoir à ces grands patriotes, à ces hommes d’État instruits et distingués »... « qui s’efforcent nuit et jour de saper les bases de notre édifice national. »
— Comment ! Tu te trompes ! dit brusquement Baï Gagno.
— Attends ! nous allons changer ça et mettre au lieu de « saper », « consolider ».... « et de précipiter notre chère Patrie sous la botte puante du Cosaque. »
— Voyons un peu maintenant, dit Baï Gagno. Voilà le hic ! nous ne savons diantre pas comment les « nouveaux » vont se comporter vis-à-vis des Moscovites. Si nous étions sûrs qu’ils veulent la paix, ce serait facile. Il y aurait un tas de choses à écrire : « Le tsar libérateur ; le tsar protecteur ; nos frères jumeaux ; les Allemands sont des juifs teigneux » et ainsi de suite. Mais nous ne savons pas de quel côté va souffler le vent... « Nos frères les Slaves », c’est parfait. Mais si les hommes du jour sont russophobes... hop ! Baï Gagno est un traître ! Non. Croyez-moi. Il vaut mieux enlever l’expression : « la botte puante »...
— Eh bien ! alors, qu’est-ce que nous mettrons ?...
— Attends un peu ! Ne sois pas si pressé ! Nous verrons... Savez-vous ce que nous allons faire ? Comme nous ne pouvons pas deviner comment va souffler le vent, nous mettrons quelque chose de vague, de manière qu’ils comprennent ce qui leur fera plaisir. Voici ce que nous dirons : ... « Et embrassons-nous fraternellement, hem ! avec les Russes, hem ! avec les Allemands »... Allons-y ! À la grâce de Dieu !...
— Non. Ça ne va pas. Qu’est-ce que ça signifie : « hem, hem » ? Est-ce qu’on parle comme ça devant le Prince ? fit remarquer Gounio l’avocaillon.
— Comment veux-tu donc qu’on parle, espèce de teigneux ? Est-ce toi qui vas m’apprendre à parler ? s’écria Baï Gagno en s’enflammant. Sais-tu un peu qui je suis ? Sais-tu bien que je me suis promené à travers toute l’Europe ? Je ne suis pas comme toi, vieille souche ! Sais-tu que le Jireczek-Mireczek74 restait comme ça, bouche bée, pendant que je lui parlais ? Des Anglais, des Américains m’ont fait des salamalecs à Dresde75... Et c’est toi qui voudrais m’apprendre... ? Sais-tu bien que moi qui te parle...
— Je sais, Baï Gagno, je sais. Comment pourrais-je ne pas savoir, dit en s’excusant d’un air craintif Gounio.
— Eh bien ! puisque tu sais... ce que là-bas... e... e... Eh bien ! écris ce que tu sais...
— Mettons ceci : ... « Et qu’ils nous placent, sinon plus haut, du moins au niveau des grandes puissances européennes »...
— Bon, je veux bien, dit Baï Gagno conciliant.
— ... « des grandes puissances européennes, en nous ramenant à l’époque glorieuse d’Asparouch et de Kroum. »
— Bon, je veux bien.
— Et après : « Votre Altesse Royale, Timeo Danaos et dona ferentes ! »... À la place de cela, il vaudra mieux mettre : « Vox populi, vox Dei. » Ça vous va-t-il ?
— Tu peux le mettre, somme toute. Ça n’est pas à proprement parler du bulgare, mais quand c’est nécessaire, dit Baï Gagno.
— ... « La résolution précédente émane de 11.000 citoyens des plus considérables qui ont délégué Gagno Balkanski... » et cætera. On peut laisser ça entièrement jusqu’à la fin.
— Faut-il écrire seulement 11.000, ou bien, pour faire plaisir aux « nouveaux », ajouter encore un ou deux milliers ? Ça graisserait le char du nouveau ministère...
— Non, ça suffit, Baï Gagno. Dans notre ville, en comptant les aveugles et les culs-de-jatte, pourrait-on trouver seulement 11.000 âmes ? Après tout, c’est pour leur faire plaisir !...
— Je veux bien... Mais, e... e... au lieu de Gagno Balkanski, est-ce qu’il ne serait pas plus élégant de mettre : « Monsieur Gagno »... et cætera ? Le Prince verrait que nous ne sommes pas de la petite bière, hein ?
— Moi aussi je suis de cet avis, répartit Michel.
— Messieurs, il est tard. Partons ! leur cria le cocher turc du seuil de l’auberge.
Les voyageurs partirent pour Sofia...
Le surlendemain, messieurs, je lus dans l’un des journaux locaux qu’à la grande porte du Palais s’était présentée la députation de la ville de P... composée, entre autres, de Gagno Balkanski, pour apporter ses félicitations à l’occasion de l’affranchissement du régime tyrannique.
Deux jours plus tard dans le même journal je lus un télégramme envoyé de cette même ville et signé : les « milliers » de citoyens. Ce télégramme informait les hauts fonctionnaires du Palais que Baï Gagno et ses compagnons formaient une députation sans mandat, et que les véritables élus du peuple étaient déjà partis pour la capitale apportant leurs félicitations...
Je savais dans quel hôtel descendait Baï Gagno. Je dirigeai mes pas de ce côté. Je n’avais pas l’intention de lui exprimer l’indignation que m’inspirait son odieux procédé. Non, parce que toute espèce d’indignation était impuissante à stigmatiser cette manière d’agir. Je voulais seulement faire un essai et voir s’il était possible d’amener ce triste produit des circonstances à concevoir toute l’infamie de son acte.
Le tableau de l’hôtel m’apprit dans quelle chambre était logé Baï Gagno. Je montai l’escalier. Je frappai à la porte. Personne ne répondit. Je tournai le bouton et la porte s’ouvrit. La chambre était vide. Il était parti. Sur la table j’aperçus un bout de papier sur lequel était écrit de la main de Baï Gagno :
« À la rédaction du journal
« La Tribune libre ».
Le nom du journal avait été rayé et on avait écrit à la place :
« La Liberté »
et ensuite :
« Les secrets de Stamboulov ».
Ce titre aussi avait été rayé et remplacé par le mot :
« L’anarchie ».
On voyait clairement que l’auteur de la lettre avait hésité longtemps avant de savoir quel chemin prendre, parce que beaucoup de mots avaient été rayés et remplacés par d’autres dont la signification était diamétralement opposée. On avait écrit par exemple : « patriotes », puis on avait rayé ce mot et on avait écrit au-dessus : « brigands qui opèrent en plein jour » ; cette expression avait été rayée elle-même et on avait écrit de nouveau le mot « patriotes ». Sur toute la lettre on avait tiré deux larges traits noirs en croix, tracés d’une main en colère, car pour le deuxième trait l’encre avait manqué, on avait trempé la plume dans l’encrier et achevé par un trait deux fois plus large... Au-dessous des lignes biffées on pouvait lire les mots suivants :
« Vous nous avez changés en singes, que le diable vous emporte, vous et vos mascarades ! »...
Je dédie cette esquisse à mon inestimable ami Tsvetan Radoslavov.
— QU’EST-CE que vous me chantez là ? Je vous dis qu’il faut que nous élisions des députés ministériels, s’écria Baï Gagno en frappant violemment sur la table.
— Oui, mais comment élirons-nous des ministériels, comment travaillerons-nous les électeurs ? Voyons, toi, Baï Gagno, n’es-tu pas, comme qui dirait, un libéral ? eut l’aplomb de répliquer Botcholou.
— Qui est-ce qui t’a dit que j’étais un libéral ? demanda sèchement Baï Gagno.
— Comment ! qui est-ce qui me l’a dit ? Voyons, as-tu oublié tous les conservateurs à qui tu as flanqué une pile, tous ceux que tu as injuriés ? Comment ! tu n’es pas libéral ! As-tu oublié — c’est toi-même qui nous l’as dit — qu’auprès de Jireczek tu t’es vanté d’être libéral ? répliqua Botcholou.
— Eh ! que tu es donc simple ! répondit avec un sourire de pitié Baï Gagno. Et puis après, si j’ai dit ça à Jireczek, la belle affaire76 ! Voyons, espèce de bête, si je ne raconte pas de balivernes à un Jireczek, à qui donc est-ce que j’en conterai ?
— Ta seigneurie a raison ! Botcholou, range un peu tes torchons dans l’armoire, ne lui récite plus ces litanies, répliqua Gotcholou. Moi aussi je suis conservateur.
— Et moi, est-ce que vous me prenez pour une pierre tombale ? Moi aussi je suis un pur parmi les plus purs des conservateurs, proclama à son tour Dotcholou. Allons, Botcholou, mon vieux, il faut que tu deviennes toi aussi un conservateur, pour que nous les tenions, les autres, pour que nous les empêchions de bouger.
— C’est bon, mais je ne connais pas le préfet. Je ne sais pas de quel côté il sera, répondit Botcholou.
— Le préfet ? Il sera avec nous, c’est sûr, fit observer Baï Gagno, et le sous-préfet aussi. La commission permanente est illégale, mais qui donc ira invoquer la légalité ? Elle est avec nous aussi, la commission. Le bureau est nôtre. Nôtre aussi le conseil municipal. Le maire louvoie bien un peu, mais nous le ferons marcher droit77. Les conseils municipaux des villages ne sont pas encore validés — mais c’est exprès, vous comprenez. S’ils sont avec nous, nous les validerons. Sinon — au diable ! Je te le répète, pour ce qui est de l’administration, tu n’as pas à t’inquiéter, elle est avec nous.
— Mais les portefaix ? demanda avec curiosité Botcholou.
— Les portefaix aussi sont des nôtres, et les tsiganes, et Dianko l’Apache...
— Mais Dianko n’était-il pas en prison pour vol ? demanda avec étonnement Botcholou.
— Hé ! tu gardes les oies ! Nous l’avons relâché, celui-là. C’est justement lui qui nous a gagné les portefaix. Il est allé les trouver l’autre jour, il les a réunis et il s’est mis à grincer des dents, si bien que les autres sont restés gelés sur place ; et il leur a dit en grognant : « Je vous casserai la mâchoire, si vous ne votez pas pour Baï Gagno ! » Et les portefaix ont promis ; Dianko les a achetés deux francs par tête. On leur donnera à boire et à manger pendant toute la nuit qui précédera les élections.
— Quel terrible gaillard, sacrebleu ! ce Dianko.
— Et pour combien, crois-tu ? Pour cinquante francs. Il est allé trouver nos adversaires et leur a demandé cent francs. Ils l’ont envoyé promener en lui disant des sottises. Et maintenant tu le verras dimanche. Il leur cassera les os ! dit Baï Gagno rayonnant.
— Botcholou, va donc un peu appeler Gounio l’avocat ; il faut qu’il vienne ici nous rédiger une proclamation. Dis-lui : « C’est Baï Gagno qui t’appelle. »
Dès que Botcholou fut sorti, Baï Gagno se pencha vers ses compagnons et leur dit d’un air mystérieux :
— Écoutez-moi un peu. Cet abruti-là, jusqu’au jour des élections, nous lui ferons croire que nous le portons sur la liste ; nous écrirons pour le tromper quelques bulletins avec son nom, et les autres bulletins nous les ferons faire par les scribes du conseil municipal et de la préfecture. Maintenant, parlons peu, parlons bien : le ministre veut absolument que je sois député. Et toi, Gotcholou, veux-tu ?
— Ma foi, je veux bien, Baï Gagno, répondit Gotcholou.
— Et moi aussi je veux bien, fit observer Dotcholou.
— Hé ! tu veux bien ! mais il faut que tu le saches, toi. Tu es complètement brûlé auprès des électeurs. Tu avais bien besoin de te compromettre ainsi personnellement ! Qui est-ce qui criait sur la place publique : « Vive le grand patriote ! » et « À bas l’odieux tyran ! » — « À la potence Clément ! » et « Vive Clément78 ! »
— Mais n’étions-nous pas d’accord, voyons, Baï Gagno ? Pourquoi fais-tu comme ça l’innocent ?
— Nous étions d’accord, soit. Mais nous autres, nous savions être plus discrets79. Enfin passons. Puisque tu en as si envie, c’est bon, je te ferai élire. Mais tu sais, les paysans te détestent. Tu leur as fait vendre leurs dernières couvertures, avec ta sacrée usure !
— Oh ! quant à cela, tu n’as rien à dire, Baï Gagno ; je sais quelle marchandise tu vends, toi aussi, dit Dotcholou en se mettant sur ses gardes.
Baï Gagno va se fâcher, mais à ce moment entre Gounio l’avocaillon. Baï Gagno lui explique ce que doit être la proclamation. Gounio s’assied à leur table, prend la plume et se plonge dans ses pensées. Sur l’ordre de Baï Gagno, le garçon apporte une bouteille de mastic. Gotcholou, Dotcholou et Baï Gagno boivent, Gounio écrit. Au bout d’une demi-heure, la proclamation suivante est prête :
Proclamation
aux Électeurs de notre arrondissement.
Considérant l’importance et la grande signification que les élections actuelles des Députés ont pour le présent et l’avenir de notre Patrie, nos concitoyens, au nombre de plus de sept cents, réunis aujourd’hui dans la cour de l’école du quartier des chiffonniers, pour s’occuper de la question des candidatures aux sièges de députés, sont tombés d’accord et ont décidé à l’unanimité de recommander à MM. les Électeurs de cet arrondissement comme députés, leurs concitoyens :
Gagno Balkanski, commerçant, célèbre dans toute la Bulgarie ;
Philiou Gotcholou, commerçant possédant un capital ;
Tanase Dotcholou, commerçant en industrie vinicole.
Ce sont précisément ces mêmes personnes que le Comité du parti nationaliste vous avait recommandées dans sa proclamation du 27 août du mois dernier80.
En informant de cette décision unanime MM. les Électeurs de la ville et de la campagne qui n’ont pu assister à cette réunion, mais qui ont à cœur le bien de la patrie, l’amélioration matérielle de l’agriculture, la diminution des impôts, en un mot les intérêts de notre arrondissement, nous les invitons à voter le jour des élections, le 11 de ce mois, pour nos trois concitoyens nommés plus haut. Nous avons la plus entière confiance qu’ils représenteront dignement notre région au Sobranié National.
Messieurs les Électeurs,
Il vous a été présenté aussi par quelques citoyens une liste avec les noms de Nicolas le Tirnovien, Loultcho Doctorov et Ivanitsa Gramaticov, personnes qui ne sont pas de notre milieu, des étrangers pour nous, qui n’ont pas et qui ne peuvent pas avoir notre confiance. Il s’en présentera peut-être encore d’autres, qui vous engageront à voter pour leurs candidats. Nous vous conseillons, MM. les Électeurs, de ne pas vous laisser prendre à leurs beaux discours, de ne pas ajouter foi à leurs flatteries et de ne pas croire les divers bruits qu’ils pourront répandre ni les inventions de leurs circulaires, télégrammes, etc. Nicolas le Tirnovien est né natif de Tirnovo : aussi dans sa fureur contre la puce, brûlera-t-il l’ourgane81 ; Loultcho Doctorov est une créature du gouvernement transdanubien ; quant à Ivanitsa Gramaticov, personne ne le connaît. Nota bene : il a fait ses études en Russie, par conséquent c’est un traître à notre chère Patrie.
Messieurs les Électeurs,
Nous sommes persuadés que les personnes indiquées plus haut, c’est-à-dire plus bas :
Gagno Balkanski ;
Philiou Gotcholou ;
Tanase Dotcholou,
qui professent le plus entier dévouement et la plus respectueuse confiance envers le Trône et la Dynastie de Son Altesse Royale notre Bien-Aimé Prince Ferdinand Ier, et qui soutiendront sans aucun doute le gouvernement patriote actuel et surtout son Ministre-Président, réussiront à gagner votre confiance.
— Bravo ! Gounio, s’écria Baï Gagno, tu es un vrai Bismarck !
— Me prends-tu donc pour une bête ? répliqua Gounio avec suffisance.
— Va maintenant et donne ça à imprimer ; qu’on nous l’imprime en lettres grasses, grandes comme ça !
— Mais qui est-ce qui paiera ?
— Personne. Si l’imprimeur ne veut pas marcher, tu le préviendras que nous déciderons au conseil municipal et dans les autres bureaux de ne plus rien faire imprimer chez lui. C’est compris ? Ouste ! commanda Baï Gagno. Puis il continua :
— Vous ne savez pas que « les autres » ont passé un télégramme au ministre pour se plaindre auprès de lui de ce que le préfet avait parcouru les villages en vue de la campagne électorale !
— Les sauvages ! répliqua Gotcholou.
— Mais quelles brutes ! ajouta Dotcholou.
— Oui, mais le ministre n’est pas la Sainte Vierge pour les écouter comme ça ! Il leur a répondu : « Les élections sont libres », ha, ha, ha !...
— Ha, ha, ha !... s’écrièrent en éclatant de rire Gotcholou et Dotcholou.
— Ha ! le gaillard ! que l’eau trouble l’emporte ! La liberté ? Ha ! la liberté ! On leur montrera dimanche une liberté dont ils se souviendront toute leur vie. Ah ! Gramaticov ! Le malheureux n’a pas encore vu nos élections. Qu’ils viennent un peu à sa rencontre, ces valaques, ces tsiganes, les yeux injectés de sang leur sortant de deux doigts de la tête, avec leur ceinture montant jusqu’à la gorge ! Qu’ils se ruent sur lui, que ce sanglier de Dianko l’Apache aille un peu se placer derrière lui, et qu’il se mette à crier : « Empoignez-le ! »...
— Ha, ha, ha ! s’esclaffèrent Gotcholou et Dotcholou, un éclair de joie dans les yeux.
— Libéraux ! Constitution ! Ah ! Constitution ! Ils comptent toujours sur « le télégramme-circulaire ». Ils cassent les oreilles des gens avec ce fameux télégramme-circulaire. Sans cesse ils le lisent, sans cesse ils l’exhibent... Nous en avons bien ri hier avec le préfet au café. Le préfet, pour faire croire qu’il avait donné à imprimer ce sale télégramme, l’avait fait répandre dans les cafés. Hier nous étions assis avec lui au café et nous regardions « les autres » qui se penchaient sur le télégramme en se réjouissant ; nous les entendons murmurer : « Libres ! Les élections sont libres ! La police ne doit pas s’en mêler ! » Et nous autres, avec le préfet, kss, kss, kss ! Je le regarde du coin de l’œil et je lui dis en riant : « Nous sommes sûrs de notre affaire ! » Et il avait bien envie de partir d’un éclat de rire. Hop ! un mastic. Il frappe sur sa poche, où se trouve la fameuse lettre sur la liberté des élections, cligne de l’œil et me dit : « Nous ne sommes pas sûrs ! » et kss, kss, kss ! Hop ! encore un mastic !... Nous nous sommes richement cuités !... Et quand arriva Dianko l’Apache, puis d’autres, et d’autres encore, et quand nous nous fûmes enfermés dans le café, je criai aux violoneux : en avant, maintenant ! ils en cassèrent leurs cordes !... Le mastic de Georges82 n’est pas fameux et son mézet83 est exécrable : il ne se donne pas la peine de faire des cornichons et il sert des bamia84 conservés dans du vinaigre !... Ouf ! j’ai mal à la tête depuis hier. Gotcholou, veux-tu, verse-nous encore un mastic.
— Pour te guérir !
— Laisse-moi donc tranquille ! Jusqu’à ce soir il nous faudra encore boire. Dès maintenant répartissons nos hommes dans les auberges.
— Est-ce qu’il n’est pas un peu tôt, Baï Gagno ? remarqua Dotcholou.
— Mais non, il n’est pas trop tôt, c’est demain samedi, il ne leur reste que trente-six heures à boire. Il n’est pas trop tôt ! C’est le moment ! Et puis, somme toute, ils ne peuvent pas boire tout le temps. Ils s’arrangeront. Les uns boiront pendant cinq ou six heures, puis ils se reposeront, et les autres commenceront à boire à leur tour. De l’ordre, de l’ordre ! Une fois qu’ils seront groupés, il ne faut plus qu’ils se séparent. Là où ils boiront, là ils mangeront et là ils dormiront. Avez-vous compris ?
— Nous connaissons ça, nous autres ; ce n’est pas la première fois que nous faisons les élections, fit remarquer Gotcholou.
— Toi, Gotcholou, quand tu passeras devant l’Albanais, tu lui diras de préparer pour ce soir trois cents oki de pain et d’en envoyer : cent oki dans le quartier tsigane, chez Topatcholou, cent oki dans le quartier des chiffonniers au café Gogov, et cent oki en bas, chez les portefaix. Toi, Dotcholou, tu passeras dans les cafés et tu diras de commencer dès ce soir à donner du vin et du raki. Plus de raki que de vin, n’est-ce pas ? Et puis tu les inviteras à ne pas nous compter plus qu’il ne faut, ou sans cela, que le diable les emporte ! Il y a deux ans, ils nous ont écorchés, les masques ! deux mille francs, et pour des prunes ! Dis-leur de faire attention, parce que le conseil municipal est avec nous. Passe aussi chez les bouchers et recommande-leur de réunir tout ce qu’ils ont de restes, basse viande, mou, tripes, os, dans un ou deux paniers, et de les porter dans les auberges pour qu’on puisse faire pour nos hommes un chaudron de soupe. D’ici ce soir le préfet et le sous-préfet seront de retour des villages. Je les prendrai avec moi et nous ferons le tour des autres auberges et des cafés. Nous réunirons les scribes de toutes les chancelleries pour écrire les bulletins ; nous les ferons travailler toute la nuit. J’ai choisi le papier, il sera d’un gris jaunâtre. Nous plierons nos bulletins en pointe...
— En triangle, précisa Dotcholou.
— En triangle, oui. Et puis il faut que nous chipions quelques bulletins des autres, pour savoir quel est leur papier et comment ils les plient. Nous ferons faire par les scribes mille ou deux mille bulletins avec leur papier et à nos noms.
— Quel gredin tu fais, Baï Gagno ; tu connais tout cela dans les coins ! dit Gotcholou avec admiration.
— La belle affaire ! À quoi bon serais-je Gagno Balkanski, si je ne possédais pas cette science ? Mon cher, mets-moi dans l’arrondissement que tu voudras, et dis-moi de te faire élire qui tu voudras : je m’en charge. Présente une bourrique comme candidat, et je te ferai élire la bourrique, quand le diable y serait ! Donne-moi seulement le sous-préfet et les gendarmes, et mille à deux mille francs. Que je réunisse seulement, mon vieux, quelques individus de sac et de corde, quarante ou cinquante repris de justice, par exemple, et que je les case dans deux ou trois auberges des faubourgs, que je leur distribue un védro85 par tête, et que je leur crie : « Allons, sacrebleu ! vive la Bulgarie ! » Hé ! Es-tu là, Penka86 !... Quand tu vois leurs yeux injectés de sang leur sortir de la tête, quand ils commencent à tirer de leurs ceintures leurs couteaux pour les planter dans les tables, quand ils hurlent de leurs voix rauques et enrouées, tu as peur d’un mauvais coup ! Et puis prends-la et conduis-la, cette horde, la nuit, à travers la ville... Y a-t-il un obstacle ?... Le diable ne pourrait pas les arrêter ! Amène-les devant la maison de quelque adversaire... Ah ! malheur !... Quand ils se mettent à hurler !... Si tu les entends à une heure de distance, tu en as la chair de poule, tes cheveux se dressent sur ta tête !... Ensuite convoque les maires et les secrétaires des villages, regarde-les avec des éclairs dans les yeux, grince des dents, montre-leur tes amis... Les électeurs ? Tu n’en verras pas l’ombre d’un seul! Tu feras venir de chaque village douze conseillers avec le maire, tu réuniras les fonctionnaires et les scribes, tu placeras aux issues de la ville des gendarmes qui renverront les autres paysans, tu entoureras le bureau avec tes quarante ou cinquante apaches, tu simuleras quelque bagarre, tu flanqueras dans les boîtes quelques paquets de bulletins, et voilà ta bourrique élue député ! ha, ha, ha !...
— Ha, ha, ha ! reprirent Gotcholou et Dotcholou, hé ! bravo ! Baï Gagno !
— C’est bon, mais la police toute seule ne suffit pas, il faut aussi que le bureau soit pour toi, insista Gotcholou.
— Je suis aussi de cet avis, appuya Dotcholou. Il est pour le moment avec nous, mais, somme toute... Enfin, Baï Gagno, dis-nous donc un peu, je t’en prie, comment vous avez fait pour le cuisiner, ce bureau...
— Comment nous avons fait ? répliqua avec un sourire plein de suffisance Baï Gagno, c’est bien simple ! Nous avons élu, n’est-ce pas, le conseil général. Huit noms des leurs sortirent de l’urne et quatre des nôtres. Nous avons fait casser par l’Administration l’élection de quatre des leurs, les plus importants... Vous me direz que cela a soulevé une toile. Tas d’imbéciles ! En attendant, nous ferons les élections. Nous sommes donc restés quatre des nôtres contre quatre des leurs. Mais des leurs, nous n’avions gardé que les miséreux. Nous nous réunissons pour élire la commission permanente. Justement l’huissier ne peut pas arriver à découvrir l’un des leurs... vous devinez ?
— Ts... ts... ts !... fit Dotcholou en faisant claquer sa langue. Quel Bismarck tu fais ! Bismarck ne pourrait pas retourner tes pantoufles87 !
— Attends un peu, tu n’as encore rien vu. Et puis, à la fin, est-ce qu’il n’y a que les Allemands pour avoir un Bismarck ?... La belle affaire !... Nous restâmes donc, mon cher, trois des leurs contre quatre des nôtres, la majorité ! Et, comme bien vous pensez, — nous ne sommes plus des blancs-becs — la commission fut élue tout entière nôtre. Il y eut même six voix pour les nôtres, parce que nous avions promis séparément à deux des leurs que nous les élirions secrétaires, et ces imbéciles-là n’ont-ils pas voté pour les nôtres... ha, ha, ha ! Et maintenant ils vont par la ville, comme s’ils étaient ivres d’opium. Nous avons pris l’un d’eux, une crapule, mais qui a de l’influence dans les villages, pour faire campagne avec nous, en lui promettant de l’élire secrétaire, et lui, l’animal, est-ce qu’il ne nous a pas lâchés... Chasse le naturel, il revient au galop ! Quelle buse !... Dotcholou, verse-nous encore un mastic.
Baï Gagno filtra le mastic à travers ses moustaches, s’essuya avec la paume de sa main, retroussa « ces sacrés poils » et continua :
— Et maintenant, que je vous raconte comment a été nommé le bureau pour les élections. L’opération a lieu par tirage au sort. C’est le président du tribunal qui procède au tirage. Cela s’appelle « tirer au sort », mais je pourrais te faire nommer qui tu voudrais. Rien n’est plus facile. Si tu mets les bulletins dans un verre, tu n’as qu’à marquer les bulletins pleins d’un petit signe à l’encre, pour que tu puisses les voir du dehors. Si au contraire les bulletins sont dans une boîte, il faut que cette boîte soit assez profonde pour qu’on ne puisse pas voir de quel côté sont les bulletins. Tu rangeras alors les bulletins pleins d’un côté et les bulletins blancs de l’autre. Il ne te reste plus qu’à murmurer au président que « ses affaires vont mal » et que par conséquent « il ouvre l’œil »... On appelle : Ivan, Stoïan, Peurvan ! En veux-tu, de ce Peurvan ? Prends un bulletin plein. Tu n’en veux pas ? Prends un bulletin blanc. Et c’est ainsi que le président tire au sort...
— Quel type que ce Baï Gagno ! Et les autres, les malheureux, ils ont trouvé quelqu’un à qui parler. Ils auront du mal ! prononça sentencieusement Gotcholou.
— Et avec cette caboche-là, tu n’as pas encore été ministre ? dit Dotcholou étonné.
— Ah ! tais-toi donc ! conclut d’un air modeste Baï Gagno. Tu connais les Bulgares !...
Vers l’est l’aurore se lève peu à peu et répand une lueur pâle à l’intérieur de l’auberge de Gogov, dans le quartier des chiffonniers. De solides gaillards, une trentaine environ, sont vautrés pêle-mêle sur les tables, par terre, sur les chaises ; leurs ronflements, qui pourraient faire croire que trente tigres sont aux prises, s’entendent de la rue et agacent l’oreille du gendarme qui est dehors. De temps en temps l’un des gaillards se soulève, les yeux encore à demi fermés. Il enjambe les corps de ses compagnons, cherche des mains la cruche et s’efforce avidement d’éteindre le feu de l’alcool qui brûle son estomac, sa gorge, sa bouche et ses lèvres sèches ; les hommes ivres-morts sur lesquels il bute dans l’ombre se réveillent et lancent des injures d’une voix enrouée. Et une odeur ! une odeur infernale qu’exhale l’atmosphère empoisonnée de l’auberge, saturée des émanations de cet amoncellement de héros obscurs.
Gotcholou et Dotcholou sont éveillés déjà. Chargés de faire la dernière inspection des positions, ils prennent un café chez Hassanov le teigneux. Il est temps de réveiller les camps endormis pour la bataille électorale. Les voilà déjà devant l’auberge de Gogov. Ils ouvrent la porte, et une bouffée suffocante les force à se rejeter en arrière.
— Pfou ! que le diable les emporte ! s’écrie Gotcholou d’une voix étouffée en se bouchant le nez.
— Ils ont donc mangé de l’ail ! grommelle Dotcholou en esquissant une amère grimace et en se bouchant le nez à son tour.
Par la porte ouverte de l’air pur s’engouffre dans la salle, permettant aux deux hommes d’y pénétrer enfin.
— Quoi ! vous dormez encore ! tas d’animaux ! Vite ! Debout ! commanda Gotcholou avec autorité, et il se mit à fourrager avec ses pieds dans son régiment d’ivrognes.
— Gogov, donne-leur un raki pour leur ouvrir les yeux, ajouta Dotcholou.
Gogov se leva péniblement, s’étira, bâilla, épongea son front en sueur et se mit, sans grand entrain, à fouiller au milieu des bouteilles et des verres. Les rakis versés, il les apporta aux gaillards à demi endormis encore.
— Allons, debout ! espèce d’âne, na, avale ! Tu as suffisamment bâillé comme un chien. Si tu voyais tes yeux, gonflés comme des abcès ! Allons, avale !
C’est avec de pareilles amabilités, accompagnées d’énergiques coups de pied, que Gogov parcourt les rangs de ses hôtes transformés par l’alcool en soliveaux, et leur distribue du raki pour les ressusciter. De-ci de-là, il y en a un qui grogne contre les coups de pied de Gogov, un autre qui lui jette un regard féroce, un troisième qui essaye même de bondir et d’empoigner le manche de son couteau de pêcheur, enfoui dans sa ceinture. Ces gestes effrayants ont le don de communiquer une ardeur nouvelle à Gotcholou et à Dotcholou. Ils murmurent entre eux :
— Regarde un peu, Dotcholou, ce gaillard, là-bas, dans le coin, avec l’œil bandé, le connais-tu ?
— Si je le connais ! c’est Petrescou, celui qui a noyé son père dans la mare. Je le connais bien. Dieu te garde de tomber sous sa patte ! Vois-tu le couteau qu’il porte à sa ceinture ? Et celui-là, là-bas, sous le comptoir, le connais-tu ?
— Le gros ? qui est en train de bander la blessure de sa jambe ?
— Non, l’autre, celui qui a la bouche fendue.
— Sa tête ne me revient pas... Ah ! attends, est-ce que ce n’est pas lui l’orphelin de Petsa l’Idiot, celui qui a pillé l’église ?
— Non. Le fils de Petsa l’Idiot, c’est celui-là, là-bas, couché près de Bontcho le bandit. Non, celui-ci, c’est le petit-fils de Dianko l’Apache. Baï Gagno l’a envoyé ici pour surveiller ces fripouilles et pour les empêcher de se laisser soudoyer par « les autres ». Quel effroyable ramassis de brigands ! C’est ce gamin-là qui a volé cette nuit un paquet de « leurs » bulletins.
— Bravo !
— Sais-tu de quoi nous l’avons chargé ? Quand nous serons autour du bureau, si quelques-uns des leurs ont le toupet de venir, le gosse attrapera Nicolas le Tirnovien au collet et se mettra à crier : « Arrêtez-le ! Il insulte le Prince ! Il injurie le Prince ! Arrêtez-le ! » Alors Petrescou et Dianko l’Apache empoigneront Nicolas et le jetteront dehors. La police le cueillera et — au violon !88 Les siens voudront le délivrer, nous nous jetterons sur eux. On se battra. La police viendra à la rescousse et les dispersera comme des poulets. Tout cela est prévu.
— Mais Loultcho et Gramaticov, qui est-ce qui se charge d’eux ?
— Eh ! les prends-tu, ceux-là, pour des hommes ? Qu’un Topatcholou vienne seulement à leur rencontre, ils ficheront le camp !
Telles sont les paroles qu’échangent Gotcholou et Dotcholou, en contemplant avec enthousiasme le pénible réveil de ces trente individus de sac et de corde, à qui incombe aujourd’hui le rôle de semer la terreur et l’épouvante autour du lieu de l’élection, et de forcer le Bulgare, déjà naturellement craintif, à abandonner ses droits qu’il ne connaît pas encore bien, et à céder à l’Administration l’exercice de sa volonté libre.
Telles sont les paroles qu’échangent Gotcholou et Dotcholou, en regardant ces trente individus effrayants, difformes, bouffis, les yeux injectés de sang, couverts de cicatrices et d’estafilades, avec leurs larges ceintures et leurs coutelas, avec leurs visages féroces, avec leurs mouvements convulsifs d’apaches : et en les contemplant, ils ont comme un avant-goût de la douceur de la victoire électorale.
Tous ces gaillards étaient déjà sur pied, lorsqu’on entendit, venant du quartier des tsiganes, une musique... une musique ! me faut-il décrire cette musique qui a joué toute la nuit sans interruption dans l’auberge de Topatcholou, cette musique au son de laquelle l’aubergiste seul a dansé et chanté : « Bangnelita a brodé un petit mouchoir, elle a fait une faute... ah ! que la foudre me tue et m’emporte bien vite dans l’autre monde ! » Me faut-il vous peindre le violoneux qui dort debout et qui tient d’un air las son instrument sur son ventre ? Me faut-il vous montrer le clarinettiste qui tantôt oublie de jouer, et tantôt souffle comme un enragé dans son embouchure, en gonflant ses joues à en faire éclater les veines de son cou et jaillir de leur orbite ses yeux injectés de sang. Il s’en faut d’un rien, semble-t-il, pour qu’une terrible attaque d’épilepsie ne le fasse rouler aux pieds de ses auditeurs. Non, je ne vous décrirai pas cette musique ; je pense qu’il me suffira de vous dire que c’étaient des musiciens « à la Baï Gagno ».
La musique jouait la marche de Petchenek... Au milieu des sons entrecoupés, un hurlement sauvage, confus, fendit l’air. Un vol de petits oiseaux effrayés s’enfuit des arbres et des corniches du quartier des chiffonniers. Si une armée de lions affamés était tombée sur une bande de tigres furieux et si, à un signal donné, ces deux troupes s’étaient précipitées l’une contre l’autre, le rugissement qui aurait retenti sur le champ de bataille n’aurait pas été plus sauvage que le hurlement qui répandait maintenant la terreur parmi les habitants du quartier tsigane et du quartier des chiffonniers. C’était un « hurrah ! » poussé par les gaillards réunis par Dianko l’Apache. Les voilà qui se montrent au tournant de la rue et se répandent sur la place.
La musique, puis les tsiganes et les portefaix. En tête, ils portent sur leurs bras un individu, les moustaches en crocs, le kalpak sur l’oreille... vous devinez qui : lui-même, Baï Gagno Balkanski.
Même en cet instant solennel, notre héros ne perd pas la carte ; il tient ses poches, « car quelque apache pourrait bien le fouiller — et alors, adieu sa bourse ! » Il connaît bien son monde. Un deuxième « hurrah ! » à réveiller les morts, casse les oreilles des clients de Gogov, au moment où ils sortent du café pour aller sur la place, et ils répondent par une salve de : « Vive Baï Gagno ! »
— Bien le bonjour, les enfants ! s’écrie d’un air important Baï Gagno rayonnant.
Un chœur de trente « bonjour ! » enroués répond à son salut.
— Courage, les gars, la force est avec nous, déclare Baï Gagno sur le ton de Napoléon avant Austerlitz. Écoute un peu, toi, le petit de Dianko, te souviens-tu bien de ce que je t’ai dit : quand tu verras que c’est le moment, tu empoigneras le Tirnovien au collet et tu crieras : « Il a injurié le Prince ! » As-tu compris ?
— Je sais, je sais, répondit gaiement de son rang le petit de Dianko.
— Et toi, Dianko, et toi, Petrescou...
— Nous le savons... par cœur, dit Petrescou profondément pénétré de l’importance de sa mission.
— Bravo ! Mais écoute, Petrescou, je veux encore de toi un travail d’artiste : quand vous vous battrez avec les électeurs, tu n’en frapperas que deux ou trois avec ton couteau, juste assez pour les bousculer un peu ; ensuite, mets de côté ton couteau, déchire ta chemise sur ta poitrine et barbouille-toi la peau de sang, comprends-tu ? Salis ta figure et tes habits de sang, comprends-tu ? Et puis après mets-toi à crier que les citoyens ont voulu te tuer, parce que tu criais : « Vive le Prince ! » comprends-tu ?
— J’ai compris, mais tu me donneras encore cent sous, le prix du sang.
— Pour ce qui est de l’argent, c’est facile ; fais seulement ce que je te dis, répondit Baï Gagno pour le calmer.
Mais les délégués envoyés du quartier tsigane pour inspecter le lieu du vote, Adamtcho le voleur de poules, Spiro le fureteur et Moustapha le bancale, arrivèrent en toute hâte sur la place, et informèrent Baï Gagno que trois mille paysans environ étaient entrés dans la ville par différents chemins, et que les gens du Tirnovien leur avaient distribué des bulletins. « Le sous-préfet disait qu’il fallait se hâter, que l’affaire était manquée. »
— Que le diable l’emporte, ton sous-préfet ! hurla Baï Gagno. À quoi est-il bon, s’il n’est pas capable de disperser quelques paysans ? Un sous-préfet, ça ! Un cornichon, oui ! Il ne sait que courir après les filles des villages. Quelle brute ! Pourquoi n’a-t-il pas envoyé des gendarmes aux issues ? Il s’est si bien saoulé, l’âne, qu’il en a oublié ce qu’il avait à faire. Cours vite lui dire de réunir les gendarmes à cheval, et de les lancer au galop à travers la ville, comprends-tu ? à travers la ville, comme une trombe, entends-tu ? Et nous, nous lui enverrons d’ici un « hurrah ! » pour voir un peu si un paysan osera venir à notre rencontre. Cours vite !
— Gogov, donne-nous du raki, commanda Baï Gagno. Allons, buvez, par ma vieille mère ! c’est moi qui régale. Et les violons, qu’est-ce que vous attendez ? Jouez donc, voyons, espèces de tsiganes ! Et toi, souffle dans ta clarinette. Pourquoi me regardes-tu bouche bée, comme un veau ? Bien ! I-i-ih-ha-a89 !
— Dianko, distribue à chacun un paquet de bulletins ! Et maintenant, allons, les gars, en avant ! Courage ! Vive Son Altesse Royale ! hurrah ! hurraaaah !...
Et... les électeurs partirent.
Ivan Gramaticov, candidat de l’opposition, s’éveilla à six heures du matin. Il s’habilla, but son café et sortit sur la grande véranda, devant sa maison. Le soleil, à peine levé, se réfléchissait sur le dôme de l’église et sur les fenêtres tournées vers l’Orient. La nature entière semblait en fête. En réalité, la nature était aussi insensible que de coutume, et la joie ne se trouvait que dans l’âme du candidat.
Jeune, instruit, un peu idéaliste, encore plus rêveur, il avait le cœur gonflé d’amour, il avait foi dans le bien et espérance dans l’avenir, mais ne possédait pas encore l’expérience des réalités de la vie. Insouciant jusqu’à s’oublier soi-même, incorrigible optimiste, habitué à voir toute chose par son bon côté, il était confiant jusqu’à la naïveté, jusqu’à la bêtise.
Quelques-uns de ses amis lui conseillèrent de poser sa candidature à la députation ; une assemblée de citoyens accueillit avec sympathie cette candidature ; Gramaticov pensa que tout était fini et il se plongea dans ses pensées pour préparer son futur rôle au Sobranié. Tout lui semblait miel et sucre en Bulgarie. Pourtant quelques détails, quelques démarches de ses amis en vue de l’élection, démarches qui n’étaient pas prévues dans la loi électorale, troublèrent peu à peu ses douces pensées. Pourquoi lui fallait-il exposer maintenant son programme aux électeurs ? Comme si l’on ne pouvait pas s’en passer ! Pourquoi lui fallait-il subir l’épreuve de ces instants si pénibles, répondre, promettre son appui pour donner satisfaction aux solliciteurs, alors que ces affaires n’intéressaient peut-être qu’eux seuls. C’était comme s’il avait fait l’abandon complet de lui-même à l’état-major d’amis qui l’entouraient. Ils lui disaient qu’il devait prononcer un discours, et il prononçait un discours. Ils lui disaient qu’il devait recevoir les maires des villages et leur parler aimablement, et il recevait chez lui les maires et les secrétaires et leur parlait avec tant d’amabilité que les paysans baissaient les yeux et ne le comprenaient pas. Ils lui exposaient leurs besoins, il prenait des notes et leur disait à cœur ouvert ce sur quoi ils pourraient ou ne pourraient pas obtenir satisfaction, ce qui avait pour résultat de mécontenter les paysans qui étaient habitués à ce qu’on leur promît des montagnes d’or. Il lui fallait assister aux réunions dans lesquelles les agents électoraux se répartissaient les villages et les quartiers de la ville. Les citoyens discutaient, faisaient du bruit, tandis que lui, assis dans un coin, se taisait, comme si tout cela ne le touchait pas. Bientôt cet état de passivité stupide l’agaçait ; il ouvrait la bouche pour dire quelque chose, pour répliquer, mais l’un des officiers de son état-major le tirait par la manche et lui disait d’un ton paternel et protecteur : « Tais-toi, reste dans ton coin, tu ne comprends encore rien à ces histoires-là. » Et lui se taisait docilement, et il écoutait les conversations sérieuses et pleines d’aplomb des honorables citoyens. « Est-ce que c’est toujours ainsi que ça se passe, les élections, pensait-il, ou bien sommes-nous peut-être au début d’une ère nouvelle ? » Il poussait le coude de l’un des orateurs et lui murmurait à l’oreille : « Dites-moi, je vous prie, est-ce que c’est toujours comme ça que ça se passe, les élections ? » Et l’autre, dans le feu de la discussion, lui jetait un regard brumeux et lui disait en souriant d’un air paternel : « Laisse donc ça,... une autre fois ; tu n’entends rien à ces affaires-là, reste tranquille : tout va bien ! »
Tout va bien ! Gramaticov se persuada de cette idée que tout allait bien. Qu’il fût assis, qu’il fût debout, qui que ce fût qu’il rencontrât, un commerçant, un artisan, un villageois, toujours il entendait dire que « tout allait bien ». Entrait-il dans un café, ses amis l’entouraient et s’empressaient de lui donner des nouvelles de la ville et des villages. « Ah ! bonjour, monsieur Ivan, comment vous portez-vous ? tout va bien ! » — « Ah ! monsieur Ivan, c’est une affaire réglée ! Nous tenons tout l’arrondissement dans notre poche. Vous pouvez être tranquille : tout marche à merveille. » Allait-il le soir se promener au jardin public, dans toutes les allées il rencontrait de ses amis qui de loin lui faisaient des signes avec la main : « Tu sais, c’est couru ! tout va bien !... »
Tout va bien ! Pourtant un événement dont il fut le témoin la veille au soir des élections, lui fit comprendre qu’il y a une différence entre les élections telles que les prévoit la loi électorale et les élections dans la réalité. C’est cet événement que lui rappelait plus tard un de ses amis dans la lettre suivante :
« Légalité, ordre, liberté, succès, tout cela est à nous !... Te souviens-tu, te souviens-tu ? Quelles blagues ! Te souviens-tu de l’irruption des Huns dans le café, la veille au soir des élections ? Vois-tu encore ce « citoyen bulgare », avec sa chapka russe en arrière, nu jusqu’à la ceinture et les genoux en sang ? Et cet autre, les yeux rouges, en chemise, tête nue, avec son grand coutelas à la main ? Et ce Roumain, devant la porte, dehors, qui, dans sa vaillante « ivresse » de patriotisme, profondément pénétré de ses droits et de ses devoirs de citoyen libre, et imbu des principes de la sagesse politique, tenait à peine sur ses jambes ? Te souviens-tu ? Le cœur tout gonflé des idées les plus nobles et les plus philanthropiques, bien faites pour donner le bonheur au monde entier, la langue alourdie par des mots aussi sublimes que difficiles à exprimer qui fermentaient dans son cerveau, comme il déclamait sur la liberté et les droits du peuple ! Tant et si bien que lorsqu’un citoyen plus âgé qui sortait du café l’interpella, la liberté et les droits du peuple restèrent brusquement accrochés dans son gosier, de même qu’ils s’étaient réfugiés aussi dans un coin reculé de l’âme de son chef politique et ami, Baï Gagno. Et cette horde, cette lie d’une corporation de citoyens sauvages, grossiers, dépourvus de toute instruction et de toute éducation, prêts à toutes les brutalités, tels enfin que je ne pouvais même pas imaginer qu’il existât dans notre ville, si orgueilleuse de sa « civilisation » et de son « occidentalisme », une pareille foule, conduite par des chefs aussi ignorants, aussi dépourvus de caractère et de principes... et cette horde, dis-je, a ses représentants au Sobranié, tandis que des milliers d’électeurs »...
C’est ainsi que le dimanche, jour des élections, aux environs de sept heures, Gramaticov se tenait sur la véranda élevée de sa maison, et léger, joyeux, aspirait la fraîcheur du matin. La loi électorale, présente à sa mémoire, lui montrait successivement les diverses phases d’une élection régulière. L’horloge de la mairie, en marquant la demie de deux coups de cloche, vint interrompre les douces pensées du candidat et lui rappeler qu’il était temps de se rendre au lieu du vote. Il s’habilla, prit sa canne, mais se souvenant qu’il était interdit d’entrer dans la salle d’élection avec une arme ou tout ce qui pouvait être considéré comme tel, il la laissa et partit...
Les rues étaient presque désertes. La foule s’était déjà massée dans la cour de l’école. Sur la place de l’église, un groupe d’amis vint à sa rencontre et lui dit amicalement : « Bonjour, monsieur Ivan. Les avez-vous vus ? » — « Qui ça ? » — « Les électeurs. Rien que les paysans sont au nombre de trois mille. Nous leur avons déjà distribué les bulletins. Tout va bien. Allons maintenant à l’école. » Ils prirent une ruelle étroite et sinueuse et débouchèrent aux alentours du lieu du vote. C’était vrai : une foule compacte de citadins et de paysans bourdonnait doucement et paisiblement dans la cour et la rue avoisinante. Les agents électoraux circulaient au milieu d’eux, et, les uns ouvertement, les autres en secret, distribuaient des bulletins aux nouveaux arrivants. De-ci de-là on entendait raconter à haute voix que, depuis de longues années, on n’avait pas osé paraître aux élections. « Hé ! que le diable les emporte ! voilà huit ans aujourd’hui que je ne suis pas venu voter » — « Et moi aussi. » — « Et moi de même. » De pareils aveux s’entendaient de tous côtés.
Le bureau était déjà installé dans la salle d’école. Quelques électeurs, ainsi que l’un des candidats de l’opposition, circulaient autour du bureau. On commença à voter. Gramaticov remarqua non sans étonnement que, dans la cour voisine de l’école, comme aussi dans les cours situées de l’autre côté de la rue, fourmillaient un grand nombre de gendarmes bien armés, au milieu desquels se glissaient deux brigadiers qui leur donnaient à voix basse quelques instructions. « Mais la loi électorale ne défend-elle pas qu’il y ait de la force armée dans le voisinage du lieu de l’élection ? C’est étrange !... »
Il n’eut d’ailleurs guère le temps de s’étonner.., Devant les yeux de Gramaticov, un tel ouragan de violences et d’horreurs se mit à souffler, à tourbillonner, à mugir, à faire rage, qu’il resta planté là, comme frappé par la foudre. Voici ce qui se passa : À peine revenu de la stupéfaction que lui avait causée la vue de la force armée aux alentours du lieu de vote, il vit accourir auprès de l’un des brigadiers Adamtcho le voleur de poules, qui, essoufflé, haletant, lui murmura d’un air troublé quelque chose à l’oreille. Le brigadier appela un gendarme, lui dit quelques mots. L’homme partit. Un instant après arriva le sous-préfet90. Adamtcho lui dit quelque chose à voix basse. Le sous-préfet donna des ordres aux brigadiers ; ceux-ci s’éloignèrent et au bout de peu de temps, des maisons voisines commencèrent à sortir des gendarmes qui tiraient derrière eux leurs chevaux par la bride. Ils se mirent en selle, et le sous-préfet, sabre au clair, commanda : « En avant ! » et vingt gendarmes à cheval, armés jusqu’aux dents, s’élancèrent dans l’étroite ruelle encombrée d’électeurs ; ils s’élancèrent et firent une brèche avec le poitrail de leurs chevaux dans le mur vivant. Cris, vociférations, tumulte, protestations, commandements, sabres jetant des éclairs sous le soleil, vagues humaines ballottées en avant et en arrière, les chevaux se frayant un chemin dans la foule, le mur vivant s’ouvrant pour leur livrer passage, de nouveaux flots venus de l’arrière repoussant et dispersant les gendarmes...
Mais force reste à la police, le mur vivant est enfin ébranlé. Les électeurs turcs commencent à filer un par un : « Pourquoi donc risquerions-nous d’attraper des coups ?91 » se disent-ils. Les paysans se jettent les uns aux autres des regards affolés. Les gendarmes s’efforcent de refouler à bonne distance la plus grande partie des électeurs. Les autres, de beaucoup le plus petit nombre, restent dans la cour de l’école.
C’est là que se trouvaient le Tirnovien et Gramaticov. Du côté opposé de la rue, le cri perçant d’une clarinette se mit à fendre l’air, des violons se firent entendre, puis le bruit d’une foule se rapprochant, et un sourd grondement de tonnerre ébranla les environs. Les voilà : d’abord les violoneux, puis derrière eux, les yeux brillants, Baï Gagno Balkanski ; voilà Gotcholou et Dotcholou, voilà Petrescou, le petit-fils de Dianko l’Apache, Spiro le fureteur, Moustapha le bancale, voilà les tsiganes, les pêcheurs, voilà Dianko l’Apache en personne...
— Vive l’honorable administration ! hurrah ! s’écria d’une voix de fausset le petit Dianko.
— Hurrah ! hurrah ! répondirent cent voix terribles dans la foule.
Gramaticov se mit à trembler. Il lui vint à l’esprit le souvenir de l’année 1876, que les hordes de bachi-bouzouks avaient marquée pour lui d’une croix ; le nom de Fazla-Pacha s’arrêta sur ses lèvres92.
La horde sauvage de ces ivrognes s’engouffra dans la cour de l’école. Dieu ! Quelle grossièreté, quel air de défi, quelle brutale férocité dans ces yeux bouffis et injectés de sang, dans ces gestes d’apaches, dans ces regards provocateurs !... Baï Gagno, à la suite de ses compagnons qui lui ouvraient ainsi brutalement le chemin, monta l’escalier et pénétra dans la salle d’école, auprès du bureau. Par les fenêtres on entendit un vacarme, un sourd grondement, et, bousculé par la foule, apparut en haut de l’escalier Nicolas le Tirnovien. Immédiatement, comme un oiseau de proie, le petit Dianko se jeta sur lui, le saisit au collet, en criant d’une voix enrouée, à s’en casser le gosier : « Arrêtez-le ! Il insulte le Prince ! Le Prince est injurié ! Arrêtez-le ! » Petrescou et Dianko l’Apache, sans perdre un instant, comme deux loups, le happèrent et, l’empoignant par les bras, le précipitèrent dans l’escalier. Baï Gagno pénétra dans la salle, prit un billet que lui tendait le président du bureau, le remit au petit Dianko qui, se faufilant à travers la foule, gagna la cour voisine. Un instant après, lorsque les gendarmes firent irruption dans la cour, ils trouvèrent l’armée de Baï Gagno repoussée dans un angle par les électeurs furieux qui étaient restés autour de l’école. Petrescou, la poitrine, les mains et la figure toutes barbouillées de sang, criait comme un jeune innocent. Il avait déjà frappé deux ou trois électeurs, et cherchait justement à remplir le programme, en se couvrant lui-même de sang. Il bondit sur un tas de pierres et appela à l’aide aussi fort qu’il put : « Ils m’ont tué, monsieur le sous-préfet, ils ont voulu me tuer ! Je criais : vive le Prince ! et ils m’ont frappé à coups de couteau ! »
La police commença à jouer son rôle... « Sabre au clair !... » Cliquetis de sabres, claquements de fouets. On entendit des protestations, des jurons les couvrirent. La police, aidée par la troupe de Baï Gagno, cueillit Nicolas le Tirnovien, empoigna ses principaux compagnons ; les gendarmes à cheval se mirent en branle et déblayèrent la cour.
Et Gramaticov entraîné par le flot, se trouva dans la rue. Il était comme frappé de la foudre. À ses oreilles bourdonnèrent les paroles de Baï Gagno qui, du haut de l’escalier, s’écriait : « Nous avons passé quelque temps en Europe, nous autres ! Nous les connaissons, ces sacrées élections ! J’ai été en Belgique, moi... »
À ses oreilles résonnèrent aussi les paroles du père Dobri. Pauvre père Dobri ! Rejeté dans la rue, violemment frappé à la tête, pleurant de souffrance, de colère ou de dégoût, il exprimait sa façon de penser, le malheureux, d’une voix entrecoupée : « Ah !... monsieur le sous-préfet... c’est-il pas affreux !... est-ce qu’elles ne devaient pas être libres... malheur !... » Pauvre père Dobri !...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quelques jours plus tard, Gramaticov lut dans l’un des journaux de la capitale le télégramme suivant :
« Sofia. Ministre-Président. Les élections ont eu lieu au milieu du calme le plus parfait. Élus : Gagno Balkanski, Philiou Gotcholou et Tanase Dotcholou, tous des nôtres. Candidats opposition honteusement battus. Dès que se montrèrent les électeurs, musique en tête, leur bande s’enfuit en déroute. Ville entière en fête. Vive Son Altesse Royale !
« GAGNO BALKANSKI. »
La lettre adressée à Gramaticov et à laquelle nous avons fait allusion plus haut, se terminait ainsi :
« Et le peuple, que va-t-il dire, que va-t-il faire ? L’intéressante question ! Tu me disais un jour que tu avais confiance dans le peuple bulgare... Allons donc ! Tu plaisantes ! En qui donc as-tu confiance ? Est-ce en cette race d’esclaves, qui supporte tout cela ? Est-elle représentée, la nation bulgare, par ses députés ?
« Le peuple dans lequel tu dis avoir confiance, est esclave, je le répète, esclave ! L’esclavage est pour lui un état plein de félicité, la tyrannie un bienfait, la servilité de l’héroïsme ; un hoquet de mépris devient pour lui une musique céleste !
« Et malgré cela ce peuple est infortuné et misérable, trois fois misérable ! Maltraité par le sort, condamné à souffrir pour les autres, martyrisé par ses ennemis et plus encore par ses amis et ses sauveurs, il n’a pas un seul espoir solide sur lequel arrêter son regard, pas une perche à laquelle se raccrocher. Il a perdu sa foi en lui-même et en sa destinée, et il est devenu « pratique » et indifférent, indifférent jusqu’à l’apathie. Privé de tout appui et de tout conseil, accablé et meurtri au dehors et au dedans, voilà ce qu’il est devenu, ce triste débris des siècles passés...
« Quelqu’un pourra-t-il lui rendre la vie, l’entraîner à sa suite ? Chimères? ! Illusions, fumée !... »
L’ORCHESTRE jouait l’air roumain Doïna. Plus exactement, la jeune Annette jouait un solo de flûte, et les autres l’accompagnaient. Nous l’écoutions de la petite salle du fond. Mais, direz-vous, qui sont ces « nous » ? ? mais évidemment : le sénateur, Othello93, Stouventcho et moi. Devant nous se dressaient une longue bouteille de « Château-Sandrovo » blanc et une autre de « Giesshübler ». Pleins d’insouciance et d’entrain, nous écoutions, la cigarette aux lèvres, les fioritures de Doïna et nous nous abandonnions à l’agréable « farniente ». Le lendemain était un dimanche — jour de repos — nous pouvions rester un peu plus longtemps. La musique était passable, les musiciennes assez gentilles, et nous autres, des célibataires d’un certain âge. Alors dame !
Mais voilà que tout à coup, la flûte se met à nous déchirer les oreilles avec quelques fausses notes, et en même temps tout l’orchestre détonne. Au même instant Stouventcho part d’un éclat de rire et s’écrie : « Quel toqué que cet Othello ! quel sacré blagueur ! Regardez-le un peu !... » Nous nous retournons immédiatement, le sénateur et moi, et qu’est-ce que nous voyons ? ce diable d’Othello ! Comment peut-il imaginer des singeries pareilles ? Il s’est levé sans que nous l’ayons remarqué, il a pris un morceau de citron, et, après avoir attiré de loin par des signes l’attention de la flûtiste, il s’est mis à sucer le jus acide du citron. Et voilà que l’eau vient à la bouche de la pauvre fille, voilà que ses lèvres se pincent, essayez donc après ça de jouer de la flûte ! Fou rire...
L’orchestre s’arrêta. Dans la rue, on entendit un gamin crier : « Le nouveau journal ! La Grandeur Nationale ! »
Hein ? La Grandeur Nationale ? Qu’est-ce que c’est que ça ?
Gagnés par la contagion du fou rire après la comédie du citron, nous partîmes d’un nouvel éclat de rire. Au même moment notre ami Guedros entrait.
— Tiens, Guedros, salut ! Assieds-toi. Un peu de vin ?
— Tiens, Othello, salut ! salut, mon poulet. Mouche donc le bout de ton petit nez, répondit le joyeux Guedros qui adore les diminutifs.
— Quel est ce journal qu’on crie en ce moment dans la rue ?
— Comment ! Vous ne connaissez pas le journal de Baï Gagno Balkanski ?
— Quelle blague !
— Non, sérieusement. Gagno Balkanski, propriétaire-rédacteur du journal La Grandeur Nationale. Ah ! c’est toute une histoire ! Vous ne la connaissez pas ?
— Non. Tu parles sérieusement ?
— Très sérieusement, voyons, vieux frère. Attendez un peu que je vous raconte ça. On m’a narré aujourd’hui cette histoire en détail, et je vous la conterai comme si j’avais assisté à la scène.
Nous fîmes fermer la porte de la salle et Guedros commença son récit.
Chez Baï Gagno ont été convoqués et assistent à la réunion : le maître de la maison en personne, Gotcholou, Dotcholou et Dianko l’Apache. Ils discutent sur les moyens de tirer le meilleur parti de la situation.
— Il faut bien que nous y trouvions aussi notre petit profit, dit Baï Gagno, parce que le patriotisme tout sec, c’est de la blague. Allons, vous autres, dites-moi un peu maintenant, ce que nous avons de mieux à faire. Toi, Gotcholou, quel est ton avis ?
— Moi ? Pour te parler franchement, Baï Gagno, j’en tiens toujours pour mon idée : ouvrons un café à la russe.
— Quoi ?
— Ouvrons un café à la russe, répondit d’un air sérieux et résolu Gotcholou.
— Voyons, quoi ? Voilà que tu te tournes encore vers notre « petite mère94 » ? dit avec étonnement Baï Gagno,
— Mais entendons-nous bien, il n’est pas question ici de notre « petite mère », il est question de savoir d’où vient le vent...
— Où ça ? Dans ta cervelle ?
— Non. En Bulgarie. Il faut être fou pour ne pas profiter de la situation. C’est maintenant le moment d’ouvrir un café à la russe. J’ai fait ce métier-là chez les Moscovites, ça me connaît ! Un café divisé en deux parties, l’une pour les gens chics et l’autre pour les moujiks.
— Mais chez nous, où en trouveras-tu des moujiks ? demanda Baï Gagno perplexe.
— Eh quoi ! Est-ce que nous sommes tous des gens chics, voyons, Baï Gagno ?
— C’est bon, et après ?
— Après ? Nous y fourrerons une musique, une boîte à musique ; tu en as vu certainement, Baï Gagno ?
— Si je n’avais pas vu ça, moi, qui donc en aurait vu ? répondit avec suffisance M. Balkanski.
— En effet. Une boîte à musique et, bien entendu, du thé. Nous engagerons une dizaine de gamins, en faisant bien attention qu’ils n’aient pas les yeux noirs, mais l’air un peu russe ; nous leur mettrons une paire de bottes, une chemise rouge, nous leur couperons les cheveux à la cosaque, et le voilà monté, notre café ! Nous ferons venir des journaux russes, de la vodka russe, des hors-d’œuvre russes, nous mettrons au-dessus de la porte un écriteau « Café russe », et nous planterons notre chapka sur l’oreille. Hein ?
— Je n’approuve pas ton idée ! s’écria solennellement Dotcholou, je ne l’approuve pas ! Si nous voulons profiter du vent qui souffle en ce moment, mieux vaut ouvrir une fabrique de kvass....
— Ce serait une belle opération ! dit en riant Dianko l’Apache ; est-ce aussi un four à pain que tu veux ouvrir ?
— Mais non, vieux frère, je parle du kvass russe. C’est quelque chose... comme qui dirait, du poiré, de la bouza95...
— En voilà une idée ! Alors nous deviendrions maintenant des marchands de bouza, fit remarquer l’Apache.
— Mais non, l’ami, la boisson ne fait rien à l’affaire, ce qui est important, c’est le nom que tu lui donneras ; mets-toi un peu à crier : « kvass russe ! » et on s’essoufflera à courir après toi. N’as-tu pas entendu raconter ce que font les Français en ce moment ? Ils ont gagné comme ça de l’argent, beaucoup d’argent, ce n’est pas de la blague !
— Ce sont des histoires ! Je ne veux pas du kvass, déclara Dianko d’un air mécontent.
— Alors qu’est-ce que tu veux ? demanda Dotcholou piqué, dis-nous un peu pour voir.
— Fondons une banque ! lança Dianko l’Apache.
— Tu es toqué !
— Pourquoi ça ?
— Aurez-vous bientôt fini de vous disputer ? dit pour les calmer Baï Gagno.
— Pourquoi suis-je toqué ? insista Dianko en colère, et il lança un regard sanglant à Dotcholou.
— Allons, tais-toi, assieds-toi. Explique-nous ce que tu as à dire sur ta banque ?
— Mais dis-moi donc d’abord, très cher, pourquoi je suis toqué ?
— Nous fonderons une banque ! Ce n’est pas une petite affaire, grommela dans sa moustache Dotcholou, effrayé des regards et du ton de Dianko ; tu crois que c’est une petite affaire ? une banque !
— Mais oui, c’est une petite affaire ! s’écria l’Apache.
— Comment ? une petite affaire ? Où as-tu pris ça, que c’est une petite affaire ? répliqua entre ses dents Dotcholou.
— Taisez-vous donc, vous autres ! Est-ce pour ça que nous nous sommes réunis ? dit pour les calmer Baï Gagno. Dotcholou, va t’asseoir à ta place.
— Mais où as-tu pris ça, que c’est une petite affaire ?
Peu à peu la discussion s’envenima ; Dianko l’Apache, comme vous le savez, a le coup de poing facile, et Dotcholou n’a pas peur d’en venir aux mains, ils vont s’empoigner ; mais Baï Gagno, allant de l’un à l’autre, parvient à les calmer. Dianko se rassied à sa place et se met à exposer son plan pour la fondation d’une banque. « La chose est facile, nous émettrons pour cinq ou dix millions d’actions, nous recueillerons l’argent, nous prêterons par-ci, nous prêterons par-là, bien entendu, à de bons intérêts, à des commerçants, à des communes, et si jamais le ministère se trouve à court, à lui aussi nous prêterons quelques millions. Hein ! nous rédigerons un règlement : la moitié des bénéfices pour nous, l’autre moitié pour les actionnaires. Nous garderons une partie des actions, et nous verserons l’argent ou nous ne le verserons pas. Toi, Baï Gagno, qui es un homme influent, tu iras tousser à deux ou trois portes, et ce sera fini ! »
— Cette cuiller-là est trop grande pour ta bouche ; il y a des gens plus malins que toi ; nous les laisserons couver l’affaire, et après, nous y donnerons des coups de bec, observa Baï Gagno paternellement.
Gotcholou et Dotcholou hochèrent la tête en signe d’approbation.
— Attendez un peu que je vous dise maintenant ce à quoi j’ai pensé, moi, s’écria avec autorité Baï Gagno, et il se leva. Savez-vous une chose ? Ce n’est pas avec un café à la russe que nous ferons nos affaires. Une banque ? Nous ne pourrons pas la faire marcher comme des professionnels. Quant à ton kvass russe, Dotcholou, c’est une affaire beaucoup trop simple. Mais je vais vous dire, moi, ce qu’il vous faut.
Gotcholou, Dotcholou et l’Apache l’écoutent avec impatience.
— Voulez-vous que je vous dise quoi ? hein ?
— Allons, dis-le donc, tu nous as assez fait languir, fit Dianko agacé.
— Chut ! la chienne trop pressée a des petits aveugles. Voulez-vous que je vous dise ? hein ? Messieurs ! c’est un journal qu’il nous faut fonder ! déclara Baï Gagno dont le visage rayonna de triomphe.
Si quelque monstre marin avait fait irruption à ce moment dans la chambre, il n’aurait pas provoqué sans doute une plus grande stupéfaction que les dernières paroles de Baï Gagno. Tout d’abord comme pétrifiés, Gotcholou, Dotcholou, et Dianko l’Apache se mirent à s’entre-regarder d’un air affairé, comme s’ils se demandaient : « Mon Dieu ! Est-ce que la cervelle de Baï Gagno n’est pas un peu dérangée ? » Ils ne savaient pas s’ils devaient rire ou grogner. L’autre se fâcherait. À la fin Gotcholou, pas très fier, se décida à faire une allusion lointaine à la proposition de Baï Gagno :
— Ta seigneurie aime quelquefois, hé, hé ! pardon, je voulais dire que tu aimes... e... e... plaisanter, c’est-à-dire, hé, hé !...
— Quoi ?
— Mais non, Baï Gagno, j’ai seulement voulu dire que... e... e... Voyons, ta seigneurie, cette histoire de journal... c’est sérieux ?
— Comment ? si c’est sérieux ? et pourquoi pas ? bien sûr que c’est sérieux ! est-ce donc si difficile de rédiger un journal ? Mets-toi un mouchoir sur les yeux (et encore ! ça n’est pas nécessaire !) et injurie à droite, injurie à gauche. Voilà tout !
— Si c’est ça, je marche, observa Dianko l’Apache.
— Mais oui, voilà tout ! Nous appellerons Gounio l’Avocaillon ; il est passé maître pour les articles de tête ; quant à nous, l’un rédigera les chroniques, l’autre les entrefilets, un autre les télégrammes. Le tout, n’est-ce pas, est d’injurier convenablement les uns et les autres, et pour ça il n’est pas besoin d’être un grand philosophe ! Dianko, dépêche-toi, va jusqu’à l’étude et dis à Gounio l’Avocaillon de venir ici.
— Cet Apache-là, voyez-vous, dit Baï Gagno dès que Dianko fut sorti, pour engueuler les gens, il n’y a pas son pareil ! Les reins leur en cuiront ! Qu’il vous injurie en face ou par derrière, il ne sourcille pas davantage. Quelle canaille !
On ne peut pas dire que Gotcholou et Dotcholou fussent enchantés de ces qualités de Dianko l’Apache : on ne peut pas dire non plus que, d’après leur conception du journalisme, Dianko représentât le modèle des rédacteurs. Ils gardaient encore le souvenir d’un autre temps, de l’époque turque, alors que la presse troublait déjà bien un peu leur eau, mais ne crachait pas encore un tel torrent d’injures infernales. Mais la tempête des passions sauvages, déchaînée pendant une longue suite d’années, mais l’influence démoralisante de la presse démoralisée, mais le grossier matérialisme, mais la possibilité d’un facile enrichissement au prix de l’engourdissement de la conscience, mais l’exemple venant d’en haut, — tout cela a peu à peu recouvert d’une couche si épaisse la pureté de leurs sentiments, qu’il faudrait de longues années pour piocher cette couche de fumier et pour en faire jaillir, comme les vestiges de la grandeur passée, les sentiments purs qui y sont enfouis.
Et maintenant, tandis que Baï Gagno leur expose son plan de fondation d’un journal et ses idées sur la direction à lui donner et les individus à choisir comme collaborateurs, Gotcholou et Dotcholou sentent comme une brûlure dans un coin reculé de leurs cœurs ; ils sentent qu’il y a quelque chose de trouble dans cette affaire, qu’il y a je ne sais quoi qu’il ne devrait pas y avoir ; mais Baï Gagno ajoute une nouvelle couche d’impuretés sur celle qui comprime déjà ces sentiments honnêtes, et il les étouffe. En termes doucereux, avec persuasion, avec passion, il leur expose le profit matériel qu’ils tireront de leur entreprise. Mais il n’est pas nécessaire de chercher pour Gotcholou et Dotcholou des arguments si persuasifs.
La porte s’ouvre et, sur le seuil, se montrent Gounio l’Avocaillon avec son museau pointu de renard, et derrière lui Dianko l’Apache.
— Eh bien ! Gounio, qu’est-ce que tu en dis ? s’écria d’un air affable Baï Gagno en se retournant. Nous voulons fonder un journal. Hein ?
— Et pourquoi pas ? Fondons-en un. Mais y a-t-il quelque chose à gagner ? demanda Gounio en clignant de l’œil et en faisant avec ses doigts un geste expressif.
— Tu peux être tranquille.
— Mais y en a-t-il vraiment, du bénéfice ?
— Il y en a, il y en a, sois tranquille.
— Bon. Et quel journal allons-nous fonder ? pour ou contre le gouvernement ? Dis vite, j’ai des clients qui m’attendent.
— C’est justement la question, sera-t-il ou non gouvernemental ? Que le diable les emporte, nous ne pouvons pas savoir combien de temps durera le gouvernement actuel.
— Dis vite, j’ai des clients qui m’attendent.
— Sais-tu, Gounio ? continua Baï Gagno, sans faire attention à ce que disait l’avocat. Je pense qu’il vaut mieux, pour l’instant, nous mettre avec le gouvernement...
— C’est ça, c’est ça, le mieux est d’être avec le gouvernement, s’empressent de faire remarquer Gotcholou et Dotcholou.
Baï Gagno leur jette un regard furieux parce qu’ils lui coupent la parole, puis il continue :
— ... Et puis plus tard, quand nous flairerons qu’ils vont se casser les pattes, nous leur enverrons un coup de pied et nous nous mettrons du côté des nouveaux qui viendront au pouvoir, hein ?
— Parfait. Est-ce qu’ils vous ont promis quelque chose ?
— C’est sûr. Sans ça ce n’est pas possible.
— Alors, commençons, dit d’un air résolu Gounio l’Avocaillon.
Et ils se mirent à discuter sur le moyen de fonder le journal et la direction à lui donner sur un certain nombre de questions. On décida de se laisser guider par le vent et les circonstances, et aussi par les petits bénéfices, « s’il plaît à Dieu » d’en donner.
— Quant à la Russie, nous lancerons un : notre libératrice, la nation sœur, vive le Tsar libérateur ! (Dieu ait son âme !), et puis si nous voyons que ça ne va pas, nous reprendrons la vieille histoire du Gouvernement Transdanubien. Et quant à la Macédoine, nous n’en soufflerons pas mot. Ce n’est pas le moment d’en parler, tu sais bien, l’Autriche, et puis la Triple Alliance, ça ne me dit rien qui vaille...
— Et avec la jeunesse ? Quelle attitude prendrons-nous avec la jeunesse ? fit remarquer Gotcholou, et ils hésitèrent un instant.
— Nous l’amuserons. Qu’est-ce que tu veux leur faire, à ces gamins-là ? De temps en temps on est bien obligé de céder à leurs fantaisies. C’est la faute de l’époque, il n’y a rien à faire contre ça, dit en soupirant Baï Gagno.
— Comment, il n’y a rien à faire? ! grommela Dianko l’Apache, et ses yeux s’assombrirent. Une bonne volée de bois vert ! Si je les tenais, moi...
— Tiens-toi tranquille, Dianko.
— .... Je les réduirais en poussière...
— Laisse-les, tais-toi ! Assieds-toi à ta place. Tu as le temps.
— Allons, vite, Baï Gagno, mes clients m’attendent, s’écria avec impatience Gounio l’Avocaillon.
— Écoute un peu, Gounio, sais-tu... (hé ! laisse-nous tranquilles avec tes sacrés clients !)... sais-tu ? Tu vas nous écrire ce soir un article de tête. Envoie-lui, au Prince, un serment de fidélité si tapé qu’il en soit étonné lui-même. Mets : « Vos humbles enfants, Notre père, Notre papa, Dans la poussière de vos augustes pieds », arrange ça en chapelet, tu sais bien comment. Et puis rappelle-toi qu’il faut mettre deux ou trois mots sur le peuple, comme c’est de rigueur. M’as-tu bien compris ? Bon. Et puis en finissant prends à partie l’opposition. Mets : « ces traîtres, ces... »
— « Traîtres » est un mot bien vieilli déjà. Nous mettrons plutôt « voyous », corrigea Gounio.
— C’est bon. Tu mettras « voyous ». Et puis n’oublie pas de mettre aussi « une fatalité pour le peuple bulgare ». Que le diable m’emporte ! ce mot fatal me plaît infiniment ! Quand je dis « f... f... fatalité », il me semble que j’empoigne quelqu’un à la gorge... Il me plaît terriblement !
— Et à moi aussi, il me plaît. C’est comme si j’injuriais quelqu’un, répliqua Dianko l’Apache à cœur ouvert. Ce mot-là m’allège l’âme !
— Achkolsoun ! mon vieil apache, s’écria à pleine voix Baï Gagno, en tapant sur l’épaule de Dianko. Tout est réglé. Toi, Gounio, tu écriras, comme je te l’ai dit, l’article de tête. Et vous, Gotcholou et Dotcholou, vous inventerez quelques chroniques et quelques télégrammes.
— Mais quels télégrammes, quelles chroniques ? demandèrent les deux amis d’un air perplexe.
— Quoi ? Mais de toutes sortes. Est-ce que vous ne voyez pas ce que font les autres journaux ? Vous écrirez : « Votre Altesse Royale, la Nation se réjouit et, à l’unanimité et à genoux, prie l’Éternel »... et cætera ; et puis mettez tout ce qui vous passera par la tête. Dites ailleurs : « La Nation Bulgare a mille fois prouvé que, lorsqu’on touche à ses droits, tous les citoyens jusqu’au dernier se lèvent et... les larmes aux yeux »... et cætera. Et puis, somme toute, pourquoi m’en écririez-vous des pages et des pages ? tombez sur l’opposition, ça suffit. À quoi bon userions-nous notre salive à faire de la philosophie ? Qui est-ce qui nous comprendrait ? Le tout, n’est-ce pas, est de jeter de la poudre aux yeux, et en avant, marche ! n’est-ce pas vrai ?
— Allons, au revoir, mes clients m’attendent, murmura Gounio l’Avocaillon en prenant son chapeau.
— Que le diable les emporte, tes clients... Au revoir. Mais écoute, Gounio, que ton article soit prêt demain de bonne heure. Salut.
Gounio se dirigea vers la porte. À leur tour Gotcholou et Dotcholou se levèrent. Baï Gagno leur donnait les instructions nécessaires.
— Attendez un peu, messieurs, nous avons oublié le plus important, s’écria derrière eux Baï Gagno ; comment baptiserons-nous notre journal ?
— Tu as raison, ma foi, Baï Gagno ; que nous sommes donc... drôles ! répliquèrent Gotcholou et Dotcholou.
— C’est une question très sérieuse, dit Gounio l’Avocaillon, et savez-vous pourquoi ? Parce que ces gaillards-là ont pris tous les beaux noms, et qu’ils ne nous ont rien laissé. Mais on en trouvera un. Je crois que le mieux sera de baptiser notre journal : La Justice, et puis nous ajouterons entre parenthèses : « fin de siècle96 ».
— Quoi? !
— Ce sont des mots français, vous ne pouvez pas comprendre.
— Nous ne voulons pas de mots français, nous autres ; des mots latins si possible. Mets quelque chose, comme d’habitude.
— Allons-y d’un « Tempora mutantur » ?...
— Mets-le ; s’il est à sa place. Toi, Gotcholou, quel est ton avis ? reprit Baï Gagno.
— La Justice, c’est un beau nom, mais je crois que La Sagesse Nationale serait encore mieux, répondit Gotcholou.
— Je ne suis pas de cet avis, fit remarquer Dotcholou, ce nom-là sent trop le pope. Mieux vaut : La Fierté bulgare.
— Et toi, l’Apache, qu’est-ce que tu en dis ?
— Moi ? Est-ce que je sais ? Va pour La Bravoure nationale et n’en parlons plus. Nous mettrons comme rédacteur responsable : Sara-Tchismeli-Mehmeda97, hein !
— Tu nous racontes des bêtises. Voulez-vous que je vous dise, moi ? déclara Baï Gagno avec autorité. Notre journal, nous le baptiserons, ou bien La Bulgarie aux Bulgares, ou bien La Grandeur Nationale. Choisissez l’un des deux noms.
— La Grandeur Nationale ! Parfait ! La Grandeur Nationale ! C’est ça, c’est ça, bravo !
— Allons, au revoir Baï Gagno. Au revoir.
Gotcholou, Dotcholou et Gounio l’Avocaillon sortirent.
— Toi, Dianko, reste un peu, nous écrirons ensemble les entrefilets.
— Bon. Fais-nous apporter du mastic et des mézets, et mettons-nous au travail. Et puis qu’ils ne nous donnent plus de ces bamia au vinaigre, mais quelque mézet pour gens chics ; nous avons un journal à rédiger, c’est sérieux.
On apporta du mastic et des mézets. Mais quels mézets ? va demander Baï Manoltcho. Cela n’a pas d’importance. Ce qui est important, c’est que Baï Gagno et Dianko l’Apache retroussèrent leurs manches pour se mettre à diriger l’opinion publique.
— Dis donc, Dianko, notre voisin est rudement orgueilleux ; c’est un homme instruit, honnête, et je ne sais plus quoi encore. Si nous lui envoyions une calomnie ?
— Pas seulement une calomnie ; mais jetons-le par terre et écrasons-le, conseilla le spécialiste en injures.
Et ils commencèrent à écrire... « Nous avons appris que »... et Baï Gagno égrena sur une feuille de papier blanc un tel chapelet de noires injures contre son voisin, que jamais on n’a pu non seulement en lire, mais en rêver de semblables. Baï Gagno écrit, écrit, efface ; jamais il n’est satisfait du venin de ses flèches : « voleur » est pour lui un petit mot aimable ; il le raie et écrit « brigand », mais ce mot-là aussi est passé dans le vocabulaire courant ; Baï Gagno ajoute « en plein jour » et réunit les deux expressions par le mot « fatal. » Le voisin, sa femme, ses enfants, ses parents deviennent sous la plume de Baï Gagno des phénomènes. Il lit enfin son élucubration à Dianko l’Apache. Dianko, les yeux brillants par l’effet du mastic, encourage avec entrain le maître ès entrefilets :
— Hardi, hardi, hardi ! Pousse, par ma vieille mère ! que rien ne t’arrête, rien ! Hardi ! fulmine Dianko l’Apache, comme s’il commandait quelque tir d’artillerie......
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voilà, messieurs, comment a été fondé le journal de Baï Gagno, dit Guedros en terminant son récit.
Nous rouvrîmes la porte du petit salon ; l’orchestre attaquait l’admirable marche de Tannhaüser.
Pardonne-moi, indulgent lecteur ! Tu as rencontré dans ce livre quelques mots et quelques descriptions cyniques ; il m’était impossible de les supprimer ; si tu peux dépeindre Baï Gagno sans employer de mots cyniques, je suis ton humble serviteur !
Pardonne-moi, toi aussi, Baï Gagno ! Dieu m’est témoin que j’ai toujours été animé de bons sentiments en écrivant tes aventures. Ce n’est ni la critique malicieuse, ni le mépris, ni la fantaisie souriante et étourdie qui a conduit ma plume. Je suis moi-même un enfant de mon siècle. Diverses circonstances m’ont détourné peut-être, malgré moi, de mon objectif strict, mais je me suis efforcé de reproduire les traits essentiels de la triste réalité. Tes frères, je pense, ne sont pas tous tels que je t’ai dépeint, toi, Baï Gagno, mais ils sont pour le moment au second et au troisième plan ; ils commencent à peine actuellement à manifester leur existence, tandis que toi, tu marches en tête, ton génie plane sur l’ensemble du système et imprime son cachet à la politique, aux partis et à la presse. J’ai confiance qu’un jour viendra où toi-même, après avoir lu ce petit livre, tu réfléchiras, tu soupireras et tu diras : Européens, nous le sommes, mais pas tout à fait encore !...
Pardonne-moi ! il se peut bien qu’un jour nous nous rencontrions de nouveau.
Sofia, 17 mars 1895.
_______
Texte établi par la Bibliothèque russe et slave ; déposé sur le site de la Bibliothèque le 30 mars 2015.
* * *
Les livres que donne la Bibliothèque sont libres de droits d'auteur. Ils peuvent être repris et réutilisés, à des fins personnelles et non commerciales, en conservant la mention de la « Bibliothèque russe et slave » comme origine.
Les textes ont été relus et corrigés avec la plus grande attention, en tenant compte de l’orthographe de l’époque. Il est toutefois possible que des erreurs ou coquilles nous aient échappé. N’hésitez pas à nous les signaler.
1. La Bulgarie, Paris, Cerf, 1885.
2. Sous le Joug, traduit par Andreev (Paris, Fontanaz, sans date).
3. Œuvres d’Aleko Constantinov, livre premier, notes et souvenirs, par M. Pentcho Slaveikov, librairie Oltchev, Sofia, 1901. Pour l’étude de la renaissance de la littérature bulgare, nous renvoyons les lecteurs français à l’ouvrage, malheureusement devenu très rare, de M. Louis Léger, membre de l’Institut, La Bulgarie, Paris, 1885.
4. Les Chops sont les paysans des environs de Sofia.
5. Nous dirions en français : « Le Père » Gagno. Baï est une abréviation du mot Bachta qui signifie père.
6. C’est ce même parti démocratique qui est arrivé au pouvoir en 1908, après la chute du ministère stambouloviste, et qui a proclamé l’indépendance de la Bulgarie. Si le pauvre Aleko avait vécu, il serait devenu l’un des chefs de ce parti. Quels services un homme d’un caractère si droit, d’un jugement si sûr et d’un esprit si fin n’aurait-il pas pu rendre à son pays !
7. Centimes.
8. M. Takev était ministre de l’Intérieur dans le cabinet Malinov (1908-1911).
9. Manteau en laine épaisse et rude que les bergers bulgares mettent sur leur dos dans la montagne.
10. La Russie et l’Europe, veut dire Aleko Constantinov, ont aidé la Bulgarie à secouer le joug turc. Le jeune pays a pris à l’Occident et en particulier à la Belgique sa Constitution et son organisation politique. Et l’on s’est imaginé que, par ce seul fait, la Bulgarie était devenue un pays occidental.
11. Bonnet en peau de mouton.
12. Fromage de brebis.
13. Petit flacon d’essence de roses.
14. L’antéria est une sorte de veston court doublé de laine.
15. Solide gourdin à manche recourbé.
16. Une belle fille ! dit Baï Gagno en roumain.
17. Parlez-vous roumain ?
18. Les « guémidjis » sont les pêcheurs des bords du Danube et de la Mer Noire. Ils ont l’habitude de nager par le procédé que nous appelons la « brasse allongée ».
19. Baï Gagno accomplit là un rite funèbre de la religion orthodoxe.
20. « On nous donne de trop beaux wagons », veut dire Baï Gagno, mais on oublie, comme dans la fable, d’allumer la lanterne.
21. La guerre Berbo-bulgare de 1885.
22. Où est ma maison natale ? Ce chant a été pris aux Tchèques par les Bulgares, quoi qu’en pense Baï Gagno.
23. Toute chose a sa raison.
24. « Frères Bulgares !... La grandeur slave... Cyrille et Méthode ! »
25. « Frères, nous sommes venus nous instruire chez le grand peuple tchèque ! »
26. « Frères ! Le grand Jean Hus.... Oui, frères, Jean Hus est grand ! »
27. C’est avec l’essence de géranium qu’on falsifie l’essence de roses.
28. Théâtre National.
29. Que désire ce monsieur ?
30. Joseph-Constantin Jireczek, le grand historien des peuples slaves, est né en 1854. À peine avait-il terminé ses études à l’Université de Prague qu’il était appelé en Bulgarie, en 1879, après la guerre russo-turque, pour remplir les fonctions de Secrétaire Général au Ministère de l’Instruction publique, à l’époque de la création des services administratifs de la nouvelle Principauté.
Il devint successivement Ministre (1831-1882), puis Président du Conseil supérieur de l’Instruction publique. C’est à lui que la Bulgarie naissante fut redevable de l’organisation de ses Écoles.
En 1884 M. Jireczek fut nommé Professeur d’Histoire Universelle à Prague et en 1893 Professeur d’Histoire des Antiquités Slaves à Vienne.
Son Histoire des Bulgares (Prague, 1876), publiée en même temps en allemand et en tchèque, est encore maintenant le meilleur ouvrage sur les origines, le développement et la décadence de l’ancien Empire Bulgare.
C’est ce livre qui a servi de guide à tous ceux qui ont voulu étudier après lui les luttes héroïques des anciens tsars et en particulier à M. Georges Bousquet pour son Histoire du Peuple Bulgare (Paris, Imprimerie Chaix, l909).
31. Ne pas oublier que les Orientaux pour dire « oui » secouent la tête horizontalement, et au contraire pour dire « non » agitent le chef de bas en haut, en levant en même temps les sourcils, et en faisant claquer la langue.
32. Forme de salut d’un usage courant dans la langue bulgare.
33. Baï Gagno fait allusion à l’époque où M. Jireczek était Ministre en Bulgarie.
34. Le salut à la turque.
35. Soupe très épicée.
36. Mot intraduisible. Il signifie : tout ce qui est piquant, poivré, bref, tout ce qui emporte la bouche.
37. Un lev vaut un franc.
38. L’oka est une mesure turque qui vaut un kilogramme trois cents grammes, environ.
39. Taverne nationale.
40. Exclamation turque chère à Baï Gagno et qui exprime l’enthousiasme.
41. Batak, village voisin de Pechtera, au sud-ouest de Philippopoli, où ont eu lieu des massacres terribles en 1876.
42. Voir plus loin le chapitre : « Baï Gagno en Russie ».
43. Proverbe bulgare qui correspond à peu près à notre : « Qui se ressemble s’assemble. »
44. Ces mots sont en français dans le texte.
45. Littéralement : « où est l’endroit, pour la grosse affaire ? »
46. Entrez.
47. Que voulez-vous, monsieur ?
48. Je voudrais bien déjeuner.
49. Si nous déjeunions tous les trois ensemble !
50. Nom tchèque de la Moldau.
51. Fromage cuit fait avec du lait de brebis.
52. Vieux quartier de Sofia, renommé autrefois pour sa saleté.
53. Vieille chanson patriotique.
54. « Slaninka » signifie lard. Cette finesse est intraduisible en français.
55. Monsieur sait Slaninka, maman !
56. Chanson patriotique, qui date de l’époque de l’insurrection, et dont la musique a été empruntée à la Traviata, de Verdi.
57. Jeu de cartes connu en France sous le nom de « la préférence ».
58. Littéralement : « on secouera son col », geste du plus profond mépris.
59. Ces mots sont en français dans le texte.
60. Littéralement : comme s’il n’avait ni senti, ni mangé l’oignon.
61. Petit tapis que Baï Gagno emporte toujours avec lui en voyage.
62. Paysans des environs de Sofia, les plus arriérés de toute la Bulgarie.
63. Jeu de cartes russe.
64. Le « Café de la Paix » de Sofia.
65. Il veut parler de son patron.
66. L’armagane est le petit cadeau que toute personne qui revient de voyage doit rapporter à ses parents et à ses amis.
67. Tu es russophile.
68. Hymne bulgare.
69. Baï Gagno et ses compagnons ignoraient que, quelques jours avant, le ministère Stamboulov était tombé. Stamboulov ayant offert sa démission au Prince, comme il l’avait déjà fait plusieurs fois, le Prince l’avait acceptée.
70. La Russie.
71. Stamboulov.
72. Littéralement : « Fils du petit profit ».
73. Le tsigane n’est pas en Bulgarie un virtuose en habit rouge : c’est ce que nous appelons un bohémien.
74. Voir le chapitre VI : Baï Gagno chez Jireczek.
75. Voir le chapitre IV : Baï Gagno à Dresde.
76. Littéralement : est-ce qu’une parole peut faire un trou ? c’est-à-dire, est-ce qu’une simple parole a donc tant d’importance ?
77. Littéralement : nous lui couperons la queue.
78. Évêque de Tirnovo, ami intime de Stamboulov.
79. Littéralement : nos actes étaient mieux « cousus-cachés », c’est-à-dire que nous savions mieux nouer une intrigue et en même temps la dissimuler aux yeux de nos adversaires.
80. Le rédacteur de la proclamation fait exprès de mettre une date imaginaire, la réunion du comité n’ayant jamais en lieu.
81. C’est la même figure que celle du pavé de Tours. Un ourgane est une épaisse couverture de lit.
82. Le cafetier.
83. On appelle mézet tout ce qui se mange au café pour entretenir et exciter la soif (saucisson, fromage, cornichons, petits poissons salés, etc.).
84. Gombeau ou corne grecque.
85. Quinze litres.
86. Exclamation populaire.
87. Tu es son maître.
88. Littéralement « au grelot », à cause du bruit que font, dans la prison, les chaînes des détenus.
89. Il entonne le morceau de musique.
90. Le sous-préfet (okoliski natchalnik) est le chef de la police de l’arrondissement. Il est monté et toujours en tenue. Son uniforme diffère peu de celui d’un officier d’infanterie.
91. Cette phrase est en turc dans le texte.
92. C’est en 1876 qu’eut lieu la grande insurrection bulgare. Les paysans résistèrent pendant deux semaines aux troupes régulières turques et aux bachi-bouzouks commandés par Fazla-Pacha. La répression fut terrible. Des villages entiers disparurent dans le feu et le sang.