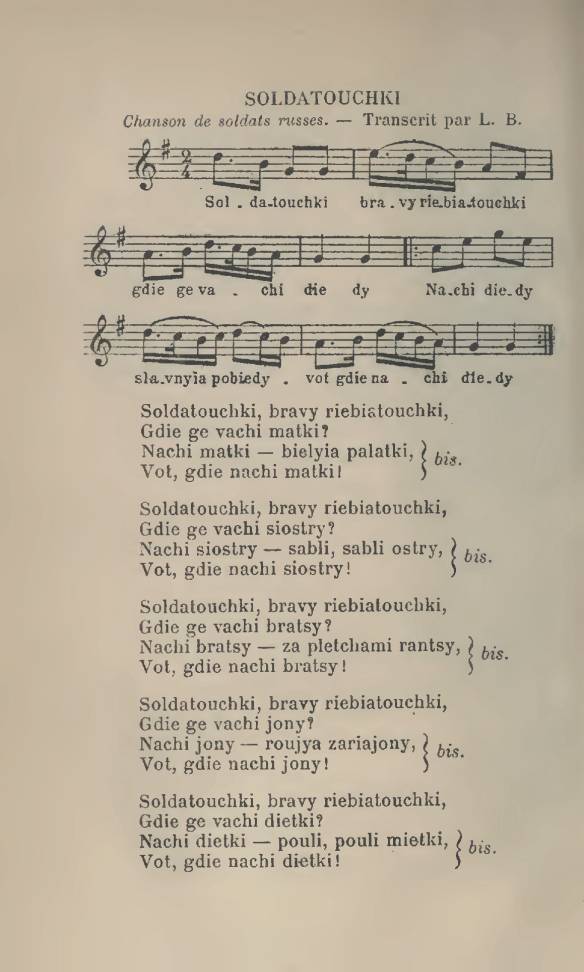
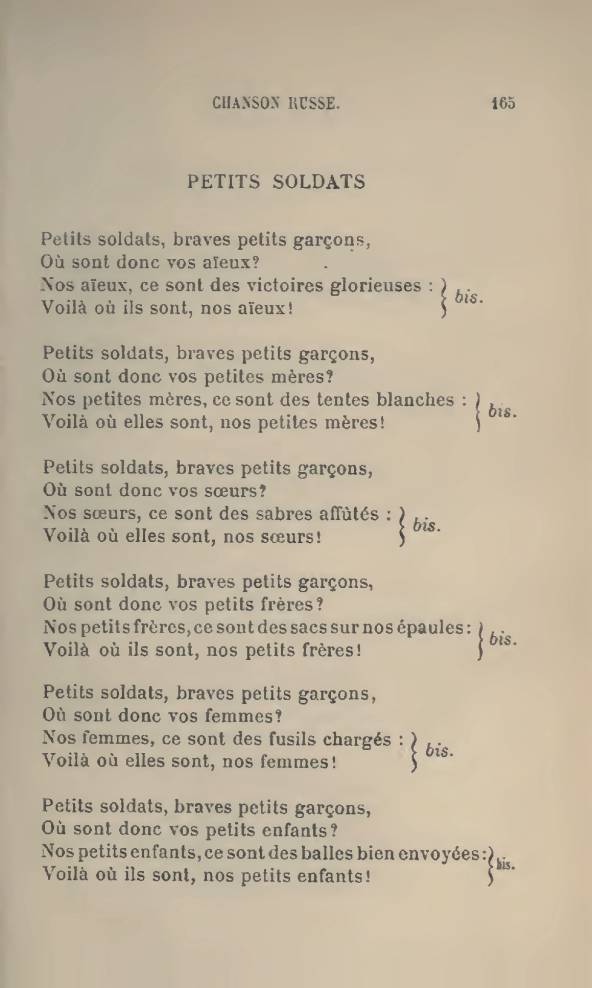
LA BIBLIOTHÈQUE RUSSE ET SLAVE
— LITTÉRATURE RUSSE —
Tatiana Alexinsky
(Алексинская
Татьяна
Ивановна)
1886 — 1968
PARMI LES BLESSÉS
Carnet de route d’une aide-doctoresse russe
1916
Librairie Armand Colin, Paris, 1916
©
Ce texte est publié avec l’accord des héritiers de Tatiana
Alexinksy ; le téléchargement est autorisé pour un usage personnel, mais toute
reproduction est strictement interdite. Texte copié et préparé par Mireille
Salvini,
Un train sanitaire. — Récits de
blessés. — Le départ. — Types d’infirmières.
Notre train
sanitaire est tout à fait une ville roulante, une petite ville provinciale,
avec ses petites affaires, ses petites occupations, ses petits intérêts.
Au milieu du train
se trouve une voiture de première classe pour le personnel ; il en vient
ensuite une de troisième classe, dont une moitié nous sert de salle à manger,
et l’autre de salle de pansement. Puis les voitures servant de cuisine, de
glacière, de resserre pour le linge propre et pour le linge sale ; une
voiture est affectée au logement de nos sanitary,
c’est à dire des infirmiers, des brancardiers, etc. Les sanitary exceptés, tout le personnel est « civil » et
composé exclusivement de femmes. Notre train est un train féministe, ce qui
m’inspire une sorte d’orgueil.
Les compartiments
administratifs et ménagers de notre train sont précédés et suivis des voitures
transportant les blessés : pour les officiers, une voiture de deuxième
classe ; pour les soldats, quatorze wagons à marchandises, aménagés en
ambulances et appelés tieplouchki, et
huit voitures de quatrième classe. Ces dernières sont occupées par les hommes
légèrement atteints ; les quatorze autres wagons sont ceux des grands
blessés. Certains sont pourvus de huit lits mobiles spéciaux avec des matelas
mous, sur lesquels on place les brancards où sont étendus les hommes.
Tout le temps, notre
train est en mouvement. Formé à Moscou, il a quitté son point de départ, au
commencement de la guerre, à l’état embryonnaire, emportant tout le matériel
médical et le personnel, mais n’ayant pas encore son nombre actuel de
voitures : les nouvelles lui furent « accrochées » dans une des
grandes villes proches de la bataille ; et il est devenu ce qu’il est
aujourd’hui : un long « train sanitaire » à trois dizaines de
wagons.
Quand je commençai à
faire connaissance avec mes collègues, je ne fus pas peu surprise, je l’avoue,
en entendant pour la première fois les noms de nos infirmiers : tous ces
noms sont à consonance germanique ; pas un seul Russe parmi eux.
Beaucoup de nos sanitary ont aussi l’aspect typique des
Allemands : les yeux clairs, les cheveux blonds ou roux, les traits mous
et les mouvements lents et méthodiques. Et ce n’est pas une illusion : ils
sont allemands en effet. Ce sont des menonites, c’est à dire des membres d’une
secte évangélique venus en Russie sous la grande Catherine, qui aimait les
philosophes français et les colons allemands. Ils se sont réfugiés chez nous
pour échapper aux persécutions religieuses qu’on leur avait fait subir d’abord
dans les Provinces-Unies, ensuite en Prusse.
La Russie est
vraiment un pays de possibilités illimitées : son gouvernement, qui
poursuivait les sectes chez ses propres sujets, accueillit ces hommes à qui
l’étranger refusait la liberté de conscience. Il leur donna des terres
cultivables dans le midi du pays, il les exempta des impôts, et, respectueux de
leur religion, qui interdit de tuer et de faire la guerre, il les dispensa du
service militaire armé, en les réservant pour les services auxiliaires et
sanitaires.
Comme infirmiers,
ces Allemands russes sont parfaits : très doux pour les blessés, très
ponctuels et très intelligents. Chacun de nous voit bien qu’on peut avoir toute
confiance en eux.
*
* *
Dans chaque tieplouchka, il y a place pour douze
blessés.
Le tieplouchka est un wagon à marchandises
avec un poêle au milieu ; des lits sont placés sur le plancher ou
accrochés aux parois, sur trois étages. Le total des voitures pour les blessés
est, dans notre train, de vingt-trois. Une aide-doctoresse, assistée d’une
sœur, a sous sa surveillance dix wagons avec des « blessés légers »
ou six avec de « grands blessés ».
Moi, je suis chargée
de six wagons de « grands blessés ».
Avant le départ du
train, nous devons interroger chaque blessé, savoir quand il a été pansé pour
la dernière fois et quel est son état.
On monte dans les tieplouchki par des marchepieds mobiles,
qu’on enlève au départ. Il faut se hâter pour parvenir à examiner tous les
blessés avant que le train se mette en marche. Au cas contraire, on risque de
rester dans la tieplouchka jusqu’au
prochain arrêt, parce que les véhicules ne communiquent pas et qu’on ne peut
passer de l’un à l’autre sans descendre. Or, on ne sait même pas quand viendra
la halte : il n’y a pas d’horaire fixe en temps de guerre. Parfois, le
train roule pendant plusieurs heures de suite ; parfois, il s’arrête
toutes les dix minutes.
Pendant que je
courais à la pharmacie, installée dans une voiture de troisième classe, le
train est parti.
J’ai donc dû monter
dans la tieplouchka la plus proche et
y rester. Je refais les pansements si c’est nécessaire, je m’assieds sur un lit
et j’entame la conversation avec les hommes. Chacun me raconte comment il a été
blessé et évacué, me donne ses impressions.
« Ma petite
sœur, dit un des soldats, on nous transporte à N..., et ma famille habite à
V... ; notre train passera par V... ; permettez-moi d’y descendre. Je
verrai mes parents et puis je viendrai tout seul à N.... »
Je réponds que je
n’ai pas le droit de l’autoriser à quitter le train et que même le médecin en
chef ne peut pas le faire, parce que cela regarde les autorités militaires.
« Il ne me
reste donc qu’à descendre à V... sans permission ? dit le soldat
mi-interrogativement.
— Si je ne peux
pas vous donner la permission, je ne peux pas non plus vous retenir de force
dans ce wagon, lui dis-je. En tout cas, n’oubliez pas que votre lieu de destination
est N.. et, après avoir passé deux ou trois jours à V... chez les vôtres, allez
à N... et présentez-vous au commandement de la place. »
Deux autres blessés
expriment aussi le désir de rester quelques temps à V... pour des raisons
semblables. Je ris et leur dis que tout un wagon de blessés ne peut pas
s’esquiver à V... sans qu’on s’en aperçoive.
Le train s’arrête.
Je passe dans une autre tieplouchka.
De nouveau le pansement, la conversation. Un nouvel arrêt du train, et je suis
dans la troisième voiture. Je les visite ainsi tous les six.
La nuit vient. Très
fatiguée, je termine mon travail et je vais au wagon-salle à manger. Mes
collègues sont déjà là, et nous nous mettons à table : il est l’heure de
dîner.
*
* *
La gare de
V... ; je descends sur le quai. Deux des blessés qui peuvent marcher
descendent aussi.
Une foule
d’habitants de V.. les entoure : des vieilles femmes, de jeunes garçons,
des ouvriers, des moujiks, des employés de chemin de fer. Ils interrogent les
blessés : D’où viennent-ils ? Contre qui se sont-ils battus ?
Quel air ont les Allemands, et sont-ils braves ? Chaque soldat répond à sa
manière. Il y en a qui admirent la préparation technique des Allemands :
« Savez-vous comment ils construisent leurs tranchées ? Une
automobile traîne une charrue qui creuse une tranchée d’un seul coup, une
tranchée telle qu’on y est bien protégé contre les shrapnells et les obus. Et
nous ? Nous ne creusons qu’avec une petite bêche. Il nous est très
difficile de les vaincre. »
La foule écoute ces
paroles avec tristesse, la tête basse. Une vieille femme essuie des larmes.
Elle songe sans doute à son fils, qui est allé combattre cet ennemi si
puissant.
Un autre soldat ne
partage aucunement l’avis pessimiste de son camarade. Il n’a que du mépris pour
les Allemands.
« Ils pourront
faire durer la guerre autant qu’ils voudront et rester dans leurs tranchées des
années entières, mais ils ne nous vaincrons jamais. Nous les briserons, bien
sûr, nous les briserons. Nous avons déjà brisé les Autrichiens. Quant aux
Allemands, il faut seulement avoir de la patience. Il ne faut pas se hâter de
faire la paix. Il n’est pas difficile de la faire, mais qu’est-ce qui en
sortirait ? Voilà à quoi il faut penser... », disait ce blessé en
pérorant.
Son langage
encourageait visiblement la foule.
*
* *
Le lendemain, vers
midi, nous étions à N.... On déchargeait le train. Je me trouvais sortie de la
gare et aidais à placer les blessés dans les traîneaux, qui les emmenaient aux
hôpitaux en glissant rapidement sur la neige épaisse. Le train contenait quatre
cents blessés ; et leur transport dans les traîneaux dura plus d’une
heure. La population fit aux soldats un chaud accueil. On leur donnait du pain,
des baranki, des pommes, des
cigarettes. Chacun apportait ce qu’il pouvait.
*
* *
Le personnel médical
de notre train compte treize personnes, dont onze femmes. Oui, c’est vraiment
un train féministe.
Le médecin en chef
est une « doctoresse » de quarante ans. Pour l’énergie, elle ne le
cède à aucun homme. Pour l’hospitalité, elle ressemble à une châtelaine :
tous les hôtes trouvent chez elle un bon accueil.
Elle traite bien ses
subordonnés, mais elle a ses petits caprices, ou plutôt ses bizarreries. Elle
surveille étroitement la vie sentimentale des jeunes filles qui travaillent dans
son train et intervient, parfois très maladroitement, toutes les fois qu’elle
soupçonne un commencement de roman.
De temps en temps,
elle leur adresse des discours où elle combat violemment ce qu’elle appelle
avec une sorte de mépris « l’instinct sexuel » et se révolte contre
la « faiblesse » des femmes.
Son androphobie
s’explique peut-être par des raisons personnelles. Elle a divorcé depuis dix
ans. Elle menait avant la guerre une vie indépendante, remplissant un emploi de
médecin dans un zemstvo provincial. Elle a un fils, élève d’un collège. La
guerre déclarée, elle quitta ses occupations habituelles, ses malades, son
fils, et alla où l’on se battait.
Les autres femmes
qui travaillent dans notre train sont pour la plupart de vraies
« intellectuelles » russes, qui ne peuvent pas se satisfaire de la
vie ordinaire dans les coins provinciaux de l’immense empire et cherchent un
débouché à leurs forces morales et à leurs aspirations sociales. La guerre les
attire, comme faisaient précédemment toutes les luttes et les souffrances du
peuple.
Une de mes collègues
est venue chercher un salutaire oubli de ses malheurs : elle a perdu son
fils, qu’elle aimait follement, et son mari, qui était pour elle non seulement
l’homme aimé, mais un ami et un camarade véritable.
Une autre, encore
jeune, a déjà réussi à passer une dizaine d’années à la campagne comme
maîtresse d’école. Elle cultivait le champ de l’instruction populaire dans des
conditions très désavantageuses, parmi une population grossière et illettrée,
sous la lourde autorité de la bureaucratie et de la police. Elle est aigrie et
dure, et la première impression qu’elle fait n’est pas bonne. Mais, quand elle
soigne les blessés, le vrai fond de son âme s’aperçoit, et à travers un ton
volontairement rude, brille une parole de caresse, un sourire d’amour, dont
elle encourage ceux qui souffrent :
« Il n’y a pas
de quoi gémir ! Aie de la patience pour une petite minute ! ça te
fait mal, mon pansement ? Mais ça te guérira tout de même, n’est-ce
pas ? »
Et elle le regarde à
travers ses lunettes comme si elle voulait lui demander pardon....
Une troisième sœur
est maîtresse d’école de village, elle aussi. Elle a connu la misère et les
labeurs. Son vieux père habitait un village distant de dix verstes. Elle
l’aimait beaucoup. Elle voulait le voir le plus souvent possible.
Mais, n’ayant pas
d’argent pour prendre une voiture, elle allait le retrouver plusieurs fois par
semaine, en fille pieuse, à pied, malgré la boue et les intempéries.
« Je mets mes
pieds dans de grosses bottes de moujik et je vais voir mon père. Je me suis
accoutumée à marcher longtemps », disait-elle, comme pour s’excuser, quand
elle me faisait part de son rêve secret : s’engager comme volontaire dans
l’armée active.
Elle n’est venue
dans notre train que pour être plus près de la bataille et se faire enrôler, à
la première occasion, dans un régiment qui se bat, devenir soldat et partager
le sort des soldats.
Elle a passé une
moitié de sa vie au milieu des paysans, à élever leurs enfants. Et, maintenant
qu’ils sont devenus soldats, elle veut continuer à être avec eux et parmi eux.
Heureusement, son
désir sera bientôt exaucé.
En route pour la Galicie. — Une engagée
volontaire. — Le bon colonel. — En route vers les positions. — Un bombardement.
— Arrivée à Pétrograd.
Notre
train est envoyé à D... en Galicie. Pour y arriver, nous devons traverser le
San. En nous en approchant, nous rencontrons beaucoup de trains
militaires ; un échelon après l’autre nous dépasse rapidement. Ils amènent
des renforts : une grande bataille se développe en ce moment au-delà du
San.
Quand un train
militaire nous dépasse, le nôtre s’arrête. Nous mettons la tête aux fenêtres et
crions notre salut aux soldats, qui nous répondent amicalement. Aux
croisements, les trains militaires stationnent parfois à côté du nôtre. Les
officiers sautent des wagons et montent chez nous. Nous leur offrons du thé, du
café, des douceurs. Mais ce n’est pas cela qui les attire.
« Nous sommes
heureux de passer quelques minutes dans un milieu qui nous rappelle la
famille », nous disent-ils.
Parfois, ils n’ont
pas le temps d’avaler une gorgée. Le clairon sonne, et ils se précipitent vers
leur train, abandonnant le verre de thé encore plein et notre salle à manger,
si confortable.
Durant cette
journée, beaucoup d’officiers de divers échelons nous ont rendu visite.
Un groupe de tout
jeunes gens, ayant remarqué le café et le saucisson sur la table, n’a pu
retenir un sourire enfantin.
« Ne vous gênez
pas, je vous en prie, soyez comme chez vous : prenez du saucisson, dit une
de nos sœurs. Quant au café, nous allons le réchauffer tout de suite. »
Le plus jeune coupe
des tranches de saucisson. Le café fume. Mais, hélas ! le clairon appelle
déjà, et nos hôtes s’envolent.
« Vous
régalerez mon frère à ma place, nous crie l'un d’eux. Il arrivera par le
prochain train. »
Les trains passent
l’un après l’autre. Ils apportent des nouvelles inquiétantes. On dit que les
Autrichiens auraient pris l’offensive et que les Allemands auraient jeté des
troupes du nord sur le sud-ouest. Notre armée aurait dû reculer. D..., où nous
allons, aurait été évacuée.
Le personnel de
notre train s’agite.
« Si nous
sommes renvoyés en arrière au lieu de continuer notre chemin, cela signifiera
que les nôtres ont commencé la retraite. »
Cependant notre
train marche toujours en avant, très lentement il est vrai, mais il avance. Des
trains militaires le dépassent à chaque instant.
À la petite gare de
K..., tout près du San, nous nous arrêtons à côté d’un échelon militaire. Les
officiers du régiment qui le constitue passent chez nous une demi-heure. ils
nous paraissent particulièrement intelligents et sympathiques. Notre
« doctoresse » en chef cède aux instances de la jeune sœur qui veut
s’engager et demande aux officiers s’ils consentent à l’admettre dans leur régiment.
La réponse est affirmative. Notre sœur est dans une joie indescriptible. Elle
revêt aussitôt l’uniforme. Ses cheveux, elle les a déjà coupés à Kiev, mais
nous le cachait en se couvrant la tête d’un mouchoir. Elle se présente à nous
travestie en soldat : elle a l’air d’un garçon de seize ans.
Le colonel et le
médecin-major nous promettent de protéger notre jeune collègue et disent qu’ils
sont sûrs que les soldats la traiteront très bien. Le colonel la conduit le
long des wagons de son train pour la présenter à ses hommes, auxquels il donne
ces explications :
« Voilà !
c’est un nouveau soldat, volontaire, Serge S..., qui partira avec vous. Si
quelqu’un ne sachant pas écrire veut qu’on écrive une lettre à sa famille ou si
quelqu’un est blessé et veut qu’on le panse, il n’a qu’à s’adresser à elle....
Ah ! diable ! je veux dire « à lui ». À lui, vous comprenez ? »
Et le colonel
hérisse sa moustache, grise et longue, comme celle de Tarass Boulba dans la
nouvelle de Gogol.
La moustache de ce
colonel est beaucoup plus sévère que son cœur. Il est pour ses soldats comme
une mère. Il sait que, demain, ils vont avec lui à l’assaut des positions
ennemies, d’où beaucoup ne reviendront plus. Il veut qu’ils passent gaîment
cette veillée des armes.
Il commande aux
soldats de quitter les wagons et de descendre sur le quai. Il dit aux musiciens
du régiment de prendre leurs tambourins et leurs accordéons et de jouer des
danses. Il appelle les petites paysannes qui se pressent autour du train et les
invite à danser avec ses hommes. Il n’est qu’onze heures du matin. Mais le bal
improvisé est en pleine ardeur. Les tambourins et les accordéons font retentir
les airs des allègres mélodies de la polka, du kazatchok, du krakoviak.
Les soldats dansent
sous les chauds rayons du soleil. À la fin du bal, ils forment le cercle et
nous chantent quelques chansons en les accompagnant de lents balancements
rythmiques à gauche et à droite.
« Merci !
merci beaucoup ! leur disons-nous. Gardez bien notre petite sœur !
— Ne craignez
pas pour elle. Nous ne la laisserons pas mourir. Nous la retirerons du feu sur
nos bras.
— Êtes-vous
toujours aussi gais ? dis-je aux soldats, en regardant leurs visages
sincèrement joyeux.
— Oui, ma
petite sœur, toujours, quand nous allons mourir. Tu sais, nous allons
directement au combat. Si on doit mourir, on doit mourir gaîment.
— Mais pourquoi
dites-vous ça ? On doit vaincre et non mourir.
— Eh ! ma
petite sœur, la victoire vient par la mort. »
Une des sœurs nous
interrompt :
« Venez vite.
On va prendre une photographie. »
Nous traversons le
talus et nous nous plaçons le long d’un fossé. Les officiers, notre volontaire
tout neuf et la doctoresse s’assoient sur le bord du fossé ; les soldats
et nous, nous les entourons. Ensuite, on photographie les soldats seuls, avec
le joueur d’accordéon et les danseurs au premier plan.
À peine le
claquement de l’appareil a-t-il retenti que la locomotive siffle. C’est notre
train qui va partir. Nous faisons des adieux précipités et sautons dans les
wagons. De grands « hourra » et « au revoir » nous
accompagnent. Suivi des acclamations des soldats, notre train s’éloigne,
laissant derrière lui notre jeune Varia, devenue le soldat volontaire Serge
S....
« Elle ne se
sentira pas mal parmi eux, dit notre doctoresse. Si le colonel traite si bien
ses soldats, il traitera notre Varia encore mieux.... Avez-vous entendu cette
histoire de la boutique que le colonel avait acheté tout entière ? »
Et elle nous raconte
ce qui suit :
« Le colonel se
préoccupe surtout de l’état moral de ses soldats. Un jour, il passait avec son
régiment devant une petite boutique où l’on vendait du tabac, des allumettes,
du sucre, etc. Il y entra et demanda au marchand :
« Pour combien
de marchandises as-tu ici ? »
Le patron le lui
ayant dit, il sortit de sa poche les quelques dizaines de roubles qu’il fallait
pour le payer, puis il cria aux soldats :
« Mes garçons,
j’ai acheté toute la marchandise de cette boutique. Prenez ce que vous
voudrez. »
La doctoresse
continua :
« Pourquoi
gaspillez-vous votre argent ? lui demandai-je. Vous avez des enfants.
— Des
enfants ? Qu’est-ce que ça fait ? Ils ont de quoi manger. Et si je
meurs, les bonnes gens s’occuperont d’eux. Maintenant, mes enfants, ce sont mes
soldats. Demain, nous mourrons peut-être. Et vous voulez que je mette mon
argent de côté ? Non ! Aujourd’hui, nous vivons gaîment ensemble, et
demain je leur dirai : « En avant, mes garçons ! »
Et ils iront avec
moi à l’attaque ! »
La doctoresse se
tut. Et nous nous taisons tous.
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*
* *
Voilà le San. Le
train s’arrête sur la rive même. Nous sortons des voitures. Nous voyons un
autre train qui vient dans le même sens. Les officiers en sautent sans attendre
l’arrêt. Ce sont ceux que nous avons quitté tout à l’heure. Et notre volontaire
est parmi eux.
« En voilà, une
surprise ! Allons à pied par le pont. Le train y passe très lentement et
nous rejoindra de l’autre côté. »
Le pont nous conduit
aux anciennes tranchées autrichiennes.
« Qu’elles sont
solides, ces tranchées ! s’écrie un des officiers. Et les nôtres !
Nous avons passé ces derniers temps dans des tranchées abominables. »
Il raconte que son
régiment se battait dernièrement dans le Nord.
« Après tout ce
que j’ai éprouvé là-bas, je suis devenu fataliste. À côté de moi tombaient des
hommes, et moi, je suis resté sain et sauf. Aujourd’hui même, nous allons à une
mort presque certaine. Nous devons en remplacer d’autres qui sont au feu, et
les plus terribles coups seront pour nous. »
Il ramasse une
douille de shrapnell brisée et continue :
« Oui, on
devient fataliste quand des choses comme celle-ci volent au-dessus de votre
tête. »
Je lui prends la
douille en souvenir. Notre train arrive. Nous faisons signe au machiniste. Il
ralentit et nous montons.
« Au
revoir ! au revoir ! »
Une heure plus tard,
leur train nous dépasse de nouveau, et nous ne l’avons plus revu.
Trois jours après
nous avons reçu la nouvelle que cet échelon a déjà participé à la bataille et
qu’il n’en reste à peu près rien. Vit-elle encore, notre volontaire ?
Vit-il encore, le joueur d’accordéon aux yeux bleus ? Et ce petit soldat
qui dansait si adroitement le krakoviak avec sa jeune paysanne ? Et le
colonel, à la moustache de Tarass Boulba, et les officiers qui nous
accompagnaient, vivent-ils encore ?....
*
* *
À Lublin, nous
arrivâmes pendant le jour. Le train devait y stationner trois heures, nous
avions le temps d’errer dans les rues de la ville. Il y a là de beaux édifices
anciens et des églises. À côté de ces splendeurs de l’histoire et de la
religion, on voit des quartiers sales, avec des maisonnettes étroites et des
boutiques juives. C’est le tableau qu’on rencontre dans toutes les villes de
Pologne, où les descendants de la noblesse catholique voisinent avec la petite
bourgeoisie israélite.
Le train quitte la
gare et se dirige vers les positions. Plus nous nous éloignons, moins nous
rencontrons de civils.
Les soldats, les
officiers, les sœurs, les médecins abondent. Les trains postaux ne dépassent
pas Lublin, et les régions au delà sont coupées du reste du pays et constituent
« la zone militaire ». À grand bruit roulent les trains transportant
les troupes, formés de wagons à marchandises, tous bourrés de chineli grises et de fusils. Les trains
d’approvisionnement les suivent, et, sur leurs wagons à plateformes
découvertes, on voit des roues, grandes et étranges, des canons et des affûts,
des automobiles et des voitures pour les blessés qui me rappellent celle dans laquelle
Charles XII, blessé devant Poltava, traversa la rivière. Deux cents ans se sont
écoulés depuis : tout a changé ; une quantité de perfectionnements
ont été introduits dans la manière de faire la guerre, qui est devenue une
technique ; seules, les voitures pour les blessés restent chez nous les
mêmes, ce qui signifie que les routes restent les mêmes aussi.
À une station avant
Iv..., un officier monte dans notre train. Il a été malade et renvoyé à
l’arrière. Guéri, il retourne au combat et recherche son régiment. Il nous raconte
beaucoup de choses intéressantes sur les opérations qui ont eu lieu sous Iv....
Il dit que, là, les Russes avaient très peu de monde, mais que néanmoins, ils
ne laissèrent pas approcher les Autrichiens. Les engagements furent extrêmement
durs. Un train sur l’autre amenait des renforts presque aux positions mêmes, et
nos soldats sautaient des wagons pour aller immédiatement à la bataille, sans
le moindre repos. L’officier est enthousiasmé du moral de notre armée.
« Nous avons maintenant une armée civile », dit-il, pour qualifier la
composition de l’armée, recrutée parmi les réservistes, « pris à la
charrue », mais se battant admirablement. « Oui, c’est une armée
civile », répète-t-il. Quant à lui, il a l’aspect typique du militaire. Et
cela augmente encore la valeur de son jugement.
En arrivant à Iv...,
nous remarquons que cette place est bien fortifiée. Les abords des forts sont
pleins de soldats prêts à l’action. Tout autour, les réseaux de fils de fer
s’étendent sur un espace infini, tendus en lignes droites, ou se croisant en
nœuds formidables, ou formant des cercles. De la fenêtre de mon wagon, ils me
font l’effet d’une quantité innombrable de filets de pêche d’une longueur gigantesque
et d’un dessin extraordinaire, qu’on a mis à sécher.
*
* *
Notre train opère
comme une grande pompe. Il s’approche de la ligne de combat, se remplit de
blessés, s’éloigne pour les déverser dans les villes russes et retourne vers
les positions pour y enlever les flots de pauvres corps mutilés.
Nous marchons de
nouveau vers les champs de bataille. Nous sommes près de Kh.... La voie ferrée
traverse un pays boisé. Les coups de canon se font entendre. Notre moral n’est
pas bon : nous sommes sur le théâtre même de la lutte. Le personnel du
train s’inquiète. Après une demi-heure de trajet, la locomotive s’arrête :
le sémaphore est fermé. Les détonations deviennent de plus en plus fortes....
Le train s’arrête encore une fois.
« Messieurs,
allons dans le bois cueillir la myrtille, propose quelqu’un : ça sera tout
de même plus gai. »
Nous sommes
descendus. Nous nous promenons près de la voie pour pouvoir sauter dans le
train quand il s’ébranlera.
Pas une seule âme
vivante dans le bois.... Soudain, nous voyons devant nous, dans une éclaircie,
un groupe caché derrière un buisson : deux paysannes vieilles, et un petit
garçon de six à sept ans. Tous tiennent des paniers contenant de la myrtille.
« Voulez-vous
nous vendre cela ? crions-nous aux vieilles.
— Qu’est-ce que
Madame veut de nous ? demande l’une d’elles en polonais.
— Nous voulons
acheter de la myrtille. Combien prendrez-vous pour ce panier ?
— Comment !
Madame nous donnera de l’argent ? demande l’une des vieilles avec
méfiance.
— Oui, oui.
Allons vers le train. Nous avons laissé notre argent là.
— Tu
entends ? On nous donnera de l’argent ! » dit une vieille à
l’autre.
Elle rajuste le
mouchoir sur sa tête, saisit son panier, prend son garçon par la main et nous
suit hâtivement. Mais, avant de parvenir au train, elle s’arrête.
« J’ai peur de
lui, dit-elle en le montrant.
— Mais il n’y a
rien à craindre. Allons, plus vite. Le train peut partir à tout instant. »
Nous montons dans la
voiture et en sortons avec de l’argent, que nous remettons à la vieille, et
avec du pain blanc, que nous donnons au petit. La vieille est visiblement surprise,
mais elle n’a pas le temps de nous remercier. Le train s’en va, et elle reste
sur place, immobile comme une souche.
Le lendemain, vers
sept heures du matin, nous arrivons à la station de R..., et le train commence
à charger immédiatement. Les blessés « légers » viennent à pied. Des
automobiles nous amènent de grands blessés qu’elles sont allées chercher
presque sur la première ligne ; elles les y ont reçus de mains du
« détachement sanitaire volant », qui travaille dans les tranchées.
D’autres autos évacuent le « point de pansement d’avant-garde » qui
se trouve à cinq verstes des positions.
On nous autorise à
aller en auto au « point de pansement » pour recueillir des blessés
sur place.
Nous partons par une
route vicinale, le long des champs et des villages. Le blé n’a pas été
moissonné. Par-ci, par-là, des soldats fauchent l’herbe et l’avoine et en
bourrent des sacs. Nous rencontrons des groupes : cinq, sept, dix
personnes, des vieillards, des femmes jeunes et vieilles, des enfants. Ce sont
des fugitifs. Ils ont quitté leurs foyers, et ils vont devant eux. Parfois, un
chariot les suit, traîné par un cheval ou une vache et portant des enfants ou
quelque pièce du pauvre mobilier paysan.
Le lieu du combat
n’est pas très éloigné. Un aéroplane ennemi évolue du matin jusqu’au soir. Le
jour même de notre arrivée à R..., deux bombes furent jetées par lui, dont une
frappa une chaumière habitée par une famille de paysans. Une autre tomba sur
une maisonnette où était installé le détachement sanitaire volant. Elle arracha
une partie de la bâtisse, et on dut déplacer le détachement. D’autres bombes,
tombant sur la route, tuèrent un soldat et un petit enfant et blessèrent
grièvement une vieille femme. Les paysans se sont enfuis où ils ont pu.
Les coups de canon
ne cessent pas. C’est notre artillerie lourde qui tire.
Notre automobile,
après avoir traversé un pont, s’arrêta. D’autres automobiles étaient déjà là.
« Ici se trouve
le point de pansement, dit le chauffeur en indiquant une petite maison. On l’a
installé aujourd’hui seulement. Son ancien local a été détruit par une bombe.
Entrez : il y a là un médecin. »
J’entrai. Le
médecin, déjà âgé, était assis tranquillement sur un banc et examinait un
soldat.
« Comment donc
cela t’est-il arrivé ? Raconte-moi ! lui criait-il.
— Eh bien,
notre convoi part. Tout va bien, tout est calme. Mais, voilà, une bombe vient
de l’aéroplane et éclate. Ceux qui marchaient en avant ont eu du mal. Quant à
nous, nous n’avons pas souffert. Moi seul suis devenu un peu sourd.
— Ferme le nez avec
ta main, ferme la bouche et souffle ! lui cria le docteur.
— Sourd !
dit-il, s’adressant à moi. Eh bien, mon cher, reprit-il, prends ce
billet : avec lui, on t’enverra à l’hôpital, et, de là, tu rentreras
peut-être chez toi. C’est bien possible ! cria le médecin.
— Pourquoi
dois-je aller à l’hôpital ? Je me porte bien. Je ne veux pas retourner
chez moi. Je veux rentrer à mon régiment, protesta le sourd.
— On verra plus
tard, mon cher, » dit le médecin....
Puis, s’adressant de
nouveau à moi :
« Vous avez
devant vous un cas touchant, et il n’est pas unique. Il arrive souvent que les
soldats ne veulent pas retourner chez eux. On s’habitue à la guerre. Bientôt
nous nous habituerons tellement que nous y adapterons toute notre existence.
Nous habiterons toujours les tranchées, nous y élèverons nos enfants.
— Qu’est-ce que
vous dites, mon docteur ? fis-je.
— Je dis qu’on
ne doit pas perdre la tête, et nous ne la perdons pas. Hier, on nous a jeté une
bombe dans la maison. Aujourd’hui, nous nous sommes installés dans une autre. »
L’apparition d’un
soldat interrompt notre conversation.
« Votre
Noblesse, dit-il au médecin, on annonce par téléphone que deux officiers sont
tués. On demande si on doit amener leurs corps ici ou les laisser là.
— Dis qu’on les
amène ici. »
Le médecin me dit
encore :
« À cinq
verstes de nous sont les positions de première ligne. Un détachement sanitaire
d’avant-garde y travaille. »
À ce moment-là, on
l’appelle pour qu’il donne des instructions concernant les blessés qu’on doit
envoyer à notre train. Je les accompagne. Nous dépassons une foule de blessés
qui « peuvent marcher ». Les uns s’appuient sur un bâton ;
d’autres soutiennent leurs camarades, quoique atteints eux-mêmes. Les têtes,
les bras et les pieds bandés, en chineli
sales et trempées de sang, ils suivent la route. Autour d’eux, des récoltes
abandonnées, des coups de canon sans interruption et les petits nuages blancs
des obus qui éclatent....
Le gigantesque
baraquement devant lequel s’est arrêté notre train était destiné probablement à
abriter les produits de l’agriculture paisible. Maintenant, c’est la guerre qui
le remplit d’épaves....
Il est déjà cinq
heures du soir. Nous nous empressons de charger le train. Mais on nous amène
toujours de nouveaux blessés.
« Voilà !
il est encore une fois là ! » crie-t-on autour de moi.
Je lève les yeux et
je vois qu’un aéroplane dessine des cercles au-dessus de notre train. Une
seconde, et il ne restera rien de nous : telle est ma pensée ; mais
elle est oubliée tout de suite, car le travail ne me laisse pas de loisir.
Notre batterie tire
sur l’aéroplane et le poursuit. Un coup ! Tous attendent pour savoir s’il
a porté.
« Eh ! il
a été manqué de peu ! » disent, avec un soupir de regret, les
infirmiers et les blessés.
L’aéroplane fait un
rapide virage et s’envole ; mais, une heure après, il apparaît de nouveau
au-dessus de la gare. On continue d’amener des blessés. Les infirmiers nous
appellent de tous les côtés : « Une hémorragie ! »
crient-ils. Les blessures sont pour la plupart causées par des shrapnells.
Elles ont des lèvres déchirées et saignent abondamment. Le travail continue
jusqu’à la nuit noire.
Enfin notre train
est bien rempli. Nous partons, cédant la place à un autre, qui prendra ceux qui
restent.
*
* *
Les blessés que nous
transportons cette fois sont des soldats de la garde impériale. Ce sont des
privilégiés qui doivent être amenés directement à Pétrograd, où les dames du
monde les soigneront.
Le trajet jusqu’à
Pétrograd dure neuf jours. Les voies sont encombrées. Les arrêts sont longs.
Nous devons souvent céder le pas aux trains militaires. Le nôtre devient un
véritable hôpital. Nous pouvons travailler sans hâte, ayant encore beaucoup de
temps avant d’arriver à destination. Nous surveillons attentivement nos
patients. On craint le choléra.
Pendant ces neufs
jours, nous nous sommes étroitement liés avec nos blessés. Ils nous racontent
toutes leurs douleurs et toutes leurs joies. Parlant des échecs de notre armée,
ils nous consolent en déclarant que les Allemands seront, sans aucun doute,
battus par les Russes. Ils imputent notre défaite momentanée à la
« ruse » des Allemands.
« Depuis
quarante ans, ils préparaient la guerre. Ils ont adapté toutes les usines et
les fabriques aux industries de guerre. Ils ont fait des lâches de tant de gens
honnêtes.
— Comment ?
demandons-nous, ne comprenant pas.
— Oui, ils
achètent des gens et en font des lâches, des traîtres, qui leur vendent les
plans. Quant à nous autres, Russes ou Français, nous ne le faisions pas. Et,
tout de même, nous les vaincrons. Notre esprit est plus fort.... Mais c’est la
Belgique qui est vraiment malheureuse. Un si petit pays !... »
Parfois, ils nous
parlent d’eux-mêmes et de leurs proches. Un soldat ayant le pied gravement
endommagé me demande si on lui coupera la jambe et ajoute :
« Je ne crains
pas de retourner chez moi, même sans ma jambe. Ma femme, Macha, c’est une femme
remarquable. Elle m’a dit, quand je suis parti : « Même sans bras et
sans jambes, mais reviens chez moi. Il me suffira de contempler tes yeux. »
C’est une femme remarquable, ma chère Macha. Nous nous sommes mariés par amour.
Mon père et ma mère me disaient : « Pourquoi épouses-tu une fille
sans dot ? » Mais nous ne leur avons rien demandé. Nous avons
travaillé autant que nous avons pu. »
Un autre me raconte
qu’actuellement il pense souvent à Dieu. Combien de fois a-t-il cru qu’il
serait tué, mais a échappé ! En des moments pareils, il croyait en Dieu.
« Ne pense pas,
ma petite sœur, que ce soit par crainte de la mort. Non, je ne la crains pas du
tout. Notre guerre est juste. Personne ne peut se dérober à elle. Donc personne
ne peut éviter la mort, si elle est écrite dans sa destinée. »
Notre conversation
tourne insensiblement vers Tolstoï et sa doctrine. Le blessé a lu quelque chose
de lui et sait ce qu’il pense de la guerre.
« Savez-vous
que la fille de Tolstoï et son exécutrice testamentaire, Alexandra Lvovna,
travaillent aussi dans un train sanitaire ? lui dis-je.
— Non, je ne
l’ai pas encore appris. Mais pourquoi pas ? Cela me prouve encore plus que
notre guerre est juste. Ce n’est pas nous qui l’avons commencée. La fille de
Tolstoï a sans doute la même opinion que son père sur la guerre. Et, cependant,
elle est partie pour nous porter secours. Toutes les guerres ne se valent
pas. »
Un blessé me montre
un carnet où il notait tout ce qu’il avait vu et éprouvé, la vie dans les
tranchées, les heures de bataille.
« J’enverrai ce
carnet à ma famille pour qu’on sache chez moi ce que nous avons supporté en
combattant les Allemands. »
En arrivant à
Pétrograd, nous échangeons de chaleureuses paroles d’adieu avec nos patients.
Ils ont apprécié notre travail et nos soins. Ils nous donnent leur adresse et
nous prennent la nôtre. Un des blessés me dit :
« Ma petite
sœur, permettez-moi de vous remercier publiquement par l’intermédiaire d’un
journal. J’ai un frère qui travaille au... (il nomme un quotidien). C’est avec
un grand plaisir qu’il parlera dans son journal de vous et de ce que vous avez
fait pour nous. »
Ce naïf désir me met
en un grand embarras et même m’effraie. Le journal qu’il a nommé est un organe
de la droite antisémite et réactionnaire, tandis que je suis socialiste. Mes
camarades seraient bien surpris s’ils lisaient mon éloge dans cette
publication. Je prie mon blessé de se borner aux remerciements verbaux et de ne
pas me faire de réclame dans un journal si... important.
Nous voici à
Pétrograd. Notre arrivée provoque un incident comique. Comme nous amenons des
soldats de la garde impériale, une foule de « chefs » viennent à la
gare assister à leur débarquement. Il y a des dames du monde, dont quelques
unes ont l’aspect des baronnes baltiques.... Tout cela serait peut-être très
imposant, mais un mot imprudent prononcé par notre doctoresse gâte la cérémonie.
Avant de commencer
le déchargement, le médecin en chef du train fait un rapport aux autorités du
point d’arrivée.
« N’avez-vous
pas eu des cas de maladies suspectes durant le voyage ? demande un des
généraux.
— Nous avons
descendu à une des gares intermédiaires deux malades suspects de
choléra », répond tranquillement notre doctoresse.
Elle n’a pas encore
terminé cette phrase que tous les gens du monde qui se trouvent sur le quai
manifestent une inquiétude extraordinaire. Les dames et diverses autorités
s’évaporent. En vain notre doctoresse leur crie qu’il n’y a pas de cholériques
dans le train, que tous les termes d’incubation sont déjà passés, que tous les
blessés se portent bien. Personne ne l’entend.
« On a amené à
Pétrograd un train où il y a le choléra ! » crie-t-on dans
l’agitation.
Nous, nous regardons
ce spectacle sans pouvoir cacher nos sourires.
« Ma sœur, me
dit un officier très chic, comment pouvez-vous apporter le choléra ici, à
Pétrograd ? »
Je lui
réponds :
« Ce n’est pas
nous qui l’avons apporté ici, c’est votre propre imagination. »
Il me regarde d’un
air déconcerté.
Les personnages
venus à la gare pour nous saluer ont disparu complètement. Pendant une
demi-heure, nous restons sans rien faire. Enfin on nous donne l’ordre de
commencer le déchargement par les deux wagons d’où nous avons descendu deux
malades suspects en cours de route. Avec des précautions exagérées, on en retire
les blessés et on les emporte. Ensuite, on décharge les autres voitures.
Le travail terminé,
je veux remonter dans mon compartiment, mais une sœur court après moi, pâle et
troublée.
« Ma sœur, vous
êtes de ce train-ci ? me demande-t-elle.
— Oui, ma sœur.
— Vous avez
amené chez nous un homme malade du choléra. Nous l’avons trouvé. »
Je vais avec elle
voir le « cholérique ». C’est un de mes blessés, qui s’est porté
particulièrement bien pendant tout le voyage.
« On me prend
pour un cholérique, me dit-il. C’est parce que j’ai mangé une petite pomme qui
n’était pas mûre. Et ça me coule du ventre. »
Je rassure la sœur
avec beaucoup de peine, et je m’en vais.
Tout notre personnel
se rassemble dans la salle à manger. Nous nous rappelons les détails de la
« réception » solennelle qu’on nous a préparée dans la capitale. Tout
le monde rit.
« C’est amusant
pour vous, mais pas pour moi, nous dit notre doctoresse. Demain, je devrai me
présenter aux autorités sanitaires et leur prouver, encore une fois, que je
n’ai pas amené le choléra à Pétrograd. »
Nous encourageons
notre aimable chef en jupons et nous passons la nuit au travail en
commun : réunies autour d’une table, nous, les onze femmes composant le
personnel du train, nous faisons un rapport que notre doctoresse remettra
demain aux autorités.
Le matin, elle part,
assombrie ; mais elle revient toute rayonnante.
« On a fait un
examen bactériologique de tous les blessés suspects. On n’a trouvé aucun cas de
choléra. On m’a remercié même pour le bon état des blessés »,
raconte-t-elle.
Tout est bien qui
finit bien. On nous donne l’ordre de repartir. Nous allons à Brest par Moscou
et Smolensk.
Une permission de 24 heures. — La jeune
révolutionnaire. — À Moscou. — L’arbre de Noël. — Des soldats affamés. — Les
blessés russes et les soldats autrichiens.
« Voulez-vous
me donner une permission de vingt-quatre heures ? dis-je au médecin en
chef. Je voudrais aller à Moscou pour revoir mon enfant. »
La permission n’est
pas difficile à obtenir, parce que notre train doit rester pendant quelques
jours à Brest pour y recevoir des réparations ; et une heure après je suis
déjà dans le train qui va de Brest à Moscou. Parmi les voyageurs qui se
pressaient devant les voitures de troisième classe, il y avait deux soldats
blessés. Je fends la foule, parviens jusqu’à eux et les aide à monter dans le
wagon. Ils marchent avec beaucoup de peine ou, pour parler plus exactement, ils
ne marchent pas, ils se traînent comme des chiens écrasés par une roue sur la
chaussée. Cependant nous avons pu monter le marchepied tous les trois et entrer
dans le wagon, où je leur ai réservé des places. Le moins malade s’est couché
sur le banc supérieur ; l’autre, sur l’inférieur. Je me suis placée en
face.
« Pourquoi
voyagez-vous tout seuls, sans infirmiers ? Vous êtes trop faibles pour
faire cela.
— Ma petite
sœur, répond celui qui est couché en haut, nous sommes de votre train
sanitaire. Nous nous sommes enfuis du point d’évacuation sans permission. Notre
convoi devait être envoyé dans une ville de province ; et ma femme habite
Moscou. Nous nous sommes mariés en mai, juste avant la guerre. Je veux la
revoir. Je m’ennuie sans elle. Vous me donnez tort, ma petite sœur, n’est-ce
pas ?
— Non, je vous
comprends bien. Je n’ai pas revu mon fils depuis quelques semaines et je suis
déjà impatiente de le rejoindre. Et vous, vous n’avez pas revu votre femme
depuis des mois entiers. Je vous comprends bien. Mais vous risquez d’être puni
pour vous être absenté sans permission.
— À qui
peut-elle nuire, mon absence ? Je ne me suis pas enfui du combat.
Oh ! là-bas, sur la ligne, nous tenions bien. Mais, à présent que je suis
blessé et ne suis bon à rien, je peux faire une petite promenade. Je verrai ma
femme. À qui ça peut faire du mal ? »
Un contrôleur passe.
Je lui présente mon billet.
« Et ces
hommes, où vont-ils ?
— Ils vont à
Moscou, à l’hôpital. »
Le contrôleur s’en
va. Mes échappés deviennent gais. Ils se préparent à dormir. Ils me prient de
prendre leurs chineli pour les
étendre sur le dur banc de bois qui me sert de lit. Mais je ne veux pas abuser
de leur générosité. Pendant longtemps, ils restent sans pouvoir s’endormir et
changent de position, en retenant des plaintes : leur corps endolori est
devenu sensible.
Le matin, nous
prenons le thé ensemble, et ils me racontent leur vie. L’un d’eux a beaucoup
souffert déjà avant la guerre. Au régiment, il eut des différents avec un chef
et fut envoyé dans un « bataillon de discipline », où la vie est
dure. Il était en Sibérie, et là il se rencontra avec la jeune Maroussia S...,
terroriste bien connue. Il y a déjà plus de dix ans, étant au lycée, elle tua à
coups de browning un fonctionnaire provincial qui infligeait aux paysans le honteux
supplice des verges. Elle fut arrêtée par deux subordonnés de ce fonctionnaire,
qui la violèrent. Peu après, tous les deux furent exécutés, à leur tour, par
des terroristes, camarades de Maroussia S.... Quant à elle, elle fut condamnée
à quelques années de travaux forcés et à la déportation perpétuelle en Sibérie.
L’histoire de la
jeune révolutionnaire a provoqué une grande impression sur mon compagnon de
voyage.
« Maintenant,
je n’accepte rien sans critique, dit-il pour résumer sa mentalité. Je doute de
tout. Mais, vous savez, je bénis cette guerre. Je ne sais pas pourquoi, mais je
suis sûr que, si nous écrasons le militarisme allemand, ce sera un bonheur pour
tout le monde, et pour la Russie. »
L’autre blessé ne
ressemble point à son camarade. Il est tout à sa personne. Il aime la vie,
telle quelle, il aime la nature, le soleil, la lumière. Son mariage n’est pas
ordinaire. Il a rencontré chez sa sœur une camarade de cette dernière. La fille
était enceinte. Son amant, père de l’enfant qu’elle attendait, l’avait
abandonnée. Le premier sentiment que cette fille lui inspira fut la pitié et le
désir chevaleresque de la protéger. Puis ce fut l’amour.
« Je deviens
amoureux d’elle et je l’épousai.
— Et elle, elle
vous aime aussi ?
— Oh !
oui !... Ah ! si je pouvais seulement la revoir d’un coup
d’œil !...
— Vous la
reverrez bientôt. Nous sommes presque à Moscou. Mais je crains qu’on ne vous
reçoive pas dans un hôpital à Moscou et qu’on vous oblige à rejoindre votre
convoi.
— Non, ma
petite sœur. J’irai directement à l’école technique, où je servais avant la
guerre. J’y étais garçon de laboratoire. Dans le bâtiment même de l’école se
trouve maintenant un hôpital. Là, on me connaît et on me permettra de rester.
— Moscou !
clame la voix élevée du conducteur.
— Donnez-moi
votre adresse », dis-je au blessé.
Il me donne le
numéro de téléphone de l’école et me prie de lui parler demain.
« Et ceci est
pour vous, ma petite sœur. Lisez cela. »
Il m’offre sa
photographie avec une dédicace touchante. Je lui promets de lui envoyer la
mienne en souvenir de notre rencontre.
Je soutiens par le
bras celui qui est le plus faible, et nous sortons. Le quai est
interminablement long. Le blessé gémit, en se traînant vers la sortie, et se
mord les lèvres pour ne pas crier.
Les sœurs et les
représentants de la Croix-Rouge en permanence à la gare nous arrêtent et
proposent à mes compagnons de s’occuper d’eux. Mais ils ont peur d’être retenus
et renvoyés immédiatement au lieu d’où ils se sont « enfuis » :
aussi l’apparition de toute personne plus ou moins officielle les remplit-elle
d’inquiétude. Enfin, nous sortons de la gare. J’appelle un cocher et je les
aide à s’asseoir dans la voiture, ce qu’ils ne peuvent faire qu’avec beaucoup
de peine. Les passants s’arrêtent et les regardent avec compassion. La voiture
s’en va. Dans quelques minutes, l’un d’eux verra sa femme. Et l’autre ?
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quand je suis
arrivée chez moi, mon petit garçon était déjà au lit et dormait. Ses boucles
blondes encadraient ses joues roses.
J’ai pris les
numéros du journal qui ont paru pendant mon absence de Moscou et je les ai
parcourus dans la chambre de mon enfant.... Où prennent-ils tout ce qu’il
écrivent sur la guerre, ces journalistes. La véritable guerre ne ressemble pas
beaucoup à celle qui est « relatée » dans la presse.
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mon garçon se
réveille pendant la nuit et se réjouit de me trouver près de lui.
« Maman, quand
es-tu venue ? Les petits soldats t’ont laissé aller chez moi, n’est-ce
pas ? Tu resteras ici jusqu’à l’arbre de Noël ? »
Nous causons
longtemps et nous ne nous endormons qu’à l’aube.
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La journée passe
vite. Il faut retourner « là-bas ». Avant de partir, je demande par
téléphone à l’école si les deux blessés ont été reçus à l’hôpital.
« Non, me
répond-on. Il n’a pas été possible de les recevoir, parce qu’ils n’avaient pas
de papiers. On les a mis à la disposition du commandant de la place. »
Mais tout de même,
l’autre a revu sa femme.
Pendant que je
retourne à B..., j’ai pour compagnon de voyage un ouvrier. Comparant la guerre
actuelle à la guerre contre le Japon, il me déclare :
« Cette fois,
nous devons vaincre, car la France est avec nous. »
Qu’a-t-il voulu dire
par là ? Devons-nous vaincre grâce à l’aide de la France ? ou bien,
la victoire étant nécessaire à la France, devons-nous l’avoir aussi ?
*
* *
Très tard dans la
soirée, nous passons par la gare de Sk... C’est un grand et beau bâtiment, qui
a été incendié. Les Allemands y sont demeurés trois semaines, et il n’en reste
que les murs avec les baies des fenêtres. Le toit s’est écroulé dans le feu.
Les murs blancs, noircis par la fumée, paraissent, sous la lune, bleuâtres et
funèbres. Je m’étais approchée des murs, et je sentais encore une odeur de
brûlé, quoique l’incendie remontât déjà à cinq semaines.
« Ma petite
sœur, ma petite sœur, faites attention ! » fit une voix tout près de
moi.
C’était une
sentinelle.
« Les pierres
tombent du mur, ma petite sœur. Un jour que je montais la garde, une pierre
s’est détachée, et j’ai failli recevoir un bon coup. »
À la gare, il n’y
avait que le personnel de notre train, les sentinelles et deux employés. Tandis
que je parlais avec la sentinelle, apparut sur le quai une foule de paysans, la
bêche sur l’épaule.
« Quels sont
ces gens-là ? D’où viennent-ils ?, demandai-je à la sentinelle.
— Ce sont des
paysans polonais des villages voisins. Ils creusent des tranchées du matin
jusqu’au soir. Bonnes tranchées ! L’Allemand n’y parviendra pas
facilement. »
Les Polonais
s’arrêtent et nous regardent avec curiosité, la sœur qui m’accompagne et moi.
Je voudrais causer avec eux, mais la conversation ne va pas : je ne
comprends pas leur patois, ni eux le russe.
*
* *
Le lendemain, vers
dix heures du matin, nous sommes à O.... C’est le terme de notre voyage. Ici,
nous devons prendre des blessés et charger le train.
C’était la veille de
Noël, style russe. Le jour était ensoleillé, clair et souriant. On avait peine
à croire que, tout près, avaient lieu des combats et que des hommes
s’entretuaient. Mais la réalité s’impose. Dès l’aube, la canonnade retentissait
sans interruption. Depuis longtemps déjà, en avançant vers O..., nous
entendions des détonations ; mais, faute d’habitude, nous ne savions
pas....
Les positions de
première ligne étaient à une douzaine de kilomètres d’O.... La bataille durait
depuis deux jours, et le canon ne se taisait pas.
Nous décidâmes de
porter aux soldats, dans les tranchées mêmes, du pain, du sel, du linge chaud
et des couvertures. L’autorisation reçue, nous nous mîmes en route. on nous
amena un train spécial, composé d’une locomotive et de deux voitures. Nous
partîmes : le chef de gare, le médecin en chef, trois sœurs, cinq infirmiers
et dix soldats de garde. Nous, les sœurs, nous avions emporté, pour le donner
aux soldats, un petit arbre de Noël, fixé dans un pot, nous l’avions décoré de
flocons de coton, de bonbons, de prianiki.
Nous n’avions pas
encore réussi à parcourir une dizaine de kilomètres, quand la locomotive
stoppa. Nous descendîmes des tieplouchki
et remarquâmes un groupe d’officiers près du talus du chemin de fer.
« Les Allemands
se trouvent à vingt kilomètres de distance et poussent leur offensive depuis
avant-hier. Je ne peux pas laisser aller plus loin le train avec le personnel
de la Croix-Rouge : si quelque chose arrivait, j’en serais responsable »,
nous dit un des officiers.
Il fut entendu que
notre train resterait là et que nous irions à pied aux tranchées. L’officier
qui nous accompagne m’offre sa jumelle. Je regarde et, à droite du talus, je
vois des colonnes de soldats qui s’avancent en un long ruban ; plus à
droite, j’en vois encore et encore, marchant en ordre comme une fourmilière
alarmée.
« Qu’est-ce que
c’est cela ? dis-je à l’officier en lui rendant sa jumelle.
— Ce sont les
nôtres. S’il n’y avait pas de brume aujourd’hui, vous pourriez voir aussi les
Allemands. Voilà la direction dans laquelle ils marchent », ajoute-t-il en
avançant le bras.
Nous faisons encore
un kilomètre, en suivant toujours le chemin de fer.
« Voilà les
tranchées ! »
Je vois un trou dans
la terre, non loin du talus. C’est une entrée. Courbée très bas, je pénètre
dans ce trou et je me trouve dans un couloir souterrain, où on ne peut pas se
tenir droit. De la paille est répandue sur le sol. La lumière entre par des
meurtrières, où sont posés les canons des fusils. En face de ces meurtrières,
dans une petite niche pratiquée dans le mur de terre, il y a un poêle ou plutôt
un bûcher au-dessus duquel est disposé un pot avec des pommes de terre. Les
branches d’arbre humides font beaucoup de fumée, qui pique les yeux. On voudrait
s’en aller le plus tôt possible et retourner à l’air pur.
« Vous êtes ici
depuis longtemps déjà ? », dis-je aux soldats.
— Nous nous
sommes retirés ici aujourd’hui, à six heures du matin, après avoir été relevés
dans nos anciennes positions. Nous n’avons ni pain ni sel. Si vous pouviez nous
donner du sel, ma petite sœur ! »
Nous sortons des
tranchées et voyons que notre train nous avait rejoints. Une des sœurs commence
à distribuer aux soldats du linge chaud ; moi, avec notre économe, je leur
donne du pain et du sel. Pendant que l’économe verse le sel, je coupe le pain
en gros morceaux vers lesquels les mains se tendent. La foule grandit autour du
wagon.
« Ma petite
sœur, donnez-moi du pain, donnez-moi ! J’ai déjà oublié le jour où j’ai
mangé pour la dernière fois du bon pain blanc et tendre. Nous n’avions que du
biscuit. »
Je vois devant moi
des centaines d’yeux me fixant dans une attente impatiente et suivant chacun de
mes mouvements.
Je coupe hâtivement
morceau sur morceau. Les hommes les enlèvent rapidement. Un d’eux, ne pouvant
contenir sa convoitise, ramasse les miettes sur le plancher du wagon et les
avale.
Ce spectacle de gens
ayant faim me parut plus pénible que toutes les blessures que j’avais vues.
L’économe se
rapproche de nous.
« Ma sœur, on
ne peut pas les rassasier tous de cette manière. Notre train ne restera pas
longtemps ici. Je vais leur distribuer les pains par compagnie : dix pains
pour chacune. »
J’y consens et
descends du wagon. En causant avec un soldat, je vois qu’il a une baïonnette
autrichienne.
« Voulez-vous
me la vendre ?
— Oui, ma
petite sœur, répond-il avec un air d’indifférence.
— Combien en
voulez-vous ?
— Pouvez-vous
me donner cinquante kopeks ? »
Je lui remets
l’argent et prends la baïonnette.
Il tient l’argent,
le regarde avec la même indifférence. Puis il me dit d’une voix très
basse :
« Ma petite
sœur, donnez-moi du pain pour cinquante kopeks. »
En me voyant changer
de visage et ne comprenant pas pourquoi, il ajoute :
« Je n’en
demande pas beaucoup. Un seul morceau, un petit. Je veux goûter du pain
frais : je n’en ai pas mangé depuis longtemps.
— Donnez-moi du
pain, je vous en prie ! dis-je à l’économe. J’en donnerai à ce soldat
séparément. »
Et je lui présente
un pain :
« Prenez, mon
cher. On ne vend rien chez nous. On donne tout simplement. »
Tout à coup, un
autre soldat se présente. Il est déjà vieux et a l’aspect d’un Tatare. Il
m’offre une poignée de petites pièces de cuivre.
« Du
pain ! Un peu de pain, je vous prie ! », implore-t-il.
Je lui remets un
morceau sans pouvoir lui dire un mot : le sifflet léger de la locomotive
retentit, et notre train s’ébranle.
« Au
revoir ! nous disent les officiers. Il faut que vous partiez sans retard.
Il est dangereux de rester ici. Bientôt nous commencerons l’attaque.
— Au revoir,
petites sœurs ! crient les soldats. Nous partons aussi tout de suite.
C’est dommage que nous n’ayons pas eu le temps de faire bouillir les pommes de
terre avec du sel », disent-ils plaisamment.
Je les regarde et je
m’étonne. Est-il possible que ce soient les mêmes soldats qui nous entouraient,
il y a quelques minutes, fatigués et ne songeant qu’au pain ! Voici le
moment d’aller à la rencontre de l’ennemi, et le courage, la fermeté, leur sont
immédiatement revenus. Que penser d’eux ? Sont-ils ce qu’on appelle des héros ?
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le train marche de
plus en plus vite, et, bientôt nous sommes de nouveau à la gare d’O.... En
quittant ma tieplouchka, je remarque
notre petit arbre de Noël. Nous l’avons oublié ici en allant visiter les
tranchées.
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le soir de cette
même journée, on nous amène des blessés de ces tranchées que nous avons
visitées. Peut-être est-ce une illusion, mais il me semble reconnaître parmi
eux des soldats auxquels j’ai distribué du pain.
Il y a beaucoup de
blessés et beaucoup à faire. Je panse jusqu’à trois heures du matin. Le travail
n’est pas encore terminé qu’on nous apporte un nouveau convoi de patients.
*
* *
Jusqu’ici, j’avais
presque toujours eu à soigner des blessés auxquels on avait fait le premier
pansement au poste de secours d’avant-garde. Mais, cette fois, on nous en a envoyé
directement du champ de bataille, et qui n’ont pas encore reçu de soins médicaux.
La plupart n’ont pas
été pansé du tout. Quelques uns l’ont été par eux-mêmes ou par leurs camarades.
Les plaies ont un
aspect terrible. Ce ne sont pas celles qu’on voit dans les hôpitaux, qui ont
passé par plusieurs étapes et ont été pansées plusieurs fois. Celles-ci sont
remplies de boue et de terre ; au sang coagulé se sont mêlées des
arrachures d’uniforme.
« Pourquoi
avez-vous tant de boue dans votre blessure et sur les mains ? demandai-je
à un homme dont les paumes sont couvertes d’une couche de terre desséchée.
— Nous avons
avancé contre les Allemands, ma petite sœur. Puis nous avons commencé à nous
retrancher. Mais j’avais perdu ma bêche. Et, comme la terre était dégelée, je
l’ai creusée avec mes mains. Je savais bien que je ne ferais pas grand’chose,
mais je travaillais tout de même. Juste à ce moment-là, j’ai été touché.
— Ma petite
sœur ! ma petite sœur ! appelle quelqu’un. C’est votre train que nous
avons vu aujourd’hui. Notre compagnie était de l’autre côté du chemin de fer.
Nous nous étions réjouis de voir une locomotive. Il y avait longtemps que nous
n’en avions pas vu. Les trains ne parvenaient pas jusqu’à nous.
— Ma petite
sœur, commence un autre, quand vous êtes partie de là-bas, notre compagnie a
occupé précisément les tranchées où vous êtes allés. Le soir, nous avons
commencé l’attaque, et j’ai été blessé. »
Les blessés étaient
excités. Ils voulaient parler beaucoup, nous faire participer à leurs émotions.
Je les écoutais attentivement
et les encourageais en les pansant.
Ces hommes qui sont
allés à la guerre, qui ont supporté le froid et les privations en remplissant
leur devoir, les voilà couchés, faibles comme des enfants et attendant avec patience
les soins de la petite sœur.
Pendant tout mon
travail du soir et de la nuit, je n’ai entendu aucun gémissement ni aucun cri.
Seulement, plusieurs hommes ont appuyé la tête au mur et, perdant connaissance,
se sont affaissés sur le plancher.
Le lendemain, de
nouveau beaucoup de besogne. D’autres convois de blessés arrivèrent. Vers midi,
tous les wagons en étaient remplis. Il nous fallait partir, mais les blessés
affluaient toujours. Les ambulances voisines, ayant appris la venue d’un train
sanitaire, nous envoyait du monde en foule. Je savais que, deux heures plus
tard, un autre train sanitaire allait continuer l’évacuation, mais il m’était
pénible de laisser des hommes ici, même pour deux heures.
J’entrai dans la
gare. Les salles étaient pleines de blessés. Au milieu des nôtres, il y avait
des Autrichiens. Les nôtres m’entourèrent, et nous causâmes. Ils me prièrent de
demander aux Autrichiens leur lieu d’origine, s’ils avaient des femmes, des enfants,
des mères, et si leurs femmes pleuraient en leur faisant leurs adieux.
Je posai toutes ces
questions aux Autrichiens très ponctuellement et je traduisis leurs réponses.
« Bien !
bien ! Celui-ci donc a une femme ? disaient les nôtres en indiquant
un Autrichien. Il a trois enfants, et sa femme pleurait quand il est parti pour
la guerre ? Tout à fait comme chez nous, remarquaient-ils, attendris.
— Que veux-tu
ajouta quelqu’un, ce n’est pas de leur propre gré que ces pauvres diables sont
allés à la guerre. On les y a envoyés aussi. »
Cette attitude si
simple et si bienveillante de nos soldats vis-à-vis de leurs ennemis blessés me
troubla. Quand j’étais à Moscou, parmi les civils, je ressentais une sorte de
haine pour eux. Nos soldats donne une leçon à l’ « intellectuelle »
que je suis. Ils me rappellent que je ne suis qu’une « sœur de
charité »...
Les « ennemis ». — Le talent
du Magyar. — Les bonbons.
Tout
le personnel s’est réuni dans la salle de pansement. Nous avons préparé tout ce
qui est nécessaire pour poser les bandages, puis nous allons dans les voitures,
auprès des blessés. Nous devons examiner toutes les blessures, pour séparer
ceux qui sont gravement atteints de ceux qui le sont légèrement et pour savoir
si le pansement est à renouveler tous les jours ou tous les deux jours.
Je travaille
rapidement, aidée d’une infirmière. Nous plaisantons pour détourner l’attention
des soldats de leurs blessures, nous mettons les bandages doucement, et une
bonne atmosphère s’établit.
« Que les
ennemis viennent se faire panser maintenant, dis-je.
— Quels
ennemis, ma petite sœur ? Ils n’ont pas d’armes ! » m’objectent
les nôtres avec reproche.
Un des
« ennemis » est magyar et ne comprend rien ni en français, ni en
allemand, ni en polonais. Nos soldats ressentent une extraordinaire sympathie
pour lui. Ils lui achètent du tabac, lui roulent des cigarettes, lui donnent du
pain. Un d’eux lui change même un billet autrichien de deux couronnes pour
cinquante kopeks.
« Je veux
garder ce billet en souvenir de l’ennemi » explique-t-il.
Comme je les avais
appelés « ennemis », ce nom leur reste. Mais il n’empêche pas nos
soldats de bien les traiter.
*
* *
Le matin, quand je
revins dans la même voiture refaire les pansements, les soldats me
crièrent :
« Ma petite
sœur, notre « ennemi » magyar nous a donné, hier, une représentation.
Oh ! comme on a ri ! Nous n’avons pas dormi avant deux heures du
matin ! Il a montré comment les Russes tirent, comment « eux »
se cachent des « nôtres » dans les tranchées, comment les Russes
poussent leurs hourras et « eux » se rendent, font des signes avec
leurs mouchoirs, la figure apeurée.
— Mais...
attendez un peu ! interrompis-je. Comment avez-vous pu le comprendre
puisqu’il ne parle ni russe ni polonais ?
— Mais il a
représenté tout cela avec des gestes et en faisant une figure effrayée. Nous
avons compris tout. C’était si amusant ! »
Je regardai
« l’ennemi ». Il était assis sur son lit, au troisième étage, et me
contemplait de haut, comme un aigle, sentant qu’on parlait de lui.
« Ma petite
sœur, il est marié, il a un bébé d’un an », continuaient à me raconter les
blessés.
Mais ce qui me plut
surtout, c’est l’entrevue que les nôtres ménagèrent à ce Magyar avec un autre
prisonnier autrichien qui se trouvait dans la voiture suivante. J’étais dans
cette voiture, occupée à panser. Les infirmiers étaient allés chercher le
dîner.
Soudain la porte
s’ouvre, et notre Magyar entre en robe de chambre (dans notre train, on change
les vêtements à tous les blessés), sans coiffure. Un autre blessé, russe
celui-là, l’accompagne :
« Nous l’avons
amené ici, ma petite sœur, pour qu’il puisse voir son camarade. Car ici, il y a
aussi un « ennemi ».
Les blessés russes
qui se trouvent dans ce wagon collaborent énergiquement à l’entrevue des deux
prisonniers et commencent à réveiller l’Autrichien.
« Lève-toi !
Lève-toi ! lui crient-ils. Ton compatriote est ici. »
Les nôtres sont émus
plus que le Magyar lui-même. Ils réveillent l’Autrichien ; mais ce
dernier, encore à demi endormi, ne comprend pas ce qu’on lui veut. Je
n’interviens pas, quoique cet Autrichien comprenne un peu l’allemand. Enfin,
l’affaire a réussi : les deux « ennemis » sourient et,
bienheureux, se regardent.
« Eh bien,
grâce à Dieu, ils sont ensemble », disent les nôtres, tout réjouis.
Mais leur joie ne
dure pas longtemps. L’infirmier vient de la voiture voisine et emmène le
Magyar.
« Le médecin va
me rabrouer. On ne doit pas se promener dans le train. »
Un jour que je
retournais dans mon compartiment après le travail, je fus arrêtée par les
blessés d’une des voitures :
« Ma petite
sœur, il y a chez nous un « Guerman » blessé. Voulez-vous lui
demander s’il se plaît en Russie ? Demandez-lui aussi s’il a une femme et
des enfants.
— Nos soldats
voudraient savoir comment vous vous sentez au milieu des Russes ?
— Pas mal. Mais
ce qui me fait de la peine, c’est que je n’ai pas pu passer la Noël parmi les
miens. Mais les Russes ne sont pas méchants.
Après un moment de
silence, il ajouta :
« C’est la
guerre qui rend les hommes méchants. »
Il se retourna vers
le mur, comme s’il ne voulait pas continuer la conversation.
Je traduisis aux
nôtres les paroles du « Guerman ».
« Que
voulez-vous ! Il a raison. Une si grande fête, et il a dû la passer avec
ses « ennemis ! » disaient les soldats.
*
* *
Nous devons
décharger le train à M... et y laisser tous nos blessés. Nous nous
hâtons : il faut que les blessés soient remis à l’administration
hospitalière dans un parfait état de propreté. Enfin, tout est fini. Je
parcours pour la dernière fois les voitures ; à un des soldats je donne un
morceau de coton, à un autre je mets le bras en écharpe.
Le train ralentit sa
marche. Nous arrivons à M...
« Nous sommes
arrivé, ma petite sœur ! Je vous souhaite tout ce qu’il y a de bon !
Avec vous, ma petite sœur, je ferais bien volontiers trois mille verstes.
Merci ! merci beaucoup ! »
Voilà ce que
j’entends de tous les côtés.
Je remercie mes
patients de leurs souhaits et je cours vers les tieplouchki où se trouvent ceux qui ne peuvent pas marcher. On les
enlève rapidement, et voilà le train vide. Je vais au « point
d’évacuation » revoir mes patients. On m’a dit qu’ils sont en train de
souper. J’entre dans la salle à manger. C’est un énorme et haut baraquement,
avec trois rangs de table. Une masse de soldats y sont assis. Je ne peux pas
reconnaître les miens. Mais une voix vient du coin de la salle :
« C’est la
petite sœur qui nous soignait dans le train. Notre petite sœur est
venue ! »
Je regarde. Les
« miens » sont là et me sourient avec une mine accueillante. Il y a
près d’eux des dames du genre des « bienfaitrices » mondaines. Leur
costume est un mélange de la toilette ordinaire et de l’uniforme des sœurs de
charité ; leur poitrine est ornée de plaques et de chiffres.
« C’est notre
petite sœur, leur expliquent mes patients.
— Ah !
c’est bien, c’est bien, prononce une d’elles d’un ton « protecteur ».
C’est bien qu’il y ait de bonnes sœurs dans le train. »
Je ne sais pas
pourquoi, je ressens une sorte d’irritation contre cette dame et ses collègues.
Mes blessés me
régalent. Ils m’offrent de la soupe, de la kacha, et me demandent où on les
transportera maintenant. Au moment où je m’en vais, un des soldats me tend un
petit bonbon.
« Voulez-vous
manger ça, ma petite sœur ? Une dame m’a donné trois bonbons tout à
l’heure. Un, je l’ai mangé moi-même. Un autre, je l’ai donné à mon camarade. Le
troisième est pour vous. Mangez, s’il vous plaît, ma petite sœur. Si j’avais su
que vous viendriez encore, je les aurais gardés tous les trois pour
vous. »
Il développe le
papier et en tire un petit caramel.
Je sais bien qu’il
est stupide d’être si « sentimentale », mais, en voyant ce paysan
barbu me tendre sa main calleuse avec son « troisième » bonbon, comme
un enfant qui veut partager ses douceurs avec sa mère, une émotion me
saisit :
« Mangez-le
vous-même, mon cher. Vous revenez des tranchées où vous n’avez pas vu de
bonbons depuis longtemps. »
Mais il me regarde
d’un air si suppliant que je ne peux pas refuser.
« Merci !
Je ne mangerai pas votre bonbon, mais je le garderai en souvenir de vous.
— Ma petite
sœur, voulez-vous aussi visiter les « ennemis » ? Ils sont là,
dans ce baraquement, à côté du nôtre. »
J’allai voir les
« ennemis ». Mon Magyar était là, assis sur un lit, avec un autre
prisonnier. Le local était grand, et il y avait beaucoup
d’« ennemis », mais ils s’étaient entassés tous dans un coin, comme
un troupeau sous l’orage et sans berger. M’ayant aperçue, les
« ennemis » qui avaient fait le voyage dans mon train se rapprochèrent
de moi. Je fus très étonnée de voir parmi eux le « Guerman » qui
n’avait pas voulu causer avec moi dans le wagon.
« Permettez-moi
de vous présenter ce monsieur, ma sœur, dit-il, en indiquant un autre
prisonnier, le bras bandé. Il est allemand
aussi, lui ! ajouta-t-il non sans orgueil.
— Je suis très
heureuse de faire votre connaissance, monsieur. Peut-être vous serai-je utile
comme interprète. Voulez-vous demander quelque chose aux sœurs d’ici ? Je
traduirai votre demande.
— Non, merci
bien. Mais, si c’est possible, faites parvenir cela aux autorités. »
Et il me remit deux
lettres.
Je les transmis aux
officiers russes.
Nous nous serrâmes
la main amicalement. Mon Magyar me disait quelque chose en sa langue et
souriait avec aménité, mais je ne comprenais rien.
*
* *
Les wagons de notre
train sont vides, et je m’ennuie. Pendant ces six jours de voyage, je suis
arrivée à m’attacher sincèrement à mes blessés. Que sont-ils ? Je ne le
sais pas ; je ne connais pas même leurs noms ; nous ne nous reverrons
jamais, probablement, mais ce qui m’attire à eux, c’est la douceur de leurs
âmes. Sous l’écorce épaisse de leur rudesse, il existe un trésor de bonté et
d’humanité qu’on ne trouve pas chez les Allemands, malgré toute la supériorité
de leur culture extérieure.
Et cette simplicité
amicale, toute naturelle, avec laquelle nos soldats traitent leurs
« ennemis » prisonniers ! Je me rappelle ce propos des
nôtres :
« Quand on est
désarmé, on n’est pas ennemi ! »
Au repos. — Le récit de la Polonaise. —
Les Allemands.
Au milieu du mois de
janvier, notre inaction relative prit fin. Notre train fut envoyé à Ost...,
pour y prendre des blessés et des malades.
De nouveau, nous
passons par Iv... et Sk....
À Sk..., la vie
normale reprend. On rebâtit la gare, que j’ai vue toute détruite lors de mon
dernier passage.
Les trous dans le
quai ont été recouverts de planches ; on a enlevé les amas de briques
tombés des murs écroulés.
La population
revenue dans ses foyers, ou plutôt dans ce qui reste, a l’air de n’avoir jamais
quitté ces lieux dévastés. Près de la gare, on a élevé des sortes de tentes
faites de pieux et de toiles. Elles sont disposées sur deux rangs. Dans chaque
tente, il y a une table et une couple de chaises ; sur la table, un samovar, des tasses, des baranki, etc.
À deux verstes de la
gare, on voit un village. J’y vais. Deux paysannes polonaises me font bon
accueil dans leur maison, située à l’entrée. L’une d’elle est très jeune,
l’autre déjà âgée. Je leur demande ce qu’elles ont éprouvé pendant le séjour
des Allemands. Avaient-elles peur ?
« Si nous
avions peur ? Nullement. Nous étions seules dans la maison. Notre mère et
mes enfants étaient partis avant l’arrivée des Allemands. Quant à moi et à ma
sœur, nous sommes restées ici pour garder la maison : on ne pouvait pas la
laisser sans surveillance, explique la plus âgée. Les Allemands ont introduit
ici leur ordre, à eux. Nous devions nous coucher à huit heures, et, après huit
heures, les fenêtres ne devaient pas être éclairées. Nous les bouchions avec
des coussins, pour qu’on ne pût pas voir la lumière. Durant toute la nuit, des
patrouilles circulaient dans la rue. Presque tous les soirs, des soldats
frappaient à notre porte pour demander quelque chose à manger. Quand nous les
comprenions, nous leur donnions. Quand nous ne les comprenions pas, ils cherchaient
eux-mêmes ce qu’ils voulaient avoir. Un soir, ils vinrent et me dirent :
« Huhn ! » Je compris
qu’ils me demandaient une poule, mais je n’en avais que deux et j’en avais
pitié, de mes poules. Je fis semblant de ne pas comprendre... Je leur montrai
du pain, du sucre... Alors, un Allemand prit une bougie, alla dans la remise,
trouva les poules et en emporta une. Oh ! que je la plaignais, ma
poule !
— Payaient-ils
les denrées ?
— Pas toujours.
Pour la poule, il me donna trois pièces de plomb. Qu’en ferais-je ? Elles
ne sont bonnes à rien. À d’autres ils donnaient des récépissés. »
Après une minute de
silence, elle continua :
« À un de nos
paysans ils ont voulu prendre son cheval. Il s’accrocha à lui, ne voulant pas
le laisser partir. On lui donna un coup sur la tête... Il mourut.... »
Elle racontait tout
cela d’un ton posé et avec réserve, ce qui m’étonna d’abord. Puis je compris.
Leur village est devenu un champ de bataille changeant de maîtres suivant la
fortune des armes. Avant-hier, il faisait partie de l’empire russe. Hier, les
Allemands en étaient devenus les possesseurs. Aujourd’hui, ce sont de nouveau
les Russes.... Qu’est-ce que l’avenir leur apportera, à ces pauvres
paysannes ? Elles n’en savent rien. Mais ce qu’elles savent, c’est qu’il
faut être prudent...
L’intérieur de leur
maison était si propre et si bien rangé que la différence était frappante entre
cette demeure paisible et le chaos régnant encore à la gare. De la pièce
voisine, quatre petites têtes d’enfants regardaient avec curiosité.
« Quand
sont-ils rentrés, vos enfants ?
— Quand ?
Aussitôt que les Allemands se sont retirés.
— Et quand
ont-ils incendié la gare ?
— Pendant la
retraite. Ici, ils n’ont incendié que des bâtiments gouvernementaux. Ils ont
fait aussi sauter le chemin de fer. À la première explosion, les fenêtres chez
nous faillirent être brisées. »
Quand je quittai les
deux paysannes, il neigeait. Je n’étais pas revenue à la gare que le village
cessait déjà d’être visible pour moi, derrière l’épais rideau des flocons
dansant dans l’air assombri.
Une chanson russe. — À Brest-Litovsk. —
Une héroïne. —
Une bibliothèque dans le train. — Un
aviateur il y a 300 ans. — Les grands blessés.
La voiture de
quatrième classe est remplie de blessés légers.
Un soldat chante[1] :
Petits
soldats, braves petits garçons,
Où
sont donc vos aïeux ?
Nos
aïeux, ce sont nos victoires glorieuses :
Voilà
où ils sont, nos aïeux !
Petits
soldats, braves petits garçons,
Où
sont donc vos petites mères ?
Nos
petites mères, ce sont des tentes blanches :
Voilà
où elles sont, nos petites mères !
Petits
soldats, braves petits garçons,
Où
sont donc vos petits frères ?
Nos
petits frères, ce sont des sacs sur nos épaules :
Voilà
où ils sont, nos petits frères !
Petits
soldats, braves petits garçons,
Où
sont donc vos sœurs ?
Nos
sœurs, ce sont des sabres affûtés :
Voilà
où elles sont, nos sœurs !
Petits
soldats, braves petits garçons,
Où
sont donc vos femmes ?
Nos
femmes, ce sont des fusils chargés :
Voilà
où elles sont nos femmes !
Petits
soldats, braves petits garçons,
Où
sont donc vos petits enfants ?
Nos
petits enfants, ce sont des balles bien envoyées :
Voilà
où ils sont nos petits enfants !
Le train roule. La
chanson coule. L’air en est un original mélange de gaîté martiale et de
mélancolie.
*
* *
Nous sommes à la
station de Brest-Litovsk. Il est minuit. La grande gare est pleine d’hommes et
de mouvement. Partout des soldats en chineli
grise, attendant l’heure du départ.
« Où
allez-vous ?
— À Lublin.
— Et
ensuite ?
— Ensuite ?
Personne n’en sait rien. À la rencontre des Allemands ! »
Je quitte la salle
de troisième classe. À côté de la salle de première, dans un coin, je vois un
grand kiote qui encadre des icônes.
Sous les yeux de la Vierge Marie, de Jésus, des saints, s’allonge le flot des
soldats de races et de religions diverses, — orthodoxes, catholiques,
musulmans, israélites — qui forment l’armée russe et qui passent ici pour aller
à la guerre, à la mort....
Un jeune soldat
s’approche du kiote ; il jette
une monnaie de cuivre dans le tronc qu’on y a placé et prend un menu cierge.
Longuement et
attentivement, il regarde le kiote
comme s’il y cherchait quelqu’un.
Enfin, il allume son
cierge, le place devant un des saints, s’agenouille et prie pendant
longtemps... longtemps.... Pour qui ? Pour ses proches ? Pour
lui-même ? Prie-t-il son Dieu de faire cesser les souffrances du monde,
qui sont devenues ses propres souffrances ? Toujours est-il que je le vois
se lever, le visage calme et satisfait. La prière a fait ce qu’il lui
demandait....
*
* *
Après une journée
d’arrêt à Brest, nous allons à O..., pour y prendre des blessés : de
sanglants combats viennent en effet d’y avoir lieu.
Pendant le trajet de
Brest à O..., à chaque nouvelle station, montent dans notre train de nouveaux
passagers momentanés : des officiers, des prêtres, des fonctionnaires
divers. Une dame se présente à nous : elle est en uniforme de soldat,
coiffée d’une papakha ; elle est
blessée et s’appuie sur deux béquilles. Elle nous montre un papier du
commandant de la gare qui l’autorise à voyager dans notre train. J’ai une place
libre dans mon compartiment et le la lui offre. Elle se couche sur le banc, et
nous causons.
Elle me raconte
qu’au début de la guerre, elle a quitté ses deux petits enfants pour
accompagner son mari, médecin militaire, et son frère, capitaine. Travestie en
soldat, elle travaillait dans les tranchées comme infirmier. Les soldats ne
savaient pas que cet infirmier fût une femme et la prenaient pour le
« petit frère » de leur capitaine. Pendant les attaques, elle courait
le long des rangs pour transmettre les ordres de son frère ; l’action
finie, elle pansait les blessures.... Un shrapnell les frappa tous les
trois : son mari, son frère et elle-même. On amputa une jambe au frère. Le
mari, grièvement blessé, resta sur le terrain et fut ramassé par les Allemands.
Quant à elle, elle avait les doigts du pied gauche écrasés.
« Mais il n’y a
qu’une chose qui m’afflige, dit-elle : c’est qu’une partie du régiment fut
cernée par les ennemis et dut se rendre sans combat.... Vous comprenez ?
sans combat !! »
Ses prunelles
brillaient. Je l’écoutais attentivement en regardant la finesse de ses traits,
ses beaux yeux gris, ses cheveux coupés court, mais bouclés, et je me
représentais si vivement le « petit frère » du capitaine courant dans
les tranchées porter ses ordres !
Pendant quelques
minutes, nous gardons le silence. Je le romps pour demander à ma compagne de
voyage où se trouvent ses enfants.
« Je les ai
laissés à la campagne, chez maman. Je vais à X... (une ville de Pologne) pour
me défaire de l’appartement et des meubles. Je ne sais pas quand nous y
retournerons, et même si nous retournerons jamais. Il faut liquider
tout. »
À X..., nous
arrivons tard dans la nuit. J’aide la blessée à descendre sur le quai, et
j’appelle un cocher. Nous nous disons adieu, et je l’embrasse. Elle obtient de
moi la promesse de lui rendre visite à Moscou, dans l’hôpital où elle terminera
sa cure, interrompue par ce voyage.
*
* *
Depuis longtemps
déjà, j’ai voulu avoir une petite bibliothèque dans notre train pour distraire
mes patients par la lecture pendant nos longs et fatigants voyages d’un
« point d’évacuation » à l’autre.
Mais créer une
bibliothèque dans un train sanitaire est une affaire assez difficile. Car, dans
les bibliothèques des « établissements hospitaliers », seuls sont
admis les livres portés sur la liste des ouvrages « non subversifs »,
qui est élaborée et approuvée par le ministère.
Mettant à profit mon
court séjour à Moscou, je me suis adressée à un comité qui s’occupe
spécialement de former des bibliothèques pour les soldats blessés, et là, on
m’a remis une collection de livres et de brochures. Je l’ai placée dans mon
compartiment et maintenant j’ai, plus ou moins, de quoi donner à lire aux
soldats.
Les blessures
nettoyées et pansées, je prends une brochure et je lis à mes patients
« comment les hommes ont appris à voler en l’air ».
Nous voyons dans
cette brochure qu’un des premiers à qui soit venue l’idée de faire de
l’aviation est un moujik russe du xvie
siècle. Il « se vantait » de pouvoir faire des « ailes de
mica » et de voler au moyen de ces ailes.
Le tsar Ivan Le
Terrible s’intéressa à l’invention de son sujet et lui ordonna de prouver
devant le public qu’il ne mentait pas. Le jour de l’épreuve, le pauvre moujik
n’ayant pu s’élever sur ses « ailes de mica », le tsar ordonna de lui
brûler le nez, de lui donner le knout et de le déporter.
Mes hommes écoutent
cette triste histoire, plaignent le sort de l’aviateur malheureux, mais sont
contents de savoir qu’un des « leurs » s’occupait d’aviation il y a
trois cents ans déjà.
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Je récite aux
blessés des poésies que j’ai apprises au lycée et que je n’ai pas encore
oubliées.
Celle-ci, de
Nekrassov, leur plaît surtout :
En
écoutant les horreurs de la guerre,
Devant
chaque nouvelle victime des combats,
Je
ne plains ni l’ami ni la femme,
Je
ne plains pas même le héros.
Hélas !
une femme se consolera,
Et
le meilleur ami oubliera son ami.
Mais
il y a dans le monde une âme
Qui
se souviendra toujours.
Parmi
nos affaires hypocrites,
Et
toute la platitude et tout le terre-à-terre,
Je
n’ai vu qu’une sorte
De
larmes saintes et sincères.
Ce
sont les larmes des pauvres mères.
Elles
ne peuvent oublier leurs fils
Tombés
dans la moisson sanglante,
Comme
un saule pleureur ne peut relever
Ses
branches inclinées vers la terre.
« Qui a composé cela ? demande un des
auditeurs.
— Nekrassov,
poète bien connu.
— C’est un bon compositeur. Il dit la vérité. Ce sont
les mères qui pleurent le plus ceux qui meurent à la guerre. Répétez-moi encore
une fois ces vers. »
Je recommence :
En
écoutant les horreurs de la guerre...
*
* *
Une nuit noire
bouche les fenêtres de notre wagon quand nous arrivons à R.... Le médecin chef
du « point d’évacuation » entre chez nous :
« Il y a
beaucoup de grands blessés. Ménagez l’espace dans le train ; réservez des
places pour de grands blessés. On décrochera de votre train quatre tieplouchki et on les enverra avec vos
sœurs vers les positions qui se trouvent à sept verstes de la ligne de combat.
On y ramassera des blessés. »
Les tieplouchki vite décrochées, nous nous
mettons en route. Un médecin et dix infirmiers nous accompagnent.
Il est deux heures
du matin. La nuit est sombre. Sur l’horizon noir à chaque instant s’allume une
flamme d’un blanc rougeâtre, qui rappelle les éclairs de chaleur. Elle
s’allume, éclaire l’espace, et tout de suite on entend des détonations.
C’est l’artillerie
qui travaille.
Nous avons dépassé
un bois. Une plaine s’étend.
La flamme des canons
vue sur la plaine nue produit un effet plus saisissant que quand on l’aperçoit
par-dessus la cime des arbres. Sur un fond couleur de sang se détend subitement
un fil d’argent, au bout duquel s’allume pour un instant comme une ampoule électrique.
De nouveau, nous
entrons dans le bois. Notre voyage se termine bientôt. Un coup de sifflet léger
nous parvient. La locomotive s’arrête.
Le son du canon se
rapproche. La bataille se livre à notre droite, et nous descendons du train au
côté gauche du bois. Nous avançons avec des lanternes parmi les arbres.
Il y règne un
silence interrompu seulement par le canon. Le bois paraît enfoncé dans une
lourde torpeur. Tout est noir autour de nous. Mais voilà que, de tous les
côtés, de petits feux apparaissent comme des vers luisants : ce sont des
infirmiers avec leurs lanternes. Ils transportent des blessés vers notre train.
Nous les aidons à déposer leur charge sur les lits, tandis que ceux des hommes
« qui peuvent marcher » s’approchent en silence, et en silence
s’assoient près des wagons, comme pour s’effacer devant leurs camarades plus grièvement
atteints.
Les infirmiers
allument un feu de branches sèches. La flamme saute, éclairant les groupes où
les hommes se serrent l’un contre l’autre, les bras et les têtes bandés, les
visages mortellement pâles, les chineli
ensanglantées, les rangées de brancards chargés de corps immobiles.
On m’apporte un
blessé. Toute sa figure est enveloppée ; seule, la bouche est à découvert.
Je le prend par la main. La main est froide. Je tâte le pouls, qui n’est pas
facile à trouver.
« Laissez
celui-là, ma sœur, me dit le médecin. Ne vous en occupez pas. Faites-le coucher
sur un lit. Il n’est pas probable que vous l’amènerez vivant à R.... »
Mais je cours chez
une autre sœur et je la prie de lui faire une injection de camphre et de lui
mettre des couvertures chaudes : il me semble qu’il a froid.
« Il n’y a plus
de blessés sur les brancards, déclare le médecin. On peut monter dans les
voitures ceux qui peuvent marcher. »
Et « ceux qui
peuvent marcher » se traînent péniblement vers les marchepieds, pour les
gravir plus péniblement encore. Quelques minutes plus tard, nous retournons à
R....
À R..., un autre
train de marchandises nous attend déjà, tout plein de blessés qui doivent être
transférés dans le nôtre. Toute la nuit le transbordement continue. Tous sont
dans un état grave. Aucun ne « peut marcher ».
Cette bataille
nocturne nous a coûté cher.
Mais le fait même
que nous avons un tel nombre de grands blessés est rassurant : il indique
avec certitude que les nôtres ne reculent pas, car on ne peut pas ramasser les
grands blessés pendant une retraite. Donc, cette bataille est heureuse ;
et cela me console....
*
* *
Quelques-uns de ceux
qu’on nous a amenés meurent dans le train. En passant par une des voitures, je
vois un soldat en une pose étrange : il appuie les genoux et les mains sur
le plancher, donc son front touche la poussière.
« Monsieur le
docteur, commençons le travail par celui-ci : il se tient si
singulièrement ! », dis-je à notre jeune médecin auxiliaire. Mais ce
médecin est têtu comme un vrai Caucasien qu’il est. Et il fait, de parti pris,
le contraire de ce qu’on lui conseille.
« Pourquoi par
celui-ci ? Il faut aller de l’un à l’autre en suivant l’ordre. »
Nous suivons
« l’ordre ». Pour arriver à ce soldat, j’ai dû faire transporter une
trentaine d’autres.
Quand, enfin, je
tâche de soulever l’homme toujours agenouillé au milieu du wagon, je vois qu’il
est déjà mort. Ses mains et ses pieds sont froids.
Après le
transbordement, nous commençons à panser de nouveaux patients. Des fractures,
des blessures horribles, des hémorragies.... Le travail marche vite et bien,
mais mon docteur aime trop à procéder par ordre. J’ai dans une des mes voitures
deux hommes dont l’état est extrêmement grave. Je prie le docteur de
m’autoriser à les laisser à une station intermédiaire où il y a de bons
hôpitaux, à M... ou à P.... Je crains qu’ils ne supportent pas le long voyage
jusqu’à la ville qui nous est assignée comme terminus de notre présente course.
« Je sais mieux
que vous qui doit être laissé à M... ou à P... ». Telle fut la réponse.
« Mais vous ne
les avez pas encore examinés. Il faut que vous les examiniez bien. »
Mon docteur reste
implacable.
Je rentre dans la tieplouchka pour voir mes deux blessés.
Leurs bandages sont mouillés. J’en ajoute d’autres.
« Qu’ils ne
meurent pas ! » c’est l’unique pensée qui occupe mon cerveau.
Le lendemain, à cinq
heures du matin, l’infirmier me réveille.
« Le blessé que
vous avez prié le docteur de laisser à P... gémit et prie qu’on lui renouvelle
son pansement. Il a une température de 38 degrés 8. Il n’a pas dormi de toute
la nuit. »
Je saute de mon
banc, je réveille le médecin et une autre sœur. Nous faisons au blessé un
nouveau pansement, mais sans qu’il soit soulagé ; sa jambe devient de plus
en plus bleuâtre....
Je pense que, si
nous ne le laissons pas dans un hôpital pour qu’on l’opère, il sera
perdu ; et cette idée me tourmente.
Je m’asseois au
chevet du soldat. Il s’agite sur son lit et me demande s’il survivra.
« Tu sais, ma
petite sœur, j’habitais la campagne. Juste à la veille de la guerre, j’ai
construit une nouvelle maison. Nous nous en réjouissions tellement, moi et ma
femme ! J’étais allé en ville pour gagner de quoi payer la maison. J’y
travaillais tranquillement. Et voilà qu’on me raconte que la guerre est
déclarée. Le patron me dit : « On te prendra pour le service. —
Pourquoi ? demandai-je. Je veux travailler : j’ai construit une
nouvelle maison. » Le patron me dit : « Il vaut mieux tout de
même que tu ailles chez toi, chez ta femme et que tu lui fasses tes
adieux ». Et voilà que j’apprends qu’on prend tout le monde pour la
guerre, et moi aussi. Je retourne sans retard dans mon village, sans avoir rien
dit à personne. J’arrive chez moi et je dis à ma femme : « Adieu, ma
petite femme ! je vais mourir. »
Elle pleure, et moi
aussi. Nous avons pleuré tous les deux. Ensuite, je me lève et je dis :
« Eh bien, assez ! » Et je partis pour la ville. Depuis cette
heure-là, je n’ai pas revu ma femme.
— De quel
gouvernement êtes-vous ?
— De
Tchernigov. »
Après l’arrivée à
G..., je m’adresse directement au médecin en chef du « point
d’évacuation », et, sans l’autorisation de mon docteur, je le prie de
prendre chez lui mes deux blessés. Il consent volontiers. Pendant ma
conversation avec lui, notre médecin auxiliaire donne l’ordre de transporter
tous les blessés de notre train dans un autre qui les attend ici pour les
évacuer plus loin. « Personne ne restera ici au point de pansement »,
dit-il. Mais mes deux patients sont déjà dans la salle du « point ».
« Celui-ci doit
rester ici, et celui-là aussi » dit le chirurgien après les avoir
examinés....
« On t’enlèvera
la jambe, mon petit, dit-il à un des miens. Sinon, ce sera trop tard. Quant à
l’autre, on l’enverra à la ville, à l’hôpital de la Croix-Rouge. Son état est
le même », dit le chirurgien à une des sœurs qui l’aident.
Vingt minutes après,
je vois mon blessé déjà couché sur la table d’opération et chloroformé. Il
dort, et le médecin termine son travail.
Mon docteur ne sera
pas content de moi, probablement. J’ai agi sans autorisation et sans observer
« l’ordre ». Mais quoi ! si la subordination est une bonne
chose, la vie humaine en est une aussi.
Le train-bain. — En route pour
Varsovie. — Les deux croix.
Le petit bourg où
nous allons chercher des blessés est situé au milieu d’un bois de sapins. L’air
est pur et léger.
Nous remplissons
notre train de grands blessés couchés sur des civières. Le travail marche vite.
Nous faisons sortir les lits des wagons, y plaçons notre monde et le montons à
l’intérieur.
Les bottes, les chineli, les pantalons de ces hommes,
sont couverts de boue, d’argile. L’uniforme et le linge font l’impression
d’avoir été bien goudronnés, tellement ils sont sales.
« Pourquoi
avez-vous tant de boue et de terre sur vous ? dis-je à un des blessés les
plus crottés.
— Comment voulez-vous
qu’il en soit autrement ? me répond-il. Nous sommes restés couchés pendant
quatre jours et quatre nuits sur le ventre, dans des marais. Nous avons marché
en pays marécageux pendant deux semaines entières. »
Un large sourire
inonde subitement sa figure, et il ajoute :
« Mais ce n’est
pas pour rien que nous nous sommes roulés dans la boue. Nous avons battu
l’Allemand : il a reculé.
— Où
donc ?
— Sous
Pr.... »
*
* *
Le train est chargé.
Nous pouvons nous reposer un peu. Un officier vient chez nous. C’est le
commandant du train-bain qui se trouve près du nôtre. Il nous remercie pour
notre travail, qu’il « contemplait » (c’est son expression) avec ses
camarades, et nous invite à venir voir son installation. Nous y allons après le
dîner.
Le commandant du
train-bain nous reçoit bien. Il nous offre du thé et des « bonbons de
Moscou ».
Il nous raconte ce
qui lui est arrivé la veille. Un train sanitaire s’est arrêté à côté du sien.
Il le « contemplait » aussi et a remarqué que personne ne surveillait
le transport des blessés : pas un médecin, pas une sœur.
« Alors, je
fais des recherches, nous dit-il, je trouve une sœur et je lui déclare qu’on ne
doit pas laisser les infirmiers travailler sans surveillance. Elle se fâche. Et
voilà qu’un médecin saute d’un wagon et me crie : « Comment
pouvez-vous être aussi impoli avec Mme Z.... ? » Puis on m’explique
que cette dame est une personne très importante. Mais comment pouvais-je
savoir ? Pour moi, toutes les sœurs sont égales. Une personne
importante ! Si elle travaille bien, je m’agenouillerai devant elle.
Sinon.... »
Après le thé, le
commandant nous fait voir tout l’intérieur de son train. Il y a vraiment de
quoi regarder. Il s’y trouve une salle de bain, une avant-salle où on laisse le
linge et les vêtements. Puis c’est une chambre de coiffure, une lingerie, où on
échange le linge sale contre du propre. La salle de bain est organisée à la
russe : de larges bancs pour les clients, des chaïki (seaux de bois), des torchons, des morceaux de savon. De là,
nous passons dans un wagon-blanchisserie où, au moyen de machines spéciales, on
lave le linge, on le presse, on le sèche. Plus loin, nous entrons dans la resserre
pour le linge rangé sur des rayons.
« Quant à cela,
c’est une chambre de désinsection,
nous dit le commandant.
— De
désinfection, voulez-vous dire ?
— Non, de désinsection. C’est pour anéantir les amis de
Guillaume.
— Quels
amis ?
— Mais les
insectes, la vermine. C’est le fléau de l’armée. Ils aident Guillaume. Nous les
combattons ici, et avec beaucoup de succès. Nous mettons dans cette chambre les
chineli et tous les vêtements des
soldats et faisons monter la température jusqu’à 94 degrés. Ils peuvent en
supporter une de 60 à 70 degrés ; à 80 degrés, ils commencent à craquer
et, à 90 degrés, ils périssent tous. »
*
* *
Nous remercions
notre hôte aimable et nous hâtons de retourner chez nous. Quelques minutes
après, nous roulons vers Varsovie.
Je reste dans une
des tieplouchki, chargée de dresser
la liste des blessés qui s’y trouvent et de savoir quand ils ont été pansés
pour la dernière fois.
Il y a là un
Allemand. Pendant que j’inscrivais les noms sur mon registre, il était resté
couché sur son lit, le visage entre les mains et sanglotant.
« Dites-moi
votre nom, lui dis-je en allemand.
— Franz L....
— Ma petite
sœur, me demandent nos soldats, pourquoi pleure-t-il ? Expliquez-lui qu’il
n’y a pas de quoi tant s’affliger. On ne l’a pas tué : donc après la
guerre, il retournera chez lui. Il est marié, n’est-ce pas ? A-t-il une
femme et des enfants ? Demandez-le-lui, ma petite sœur,
encouragez-le. »
Je traduis ces
paroles à Franz L... Mais il me regarde avec méfiance.
« Mais écoutez
donc ! Les Russes ne sont pas méchants. Pourquoi avez-vous peur ?
— Savez-vous,
ma petite sœur ? me dit un des blessés. Nous avons été voisins de lit à
l’hôpital. Quand on nous mit dans le train, l’Allemand devint tout pâle et
commença à pleurer. Il croyait probablement qu’on allait le tuer. C’est en
Allemagne qu’on lui a raconté des bêtises sur nous. C’est pourquoi il a peur. »
Je distribue des
cigarettes aux soldats.
« Ma petite
sœur, donnez-en à l’Allemand », me disent les blessés.
J’obéis bien
volontiers à leur désir. L’Allemand me remercie et se calme un peu.
Vers minuit, nous
arrivons à Varsovie. Notre train reste sur une voie de garage. Le matin, on
nous transmet l’ordre de laisser à Varsovie dix grands blessés russes et tous
les prisonniers.
Je vais chez Franz
L..., et lui dis qu’il restera à Varsovie. Cette nouvelle le trouble, et il me
regarde avec crainte.
« Ma petite
sœur, me disent les blessés, priez le docteur de laisser cet Allemand avec
nous. C’est un brave garçon, cet Allemand. Nous le connaissons bien. Nous
sommes bien attachés à lui. Parlez-en au docteur, ma petite sœur.
— Le docteur
n’a pas le droit de le garder dans le train si l’ordre est de le laisser à
Varsovie. Cela ne dépend que des autorités militaires. »
Mais je suis touchée
de leur demande.
Je dis à l’Allemand
qu’à Varsovie on le transportera à l’hôpital, où se trouvent prisonniers des
compatriotes à lui ; là, il ne s’ennuyera donc pas.
L’Allemand me croit
cette fois :
« C’est bien.
Car je craignais d’être envoyé en Sibérie. Il y fait froid, et tous les nôtres
y meurent. »
Je ris :
« Mais comment
nous, les Russes, pouvons-nous habiter la Sibérie sans y mourir ? Tout de
même, soyez tranquille. Aussi longtemps que vous ne serez pas bien guéri, on ne
vous enverra pas en Sibérie. »
*
* *
Le soir de la même
journée, nous quittons Varsovie pour aller à Moscou avec un très fort convoi de
grands blessés : 370 sur 480 ne peuvent se lever.
Les trajets d’une
station à une autre étant parfois très longs, je dois rester pendant deux ou
trois heures dans la même tieplouchka.
J’y termine tous les pansements et, assise sur un lit, je cause avec mes
patients.
Un d’eux est blessé
pour la deuxième fois ; un autre, pour la troisième. Les anciennes
blessures font encore penser à elles. Les nouvelles y ajoutent de la douleur.
Les blessés en sont déprimés.
« Ne vous
affligez pas tant ! leur dis-je, essayant de les encourager. Vous
guérirez, vous retournerez chez vous, et on vous donnera la croix de
Saint-Georges. Vous l’avez bien gagnée. Être blessé pour la troisième fois
pendant la même guerre, c’est quelque chose.
— Non, ma
petite sœur, répond un des hommes, le visage grave. On ne me donnera pas cette
croix dont vous parlez.... J’en aurai bientôt une, mais une autre.... Une
grande, de bois.... »
Il a raison. C’est
la mort plutôt qui l’attend, et non la guérison. Mais puis-je le lui
dire ? On ne peut pas dire la vérité à ces gens dangereusement atteints et
fatigués.... Mais je sens que je dois leur dire quelque chose. Et je leur
parle, non d’eux-mêmes, à qui il ne reste pas beaucoup d’espoir, mais de la
cause pour laquelle ils souffrent. Le cœur serré, je leur dis que la guerre est
le plus terrible des maux, mais que, puisqu’elle a gagné le monde entier,
personne ne peut s’y dérober. Ce n’est pas notre pays qui a voulu cette guerre.
L’Allemagne l’a provoquée. L’Allemagne a écrasé la petite Belgique, tient une
partie de la France, a envahi la Pologne. Les Allemands incendient les
villages, emmènent les habitants et les forcent à travailler comme des
esclaves. Les petits enfants restent sans soutien et meurent de faim. Nous
devons briser l’orgueil et la domination des Allemands. Si nous ne le faisons
pas, nous souffrirons encore plus qu’aujourd’hui. Nos enfants devront payer
tribut et travailler pour l’enrichissement de l’Allemagne, déjà cent fois plus
riche que notre pays.... Il faut avoir du courage et de la confiance en
soi-même.
Je termine là mon
improvisation. C’est le premier discours que j’ai fait en faveur de la guerre.
Il me semble que tout ce que je viens de dire est inutile et déplacé, que les
souffrances personnelles de ces soldats ne sauraient être allégées par des
mots. Il me semble même qu’il est cruel de ma part de tenir ce langage à des
gens qui savent mieux que moi ce qu’est la guerre.
Mais, chose
étrange ! quand le train s’arrête et que je quitte la voiture, les blessés
m’accompagnent d’exclamations émues :
« Merci bien,
chère petite sœur ! Tu nous as relevé le moral. Merci bien à toi, chère
petite sœur ! »
*
* *
Peu de temps après,
l’infirmier m’appelle dans la même tieplouchka.
Chez le soldat qui est blessé pour la troisième fois, la température monte et
devient brûlante. Je l’examine et je refais le pansement. La blessure est très
petite, et l’aspect extérieur n’en est pas mauvais. Qu’est-ce qui se passe
au-dedans ? Il n’y a rien à y comprendre. Nous appelons le médecin. On
examine de nouveau le blessé.
Toute la nuit, le
cauchemar le poursuit. Dans son délire, il combat les Allemands, il crie, il
saute de son lit et se précipite contre les lits voisins ; les infirmiers
le retiennent ; il les prend pour des ennemis.
Une autre journée se
passe. Vers le soir, le malade se calme un peu, mais la température monte
encore. Le lendemain matin, l’infirmier vient me chercher.
« Il meurt,
celui-là. »
Je cours dans la tieplouchka. Je tâte le pouls, mais il
disparaît sous mes doigts, et la main se refroidit dans la mienne.
Une injection de
camphre.... Sans résultat.
Le soldat aura sa
croix, une grande croix de bois....
Les femmes soldats. — Ceux qui ne se
réveillent pas. — Sur les bords du San. — Des tombes.
Sur le chemin de
K..., notre train prend une allure de tortue. On dit qu’à K... il y a
énormément de blessés. Mais nous nous arrêtons à chaque instant. Toutes les
voies sont occupées, et nous devons laisser passer les trains militaires, qui
conduisent des soldats sur la ligne de combat.
Tout près de K..., à
une petite station, en face de notre wagon, s’alignent des soldats arrivés tout
à l’heure. On les inspectera, et ensuite ils iront aux tranchées. Nous les regardons
par les fenêtres. Or, parmi eux, nous remarquons quatre femmes en uniforme militaire.
Une a environ dix-huit ans ; elle est jolie. Deux autres ont environ
vingt-cinq ans. La quatrième a l’aspect d’une suffragette ; c’est pourquoi
il est difficile de reconnaître son âge. Ce sont des volontaires.
En attendant
l’arrivée des officiers, les soldats s’occupent fraternellement de leurs
compagnes :
« Tu veux boire
peut-être ? », demande un soldat à une des volontaires. Et il tient
sa théière par le fond pendant qu’elle boit au goulot. Un autre soldat
s’approche et présente à une d’elles un kalatch,
à une autre un morceau de saucisson, à la troisième des cigarettes.
Un commandement
résonne. Les soldats se mettent en marche, et les quatre camarades avec eux.
Elles marchent comme de vraies militaires ; leur allure ne se distingue
pas de celle des hommes, quoiqu’une d’elle soit une vraie
« demoiselle ».
*
* *
Dès cinq heures du
matin, nous sommes occupées à panser. Nous avons commencé par les sept wagons à
marchandises. Les hommes sont couchés sur de la paille, en rangs serrés :
quarante blessés par wagon.
« Où êtes-vous
blessé ? » dis-je, en me penchant sur lui, à un homme dont la figure
est contre la paille.
Il ne me répond pas.
« Écoute. On te
demande où tu as mal », intervient son voisin.
Il ne lui répond
pas.
Je touche sa main.
Elle est froide.
« Il ne faut
pas le réveiller. On ne le réveillera jamais ! dis-je.
— Est-ce qu’il
est mort ? « demande le voisin.
Et graduellement, un
vide se forme autour du corps, autant que le permet l’étroitesse de l’espace.
À quoi pensait-il en
mourant ?
Les lèvres du mort
sont fortement serrées. Un grand effort se traduit dans l’expression de son
visage. On voit qu’il retenait ses cris.
Je lui couvre la
figure avec sa casquette et je passe à d’autres.
Nous avons ainsi
examiné les blessés de tous les wagons à marchandises. Presque dans chaque
voiture, il y avait un mort ou un mourant qui, hier, pendant le chargement, passait
pour « pouvoir marcher ».
Dans les tieplouchki, il y a eu quatre morts
pendant la nuit. À la première station, on descend les cadavres, et je choisis,
parmi ceux qui couchent sur le plancher, les plus malades pour leur donner les
quatre lits redevenus libres. Ma vieille expérience m’a appris que ceux qui
sont dans le pire état ne réclament jamais rien ; ils demeurent inertes.
Je tâche de
reconnaître à l’expression du visage ceux que je cherche.
« Quelle est
votre blessure ? Vous en souffrez beaucoup, n’est-ce pas ? dis-je à
un soldat.
— Ca ne fait
rien. Je tâcherai d’avoir de la patience, ma petite sœur », prononce-t-il
avec difficulté.
Les traits
paraissent calmes. Mais, dans le regard, il y a tant de douleur ! Je
relève sa chemise. Les bandages qui garnissent le dos et une hanche sont
rougis.
« Mettons
celui-ci sur le lit », dis-je aux infirmiers.
Quand, l’homme placé
sur le lit, je lui refais le pansement, je vois des blessures terribles :
profondes, avec des lèvres bleues et déchirées.
Comme il dû
souffrir !
Mais il n’a pas
poussé une seule plainte. Où prennent-ils pareille force de résignation et de
patience ?
À la fin de mai...
Nous arrivons de nouveau sur les bords du San, de ce San où chaque pouce de
terre est arrosé de sang humain.
Notre train
s’arrête. Nous en profitons pour descendre ; nous traversons le pont et
avançons à gauche, le long de la rive. La forêt nous entoure. Toutes les cinq
ou toutes les dix minutes, nous rencontrons des tranchées. Les une ont la forme
d’un fossé ; d’autres, celles d’un souterrain. Nous marchons sur des
douilles brisées de shrapnells, sur des lambeaux d’uniforme autrichien :
voici une manche de vareuse bleue ; plus loin, une vareuse sans manche....
Des chaussures autrichiennes aux semelles garnies de clous, des sacs militaires
en fourrure jaune.....
Et la
forêt !... La forêt se tient encore, mais triste et blessée !
Beaucoup de sapins brisés, déjà morts, appuient leurs troncs et leurs branches
desséchés sur leur voisin. Parfois une moitié de l’arbre est mutilée et
demi-morte, l’autre est restée verte. Les cimes se balancent douloureusement.
« C’est une
tombe commune autrichienne », dit, interrompant notre méditation, le
capitaine qui nous accompagne.
Nous voyons un petit
tertre couvert d’un vieux képi autrichien.... Les arbres continuent à gémir
doucement de leurs branches sèches.... Nous sentons la présence de la mort
parmi nous. Silencieusement, nous sortons de la forêt en rejoignant la rive
élevée du San, qui coule rapidement à nos pieds.
« Des monceaux
d’armes gisent au fond de la rivière. Les Russes, dont l’attaque venait de
l’autre rive, et les Autrichiens, qui se couvraient de la rivière, lui ont payé
le même tribut. Il y a quelques jours, notre médecin, qui se baignait ici, eut
le pied percé dans l’eau par une baïonnette autrichienne, comme si, même abandonnée,
elle devait continuer le combat.... Nos soldats repêchent beaucoup d’armes en
se baignant. De temps en temps, des cadavres flottent, emportés par le courant.
L’ordre est donné de les retirer de l’eau et de les enterrer »... termina
le capitaine.
« Et, là, ce
sont les tombes communes de nos soldats », dit-il peu après en montrant
l’autre rive, où on distinguait la blancheur des croix sur les tombes.
Tandis que mes
compagnons se reposaient sur l’herbe, j’allai vers les tombes communes des
soldats russes. Elles sont entourées d’une clôture de bois. Il y a là cinq ou
six tombes, sur chacune desquelles se dresse une grande et haute croix blanche.
Une inscription
dit : Ici reposent les soldats du
... régiment tombés courageusement en traversant le San sous le feu des fusils,
des mitrailleuses et des canons ennemis, le ... octobre 1914. Deux croix portent
aussi des noms et ces mots au crayon : Et
encore quatre soldats.
Non loin de là, au
milieu d’un champ, sous un saule, s’élève encore une croix, aussi grande que
les autres. Je traverse le champ avec précaution, car il est labouré. Pas
d’inscription sur cette croix. Mais après de longues recherches, je déchiffre
sur un des bras ces mots, griffonnés au crayon : Ont péri dans la nuit du... octobre 1914.
Ils sauront... — Celles qu’on a
laissées. — La Russie est grande.
À Brest, nous laissâmes tous les blessés qui
se trouvaient dans les wagons à marchandises et ceux qui étaient couchés dans
les tieplouchki, sur les planchers.
Il ne resta dans le train que le nombre normal des blessés, prévu par le règlement
d’après la capacité des locaux.
Dans une de mes tieplouchki, il y avait un soldat
atteint à la poitrine. Sa blessure n’était pas très grande ni grave, mais il
était en un état très inquiétant : il parlait avec beaucoup de peine et crachait
le sang. On décida de le débarquer aussi à Brest. Mais, pendant qu’on le
transportait sur le brancard, il mourut. L’infirmier qui le soignait ne se rappelait
pas son nom, ni notre médecin non plus. Mais son voisin de lit nous aida.
« Ma petite
sœur, on a pris quatre blessés de notre voiture. Je les connais tous.
Permettez-moi de regarder le mort. Je le reconnaîtrai et je vous dirai son
nom. »
J’y consentis.
L’hôpital n’était pas loin. Lentement, nous y amenâmes notre patient pour qu’il
pût reconnaître son camarade. Il le nomma tout de suite.
« Je ne croyais
pas qu’il serait mort, dit-il, secouant la tête d’un air pensif. Je ne le
croyais pas. »
Remontée dans le
train, je parcours la longue liste des blessés que nous avons
transportés ; je trouve le nom du mort, et je le marque d’un signe.
Maintenant, ses parents ne seront pas dans l’ignorance de son sort. Ils
recevront une triste nouvelle ; mais, au moins, ils sauront et ne passeront
pas des journées et des mois dans une attente angoissante et vaine. Ils
sauront....
« Pourquoi se
déranger pour ça ? », me dit ironiquement une autre sœur de notre
train.
Cette question m’est
désagréable ; mais je me retiens et réponds aussi tranquillement que
possible :
« Je voulais
informer la famille du mort.
— Mon
Dieu ! que vous êtes sentimentale ! », m’objecte-t-elle.
Je ne peux rien lui
répondre : peut-être a-t-elle raison.
*
* *
À M..., nous
laissons les autres blessés et nous retournons aussitôt à K..., où nous devons
évacuer les hôpitaux.
Mais, en dehors des
hommes hospitalisés à K..., on nous en apporte qui viennent directement des
positions : Russes et Autrichiens.
Mes wagons sont
remplis presque exclusivement d’Autrichiens.
Pendant le transport
dans les tieplouchki, je commence à
panser mes nouveaux patients dans une voiture déjà pleine.
Un Autrichien a
quatre blessures : aux deux bras, à la tête, à la poitrine. Avec toutes
les précautions, je le panse. Je passe à un autre, à un troisième. Je lave
leurs blessures et je les bande. Je tâche de travailler le plus doucement
possible, pour ne pas faire souffrir les « ennemis ». Les Autrichiens
en paraissent étonnés. Leurs chefs, probablement, leur avaient promis des
tortures en Russie.
Un d’eux me regarde
et me dit soudain :
« Ma sœur, vous
ressemblez par la figure à ma femme.
— Vous êtes
donc marié ? Et vous avez le portrait de votre femme avec vous ?
Montrez-le moi. »
L’Autrichien sort un
paquet, caché sous l’oreiller, le délie et me tend une photographie. Je vois
une jeune femme au visage agréable, qui ne me ressemble que par la couleur des
cheveux : elle est blonde. Je suppose que l’Autrichien, en me comparant à
sa femme, a voulu me flatter pour me remercier de mes soins.
« Ma sœur,
j’avais encore un autre portrait, plus grand, et des lettres d’elle aussi. Tout
cela était dans mon sac et est resté sur le champ de bataille. Quant à cela
(désignant le paquet), je l’avais caché sur ma poitrine. »
Un autre Autrichien
me tend aussi une photographie de sa femme ; un troisième suit son
exemple. Chacun veut causer avec moi de celle qu’il aime. Je contemple les femmes
de tous mes patients et j’écoute ce qu’ils me racontent d’elles. Ils parlent
avec un plaisir visible, et quelque chose d’enfantin se marque sur leurs
traits. Pour le moment, ils oublient que c’est la guerre, qu’ils sont
prisonniers et que c’est « l’ennemi » qui les entend : leurs
rêves et leurs conversations les ramènent chez eux....
*
* *
Le train roule
toujours. Les Autrichiens regardent par les fenêtres et s’étonnent de ce qu’ils
voient : des grands bois qui accompagnent le train pendant des journées et
des nuits entières, de l’abondance du matériel et des approvisionnements dans
les stations. Mais ce qui les frappe le plus, c’est la durée de notre voyage.
« Que de bétail
vous avez encore en Russie ! s’écrient-ils, en regardant le train qui nous
croise et dont les wagons sont remplis de porcs et de bœufs. Que de bétail
encore, après des mois de guerre !
— On nourrit
bien les blessés dans vos trains sanitaires. Le pain est si blanc, si
frais !
— Ma mère m’a
écrit récemment, raconte un d’eux, qu’un kilo de viande coûte maintenant chez
nous six couronnes. Au pain on ajoute quelque chose pour économiser la farine.
Le pain n’est pas bon. Que sera-ce plus tard, si la guerre dure encore, si elle
n’est pas finie bientôt ? »
Les Autrichiens qui
se trouvaient dans cette voiture étaient d’origine allemande ; parmi eux,
il y avait deux Viennois. Dans d’autres voitures, en dehors des Allemands, il y
avait des Serbes, des Croates, des Ruthènes, des Slovaques, des Polonais et des
Roumains. Les Serbes et les Ruthènes se tenaient ensemble, tâchant d’être
voisins de lit.
« Comment
pouvez-vous faire la guerre aux vôtres ? dis-je aux Serbes. Est-il
possible que vous ayez tiré sur vos frères ?
— Mais nous
n’avons pas tiré ! répondit vivement un des Serbes, aux malins yeux noirs.
Nous avons tiré en l’air.
— Ne le croyez
pas, ma sœur, fait une voix (c’était un officier russe qui était entré dans la
voiture et avait assisté à notre conversation). Ils n’ont pas tiré ?
Allons donc ! On leur commande, et ils tirent ; et c’est tout.
— Est-ce
vrai ? demandai-je plus bas au Serbe quand notre officier fut sorti et que
le train se fut remis en mouvement.
— Mais que nous
restait-il à faire ? » me demanda-t-il à son tour, tandis que ses
yeux brillaient.
L’abattement des
premières heures est passé définitivement. Les prisonniers, voyant qu’on les
traite bien, deviennent de plus en plus confiants ; ils causent avec moi,
me racontent leur vie, se renseignent sur ce qui les attend à l’intérieur de la
Russie.
« Où
habiterons-nous ? » s’enquiert avec inquiétude l’un d’eux.
Et, se répondant à
lui-même :
« En Sibérie
probablement... Mais nous mourrons de froid là-bas », continue-t-il après
une minute de silence.
Je me vois obligée
de leur expliquer que la vraie Sibérie ne ressemble pas à ce qu’on raconte
d’elle en Europe ; que la neige et le gel n’y sont pas
« éternels » ; que les gens qui y demeurent, loin de mourir de
froid, se portent très bien ; que la Sibérie est un pays très riche et que
beaucoup de paysans y viennent chaque année des régions intérieures de la
Russie.
« Oui, la
Russie est grande ! Pourquoi donc avez-vous besoin de notre terre ?
Et pourquoi voulez-vous nous l’enlever ? », dit un des Autrichiens.
Je lui explique que
le peuple russe n’avait aucune envie d’enlever quelque chose au peuple
autrichien et que c’est l’Autriche qui a commencé la guerre.
*
* *
Nous allons à G....
Quelques heures avant l’arrivée, je visite toutes les tieplouchki et j’indique aux infirmiers ceux des hommes qui doivent
être pansés au point de déchargement avant d’être placés dans le train qui les
emmènera à l’intérieur du pays.
« Merci bien à
vous, ma sœur ! me dit l’Autrichien qui a trouvé que je ressemble à sa
femme. Les sœurs russes méritent des croix d’or pour leur peine.
— Nous
préférons une croix rouge à une croix d’or, lui dis-je. Si vous appréciez
tellement notre travail, écrivez plutôt chez vous et racontez aux vôtres que
les sœurs russes vous soignent comme leurs frères. Ce sera la meilleure
récompense pour nous.
— C’est trop
peu, ma sœur. Mais savez-vous ce que je ferai ? Avant la guerre, j’étais
conducteur au chemin de fer. Je faisais le trajet de Vienne à la frontière
russe. Quand, après la guerre, vous voudrez aller en Autriche, vous voyagerez
jusqu’à Vienne sans payer : je vous transporterai gratuitement dans mon
train, comme vous me transportez aujourd’hui dans le vôtre.
— Merci
beaucoup ! dis-je en riant. Mais quand la guerre sera terminée, je vous
oublierai, et vous ne vous souviendrez pas de moi non plus.
— Est-ce que la
guerre durera donc encore si longtemps ? Mais c’est impossible ! On
se révoltera chez nous, en Autriche. Il n’y aura pas assez d’hommes pour
continuer la guerre aussi longtemps. La paix est nécessaire ! La
paix !
— Chez nous, en
Russie, on croit que la guerre durera encore au moins un an. »
Ces paroles les
abattent visiblement.
À G..., nous avons
descendu du train tous nos blessés, qui vont être dirigés vers le cœur de la
Russie. Nous leur faisons nos adieux.
« Nous
arriverons à Moscou dans cinq ou six heures, n’est-ce pas ? demande un des
Autrichiens.
— Non, dans
deux jours.
— Comment !
dans deux jours ?.... Mais nous sommes en voyage déjà depuis trois jours
entiers. Encore deux jours ?
— Après Moscou,
la Russie finit sans doute, dit un autre, et c’est la Sibérie qui
commence ?
— Non. Après
Moscou, la Russie ne se termine pas ; elle commence seulement. De là à la
Sibérie, il y encore loin. »
Les Autrichiens me
regardent avec méfiance. Mais je n’ai pas le temps de les convaincre. Notre
train est prêt à partir, et je les quitte.
Un arrêt à Kiev. — « Nous n’avons pas voulu la guerre ! »
Des sept prisonniers
allemands que j’ai dans ma tieplouchka,
deux sont grièvement blessés. L’un est mort ce matin de bonne heure, avant le
lever du soleil.
Les prisonniers
germains ont l’air très sombre et morose. Quand j’entre dans leur wagon, ils
gardent obstinément le silence. Dans la même voiture, il y a cinq blessés
russes. La sœur qui m’aide et moi ne faisons, bien entendu, aucune distinction
entre les hommes que nous devons soigner : les « nôtres » et les
« ennemis » sont égaux pour nous. Un des Allemands a une fracture
compliquée de la jambe ; le membre est mis dans un appareil. Nous lui
changeons les bandages. Il en est rafraîchi et soulagé. Il tâche de conserver
sa mine froide, mais ne peut pas retenir un sourire de plaisir. Il ne vivra pas
longtemps : son état est trop grave.
L’attitude des
prisonniers allemands est tout autre de celle des Autrichiens. Ces derniers
sont affables, bavards, ouverts. Même les Magyars « sauvages »
plaisantent chez nous et nous apprennent leur langue difficile. Quand nous
avons achevé de les panser, ils nous remercient : Khessanam sepan ! (grand
merci !). Les Allemands sont taciturnes et orgueilleux. Et ils le
restent pendant tout le trajet, jusqu’à Kiev.
Toutefois, avant que
le train arrive à destination, un d’eux me salue et prononce d’une voix
décidée :
« Ma sœur, je
vous remercie pour vos bons soins et pour le bon traitement. Je vous remercie
au nom de nous tous ! »
Le train stoppe à la
gare de Kiev. les brancardiers enlèvent les blessés de leurs lits. L’Allemand à
la jambe brisée et qui doit mourir me fait signe d’approcher. Je le fais, et il
me dit tout bas :
« Merci
beaucoup, ma sœur ! Ne soyez pas fâchée contre nous, pardonnez-nous. Nous
n’avons pas voulu la guerre. »
Il ne peut terminer
sa phrase, il pleure.
« Il ne faut
pas pleurer, il ne faut pas pleurer, dis-je en le consolant. Je ne suis pas ici
pour vous juger, mais pour vous soigner. Je ne suis qu’une sœur de charité, et
non un juge. »
Le blessé prend ma
main et la baise :
« Oui, ce n’est
pas nous qui avons voulu la guerre. C’est notre empereur. Pardonnez-nous tout
le mal que la guerre vous a fait. »
Et de nouveau il
pleure.
J’ai envie de
pleurer avec lui.
Lettres de soldats.
Notre
« base » est à Brest. C’est là qu’on nous adresse notre correspondance.
Chaque fois que notre train y est de passage, nous courons au guichet du bureau
postal de la gare.
Chaque courrier nous
apporte des lettres de nos anciens patients.
Elles sont
toujours très sincères et très touchantes, ces lettres des soldats qui écrivent
à leurs « petites sœurs ».
Aujourd’hui même,
j’en ai reçu une dizaine.
Un soldat m’envoie
une carte postale avec ces lignes griffonnées par une main qui tient sans doute
mieux un fusil ou une charrue qu’un crayon :
1914. 16...
« Lettre d’Iakov Vassilievitch.
« Je me dépêche
de vous écrire cette lettre. Bonjour, ma petite sœur N. N.
« Je vous
envoie mes respects très humbles avec l’amour et mon humble révérence. En
dehors de cela, je vous annonce qu’on m’a libéré définitivement du service
militaire. Avec cela, je vous dis : « Au revoir ! ». Je
vous prie de me répondre, ma petite sœur.
« Gouvernement
de Kiev, district de Radomysl..., village....
« Iakov
Vassilievitch B... sky. »
Une autre carte
postale porte ce qui suit :
« Année 1915, au mois de janvier.
« Bonjour, ma
sœur. Je vous salue, moi, Piotr Andreevitch Ivanov. Je me trouve sur la
frontière allemande, à soixante verstes de Varsovie. J’ai été deux fois au
combat, et Dieu m’a protégé. Ensuite, adieu. Je suis sain et sauf et je vous le
souhaite aussi. Mon adresse : Armée active,... régiment,... compagnie.
« Piotr
Ivanov. »
Un paysan, un
fantassin, se donne la peine de m’écrire, de l’hôpital où il a été transféré
après avoir quitté notre train :
14 février 1915.
« Ma petite sœur très estimée,
« Dans les
premières lignes de ma lettre, je vous envoie mes respects cordiaux, et je vous
souhaite de toute mon âme tous les bonheurs. Ma petite sœur, mon cœur est touché
de vos profondes attentions et des soins difficiles que j’ai reçus de vous
pendant mon voyage. Je vous remercie infiniment d’avoir eu tant de souci des fidèles
défenseurs de notre chère patrie. Que Dieu vous donne le courage de travailler
encore pour le bien de la grande Russie. Je n’oublierai pas vos labeurs et vos
soins avant d’être dans les planches de cercueil.
« Maintenant,
je m’empresse de vous donner de mes nouvelles. Ma maladie s’améliore doucement.
Je me trouve à Minsk, au lazaret pour les militaires blessés de la communauté
juive. Le lazaret est très bon, la nourriture est excellente, les petites sœurs
sont très bonnes : ainsi, on ne peut en dire que du bien. Je suis très
content de me trouver dans un lazaret si excellent. Quand je serai complètement
guéri, je vous le ferai savoir. Ensuite, soyez en bonne santé et heureuse. Je
reste, avec un profond respect pour vous,
« Vassili
P... ».
Avec un blessé, j’ai
eu beaucoup de contestations à cause de son refus obstiné de porter un bandage
spécial nécessité par une blessure aux côtes. Maintenant, son état moral s’est
amélioré. Je le vois par sa lettre :
1915, 25/II.
« Ma très estimée N. N. !
« Je veux vous
écrire quelques lignes sur moi. Celui qui vous écrit cette lettre est le petit
soldat Serguei Fedorov ; c’est celui qui était mécontent de porter une chemise
glacée ; aujourd’hui encore, il est obligé de la porter.
« Je me trouve
à Moscou, au lazaret de.... Il y a ici dix hommes de votre train ; les
autres sont répartis dans d’autres villes : à Riazagne, à Tambov, à
Samara, à Kostroma, à Penza. Ceux qui ont des blessures particulièrement graves
restent à Moscou. On nous soigne très bien. C’est gai ici. Il y a beaucoup de
sœurs, jeunes et si attentionnées ! On ne peut trouver pour elles d’autre
nom que celui de petit chérubin. Il y en a qui sont déjà âgées, mais pas trop.
Nous jouons au loto, aux cartes, aux échecs. Je suis très content des sœurs,
et, en général, de tout. Ma chère petite sœur, je vous remercie pour les
secours que vous m’avez accordés.
« Au lazaret,
nous sommes vingt-neuf soldats et un officier ; cinq hommes par chambre.
On est tranquille de coucher ici.
« Il n’y a rien
à écrire en dehors de cela. Puis au revoir !
« Je reste
« Serguei
Dimitrievitch F...v. »
L’auteur de la
lettre suivante, ne pouvant écrire lui-même, a eu recours à une plume plus
exercée :
« Ma chère petite sœur,
« Je suis
arrivé à P... le 13 courant, et je suis couché au lazaret. Le jour de mon
arrivée, je me sentais très mal ; maintenant, un peu mieux. La température
est parfois de 38 à 39 degrés, et, le premier jour, elle était de 40 degrés.
Maintenant, grâce à Dieu, je me porte mieux. La blessure au bras se cicatrise
déjà, aussi bien que quelques blessures à la jambe. Ce qui me fait très mal,
c’est la blessure au dos.
« Je vous suis
très reconnaissant, ma petite sœur, pour vos soins et vos secours. Je vivrais
tout un siècle que je ne vous oublierais jamais.
« Je raconte
toujours aux sœurs comme vous êtes bonne et jusqu’à quel point je désire vous
dire un grand merci de tout mon cœur.
« Au
commencement, je ne me plaisais pas ici, mais ensuite je me suis habitué ;
ce n’est pas mal ici. Que Dieu me laisse me guérir ; je vous écrirai alors
moi-même ; maintenant, c’est la sœur qui vous écrit pour moi.
« Ensuite, je
vous souhaite tout ce qu’il y a de bon et la santé.
« Je reste
celui que vous connaissez, Mikhaïl Z...sky, à qui on a extrait un shrapnell de
la jambe. »
Celui-ci semble
content que je lui aie écrit :
« Ma petite sœur bien estimée,
« Je vous
remercie cordialement pour votre lettre que j’ai reçue le 3 mars. Je suis
touché jusqu’au fond de mon cœur par votre bonne attention. Vous travaillez
tant et soignez les blessés sans repos, et vous avez trouvé encore une minute
de liberté pour me répondre, ce que je ne pouvais pas même espérer.
« Pour votre
bonne attention, je me souviendrai de vous tant que je vivrai, et, si je ne
vous dérange, je vous ferai toujours savoir ce qui me sera arrivé à l’avenir.
« Maintenant,
je vous souhaite la santé et un grand succès dans votre labeur.
« Maintenant,
je vous donne de mes nouvelles. Je guéris, mais ce n’est pas encore fini, il me
faudra encore rester au lit. Je n’ai pas d’ennui particulier. Il se trouve chez
nous, à l’hôpital, une petite sœur, dame aussi excellente que vous. Donc, je
n’ai qu’à remercier tous pour leur traitement et leurs grands soins.
Maintenant, il ne me reste qu’une seule tâche : c’est de guérir et de
retourner aux positions.
« Puis je vous
souhaite tout ce qu’il y a de bon, et je reste, avec un profond respect pour
vous,
« V.
P... ff. »
19 III/III 15 »
Les blessés que nous
soignons nous demandent souvent nos portraits. Il y a quelque chose de
chevaleresque dans ce qu’ils nous écrivent à ce sujet :
19/30 avril 1915.
« Bonjour N. N. !
« Je vous
remercie pour votre photographie que vous m’avez envoyée. Cette photographie
sera gardée chez moi pendant de longues années, en souvenir de la guerre européenne
et de vos vertus. Votre amabilité et tous vos soins resteront dans ma mémoire
pendant de longues années. Je vous salue, et ma famille vous salue aussi :
Philippe Stiepanovitch, Alexandra Ivanovna, mon épouse, et les enfants :
Olga, Kostia, Micha, Petia.
« Votre
photographie, nous l’avons placée dans un cadre doré.
« Puis au
revoir ! Nous vous souhaitons de vous porter bien pendant de longues années.
Je suis le soldat Philippe Stiepanovitch Mitrofanov..., ville de Saratov,
rue... »
Smolensk. — Pour suivre son mari. — Le
déménagement d’un palais.
À Smolensk, on nous
annonce que nous n’irons pas plus loin. Il faut que nous aidions à évacuer les
blessés des hôpitaux de cette ville, où l’on attend de grands blessés venant
des positions.
Une heure après,
nous sommes déjà en plein chargement. La plupart de nos nouveaux hôtes sont
convalescents ; ils ont passé la période la plus difficile de leur cure.
Deux brancardiers
apportent un soldat. Une femme suit. On couche le blessé. La femme reste devant
la portière.
« Les personnes
étrangères au service ne peuvent pas venir ici, dis-je à la femme. Vous
attendez quelqu’un ?
— Je suis avec
mon mari, chère petite sœur. Il m’a appelée du village. Je ne suis venue à
Smolensk qu’hier matin, et, aujourd’hui, on l’emporte. Je veux aller avec lui
jusqu’à Moscou. Arrangez-moi cela, ma petite sœur. »
Je lui promets de le
faire et je vais chercher notre doctoresse en chef.
« Elle peut
voyager dans la cuisine, dit la doctoresse. Mais n’oubliez pas
qu’officiellement je n’en sais rien », souligne-t-elle.
Je remercie mon
aimable « chef » et je cours auprès de la femme. J’en trouve une
autre, à côté d’elle.
« Ma petite sœur,
celle-ci prie aussi de l’admettre dans le train. Elle est venue aujourd’hui
seulement à Smolensk.
— Bon. Mais,
d’abord, il faut que je sache que son mari se trouve dans notre train. Dans
quel wagon est-il ? Puis il faut que vous présentiez vos papiers. »
Elles le font bien
volontiers, et je les emmène dans le wagon-cuisine : il y a là un
compartiment vide, où, d’ordinaire, on lave la vaisselle. Je prie nos
cuisiniers de leur donner à manger.
Le soir, pendant
l’arrêt à une grande station, je visite les deux voyageuses et je leur demande
si elles sont bien.
« Merci, merci
beaucoup ! On nous a donné à manger et à boire. Nous sommes très bien ici.
— Ma petite
sœur, dit l’autre, mon mari sera bientôt guéri, et on l’enverra de nouveau à
l’avant. Je veux y aller avec lui. Comment pourrai-je le faire ? Je
prendrais l’uniforme de soldat....
Elle est de taille
moyenne, brune et maigre. Les cheveux coupés courts et en costume masculin,
elle ressemblerait à un jeune tsigane.
« C’est bien.
Ce n’est pas une mauvaise action. Mais comment voulez-vous faire ? »
Elle me développe
tout un plan. Quand les soldats iront à la gare pour rejoindre, elle
s’attachera à l’échelon, vêtue en soldat. Si on lui demande d’où elle vient,
elle répondra qu’elle s’est égarée et cherche son régiment.
« Nous n’avons
pas d’enfants, ma petite sœur. Pourquoi resterais-je seule au village ? Il
vaut mieux que je meure avec mon mari. »
L’arrêt est long à
cette grande gare. J’emmène les deux femmes dans les voitures où sont leurs
maris et je les autorise à y rester une demi-heure.
« Prenez
conseil de vos maris et décidez ce que vous ferez ensuite. »
À Moscou, je prie
les sœurs du « point d’évacuation » de s’occuper des deux femmes,
pour qu’elles ne soient pas séparées de leurs maris.
*
* *
Nous ne nous
arrêtons nulle part. Nous allons tout droit vers la pouchtcha (forêt épaisse) de Bielovège. C’est la chasse gardée du
tsar russe, célèbre par ses aurochs.
Quand notre train
s’arrête en gare de Bielovège, le quai, très long, couvert d’un toit artistique,
que supportent des colonnes sculptées, est encombré de meubles et de tableaux.
C’est le mobilier du palais impérial élevé dans la pouchtcha. On l’emporte pour qu’il ne tombe pas entre les mains des
Allemands.
Nous devons prendre
des blessés d’un lazaret qui se trouve dans une dépendance du palais. Mais ils
ne nous seront amenés que l’après-midi.
Nous avons donc le
temps de visiter le palais, qui est à dix minutes de marche de la gare.
Après avoir traversé
un pont, nous entrons dans une allée qui mène à la porte du palais. Personne
n’y monte la garde. Nous pénétrons dans un parc, au milieu duquel s’élève un
bel édifice, ressemblant à un château du moyen âge. Une fontaine devant le château.
Un passage formant arcade conduit à un perron intérieur, où s’agite une foule
de serviteurs en livrée noire. Nous demandons si nous pouvons visiter le
palais. On nous répond affirmativement. Mais nous ne voyons plus que les murs,
car tout ce qui est meuble a déjà été sorti. La richesse de la décoration,
l’élégance de l’architecture, attestent cependant la splendeur de ce séjour abandonné....
Les Allemands ne
trouvèrent rien au palais et durent se contenter du maigre butin fait sur les
paysans des villages voisins....
Plus de blessés que de places. — Les
heures lentes. — Une bombe sur un train sanitaire.
Le voyage de Kiev à
Tr... a pris toute une journée, et c’est vers le soir seulement que nous
arrivons à Tr.... Nous chargeons le train pendant la nuit. Il faut se hâter.
Il y a plus de
blessés que de places, et il reste onze hommes que je ne puis caser.
Je tâche de les
convaincre :
« Il n’y a rien
à faire que d’attendre le train suivant. Ayez de la patience, mes petits
soldats. »
Ils consentent à
retourner au point d’évacuation, et je suis déjà prête à les y accompagner,
quand un monsieur, témoin de la conversation, me dit :
« Non, ma sœur,
il ne faut pas les ramener au point d’évacuation. Si vous n’avez pas de place
chez vous, menez-les dans le train de P...tch. Ce train est derrière le vôtre. »
Ce monsieur, en imperméable,
avec des épaulettes d’officier et de grandes lunettes de chauffeur sur le nez,
remarquant mon hésitation, ajoute :
« On s’occupera
bien d’eux dans le train.
— Allons,
dis-je aux blessés..... Mais qu’est-ce que je dirai là, au train ? fais-je
remarquer au monsieur, qui s’en va. Il faut donner le nom de celui qui m’a
autorisée à les conduire là.
— Dites-leur
que c’est P...tch qui vous a donné l’autorisation », me répond-il.
Comment ? ce
monsieur est P...tch lui-même ? C’est lui, ce farouche réactionnaire et
instigateur de pogromes ? Je suis une « sœur » pour lui ?
La guerre seule peut avoir des effets pareils. Les socials-démocrates allemands
sont mes « ennemis », à moi, socialiste russe, et, pour P...tch, je
suis devenue une « sœur » !...
*
* *
Nous attendons des
ordres à Tr.... Plus d’une journée se passe dans cette attente. Les heures se
traînent affreusement lentes.
Des nouvelles
viennent, l’une plus alarmante que l’autre : les Autrichiens avancent
toujours et sont près de Mel.... Et Mel... n’est pas loin de Tr.... On nous dit
qu’à Mel... il y a beaucoup de blessés. Nous prions la doctoresse en chef de
nous y envoyer avec quelques tieplouchki
pour les ramasser. La doctoresse ne consent pas :
« Je n’ai pas
d’instructions ! »
Encore une journée à
attendre des instructions. Dans la nuit, une dépêche vient : notre train
doit aller sans retard à Mel.... Le matin, nous y sommes déjà.
Deux trains sont en
gare. L’un est chargé de rails et de munitions ; l’autre transporte un
« détachement de ravitaillement ».
Sur le quai et sur
la voie, les blessés sont couchés. Ils sont très nombreux. Ceux qui peuvent
marcher se lèvent et vont d’eux-mêmes aux voitures de quatrième classe ;
ils en remplissent rapidement les trois étages de lits et se pressent dans les
couloirs. Tout l’espace libre y est occupé. Ceux qui ne peuvent marcher sont enlevés,
même les mourants et les agonisants. On tire les lits mobiles des tieplouchki, on y met les blessés et on
les porte dans les wagons.
Tandis que nous
installons notre monde, un aéroplane autrichien apparaît. Nous, le personnel,
nous sommes trop absorbés pour nous occuper du danger, mais les blessés restés
dehors s’agitent anxieusement sur leurs brancards.
« Emportez-nous
d’ici ! Emportez-nous ! Il est au-dessus de nous !
— Nous avons
échappé à une mort pour en trouver une autre !
— Faites partir
le train ! »
Subitement, boum ! tombe la bombe de
l’aéroplane. Elle éclate non loin du train et blesse un soldat. On le transporte
en hâte dans une tieplouchka.
Notre batterie
commence à tirer sur l’aéroplane. Il paraît que le tir est bon, car l’engin
s’envole et disparaît à nos yeux.
On continue à amener
de grands blessés. Tous les lits en sont déjà remplis. Où pourrons-nous mettre
les nouveaux venus ? Je cherche notre doctoresse. Elle cause avec le médecin
du détachement de ravitaillement.
« Il faut que
nous enlevions tous les blessés, et cela le plus tôt possible, me dit-elle avec
émotion. On accrochera encore à notre train sept wagons à marchandises. Nous y
mettrons ceux qui sont légèrement atteints. Si nous manquons encore de place,
nous coucherons des hommes sur le plancher des tieplouchki.
— Tous les lits
sont déjà occupés par de grands blessés, lui dis-je. On ne peut pas mettre de
grands blessés sur le plancher. »
Une sœur du détachement
de ravitaillement s’approche de moi et me dit tout bas :
« Tout est
préparé pour la retraite. Aussitôt votre train parti, le nôtre s’en ira aussi,
et, alors, on fera sauter la gare. On ne peut pas laisser nos blessés aux
Autrichiens. Il faut les enlever tous, même les moribonds. Votre train a de la
place pour quatre cent cinquante blessés ; mais il vous en faut prendre
jusqu’à mille. Si même dix, quinze ou vingt-cinq meurent pendant le voyage,
vous n’en aurez pas moins sauvé la vie à six cents autres en les emportant
d’ici.
— Il faut
accélérer le chargement », dit la doctoresse en chef.
Je cours vers mes
wagons.
« Il y en a un
qui va mourir chez moi, me dit un des infirmiers dès que j’arrive.
J’entre dans la tieplouchka. Le blessé saute de son lit.
L’infirmier le retient. À travers les bandages posés sur le ventre, le sang
coule.
« Passez-moi un
bandage-compresse, dis-je à mon aide. Plus vite ! »
Je prends le blessé
par la main. Le pouls est faible et rare. Le regard est perdu dans le vide.
J’injecte du
camphre. Le blessé gémit, me fixe et murmure :
« On nous
transportera dans le gouvernement natal, n’est-ce pas ? »
Il retombe aussitôt
dans l’inconscience. Une heure après, il était mort.
La sœur qui m’aide
et moi, nous visitons tous les lits, en rajustant les bandages mal placés, en
donnant des injections de camphre et de morphine.... On nous presse de partir,
mais nous avons à remplir de blessés les sept wagons à marchandise qu’on nous a
ajoutés. Enfin, le train est plein. Tous les blessés sont enlevés. On part.
Je suis avec la sœur
dans une de nos tieplouchki.
J’examine la foule entassée là et je me sens impuissante. Tous sont dans un
état grave ; leurs pansements sont imbibés ; il y en a qui crachent
le sang. Par qui commencer ? Le crépuscule est descendu. Il est difficile
de travailler à la lumière d’une bougie. Mais il faut faire tout ce qui est
possible. Et nous nous mettons à l’ouvrage....
Tout le monde ayant
reçu nos soins, nous allons à la portière. Une gigantesque colonne de lumière
rouge se dessine sur le ciel. Des fusées s’élèvent.
« C’est Mel...
qui est incendié, probablement, me dis-je. Cela signifie que les nôtres ont
déjà reculé de là. »
Encore des remerciements. — Une
gratitude qui s’élève au lyrisme. — Une bonne nouvelle.
Nouveau passage par
Brest et nouveau paquet de lettres de soldats blessés :
1915, 16 juillet.
« Dans les
premières lignes de ma lettre, je salue ma chère sœur miséricordieuse N. N.
« Vous nous
avez soignés comme vos propres enfants. Nous vous remercions. Jésus seul aurait
pu nous soigner aussi bien que vous l’avez fait. Nous vous remercions. Que le
Seigneur vous donne la santé et que le général vous envoie une lettre.
« Adressez vos
lettres à la ville de P..., hôpital..., chambre....
Nicolas
Fedorovitch B.... »
La « lettre du
général », dont parle Nikita Fedorovitch, c’est un diplôme ou un
certificat, que nos patients nous souhaitent très souvent de recevoir.
Le soldat de la
garde qui m’a proposé de faire de la réclame dans un journal réactionnaire n’a
pas été satisfait de mon refus. Et, quelque temps après, il a adressé au comité
central de l’Union des zemstvos le papier suivant, que nos chefs nous ont
transmis :
« Monsieur le directeur de
l’union des zemstvos,
« Nous avons eu
le bonheur de voyager dans le train n°..., nous, militaires blessés sur le
champ de bataille, le... juillet. Et nous vous sommes très reconnaissants de
vos soins. Et les sœurs de charité nommées par l’Union nous ont soignés avec
beaucoup de dévouement et de bonne grâce. Notre train n°... contenait
exclusivement des grands blessés ; presque aucun n’avait été atteint par
la mousqueterie ; tous avaient reçu des shrapnells ; quelques-uns
avaient des fractures des bras et des jambes ; plusieurs avaient beaucoup
de blessures graves sur tout le corps et en souffraient beaucoup. Mais les
sœurs de notre cher train, ne restant pas les bras croisés un seul instant,
refaisaient les pansements plusieurs fois par jour, faisaient tout le
nécessaire pour adoucir les douleurs des blessés et, pendant des nuits
entières, se tenaient à leur chevet, les aidaient et causaient avec eux, sans
ménager leur propre santé, sans manger pendant des journées entières et n’ayant
aucune possibilité de dormir. Nous étions là quatre cents blessés environ, et
presque tous grièvement, et, grâce aux sœurs, en quatre jours, deux hommes
seulement sont morts. Que Dieu leur donne la santé, surtout à la petite sœur N.
N.
« Avec respect
pour vous, le blessé
« Jacob
J....
« Soldat du régiment
de la garde. »
Le sous-officier qui
a écrit la lettre ci-après a remarqué chez ses compagnons de voyage des fautes
contre la civilité :
« Ma chère petite sœur,
« Excusez-moi
de vous déranger par cette lettre. Je vous envoie ma reconnaissance cordiale
pour votre labeur inappréciable. Vous nous avez soignés sans repos et vous avez
travaillé pendant des jours et des nuits entières. Mais il y avait parmi nous
des soldats manquant de respect qui, au lieu de remerciements, se permettaient
de prononcer des mauvaises paroles. Cependant, vous, nos chères sœurs, n’y
faisiez pas attention. Encore une fois, je vous apporte ma reconnaissance
cordiale. Je suis tellement touché que je ne peux pas faire l’éloge des soins
et des secours que nous avons trouvés chez vous pendant les sept jours que nous
sommes restés sous la protection des sœurs et des aides-doctoresses du wagon n°
11, du train n°... de l’Union panrusse des zemstvos.
« Ma chère
petite sœur, je vous renseigne sur mes blessures. Tout va bien, grâce à Dieu.
Seulement, les blessures suppurent, et je ne peux pas rester assis. Ma chère
petite sœur, je crois que, si l’on me soigne dans notre hôpital aussi bien
qu’on m’a soigné dans le wagon n° 11, je pourrai bientôt aller punir l’ennemi.
Je suis en traitement à Petrograd....
« Ensuite, au
revoir ! Que Dieu vous permette de continuer votre honorable labeur à la
joie de notre armée valeureuse et au péril et à la mort de nos ennemis
perfides.
Mikhaïl
Nikolaïev G...,
« Sous-officier
blessé au ventre, qui a été dans le wagon n°11.
1915, 17 juillet.
Ici, la gratitude
s’élève au lyrisme :
« À la glorieuse,
miséricordieuse, patiente travailleuse N. N.
« Bonjour, ma
petite sœur N. N. ! Je vous adresse mon humble révérence de toute mon âme
et mes respects. Que Dieu vous accorde la santé pendant vos exploits difficiles
au profit de la sainte Russie. Vous souffrez autant que nous. Il vous faut
laver et nettoyer chaque soldat, tout couvert de boue et de blessures. Il vous
faut le panser et l’encourager d’un mot de caresse. Ma petite sœur miséricordieuse
N. N., vous avez reçu une éducation noble et une bonne instruction. Et vous
avez dû oublier tout votre beau passé et accomplir le saint devoir, selon la
parole du Seigneur, qui nous a dit de secourir ceux qui souffrent. Et vous êtes
entrée dans le chemin difficile des exploits pour diminuer les souffrances des
frères soldats. Que Dieu vous envoie de l’énergie dans ce travail bon et
honnête. Et nous, les soldats, prierons le Seigneur qu’il vous aide à supporter
tous vos labeurs et qu’il ne laisse pas votre généreux travail sans récompense.
« Ma petite
sœur miséricordieuse N. N., j’ai reçu votre lettre et la photographie et je
vous en remercie beaucoup, beaucoup. Je me souviendrai de vous toute ma vie, de
votre générosité que je n’ai point mérité.
« Ma petite
sœur miséricordieuse N. N., ma blessure est guérie ; il n’y a pas eu
d’opération ; l’éclat d’obus se trouve dans la profondeur de la jambe et
ne m’inquiète pas ; l’ouverture de la blessure s’est cicatrisé, et il n’y
a pas d’abcès. Donc, le 15 août, je demanderai qu’on me laisse quitter
l’hôpital et je retournerai dans l’armée active pour punir cette bête
d’Allemand.
« Avec respect
pour vous et très reconnaissant à tous, le sous-officier Jacob J....
1915, du mois
d’août, à la 10e journée.
« P. S. Quand
j’irai à la guerre, j’enverrai votre portrait chez les miens : qu’ils le
gardent en souvenir d’une bonne et honnête travailleuse, sœur de
charité. »
Encore des
remerciements :
Année 1915, du mois
de juillet, au 16e jour.
« Dans les
premières lignes de ma lettre, je vous annonce, ma petite sœur, que j’ai eu une
opération, mais ma jambe va très mal. On me l’a fendue en plusieurs endroits et
on y a mis des tubes en caoutchouc. Je ne sais pas combien de temps je
coucherai ici. Puis au revoir ! Portez-vous bien, ma petite sœur. Je vous
souhaite tout ce qui est bon et un grand bonheur dans votre vie. Mon
adresse.... »
*
* *
Tout le monde se
réjouit dans le train. Parmi les lettres que nous avons reçues cette fois, il y
en a une de notre Varia, transmuée en volontaire Serge S. Elle nous écrit d’un
camp de prisonniers, en Allemagne. Son régiment a participé au combat ;
elle a été blessée légèrement et capturée par l’ennemi. Elle se trouve au camp
avec d’autres Russes, et les Allemands ne soupçonnent même pas que ce jeune
soldat est une demoiselle.
Varia vit !
Tout le monde se réjouit de cette bonne nouvelle.
Tristes nouvelles.
Nous sommes dirigés
sur Kr..., en Galicie. On devait nous y amener des blessés par un chemin de fer
militaire à voie étroite. Nous attendons vainement pendant quelques
jours : il n’arrive presque pas de blessés. Ceux que nous recevons nous
donnent des nouvelles peu consolantes : les nôtres manquent de munitions
et sont obligés de reculer.
Quelqu’un annonce
que Przemysl est reprise par les Austro-Allemands. Nous ne voulons pas le
croire ; mais nous apprenons une chose encore plus affligeante : les
Allemands sont près de Lvov. Il ne reste qu’à se rendre à la triste réalité.
Les Russes
reculent ! Nous savons que, pendant une retraite, il est difficile de
ramasser les grands blessés et nous nous représentons si bien ces champs, ces
forêts et ces routes où les nôtres, abattus et mourants, gisent sans secours et
sans soins !
On nous fait
retourner à Brest. Là, les nouvelles de la reddition de Przemysl et de Lvov
sont déjà publiées officiellement. Il m’est pénible d’entrer chez mes patients,
dont tous les efforts et toutes les souffrances, après avoir porté l’armée
russe jusqu’aux Carpathes, ont été en pure perte. Que leur dirai-je s’ils me
questionnent ?... Il m’est encore plus pénible d’être si près des
évènements de guerre et en même temps d’être si ignorante des choses militaires,
de toute cette « stratégie » et toute cette « tactique ».
Pourquoi notre armée recule-t-elle ?
Przemysl et
Lvov ! Que de sang russe y a été perdu !
*
* *
L’atmosphère devient
de plus en plus lourde. On nous a donné l’ordre de charger notre train sur
place, à Brest. On craint déjà pour le sort de cette ville et on en évacue les
hôpitaux. Mais nous n’avons pu prendre des blessés des hôpitaux locaux, parce
qu’on nous en a envoyé directement des positions. Ce sont ceux qui peuvent
marcher. Pas de grands blessés.
« Où sont les
autres ? Où les avez-vous laissés ? demandé-je aux soldats.
— Ne le
demandez pas, ma petite sœur, disent-ils avec désespoir. Ils sont restés sur le
champ de bataille. Nous avons dû battre en retraite. Qui a pu marcher est
parti. Ceux qui étaient trop touchés ont dû attendre l’arrivée des Allemands.
Dieu le voit, ce n’est pas notre faute, ma petite sœur. Nous n’avions pas peur
de verser notre sang et ne ménagions pas notre vie. Mais, quand on n’a pas assez
de munitions, on ne peut rien faire... Mais ça ne fait rien, ma petite sœur. Ne
te chagrine pas trop. Attends un petit peu... Nous reprendrons tout ce que nous
avons perdu. Lvov sera à nous ! »
Je ne sais pas
pourquoi, de toutes les villes autrichiennes conquises et perdues par notre
armée, Lvov intéresse le plus nos soldats. Ils le considèrent comme une ville
russe, et il leur plaît beaucoup. Et, en effet, il est peut-être la plus
« russe » des villes de Galicie et de Bukovine.
Arrivée à Vilna. — Les prières pour la
victoire. — Le monument de Catherine II. — Une trahison.
Notre train est
demandé à Vilna. Nous y arrivons le matin. Le train est garé sur la cinquième
voie de réserve et attend l’ordre de commencer le chargement. Nous avons
quelques heures à nous et nous prenons un fiacre pour faire une promenade dans
la capitale de la Lithuanie. La gare est, comme toujours, bourrée de soldats,
les uns valides et prêts à marcher, les autres blessés et attendant d’être
envoyés à l’arrière. Mais ce ne sont pas eux seuls qui vont se retirer. L’ordre
est venu d’évacuer Vilna, qui sera bientôt occupée par les Allemands.
Dans les rues
défilent des convois interminables. Des détachements de soldats passent. Les chariots
à deux roues de la Croix-Rouge emportent des blessés.
Notre cocher nous
mène vers le centre de la ville. Dans une rue, nous voyons un grand arc qui la
relie à une autre rue. Une foule immense est agenouillée devant l’arc et, les
larmes aux yeux, dit des prières. Une image religieuse est sur l’arc, et un
prêtre catholique, à genoux aussi, récite des prières, les mains tendues vers
elle. Il y a dans la foule des dames élégantes à côté de soldats, des femmes
pauvrement vêtues, des petits enfants, des vieillards. Le cocher polonais nous
explique que l’on prie en commun pour le salut du pays et la victoire et que
cette image a une puissance miraculeuse.
Nous traversons
encore quelques rues et nous nous trouvons devant une église orthodoxe. On
descend du clocher une grande cloche : on va la faire sortir par une brèche
pratiquée dans le mur. L’église est entourée d’une foule silencieuse ;
seules, quelques femmes pleurent.
Plus loin, une autre
église, catholique celle-là. On y enlève aussi des cloches. Les ouvriers
chargés de le faire sont perdus dans une masse de femmes qui sanglotent et demandent
avec exaltation qu’on ne touche pas à la « voix de Dieu ». D’autres
femmes, avec une expression de terreur mystique, restent immobiles, comme pétrifiées....
Voici la cathédrale.
En face d’elle, un square. Dans le square, le monument de Catherine II. Devant
lui, une sorte de potence est érigée, d’où une corde descend et entoure le cou
de l’impératrice en métal. Jamais encore la grande tsarine n’a été traitée avec
aussi peu de respect.
« On la démonte
pour l’emporter », explique le cocher.
Puis nous apprenons
que le monument du célèbre dictateur comte Mouraviev, vainqueur de
l’insurrection polonaise de 1863 et surnommé par les Polonais « Mouraviev
le Pendeur », est démonté de la même façon, à l’aide d’une potence....
Nous arrêtons le
fiacre devant une confiserie et y entrons pour acheter quelques douceurs, et
surtout pour causer avec la vendeuse.
« Qu’est-ce
qu’il nous faut faire, ma sœur ? me demande-t-elle. Devons-nous quitter la
ville ou non ? On a déjà fermé les banques, le télégraphe et tous les
établissements officiels. Mais on dit à la population de ne pas s’inquiéter et
de ne pas écouter les propagateurs de panique. À la gare, on ne délivre pas de
billets aux civils. Mais tous ceux qui ont de l’argent s’enfuient. On loue des
camions, on y place les enfants et le mobilier et l’on part pour des stations
distances de 60 à 70 verstes : là, tout le monde peut avoir des billets. »
Après cette
conversation, notre attention est attirée particulièrement par de nombreux
camions et des chariots emportant des fugitifs.
Revenus à la gare,
nous y remarquons un train plein de réfugiés qui se sauvent de Vilna. Un infirmier
nous raconte que ce train stationne ici depuis longtemps. Et, depuis le matin,
un vieillard qui se trouve parmi les réfugiés va et vient sur le quai, le
cadavre d’un bébé dans les mains. L’enfant, qui n’avait que quelques mois, est
mort de bonne heure, et le vieux ne sait que faire du corps. Il ne veut pas
s’éloigner du train, qui peut partir à tout instant ; d’autres enfants à
lui y sont montés.
Enfin, un gendarme
vient et enlève le cadavre.
Je visite le train
des réfugiés. Les wagons à marchandises sont bondés de voyageurs :
enfants, vieillards, femmes. Ils attendent le départ déjà depuis trois jours,
mais les voies sont encombrées de trains militaires. On promet de les faire
partir aujourd’hui. Ce sont des habitants des faubourgs de Vilna et des
villages environnants.
On fait avancer
notre train jusqu’au point d’évacuation. Le chargement commence. Au milieu du
travail, un officier inconnu nous aborde. Il est mortellement pâle et ému.
« Kovno a été
livrée aux Allemands. Cependant il y avait là des munitions et des vivres. Les
soldats de la garnison avaient soif de défendre la place. Mais le commandant en
chef l’a évacuée. On a vendu Kovno.... »
Beaucoup plus tard,
nous avons vu dans les journaux que l’ancien commandant de la forteresse de
Kovno, général G..., a été condamné à quinze ans de travaux forcés par un
tribunal militaire pour avoir, sans motifs plausibles, livré la forteresse à
l’ennemi. Donc l’officier inconnu avait raison...
L’optimisme du blessé. — Autriche ou
Russie ? — En permission pour un mois.
Notre train est
envoyé aux lignes du sud-ouest, presque sur la frontière de Bukovine. Septembre
commence.
Nous sommes à P...,
ancienne gare frontière russo-autrichienne. Une quantité énorme de blessés, des
« nôtres », et des « leurs », nous y attend.
« L’ordre est
donné de prendre tous les blessés russes et ceux des Autrichiens qui sont
grièvement atteints et ont besoin de secours médicaux immédiats », nous
dit le médecin en chef.
Tandis qu’on apporte
au train des blessés russes couchés sur des brancards, nous allons choisir de
grands blessés parmi les prisonniers autrichiens.
Dans un grand hangar
en briques à toit vitré, sur le pavement d’asphalte, couvert de paille, sont
couchés des blessés autrichiens. Presque tous sont dans un état grave ;
beaucoup avec des fractures des jambes et des bras.
En tout, il n’y en a
pas moins de cinq cents. Ce fait dément le bruit, répandu par la presse
austro-allemande, que les Russes abandonnent les blessés ennemis sur le terrain
et les laissent mourir.
Nous examinons les
Autrichiens, choisissons les plus souffrants, et nos sanitary les emportent au train.
Pendant le trajet,
je demande à un de ces hommes comment ils ont été faits prisonniers. Le soldat,
Roussine orthodoxe de Bukovine,
parlant un patois qui ressemble beaucoup au petit-russien, me raconte
ceci :
« Nous
avancions contre les vôtres. Mais les vôtres nous ont encerclés. Nous avons
voulu nous rendre et nous commencions à lever les mains, quand les Autrichiens
qui nous suivaient se sont mis à nous tirer dans le dos. Les Russes ont dû
repousser les nôtres pour nous faire prisonniers.... Maintenant, l’hiver vient.
Il coûtera cher aux nôtres. Ils supportent le froid moins bien que les vôtres.
Les pieds leur gèlent. »
En pansant les
nôtres, je les interroge sur ce qui se passe actuellement aux positions.
« ça marche très bien, ma petite sœur. Il
y a beaucoup de munitions. On peut bien arroser les ennemis. Ne vous affligez
pas de la retraite. Lvov sera de nouveau à nous. Nous étoufferons l’Allemand. L’Autrichien
est sans importance. Il tient par l’Allemand. L’Allemand étouffé, l’Autrichien
n’existera plus ! »
Le blessé riait. Il
dit à plusieurs reprises d’un ton assuré :
« Il y a des
munitions : la victoire n’est pas loin. »
*
* *
Nous avons laissé
les blessés russes à Kiev, où nous avons pris encore un convoi d’Autrichiens,
et nous avons dû les transporter tous, ceux recueillis à P..., et les nouveaux
venus, à Darnitza, station peu éloignée de Kiev.
Comme nous sommes
arrivés à Darnitza dans la nuit, on a remis le déchargement au matin. Nous
sommes debout au lever du soleil. Nous sortons des wagons et sommes vraiment
frappés de ce que nous voyons. Où sommes-nous ? En Russie ou en
Autriche ? Partout, des soldats autrichiens, des infirmiers autrichiens et
même des médecins autrichiens. Devant les tentes dressées près de la gare
attendent des cuisiniers militaires autrichiens.
Un médecin militaire
russe s’approche de nous et, nous indiquant un feldwebel autrichien, dit :
« C’est lui qui
surveillera les brancardiers autrichiens pendant que leurs blessés seront
extraits du train. »
Les brancardiers
sortent des voitures un blessé après l’autre et les déposent sur le quai. Les
blessés sont stupéfaits de ne voir autour d’eux que des uniformes autrichiens.
« Vous ne savez
pas si vous êtes en Autriche ou en Russie ? leur dis-je en allemand.
— Nous ne
sommes ni en Russie ni en Autriche. Nous sommes tout simplement en
guerre, » prononce-t-on derrière moi.
Je me retourne et je
vois un officier autrichien.
« Excusez-moi,
lui dis-je sèchement, mais je ne parle bien l’allemand.
— Je parlerai
français, si vous voulez, » me répondit-il en bon français.
Je lui demande alors
comment il a été pris par les nôtres.
Une ombre de
mécontentement passe sur son visage. De sa réponse je n’ai pas compris
grand’chose. D’une part, ce ne fut qu’un hasard malheureux qui le fit tomber
aux mains des Russes ; d’autre part, la faute en est aux soldats slaves.
« Sans les
Slaves qui se trouvent dans nos rangs, sans tous ces Polonais, Tchèques et
Ruthènes, nous, les Hongrois et les Allemands, nous aurions vaincu depuis longtemps.
Mais nous avons chez nous des Slaves et nous devons tenir nos fusils prêts non
seulement contre vous, mais contre eux aussi. Ils nous empêchent de bien faire
la guerre. »
En entendant ces
paroles, je me souviens qu’un Allemand blessé m’avait dit précisément la même
chose de tous les Autrichiens, en général.
« Vous êtes
Hongrois ?
— Oui, madame.
Vous avez peur de moi ? Vous prenez les Hongrois pour des sauvages,
n’est-ce pas ?
— Il n’y a pas
de quoi avoir peur. Vous êtes notre prisonnier.
— Je le sais,
madame. Mais on raconte chez vous des énormités sur les Hongrois. En réalité,
nous ne sommes cruels que pendant le combat. La lutte finie, nous nous
conduisons envers nos ennemis en galantes gens. »
Un commandement
retentit, et on emmène les prisonniers du quai au camp qui leur est réservé.
L’officier hongrois s’en va aussi.
*
* *
Un nouvel hiver
approche et amène une accalmie prolongée sur toute la ligne. J’en profite pour
obtenir une permission d’un mois. On ne me la refuse pas, car je travaille déjà
depuis un an, presque sans repos.
Le même jour, je
quitte Kiev et je roule vers Moscou, d’où je partirai pour la France. Je l’ai
vue au temps de la paix. Je veux la revoir pendant la guerre.
À une station entre
Moscou et Pétrograd, un officier entre en trombe dans la voiture et crie :
« Messieurs,
une grande nouvelle nous parvient de France. Les Français ont rompu le front
allemand en Champagne. Des milliers de prisonniers sont tombés entre les mains
des Français. C’est la victoire ! »
On se presse autour
de l’officier, on discute joyeusement la nouvelle. Et tout le monde sent alors
que la collaboration entre les peuples alliés n’est pas un vain mot. Nous
vivons en ce moment de la même pensée, de la même joie que le peuple français.
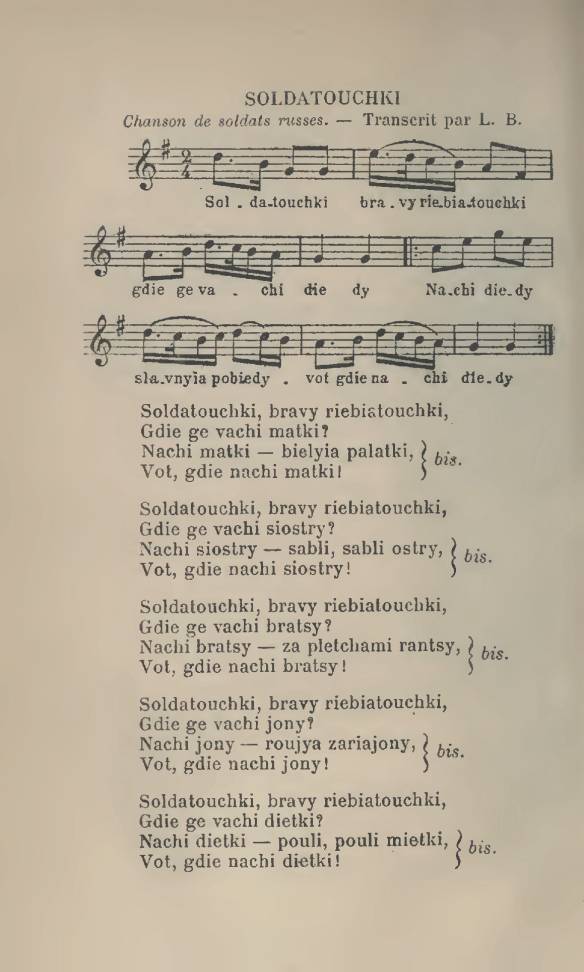
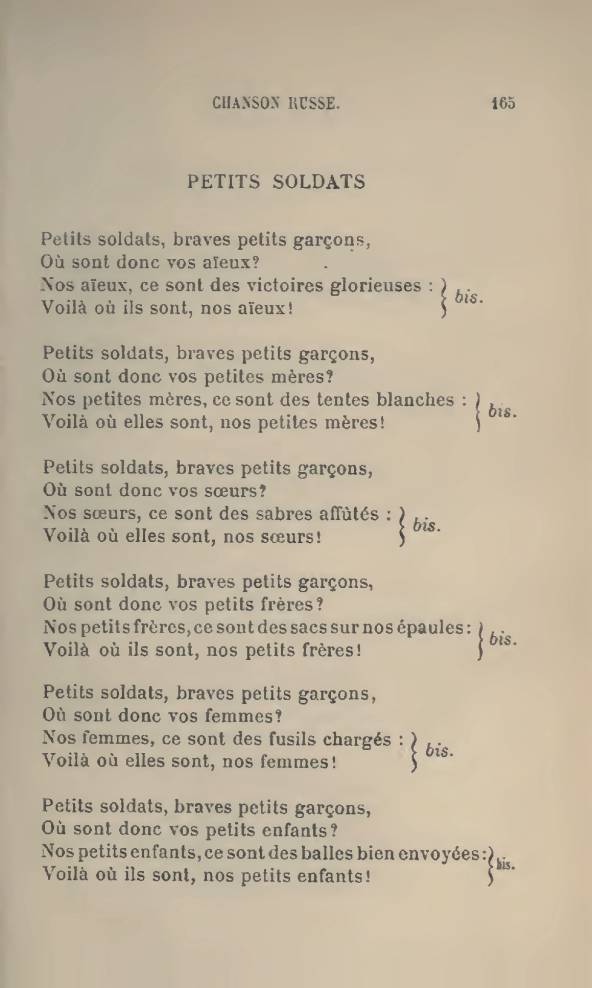
_______
Texte établi par la Bibliothèque
russe et slave d'après le texte retranscrit par Mireille Salvini, déposé sur le site
de la Bibliothèque le 2 novembre
2020.
*
* *
Les livres que donne la Bibliothèque sont libres de droits d’auteur. Ils peuvent
être repris et réutilisés, à des fins personnelles et non commerciales, en
conservant la mention de la « Bibliothèque russe et slave » comme origine.
Les textes ont été relus et corrigés avec la plus grande attention,
en tenant compte de l’orthographe de l’époque. Il est toutefois possible que
des erreurs ou coquilles nous aient échappé. N’hésitez pas à nous les signaler.